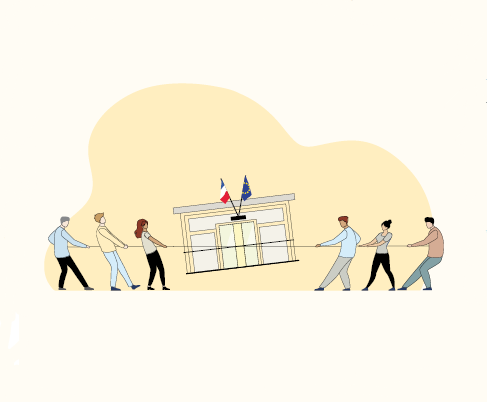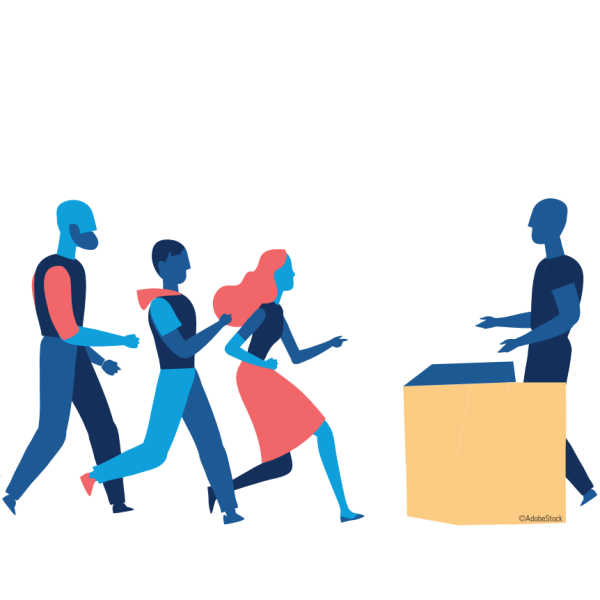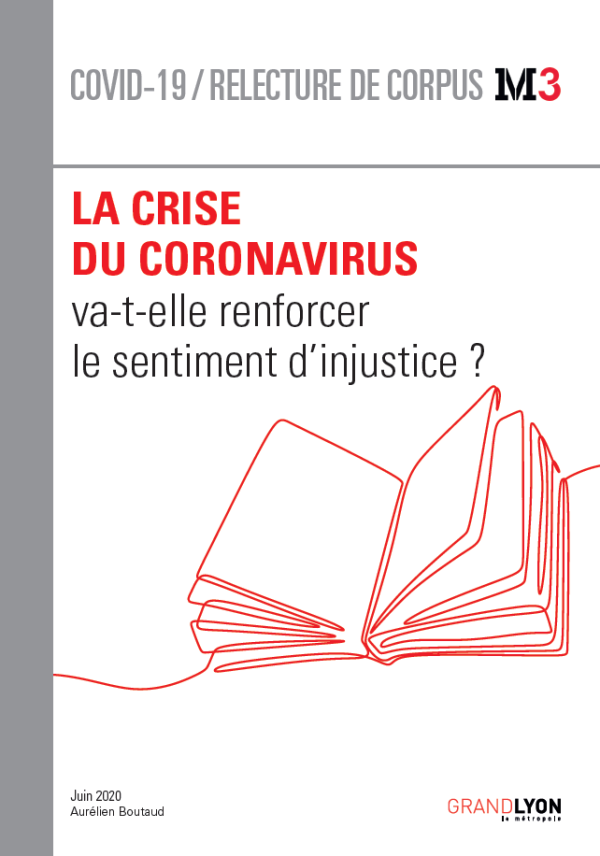Oui, dans le prolongement, ce courant de recherche porte le projet d’étudier comment les liaisons entre la justice et l’écologie prolonge les enjeux de justice sociale – la nature étant un enjeu de justice. La justice environnementale prolonge donc les débats sur la justice sociale en termes d’inégalités de distribution des ressources, de participation politique et d’invisibilité des logiques de domination. Elle conduit aussi à interroger la stabilité des systèmes de redistribution et de coopérations sociales devant la finitude de la nature, et invite à expérimenter de nouvelles formes de coopération entre les hommes et avec la nature, pour lesquelles la maximisation des intérêts humains n’est pas au cœur des intentions politiques.
La destruction de la nature engage finalement en sciences sociales une réflexion sur des considérations de justice, au-delà et avec les humains, et même « plus qu’humains ». C’est une invitation à un changement de paradigme – passer d’une conception de la nature comme objet inerte d’exploitation, un stock de ressources, à une compréhension plus relationnelle de l’expérience que les personnes ont avec elle au cours de leur histoire, de leurs trajectoires, de leur quotidien comme des initiatives et des expérimentations sociales. Les individus vivent toujours en relation-avec-leur-environnement, engagés dans des rapports interculturels, spirituels, cosmologiques, « multi-espèces ». L’enjeu politique de la justice est fondamentalement un questionnement ontologique.
Pour conclure, l’articulation entre les enjeux de justice et la nature contribue à comprendre les mécanismes de production des inégalités et de domination politique d’une part et, d’autre part, elle met en lumière la simultanéité des modes d’existence fragiles des humains et non-humains qui ont surgi des trajectoires de développement qu’ont pris les territoires. La concomitance des vulnérabilités sociales et des vulnérabilités écologiques permet alors d’explorer de nouvelles formes de coopérations qui s’agencent dans les activités économiques, politiques et sociales pour vivre dans le monde qui vient [1].
[1] Lejeune Caroline, 2020, La justice – entre détruire et réparer : l’épuisement d’un concept, in Gérald Hess, Corinne Pelluchon, Jean-Philippe Pierron, Humains animaux, nature, Quelle éthiques des vertis pour le monde qui vient, Paris, Hermann, pp. 147-161