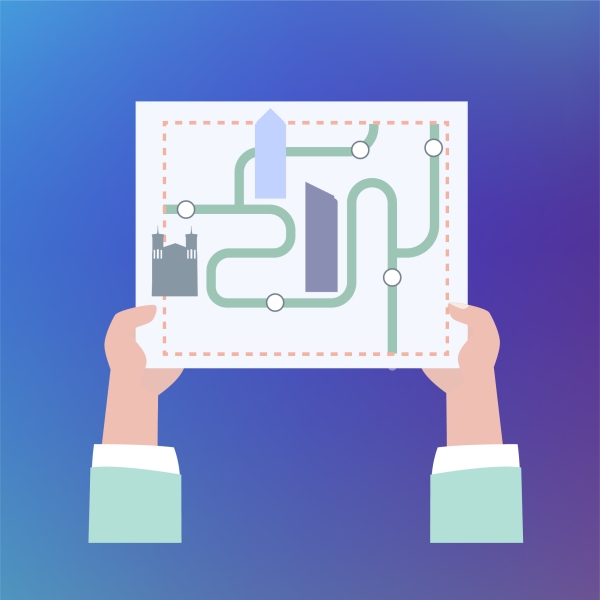La conférence de Rio+20 sur le développement durable s’est achevée au mois de juin dernier sur un constat d’amertume et d’échec. Vingt ans après le Sommet de la Terre, et malgré une situation écologique de plus en plus alarmante, les chefs d’État et de gouvernement se sont séparés en ne prenant aucun engagement concret en faveur de l’environnement. L’évolution du vocabulaire traduit d’ailleurs assez bien ce pessimisme ambiant : il était encore question il y a vingt ans d’inventer une nouvelle forme de « développement durable », c’est aujourd’hui davantage l’« adaptation » voire même la « résilience » qui sont à l’ordre du jour. Comme si les perturbations écologiques n’étaient plus évitables. C’est dans ce contexte de désillusion à l’égard du développement durable et des instances internationales que sont apparues, depuis quelques années, plusieurs initiatives mettant en avant une autre notion : celle de « transition ».
Un nouvel équilibre à l’horizon
Le terme de « transition » a été utilisé dans l’analyse des systèmes pour décrire un processus de transformation dans lequel un système (naturel ou humain) change de manière fondamentale son fonctionnement et son organisation. La transition correspond donc à une phase de changement profond d’un système : le passage d’un état d’équilibre à un autre.
On trouve une multitude d’exemples de transition, aussi bien dans la nature que dans les systèmes humains. Un pan entier de la science politique s’intéresse ainsi à la transition des systèmes sociotechniques- entendus comme un ensemble d’artefacts (objets techniques) et d’acteurs (donc de comportements, de règles, de représentations, de valeurs) qui interagissent afin de répondre à une fonction sociale précise, tels, par exemple, le transport, l’alimentation, l’éducation. Bien qu’ils soient en constante évolution, les systèmes sociotechniques connaissent, dans leur état« normal », une situation d’équilibre dynamique qui dure généralement plusieurs générations. Dans cette configuration, le système évolue constamment en s’adaptant à des pressions qui proviennent soit des innovations apparues en marge du système, soit des macroévénements (contexte géopolitique, macroéconomique ou encore écologique). Il arrive toutefois que la pression exercée par les innovations ou par le contexte macro entraîne des transformations qui dépassent le simple ajustement du système : on assiste alors à une réorganisation profonde de celui-ci, correspondant à une phase de transition.
Par exemple, le système sociotechnique dédié au transport terrestre a évolué au XXe siècle avec l’apparition de l’automobile, qui a progressivement pris le pas sur d’autres systèmes techniques dédiés au déplacement. Cette transition a duré plusieurs décennies, le temps que différentes innovations soient testées et qu’un ensemble d’acteurs (utilisateurs, fabricants, concepteurs, pouvoirs publics, législateurs) se coordonnent progressivement. Et sans doute ce système sociotechnique sera-t-il amené un jour à muer profondément, soit du fait d’innovations, soit du fait de bouleversements globaux comme la raréfaction des énergies fossiles.
Cette analyse a posteriori des phénomènes de transition invite à la modestie. La transition apparaît comme un phénomène complexe qui résulte de multiples ajustements s’opérant dans différents secteurs et à différents niveaux de la société. Et cette complexité rend les transitions à peu près impossibles à prévoir et à diriger. Le mieux que l’on puisse espérer consiste à anticiper certaines évolutions afin de faciliter tel ou tel type de transition. C’est précisément ce qu’essaie de faire le transition management.
Les niches d’innovation comme moteur
Apparu aux Pays-Bas et en Belgique, où il a fait l’objet de plusieurs applications, ce mode de gouvernance piloté par les acteurs publics cherche à stimuler et encadrer les innovations afin de les orienter vers davantage de soutenabilité. De manière opérationnelle, les différents acteurs d’un système sociotechnique sont représentés au sein d’un groupe de travail appelé « arène de transition » qui a plusieurs missions. Il doit produire une ou plusieurs visions de la durabilité du système à long terme, ce qui suppose la définition d’une situation soutenable à un horizon de vingt-cinq à cinquante ans. Il faut aussi qu’il traduise cette vision, sous la forme d’objectifs précis et chiffrés (coût pour l’usager, part d’énergie renouvelable, etc.). Enfin, il est tenu de réaliser un agenda de la transition, ce qui consiste à imaginer les étapes menant de la situation actuelle à celle souhaitée.
Testé en Belgique et aux Pays-Bas dans des domaines aussi variés que la construction, l’approvisionnement énergétique ou même la reconversion de certains quartiers, ce dispositif a permis à chaque fois d’identifier des innovations sociales ou techniques porteuses de transformation radicale, que les acteurs de l’arène se sont attachés à explorer en mettant en place des programmes de simulation et d’expérimentation — sur le modèle des niches d’innovation technologique. Le processus est complété par une phase d’évaluation qui permet d’intégrer au fur et à mesure de nouvelles informations.
Comment renforcer la résilience
S’ils partagent certains constats avec les promoteurs du transition management, les partisans des « initiatives de transition » semblent en revanche moins convaincus par la capacité des niches d’innovation technique à être le moteur essentiel du changement. À l’instar de Rob Hopkins, l’un des leaders de ce mouvement, les « transitionneurs »
pensent que le principal activateur de transition réside dans l’imminence de macrophénomènes comme le pic pétrolier qui devrait entraîner une chute de disponibilité d’énergie fossile liquide, provoquant une onde de choc sans précédent dans presque tous les systèmes sociotechniques. Pour faire face à ce choc, les villes en transition proposent un ensemble de solutions visant à accroître la résilience des sociétés humaines.
La résilience désigne la capacité d’un système à se réorganiser après une importante perturbation. Les centaines d’initiatives de villes en transition qui ont vu le jour au cours des dernières années ont donc pour objectif commun de réduire la dépendance des sociétés humaines à l’égard des énergies fossiles. Concrètement, la plupart des actions proposées vont dans le sens d’un accroissement de l’autonomie des territoires et d’une relocalisation de tout ce qui peut l’être.
Les initiatives de transition privilégient donc l’action et la transformation à l’échelle de communautés locales (villages, petites villes ou quartiers), en favorisant les initiatives issues directement de la société civile. Le mode opératoire des initiatives de transition s’appuie sur la mobilisation d’un noyau dur de citoyens motivés qui vont progressivement chercher à associer un nombre plus important d’acteurs autour de leur démarche.
Bien qu’indépendante des autorités publiques, la démarche se veut cependant très structurée. Elle aboutit dans la plupart des cas à la rédaction d’un plan de descente énergétique, c’est-à-dire un document programmatique qui vise à dresser un état des lieux de la fragilité du territoire à l’égard du pic pétrolier (en matière d’alimentation, de transport, de logement, d’économie, etc.). Il imagine également comment chaque fonction du territoire pourrait être satisfaite dans vingt ou trente ans avec deux fois moins d’énergie fossile disponible. Et il élabore un agenda qui permet de passer de la situation actuelle
à celle projetée.
Finalement, et malgré des différences notables, ces deux mouvements présentent des points communs qui semblent dessiner une rupture assez nette entre la philosophie de la transition et celle du développement durable.
La volonté de maîtrise : un fantasme ?
Tout d’abord, la transition invite à considérer les processus de transformation sociale et écologique comme à la fois inévitables et… impossibles à maîtriser totalement. En misant sur la diversité des expérimentations concrètes comme gage d’adaptation au changement, la transition semble faire le deuil d’une certaine volonté de maîtrise et de planification qui caractérisait parfois le développement durable — avec ses cohortes de conventions internationales et autres stratégies nationales. Mais elle le fait sans pour autant verser dans l’illusion d’une régulation par la « main invisible » du marché, en cherchant finalement une nouvelle forme de gouvernance du changement qui s’émancipe à la fois du marché (trop aléatoire) et de la planification d’État (trop rigide).
L’autre changement important amené par les mouvements de la transition est qu’ils misent davantage sur une transformation écologique de la société « par le bas », c’est-à-dire par le biais d’une mobilisation des acteurs à l’échelle des territoires infranationaux… et ce, sans attendre finalement grand-chose des processus générés « par le haut » dans le cadre, par exemple, des négociations internationales sur le développement durable — dont Rio+20 a une fois de plus montré les limites. Plutôt qu’imaginer que le changement dans nos modes de vie sera généré de façon descendante après d’hypothétiques conventions internationales, les mouvements de la transition préfèrent ainsi miser sur la capacité d’innovation des territoires pour générer des changements globaux.
Image renversée, en quelque sorte, du « penserglobal pour agir local » qui a servi de slogan au développement durable dans les années 1990 et 2000.