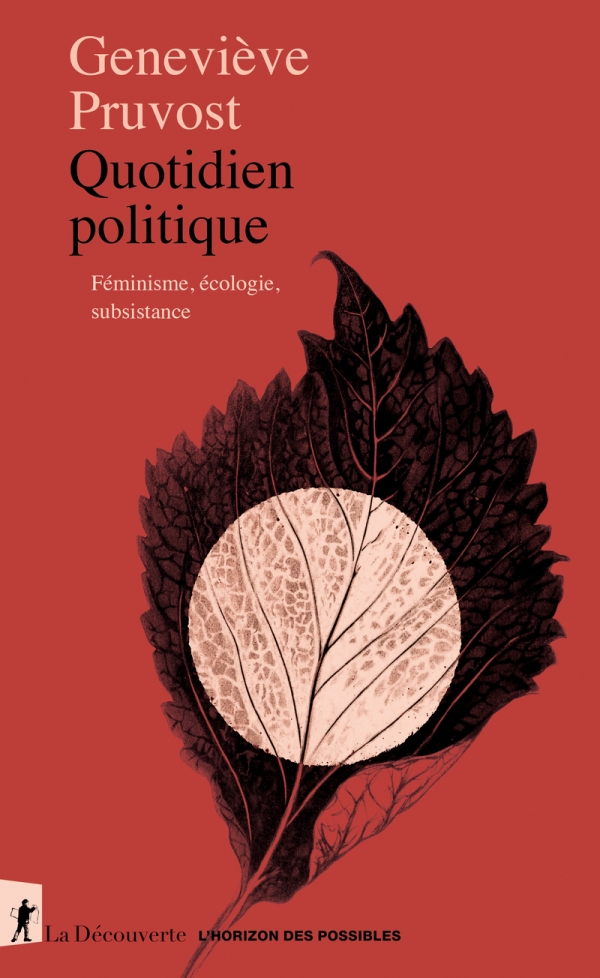1. Les moustiques sortent du cadre
Islande, octobre 2025. Trois Culiseta annulata sont capturés dans la vallée de Kjós — les premiers moustiques jamais recensés sur l’île. « It is very likely that the mosquito is here to stay » (Il semblerait que le moustique soit là pour y rester), note un entomologiste islandais. Ce micro-événement condense la réalité du dérèglement : la frontière entre le tempéré et le subpolaire recule d’un battement d’ailes (The Guardian, 21 octobre 2025 ; Washington Post, 23 octobre 2025).
Londres. Une étude menée par le Sanger Institute et le Natural History Museum révèle que Culex pipiens f. molestus n’est pas né dans les tunnels du métro, mais s’est différencié il y a plus d’un millénaire dans le bassin méditerranéen. L’évolution urbaine n’est donc pas une invention moderne : elle s’inscrit dans une co-évolution longue entre humains, infrastructures et moustiques (Natural History Museum, 23 octobre 2025).
France. À Antibes, Fréjus et Hyères, les autorités sanitaires ont recensé plus de 700 cas autochtones de chikungunya et de dengue. Les moustiques-tigres s’installent désormais jusque dans les copropriétés, les cours d’école, les terrasses de cafés. Les élus oscillent entre communication apaisante — « Vivre avec » — et dispositifs d’urgence (Santé publique France, Bulletin national, 8 octobre 2025 —).
Ces scènes, apparemment disjointes, composent un même récit : celui d’un vivant hostile co-constitué par la technique, révélant la manière dont nos infrastructures produisent des niches écologiques inattendues.
2. Quand le « vivre avec » devient impossible
Dans Living with Mosquito la sociologue Shweta Rani Khatri décrit la sidération des habitants de Delhi face à la banalité d’un danger devenu quotidien : « The imagination of Kaliyuga helps people accept the possibility of dying of a mosquito bite » (L’imaginaire du Kaliyuga — l’âge de la dégénérescence dans la cosmologie hindoue — aide les gens à accepter la possibilité de mourir d’une piqûre de moustique). Autrement dit, le rapport au moustique s’enracine ici dans un arrière-fond culturel et moral : celui d’un temps enchâssé dans un cycle de décadence, où la prolifération des fléaux devient le signe d’un monde en plein délitement.
Khatri ne propose pas une lecture religieuse. Elle montre que des cadres d’interprétation collectifs façonnent la manière de supporter l’incertitude écologique. Cette perspective permet de saisir combien les manières de rationaliser la crise — qu’elles soient sanitaires, techniques ou économiques — relèvent elles aussi de théodicées implicites du désordre. Le Kali Yuga est d’ailleurs devenu en Occident, aux États-Unis tout particulièrement un élément d’interprétation mobilisé par l’extrême droite.
Cette ambivalence — à la fois l’acceptation fataliste de devoir composer avec les moustiques et la volonté de s’en protéger ou de les combattre — vaut désormais pour les villes européennes. Les campagnes de sensibilisation (« Vidons l’eau stagnante ») côtoient les pulvérisations de larvicides, tandis que les climatiseurs continuent de suinter. Ce dilemme entre santé publique, équilibre écologique et responsabilité morale se retrouve aussi chez Rajesh Sharma, qui parle d’un « mal nécessaire » : vivre provisoirement avec les moustiques, faute de pouvoir les éradiquer totalement sans déstabiliser les écosystèmes.
Les moustiques ne s’intègrent à aucun récit de réconciliation. Leur présence déstabilise l’imaginaire du « vivre avec » hérité des années 2010 — celui d’un monde réenchanté par les alliances avec les non — (ou plus qu’)humains. Ils rappellent que toute cohabitation a un coût, qu’il existe des vivants indésirables imposant le retrait et la mise à distance.
Ici, l’écologie se fait politique du seuil : elle ne cherche plus à relier tout, mais à déterminer où placer la limite : une écologie de la distance, non de la fusion (ce que les malades, de Lyme ou du Covid, savent bien).
3. Climat + eau + infrastructures : une co-production de la prolifération
Dire « qu’il fait plus chaud, donc il y a plus de moustiques » est juste, mais incomplet. Le climat n’agit pas seul : il met en résonance des chaînes matérielles et sociales. Les chercheurs de Berkeley ont montré que certaines espèces s’adaptent génétiquement à la hausse des températures en quelques générations ; d’autres changent de comportement : elles piquent plus tôt, plus longtemps, plus près des habitations.
Les projections climatiques confirment aussi l’évolution de la zone d’habitabilité du moustique-tigre. Selon le GIEC (AR6 WGII, Chapitre 13 — Europe), Aedes albopictus [le moustique tigre] est désormais présent dans de nombreux pays européens et « peut transmettre la dengue, le chikungunya et le zika ».
Les scénarios montrent une augmentation notable des conditions favorables pour le développement de ces maladies, notamment en France, en Espagne et en Allemagne, à mesure que les températures estivales moyennes et les périodes humides s’allongent. Autrement dit, le moustique-tigre devient un indicateur direct de la transformation des régimes climatiques européens, traduisant concrètement la montée en latitude de la zone tropicale.
Mais ces dynamiques climatiques n’expliquent rien sans les formes urbaines : bassins d’orage, coupelles, récupérateurs d’eau, toitures plates, drains bouchés, climatiseurs gouttant sur les balcons. Une étude indienne sur les air-coolers montre que leurs réservoirs représentent jusqu’à 30 % des gîtes larvaires. En Méditerranée, l’eau stagnante des dispositifs de condensation joue le même rôle.
Le moustique-tigre devient ainsi le miroir de notre thermodépendance : plus nous cherchons à nous rafraîchir, plus nous entretenons l’humide. Le confort moderne nourrit littéralement son écologie.
4. Cohabiter autrement
À l’échelle européenne, la tendance est claire. L’ECDC recense près de 1 000 cas de West Nile Virus dans 13 pays, avec une saison commencée plus tôt et achevée plus tard. L’aire d’implantation d’Aedes albopictus continue de progresser vers le nord. Les autorités parlent désormais d’un « changement de paradigme » : il ne s’agit plus de gérer des cas importés, mais d’organiser une coexistence durable avec des vecteurs installés.
L’expression est trompeuse : « vivre avec » ne signifie pas tolérer, mais contenir. La santé publique invente des formes de cohabitation par le contrôle : surveillance entomologique, campagnes de détection, stratégies de retrait.
Face à ces vivants indésirables, l’enjeu n’est pas tant de renouer un lien dans l’absolu que de mettre en place d’autres rapports avec eux et les milieux qui rendent leur existence (voire leur prolifération) possible. Il s’agit d’adapter nos infrastructures et nos usages pour éviter de reproduire les conditions d’insalubrité que nous avons créées. Cette transformation implique une écologie qui n’élude pas la place de la technique et des infrastructures, attentive à la question du risque plus qu’à l’idéal d’harmonie, et consciente de la matérialité des choix collectifs.
Comme l’indique le GREC Sud : « En termes de gestion, l’un des problèmes centraux relatifs à la prolifération d’Aedes albopictus est son caractère urbain et domestique qui nécessiterait à l’avenir une prise en compte de la réduction de la formation des gîtes larvaires dès la conception des espaces urbains et du bâti, idéalement dans une logique d’habitat durable et anti-vectoriel. »
Vivre avec les moustiques c’est aussi drainer, couvrir, nettoyer
Concrètement, cela passe par la surveillance fine de l’eau, la maintenance des équipements, l’ajustement des plans d’urbanisme aux nouvelles conditions climatiques. D’autres manières d’habiter, mais pas sur le mode de la conversion ontologique : d’autres manières de produire, de construire, de déconstruire, de maintenir ou de « démaintenir ». Il ne s’agit pas de nier le « vivre avec » mais d’en redéfinir les conditions, et l’ensemble des médiations qui le rendent possible.
5. Le moustique, symptôme d’un monde qui se défait
Antoine Doré, dans Politiques du loup (PUF, 2025), propose de suivre les « trames de la cohabitation » — ces réseaux d’artefacts, de règles et de dispositifs qui rendent la vie commune possible. L’ouvrage se distingue des approches plus philosophiques du « vivre avec » incarnées par Baptiste Morizot ou Vinciane Despret : Doré ancre la question dans les pratiques concrètes, administratives et techniques, montrant comment la cohabitation s’institue matériellement, plutôt que dans une relation sensible ou symbolique au vivant.
Avec les moustiques, ces trames s’inversent, elles deviennent le lieu du délitement, prolongeant en un sens la thèse de Doré : les moustiques illustrent concrètement ses « trames de la cohabitation » en en révélant la fragilité et la tendance au délitement. Ce ne sont plus les relations qui manquent, mais leur entretien : caniveaux bouchés, plans de gestion sous-dotés, frontières administratives floues entre écologie, santé et urbanisme. C’est aussi tout un soin de la technosphère qui fait défaut et, ce faisant, engendre des relations délétères au vivant — ou des relations nouvelles à un vivant de plus en plus délétère.
Le moustique incarne un commun négatif : un bien collectif indésirable dont il faut assumer (et faire assumer) la responsabilité. Il rend visibles nos dépendances techniques : conduites d’eau, normes sanitaires, routines d’entretien et rappelle que la « nature » de l’Anthropocène n’est pas sauvage, mais infrastructurelle. Et que le soin du vivant passe ainsi désormais par la maintenance du non-vivant.
6. Prendre soin de nos ruines
À la manière de Dipesh Chakrabarty, ces constats ouvrent sur des dilemmes difficiles : comment continuer à habiter un monde que les dispositifs anthropiques rendent à la fois habitable et invivable ?
Le défaut de soin vis-à-vis de la technosphère explique en grande partie la prolifération du moustique : la négligence des infrastructures, la place subalterne accordée à la maintenance et à l’entretien, ainsi que la production accélérée de ruines et de déchets, créent autant de niches pour sa reproduction.
Les moustiques sont aussi les habitants d’un monde en ruine. Ils s’installent dans les rebuts, les friches, les infrastructures abandonnées — toutes ces strates du « progrès » qui se retournent contre leurs concepteurs. Les déchets plastiques, les pneus ou les containers de chantier retiennent l’eau et deviennent des incubateurs parfaits. Chaque innovation produit ainsi ses niches biologiques inattendues. L’accélération industrielle ne crée pas seulement du neuf : elle multiplie les ruines actives (ruineuses), où se maintient une vie proliférante, souvent pathogène.
Comme le rappelle Shannon Mattern dans un article intitulé « Maintenance and Care », les sociétés modernes se sont construites sur une fascination pour la nouveauté technique au détriment de la réparation et de la maintenance.
Ce biais traverse aussi les politiques environnementales : les budgets se débloquent plus facilement pour l’innovation que pour l’entretien des réseaux, des digues ou des systèmes d’assainissement. Ce déséquilibre explique la vulnérabilité des milieux urbains contemporains : les moustiques y prospèrent dans les interstices d’une technosphère négligée. Penser le soin du monde suppose alors de revaloriser l’activité de maintenance et les gestes d’attention quotidienne — autrement dit, de replacer ces éléments au cœur des enjeux de soutenabilité.
Le souci n’est pas seulement écologique : il tient à l’absence d’une économie du soin comme à l’existence d’une économie désajustée vis-à-vis des enseignements du système Terre, qui valorise la production, l’innovation, voire la destruction pure et simple au détriment des capacités à subsister. La crise du soin de la technosphère révèle une contradiction plus profonde : cette économie fonctionne comme si elle était indépendante du système Terre. Les enseignements des sciences du climat, de la géologie et de l’écologie rappellent pourtant que les cycles de production et d’entretien sont liés.
Ce défaut d’attention envers la technosphère explique en grande partie la prolifération du moustique : la négligence des infrastructures, la place subalterne accordée à la maintenance et à l’entretien, ainsi que la production accélérée de ruines et de déchets, créent autant de niches pour sa reproduction. Le souci n’est pas seulement écologique : il tient autant à l’absence d’une économie du soin qu’à l’existence d’une économie désajustée des enseignements du système Terre, qui valorise la production, l’innovation, voire la destruction, au détriment des capacités à subsister. Autrement dit, ce n’est pas la nature qui se venge, c’est l’économie qui s’auto-défait.
7. Le moustique, pédagogue paradoxal
Les moustiques nous rappellent que le vivant n’est pas toujours un allié, et que la proximité n’est pas synonyme d’habitabilité. Ils forcent à penser une écologie moins romantique, plus géotechnique — faite de canalisations, de bassins, de normes, de gestes d’entretien. Ils enseignent que s’occuper du monde, ce n’est pas seulement renouer avec la nature, mais préserver les conditions du vivable.
De l’Islande à Antibes, ils incarnent une vérité discrète de l’Anthropocène : nous ne faisons pas que vivre sur Terre, nous la fabriquons (le philosophe Pierre Caye parle ainsi de « Technophysis » dans un livre paru en 2020, intitulé Durer). Et plus nous la fabriquons sans discernement, plus nous devons espacer, ventiler, drainer pour pouvoir encore y respirer, au risque d’accroître la pression sur des milieux déjà fragilisés.
Le moustique incarne ainsi un commun négatif : un héritage collectif indésirable dont la gestion, coûteuse et continue, devient une condition du maintien des conditions d’habitabilité. Il nous enseigne que prendre soin du monde, ce n’est plus seulement protéger la « nature », mais apprendre à entretenir les ruines actives que nous produisons, à assumer la matérialité de nos dépendances, et à penser l’écologie au plus près de celles-ci.