Neutralité carbone : pourquoi miser sur la voiture électrique ?

Article
En quoi la transition vers le véhicule électrique est-elle réellement bénéfique pour le climat ?


Vous êtes ici :

Article
Tag(s) :
Multipliées par 7 entre 2019 et 2023, les ventes de voitures électriques neuves ont connu une nette accélération ces dernières années. 2024 marque cependant un coup d’arrêt avec un recul de 3 %. La part des motorisations électriques dans les volumes de ventes stagne ainsi à 17 %. Et si l’on peut se féliciter de l’effondrement des ventes de véhicules thermiques (-70 % depuis 2019), celui-ci profite avant tout aux motorisations hybrides qui, comme on l’a vu dans un autre article de ce dossier, ne sont pas une option viable pour décarboner les déplacements en voitures particulières.
Comment expliquer cette situation ? Comment les Français perçoivent-ils le véhicule électrique ? Quels sont les facteurs qui peuvent les motiver ou, à l’inverse, les décourager de passer à l’électrique ? Quels leviers activer pour rendre l’électrique désirable aux yeux des automobilistes ? Voici quelques éléments de réponse.
Outre ses bénéfices collectifs pour le climat — réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule — et la santé — baisse de la pollution de l’air et sonore —, la voiture électrique présente d’autres attraits pour les automobilistes.
Alors que les prix des carburants à la pompe sont aujourd’hui environ 15 % plus élevés qu’au moment du mouvement des Gilets jaunes et restent à un niveau historiquement haut une fois corrigés de l’inflation (ministère de la Transition écologique, 2024), la recharge électrique à domicile en heures creuses permet à l’heure actuelle de diviser par près de 5 le coût du plein aux 100 km, comparativement à un véhicule essence (Engie, 2024).
Rappelons également que l’Ademe estimait en 2022 que le coût complet sur 15 ans d’un véhicule électrique compact avec une batterie de 40 kWh était 8 000 € plus faible que son homologue essence. Ces constats présentent cependant une dimension conjoncturelle et sont susceptibles de s’infléchir dans un sens ou dans l’autre à l’avenir en fonction de l’évolution du prix d’achat des véhicules et de l’électricité.
Toujours au registre des incitations financières, l’achat d’un véhicule électrique donne également lieu au versement d’aides publiques. Versé par l’État pour aider les particuliers à acheter, ou louer pour une durée d’au moins 2 ans, une voiture électrique neuve, le bonus écologique peut atteindre jusqu’à 4 000 € en fonction des revenus du bénéficiaire. De même, l’installation d’une borne de recharge à domicile peut donner lieu à un crédit d’impôt pouvant représenter jusqu’à 500 € et 75 % du montant des dépenses. Une fois encore, ces aides sont susceptibles d’évoluer sensiblement dans les mois et les années qui viennent, au gré des politiques gouvernementales et de l’évolution du marché automobile.
Les incitations à se tourner vers le véhicule électrique peuvent également passer par la contrainte. Le malus sur les émissions de CO₂ concerne désormais tout véhicule émettant plus de 113 gCO₂/km et son montant croît avec le niveau d’émissions pour atteindre 70 000 euros à partir de 192 gCO₂/km. De même, la mise en place des Zones à Faibles Émissions (ZFE) dans les grandes agglomérations vise à exclure les véhicules les plus polluants, les véhicules électriques conservant un libre accès aux zones concernées.
Aux coups de pouce nationaux peuvent s’ajouter des aides proposées par les collectivités locales. À titre d’exemple, la Métropole de Lyon propose aux particuliers résidant dans son territoire, travaillant et/ou habitant au sein de la Zone à Faibles Émissions (ZFE), des aides pouvant atteindre 3 000 € pour la mise au rebut d’un véhicule (léger ou deux/trois roues motorisés) Crit'Air 5, 4, 3 et 2 ou non classé, au profit, notamment, d’une voiture électrique neuve ou d’occasion.
De plus, la voiture électrique, c’est aussi une satisfaction à l’usage. Une vaste enquête sur les « perceptions et attendus du grand public à l’égard de l’électromobilité » commanditée par l’Ademe montre en effet que, sur une échelle de 1 à 10, la satisfaction des utilisateurs de voiture électrique se situe en moyenne à 7,9, soit un niveau similaire aux véhicules hybrides, mais sensiblement supérieur à celui des véhicules thermiques (7,2). L’électrique se démarque en particulier sur la facilité et le coût de l’entretien.
Les données du Répertoire statistique des Véhicules routiers (RSVERO) du ministère de la Transition écologique permettent de suivre l’évolution des immatriculations de véhicules (neufs et d’occasion) et du parc automobile à l’échelle locale.
On observe que si la part des véhicules électriques (VE) dans les ventes de voitures neuves accusait un certain retard dans la Métropole de Lyon, comparativement à l’échelle nationale, ce n’est plus le cas en 2024. La part des VE dans le parc automobile est désormais plus élevée au sein du territoire lyonnais que dans la plupart des métropoles françaises.
D’une manière générale, l’acceptabilité même de la voiture électrique pose question. Selon l’enquête de l’Ademe, seuls 14 % des personnes ayant le projet d’acheter une voiture dans les années à venir envisagent d’acquérir une voiture électrique contre 40 % pour un véhicule hybride, 30 % pour un véhicule thermique et 30 % qui ne savent pas encore. Autre indice, 53 % des Français considèrent que l’interdiction des ventes de véhicules thermiques à l’horizon 2035 est une mauvaise chose, contre 28 % qui pensent l’inverse. Notons que cette opinion négative est d’autant plus marquée que les personnes sont âgées, votent à droite de l’échiquier politique et habitent dans des communes éloignées des centres urbains.
Comment expliquer cette image dégradée de la voiture électrique dans une large partie de l’opinion publique ? Un élément de réponse renvoie au fait que les atouts de la voiture électrique restent méconnus d’une majorité de Français. La 6e édition de l’Observatoire international Climat et Opinions publiques IPSOS/EDF (Obs’COP) publiée en 2024 indique que 71 % des Français interrogés sont d’accord avec cette affirmation « À cause de leurs batteries, les voitures électriques sont aussi nocives pour le climat que les voitures à essence » contre 50 % en moyenne dans les 30 pays couverts par l’enquête. Il est intéressant de noter que cette opinion domine même chez l’électorat écologiste, dont on pourrait penser qu’il soit mieux informé sur les écarts de bilan carbone entre véhicules thermiques et électriques.
Même son de cloche du côté de l’enquête de l’Ademe concernant le coût à l’usage : seuls 31 % des personnes interrogées estiment que recharger son véhicule électrique coûtera moins cher que faire le plein d’essence aujourd’hui.
Ces constats posent la question de la diffusion des informations sur le véhicule électrique auprès des automobilistes. Certains observateurs ont ainsi déploré la piètre qualité du débat public sur le sujet, soulignant un certain nombre d’« idées reçues » (Meunier et coll., 2022), voire dénonçant un « océan de fake news » (Jeanneau, 2022 ; Bon Pote, 2023). Du reste, les dernières élections européennes de 2024 ont vu le discours « anti-voiture électrique » monter en puissance à droite de l’échiquier politique en France et en Allemagne (Bernard, 2024).
Si la voiture électrique ne fait pas encore rêver les foules, c’est d’abord parce que son prix reste un frein structurel. 85 % des répondants de l’enquête de l’Ademe jugent les véhicules électriques difficilement, voire complètement inaccessibles pour eux, et à peine un tiers prédisent une baisse des prix dans les années à venir.
Lorsque l’on demande aux Français le prix auquel ils ont acheté leur voiture actuelle (neuve ou d’occasion), leur réponse se situe à un peu moins de 14 000 € en moyenne (Ademe, 2023). Les personnes envisageant l’acquisition d’un nouveau véhicule prochainement prévoient quant à elles un budget moyen d’un peu moins de 17 000 euros. C’est bien là que le bât blesse, car il faut à l’heure actuelle débourser bien plus pour acquérir un véhicule électrique !
Il est important sur ce point de rappeler tout d’abord que les voitures neuves n’ont pas attendu d’être électriques pour devenir hors de prix pour nombre d’automobilistes. Comme évoqué dans un autre article de ce dossier, la « SUVification » du marché automobile a entraîné une nette inflation des prix des véhicules neufs au cours des 15 dernières années (WWF, 2024).
Une analyse de l’ensemble des ventes de véhicules neufs en France entre 2009 et 2023 montre que le SUV moyen mis en circulation est 20 % plus lourd, 30 % plus puissant et… 50 % plus cher que les berlines et monospaces vendus sur la période : 35 400 € pour les premiers contre 24 000 € pour les seconds. De plus, les prix des SUV ont augmenté plus rapidement sur la période considérée : par exemple +85 % pour les SUV du segment B (Renault Captur, Peugeot 2008, Dacia Duster, etc.) contre +51 % pour les autres modèles de ce segment.
Cerise sur le gâteau, cette forte progression des SUV a pour corollaire un déclin de l’offre de petits véhicules de type citadines (Alochet et coll., 2025 ; Krajinska, 2023), comme en témoigne l’arrêt de la fabrication des Peugeot 108, Citroën C1, Fiat Punto, Ford Fiesta… La part des véhicules de moins de 1 100 kg dans les nouveaux modèles est ainsi passée de 22 % dans les années 1990 à 2 % entre 2020 et 2024.
De fait, en ajoutant le coût des batteries, l’électrification vient exacerber cette flambée des prix des véhicules : le prix moyen des voitures électriques apparaît nettement supérieur aux autres motorisations, à l’exception cependant des hybrides rechargeables (WWF, 2024). Mais ce surcoût est d’autant plus significatif que l’électrification se déploie dans un marché de plus en plus dominé par les SUV, qui impliquent des batteries plus lourdes en raison du poids et de la puissance supérieurs de ces véhicules.
Particulièrement salée, l’addition SUV + électrique décourage la majeure partie des automobilistes, et peut même susciter une forme de défiance dans le contexte de la mise en place des « Zones à Faibles Émissions », parfois rebaptisées « Zones à Forte Exclusion ». En 2022, 75 % des voitures neuves sont achetées par la moitié des ménages les plus aisés et cette part monte à 80 % concernant spécifiquement les voitures électriques (ministère de la Transition écologique, 2024).
Mais la question du prix des voitures électriques neuves ne dit pas tout. Il est important de rappeler que près de 9 voitures sur 10 immatriculées chaque année en France sont d’occasion (ministère de la Transition écologique, 2025) : par exemple, en 2024, il s’est vendu environ 1,8 million de voitures neuves contre 5,5 millions de voitures d’occasion. L’accès à l’électrique se joue ainsi en large partie sur le marché de l’occasion. Or la pénétration de l’électrique apparaît encore très limitée (voir graphique ci-dessous).
Si l’on observe nécessairement un décalage dans le temps entre l’augmentation des ventes de voitures électriques neuves et leur disponibilité sur le marché de l’occasion, un autre facteur limitant est à l’œuvre : les flottes professionnelles. Chaque année, un peu plus de la moitié des ventes de voitures neuves est en effet destinée aux flottes de véhicules de services et de fonction des entreprises et des administrations, ainsi qu’aux flottes de location de véhicules à courte et longue durée (ministère de la Transition écologique, 2025).
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) de 2019 impose aux flottes professionnelles de plus de 100 voitures et utilitaires une part croissante de véhicules à faibles émissions (électriques ou hybrides rechargeables) sur l’ensemble des commandes de voitures et utilitaires passées sur une année : 20 % en 2024-2026, 40 % en 2027-2029 et 70 % en 2030. Mais ce cadre réglementaire demeure peu respecté : en 2024, seul un quart des acteurs visés ont respecté le quota prévu.
De plus, les voitures hybrides rechargeables représentent toujours une part significative des véhicules « à faibles émissions » immatriculés par les organisations visées par la LOM alors qu’en conditions réelles de conduite, ces voitures s’avèrent pourtant aussi émissives (140 gCO₂/km) et énergivores (6 L/100) que les voitures essence ou diesel classiques (Commission européenne, 2024).
Il y a donc un enjeu crucial à renforcer l’électrification de ces flottes — dont le renouvellement est plus rapide que pour les particuliers — afin de faire émerger plus rapidement un marché de masse de véhicules électriques d’occasion (Hermine, 2024 ; Larivière, 2025). Cette transition est d’autant plus cruciale que ces flottes sont les premières clientes des constructeurs hexagonaux et constituent un débouché incontournable pour les modèles électriques made in France.
Enfin, un autre facteur d’inégalité d’accès à la voiture électrique est à mentionner : le coût de la recharge. Comme souligné plus haut, la recharge à domicile est à l’heure actuelle la moins onéreuse pour les ménages. Il n’est donc guère surprenant que ce mode de recharge soit privilégié par près de 2/3 des utilisateurs de véhicules (Ipsos/Avere, 2024). Comme l’indique l’enquête de l’Ademe, cette part monte à 89 % pour les personnes résidant en maison individuelle contre 50 % pour celles résidant en appartement, les immeubles collectifs étant nettement moins équipés en bornes de recharge individuelle ou collective (Avere, 2024).
En d’autres termes, les utilisateurs de véhicules électriques habitant en appartement sont largement tributaires des bornes de recharge publiques, dont les prix sont plus élevés et plus variables qu’à domicile. Il en résulte une forme d’inéquité entre automobilistes face au coût de la recharge électrique (Tilly et al. 2024).
Certaines études portant sur les potentielles externalités négatives de l’électrification du parc automobile attirent l’attention sur les conséquences possibles sur les pratiques de mobilité de la mise à disposition de véhicules électriques qui seraient sensiblement plus économiques à l’avenir (Orsi, 2021 ; Hensher et coll., 2021 ; Tilly et coll. 2024).
Dans la perspective d’une parité des prix d’achat entre modèles électriques et thermiques (déjà atteinte en Chine), de l’émergence de véhicules plus petits et plus sobres, du maintien des moindres coûts d’entretien et de carburant dont bénéficient les motorisations électriques, du déploiement d’un réseau de bornes de recharge aussi diffus que les stations essence, etc., l’attrait des déplacements en voiture individuelle pourrait s’en trouver renforcé, ce qui pourrait freiner le report vers les transports collectifs et les mobilités collectives, et alimenter les phénomènes de congestion et d’étalement urbain.
L’enquête de l’Ademe montre que le second frein majeur au passage à l’électrique concerne les batteries, sources de plusieurs inquiétudes. Le nombre de kilomètres qu’elles permettraient de parcourir serait insuffisant, de même que le nombre de bornes de recharge, tandis que le temps de recharge serait trop long.
Ces craintes concernent tout particulièrement les trajets longue distance (plus de 200 km). Les voitures électriques sont en effet utilisées beaucoup moins fréquemment pour partir en vacances que les véhicules thermiques : 55 % contre 83 % (Ademe, 2023). De même, parmi les personnes envisageant d’acheter un véhicule électrique, seuls 56 % l’utiliseraient pour partir en vacances.
De manière significative, le seuil d’autonomie jugé acceptable par les Français pour envisager d’utiliser une voiture électrique se situe en moyenne à 561 kilomètres. Héritée des habitudes liées aux véhicules thermiques, cette exigence d’autonomie n’a pourtant de sens qu’au regard des besoins de déplacements exceptionnels. Dans ce débat sur l’autonomie des voitures électriques, il est en effet crucial de rappeler que la « mobilité locale », c’est-à-dire dans un rayon de 80 km autour du domicile, représente… 98,7 % des déplacements des personnes résidant en France en 2019 (ministère de la Transition écologique, 2023).
Dans cette mobilité de proximité, 82 % des déplacements réalisés en voiture font moins de 20 kilomètres. Enfin, parmi les déplacements longues distances (supérieurs à 80 km), 44 % concernent des déplacements en voiture de moins de 200 km. Contrairement aux idées reçues, la voiture électrique permet donc de répondre à l’écrasante majorité des déplacements automobiles des ménages.
De plus, l’exigence d’autonomie entre en contradiction avec le frein du prix des véhicules. Des batteries de fortes capacités s’avèrent plus onéreuses : aucun véhicule de moins de 40 000 € n’offre une telle capacité à l’heure actuelle selon le classement du site Automobile propre. Contradiction également avec le bénéfice climatique de l’électromobilité, qui est d’autant élevé que les batteries et les véhicules sont de petite taille, comme évoqué dans un autre article de ce dossier.
En outre, concernant la recharge, l’Ademe indique dans son avis sur le véhicule électrique que l’idée de « recharger une batterie de 60 kWh en 2 minutes comme on refait le plein d’un véhicule thermique représenterait un appel de puissance de 1,8 MW électrique, soit l’équivalent de la puissance électrique moyenne appelée simultanément par 1 500 foyers » (Ademe, 2012).
Que retenir de ces constats ? L’Ademe est formelle : « Répliquer le modèle d’utilisation du véhicule thermique sur le véhicule électrique ne suffira donc pas. Le déploiement de véhicules à forte autonomie (plus lourds et impactant en CO₂) associé à des bornes de recharges hautes puissances pose de nombreuses questions : impact carbone, prix de l’énergie et des véhicules non accessibles à la majorité des ménages, renforcement du réseau électrique… ». Dit autrement, la transition vers l’électrique ne concerne pas seulement les motorisations, mais également les usages automobiles.
Des éclairages qui précèdent émerge un consensus de plus en plus largement partagé : l’avenir de l’automobilité passe par la fabrication et l’usage de véhicules électriques plus sobres pour répondre aux enjeux d’accessibilité sociale, de compétitivité industrielle et de soutenabilité environnementale. Cette mutation se joue notamment sur les quatre dimensions suivantes :
Comme le soulignent de nombreux observateurs (Alochet et coll., 2025, Agence internationale de l’énergie, 2024 ; Hermine, 2024 ; Eyl-Mazzega Marc-Antoine et coll. ; 2023 ; Racu, 2023 ; Ademe 2022), la démocratisation de la voiture électrique implique de remettre en question la fuite avant du SUV et la montée en gamme permanente qui l’accompagne, afin de mettre à disposition des véhicules neufs accessibles à une plus large part des automobilistes.
Le cahier des charges est connu : des batteries limitées à 40-50 kWh offrant une autonomie de 300 à 400 km, une recherche d’efficacité énergétique par une taille limitée et l’amélioration de la conception (aérodynamie, motorisation, équipements…), le choix de matériaux moins critiques et issus du recyclage, une production made in France/UE bas-carbone, etc.
Cette orientation industrielle ferait pleinement sens en France (FNH/IMT, 2024 ; WWF, 2024), où les véhicules vendus sont majoritairement et historiquement de petits véhicules. Les constructeurs hexagonaux comptent encore parmi les moins « SUV-isés » du marché et sont ceux qui vendent encore le plus de citadines en France.
De plus, les petits véhicules électriques apparaissent moins menacés par leurs équivalents importés de Chine, qui, en raison de la faible marge sur les petits modèles, sont désavantagés par les coûts additionnels de transport et de douane, ainsi que par l’écoconditionnalité du bonus écologique, ce dernier tendant à favoriser la production made in France en raison du mix énergétique moins carboné de l’Hexagone.
Mais encore faut-il réunir les conditions permettant de soutenir les industriels sur cette voie, en ciblant les aides à l’achat sur ces véhicules et en renforçant la compétitivité de la production domestique : taxe carbone aux frontières et droits de douane renforcés sur les véhicules électriques et batteries, développement des compétences, appui à l’innovation, électricité bas-carbone compétitive, accès et recyclage des métaux critiques…
Plusieurs acteurs plaident pour une réforme de la LOM afin de prévoir des sanctions plus dissuasives en cas de manquement aux obligations légales, de recentrer le dispositif sur les véhicules zéro émission et de prévoir des critères de poids et d’efficience environnementale permettant d’éviter que l’afflux de SUV électriques rendent le marché de l’occasion de plus en plus difficile d’accès aux ménages modestes (Hermine, 2024 ; WWF, 2024 ; Larivière, 2025).
Disposer d’une voiture électrique à un prix abordable suppose de ne plus la choisir en fonction d’un besoin maximum exceptionnel : partir en famille en vacances à l’autre bout de la France. Il s’agirait désormais de se « contenter » d’un véhicule répondant aux 99 % des besoins de déplacement restant. Au-delà du changement de repère culturel, cette mutation appelle bien entendu un accompagnement pour repenser les déplacements longues distances.
D’une manière générale, plus le maillage de bornes de recharge rapide sera resserré et plus le besoin de disposer d’une batterie de forte capacité sera limité pour réaliser des déplacements longs avec son véhicule électrique. Autre voie possible, développer l’offre d’autopartage permettant de louer ponctuellement des véhicules de plus grande taille et à plus forte autonomie. Au-delà de l’automobile, il est bien entendu indispensable et primordial de promouvoir les déplacements en train en réduisant leur coût, en particulier comparativement à l’avion.
L’enquête de l’Ademe montre que ces changements de pratiques ne sont pas hors de portée : 62 % des utilisateurs de voitures électriques indiquent avoir changé leurs habitudes pour partir en vacances ou pour les longues distances, principalement en faisant le trajet en plusieurs étapes (53 % d’entre eux) et en choisissant des destinations plus proches (45 %), contre 25 % en recourant au train. De même, parmi les personnes envisageant l’achat d’un véhicule électrique, 84 % prévoient au moins un de ces ajustements.
Lancé en 2024 par le ministère de la Transition écologique, le « leasing électrique » propose une offre de location longue durée de voitures électriques à 100 euros par mois (hors entretien et assurance automobile) pour permettre aux ménages les plus modestes de passer à l’électrique sans devoir en faire l’acquisition.
À l’heure actuelle, le dispositif est réservé aux personnes dont le revenu fiscal de référence par part du foyer est inférieur à 15 400 euros, utilisant leur voiture personnelle pour se rendre sur leur lieu de travail situé à plus de 15 kilomètres de leur logement, effectuant plus de 8 000 km par an en voiture dans le cadre de leur activité professionnelle. À l’issue du contrat de location (trois ans minimum renouvelable une fois), les utilisateurs ont la possibilité de restituer le véhicule ou de l’acheter à sa valeur résiduelle. Une flotte de 50 000 véhicules a été mobilisée pour la première vague de 2024, contre 25 000 prévus initialement.
Comme le souligne une étude récente (Transport & Environnement — Institut Mobilités en Transition, 2023), en levant la barrière à l’entrée du prix d’achat des véhicules électriques, le leasing social permet aux ménages modestes d’accéder à un moyen de faire baisser la facture mobilité. Il pourrait gagner cependant à davantage cibler les ménages les plus modestes et les plus dépendants de la voiture individuelle (absence d’alternatives à proximité du domicile telles que les transports en commun), ainsi que les personnes relevant des « professions essentielles ».
L’étude souligne aussi que le déploiement du service pourrait s’appuyer sur les collectivités locales. Ces dernières sont en effet bien placées pour affiner le ciblage des ménages éligibles sur le territoire. Elles pourraient également contribuer à la communication locale autour du dispositif et abonder son financement. Enfin, la possibilité pourrait leur être donnée d’opérer le service sur leur territoire.
De plus, en contractualisant avec les constructeurs français et européens, l’État se dote d’un puissant levier pour orienter la production vers les petits véhicules électriques abordables qui font aujourd’hui défaut. L’opportunité économique pour l’industrie est réelle dans la mesure où le leasing est un marché additionnel captif qui pourrait représenter jusqu’à 900 000 véhicules électriques d’ici 2030.
Enfin, ce contrat de filière pourrait offrir un bénéfice environnemental. L’objectif de produire des véhicules moins chers à l’achat et à l’usage passe en effet par un dimensionnement réduit, ajusté aux besoins de la mobilité quotidienne, par un équipement plus sobre ainsi que par la recherche d’une plus grande efficacité énergétique (consommation électrique au km), tout en répondant à un certain nombre d’exigences environnementales (réduction de l’empreinte carbone de la fabrication, recyclabilité, intégration de matériaux recyclés, etc.).
La démocratisation de l’accès aux véhicules électriques constitue une étape cruciale pour réussir la décarbonation de la mobilité des ménages. Un premier obstacle à lever est celui des perceptions des avantages et limites de l’électromobilité, souvent caricaturés dans le débat public. Apporter une meilleure information aux citoyens pose directement la question du rôle des médias, des responsables politiques ou encore des acteurs de la filière automobile (publicité).
Face à la barrière du prix des voitures neuves, la réponse est clairement du côté des constructeurs — pour mettre à disposition des véhicules plus abordables — et des flottes professionnelles — dont l’électrification est essentielle pour alimenter le marché de l’occasion.
La puissance publique dispose également d’un levier de choix pour concilier les impératifs sociaux, industriels et environnementaux de la transition vers l’électrique à travers le leasing social. L’évolution des pratiques des automobilistes n’est cependant pas en reste, car il convient désormais d’accepter de choisir son véhicule non plus en fonction des déplacements ponctuels les plus exigeants, mais en fonction de la mobilité du quotidien.
Plus largement, il apparaît que la transition vers l’électromobilité ne peut se faire sans reconsidérer le dimensionnement du parc automobile actuel. Le boom des SUV observé depuis une quinzaine d’années constitue un frein majeur à la diffusion du véhicule électrique en raison des coûts qu’il représente pour les ménages et pour l’environnement. Il devient urgent de promouvoir une électrification sobre, aussi bien concernant les caractéristiques des véhicules que leur nombre, en favorisant le report vers d’autres modes de transport et la maîtrise des besoins de déplacement.

Article
En quoi la transition vers le véhicule électrique est-elle réellement bénéfique pour le climat ?

Dossier
À quels basculements devons-nous nous préparer ?

Étude
Découvrez Mémoires - Rétroprospective, le podcast de Millénaire 3, sur les 45 ans d’histoire de la Communauté Urbaine de Lyon (1969-2014).

Dossier
Santé, mobilité, environnement, énergie, droit… Panorama des dimensions de nos modes de vie concernées par une politique de la qualité de l’air.

Dossier
Afin de tordre le cou aux idées reçues et au scepticisme persistant, revenons sur quelques questions pièges du développement durable...
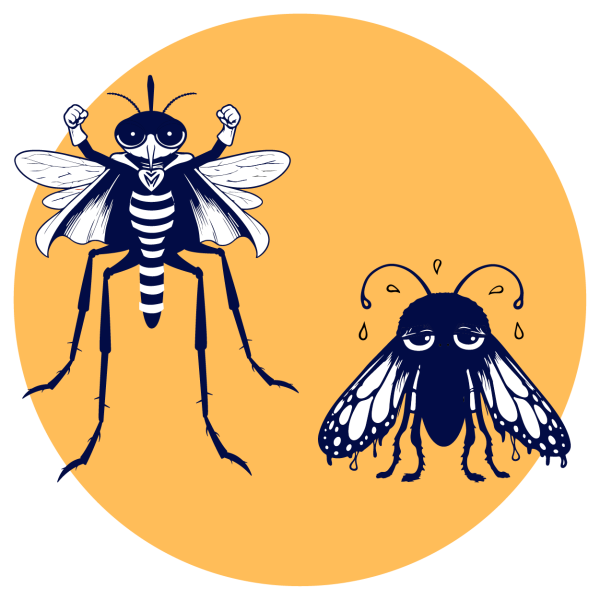
Article
Comment l’Anthropocène favorise certains êtres vivants, tout en précipitant la disparition d’autres ?
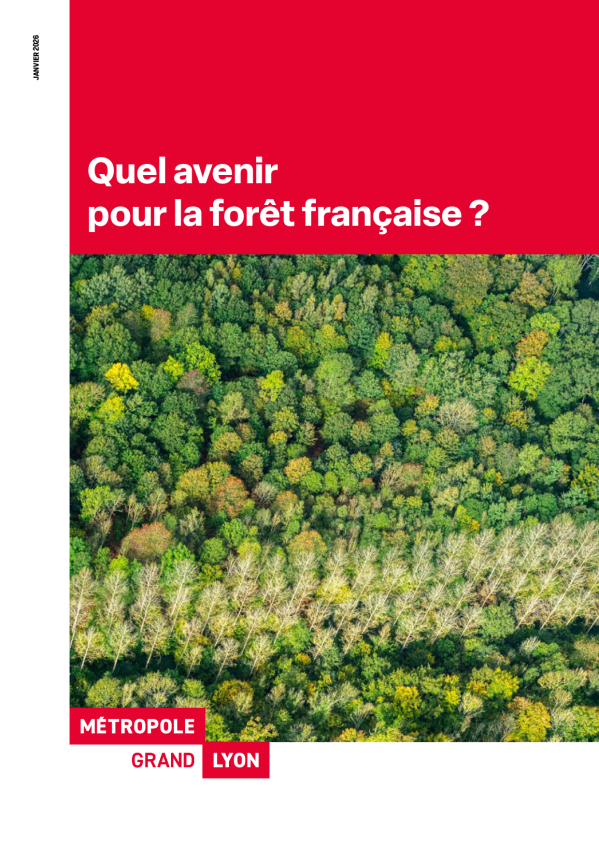
Étude
La forêt, une réalité contrastée entre les attentes d’une société une source d’énergie et de matériaux biosourcés, mais également un levier pour lutter contre le changement climatique.

Interview de Jonathan Lenoir
Chercheur au CNRS, écologue au sein du laboratoire Écologie et dynamique des systèmes anthropisés (EDYSAN), Université de Picardie
Dépérissement des arbres, incendies dévastateurs, perte de biodiversité… Ces véritables poumons verts de notre territoire subissent de plein fouet le réchauffement climatique.
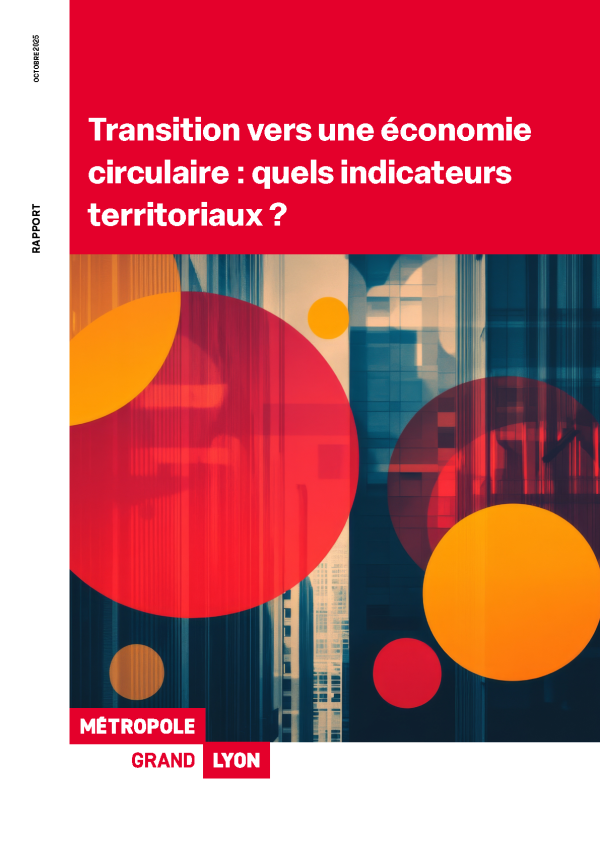
Étude
Comment évaluer son degré de déploiement ? Quels indicateurs privilégier avec quels objectifs ?