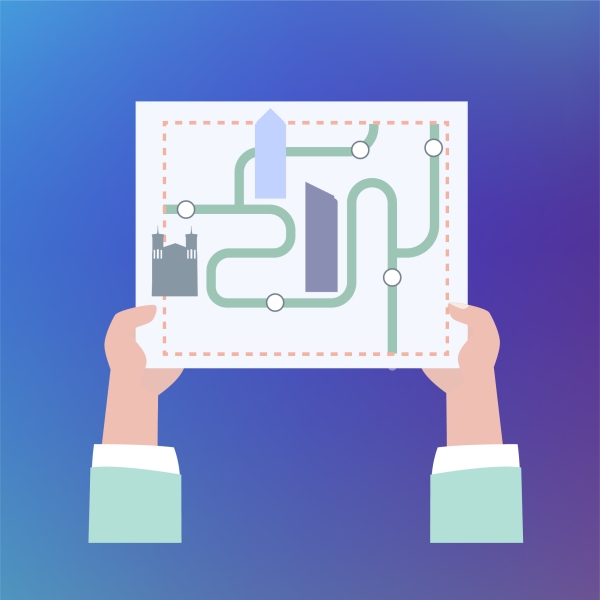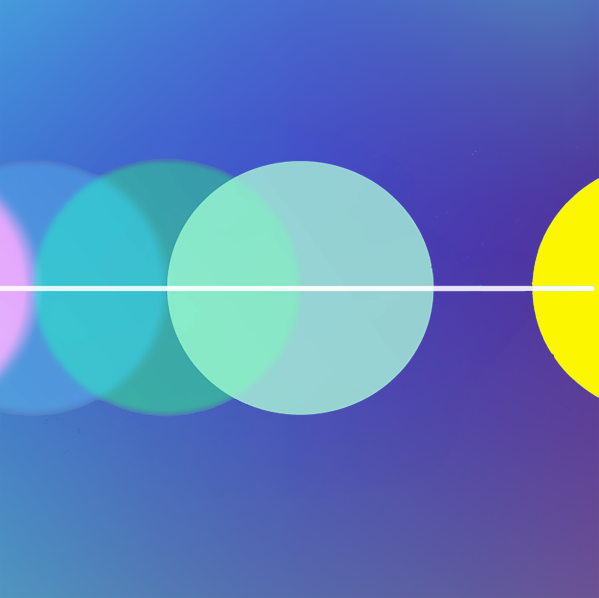Il faut le dire et le répéter, car on voit bien que beaucoup d’informations erronées circulent à propos de la voiture électrique : pour décarboner le secteur des transports au niveau requis par les engagements européens et les exigences climatiques, l’électrification du parc de véhicules représente un levier incontournable. Bien entendu, d’autres leviers sont également indispensables : poursuivre le développement des transports en commun (ferroviaire, cars express haute fréquence, lignes de co-voiturage), sécuriser les autres modes (vélos notamment), assurer l’articulation entre modes de transport et, bien sûr, maîtriser la demande de mobilité…
Pour autant, la quasi-totalité des scénarios disponibles et crédibles montre que l’ensemble de ces autres leviers ne pourraient contribuer à réduire au maximum que de 20 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) des secteurs de la mobilité et du transport de marchandises d’ici 2050 en Europe. Penser que l’on pourrait se passer de l’électrique parce que l’on pourrait tout simplement se passer de la voiture n’est pas crédible. Dans des territoires façonnés par l’automobile, la voiture va demeurer importante pour nombre de ménages. Mais cela ne veut pas dire non plus que l’on peut se contenter d’électrifier un parc automobile à l’identique.
Par ailleurs, il existe d’autres carburants alternatifs, tels que le biogaz, les agrocarburants ou encore l’hydrogène décarboné, mais à ce stade ils sont clairement moins performants à la fois sur le plan énergétique et sur le plan environnemental, et ils resteront des solutions de niche dans le champ des transports routiers, car affectés à d’autres modes (fluvial, maritime, aérien, etc.).
Il est donc important de rappeler que le consensus européen de 2022 sur l’interdiction à la vente des véhicules émetteurs à partir de 2035 s’est forgé sur l’idée que le transport routier de véhicules légers ou lourds dispose désormais d’une innovation — la batterie électrique — qui a fait ses preuves depuis dix ans et permet d’envisager une sortie des énergies fossiles. Entre un véhicule électrique et un véhicule thermique équivalent, le bilan carbone sur l’ensemble du cycle de vie et pour 150 000 km est divisé par deux en Europe et même par quatre en France compte tenu de notre mix électrique très décarboné, soit -75 %. La transition vers l’électrique offre donc un levier d’abattement des émissions considérable. De plus, ce bilan carbone va continuer de s’améliorer au fur et à mesure de la décarbonation du mix électrique et de l’industrie en Europe.