Repenser les métiers du prendre soin à l’aune des théories du care

Étude
Et si le turn-over et l’attractivité en berne des métiers du prendre soin était lié à des transformations organisationnelles et managériales ?


Vous êtes ici :

Texte de Julie JEAMMAUD et Anouk JORDAN
Tag(s) :
La première partie répond à un double objectif : décrire succinctement la manière dont est pensé et organisé le travail dans notre société, et pointer son caractère central, complexe et mouvant. En effet, le travail est au centre de notre organisation collective. Sa place et ses fonctions ont été construites durant des siècles, et seront amenées à se transformer perpétuellement sous l’impulsion des transformations techniques, environnementales, culturelles. Nous mettons également en exergue la difficulté à saisir la notion de travail, polysémique et changeante selon les époques et les points de vue. Il s’agit donc de questionner une notion qui semble aller de soi du fait de sa centralité dans notre vie collective, et qui pourtant reste insaisissable et en perpétuelle transformation.
La seconde partie décrypte les besoins individuels que contribue à satisfaire le travail dans nos vies. Pour nombre d’entre nous le travail est à la fois un « gagne-pain », un levier privilégié de construction de notre identité sociale, et une activité par laquelle nous aspirons à nous réaliser, à éprouver notre pouvoir d’agir sur le monde. L’aborder de ces différents points de vue est nécessaire pour comprendre ce que le travail fait à l’homme et ce que l’homme fait au travail. Pour ne prendre qu’un exemple, l’effet sur l’offre de travail d’un relèvement des minimas sociaux ou de l’introduction d’un revenu universel se réfléchit différemment si on envisage le travail comme une simple source de revenus (auquel cas l’effet désincitatif sur l’offre de travail sera évident), ou comme un vecteur de construction de l’identité sociale et de réalisation de soi (auquel cas, le travail fera l’objet d’une offre endogène, indépendante des niveaux comparés du salaire réel et des minima sociaux).
Nos sociétés occidentales sont décrites comme étant fondées sur le travail : il est le principal moyen de subsistance, occupe une part considérable de notre temps, et détermine en grande partie notre place dans la société. La notion de travail peut sembler aller de soi tant elle nous est familière. Son caractère est pourtant mouvant et complexe. D’une part, du fait de la place centrale qu’il occupe, le travail recouvre des domaines variés de nos existences collectives et individuelles, ce qui en fait une notion multidimensionnelle. D’autre part, la définition et l’organisation du travail sont historiquement et socialement construites : comme le souligne Dominique Méda, le concept de travail agglomère différentes couches de significations qui se sont accumulées au fil des siècles, ce qui nous incite à penser ses perpétuelles transformations.
Le travail, ses limites, son organisation, ne vont donc pas de soi, et ce concept n’est ni universellement partagé, ni figé. De nombreuses sociétés n’ont pas de termes correspondant à ce que nous nommons « travail ». D’autres possèdent une notion proche mais un peu décalée, ne distinguant pas les activités productives des autres, excluant des activités que nous considérons comme productives (comme la chasse ou la pêche), ou encore dépassant le champ de la production (inclusion par exemple des activités rituelles ou intellectuelles). Par ailleurs, dans les sociétés non occidentales, les activités productives sont bien souvent enchâssées dans d’autres pratiques sociales et les « travailleurs » n’ont pas de statut séparé (Chamoux ; 1994).
Ceci nous enjoint à nous détacher d’une perspective essentialiste (le travail n’existe pas en soi) pour préférer une approche relativiste : le concept de travail s’appréhende seulement en référence au contexte socio-historique dans lequel il s’inscrit.
Le travail aujourd’hui est au fondement de notre ordre social, mais cela n’a pas toujours été le cas. On peut retracer succinctement les transformations conceptuelles et sociales qui ont mené à cet état de fait.
En Grèce Antique, le concept unifié de travail n’existe pas : on trouve des activités, des tâches, qui ne se regroupent pas sous une fonction unique : « travailler ». L’idéal individuel et social est de se libérer des activités nécessaires pour pouvoir se consacrer aux activités libres (morales, politiques…) qui sont elles-mêmes leur propre fin. Sous l’empire romain puis au Moyen-Age, ce que l’on appellera plus tard « travail » n’est toujours pas considéré comme une contribution à l’utilité générale, et ne détermine pas l’ordre social : les positions sont acquises par la naissance (Méda ; 2018).
Après de progressives transformations de la société étalées sur une très longue durée, c’est finalement au 18e siècle qu'apparaît la catégorie unifiée de travail et la valeur qui lui est accordée. La manière dont est alors pensé le travail résulte de la superposition de trois couches de significations.
Tout d’abord, le 18e siècle est marqué par une révolution idéologique et morale centrale : par le truchement d’une réinterprétation de la bible valorisant les activités terrestres, la volonté d’enrichissement ici-bas devient l’objet d’une large approbation. La diversité des activités productives se voit rassemblée sous le terme de travail, qui apparaît comme une unité de mesure, un cadre de référence des efforts. Pour Adam Smith, et plus largement les économistes classiques, dans une société à la recherche de l’abondance, le rapport qui lie les individus est fondamentalement celui de leur contribution à la production, et de leur rétribution, mesurée par le travail. Le travail est donc « ce qui produit de la richesse », individuelle et collective, et détermine la position sociale des individus dans la société.
Puis une conception du travail comme « liberté créatrice » qui permet à l’Homme de transformer le monde en y inscrivant son empreinte naît au 19e siècle. Dans cette conception le travail devient l’essence de l’Homme, et fonde la distinction avec le règne animal. Le travail libre est pensé comme espace d’expression, d’émancipation, et c’est cette dimension qui est valorisée (au-delà de l’aspect matériel), comme centre du lien social. Dans la pensée marxiste, l’existence d’un lien de subordination entre le capital et le travail modifie radicalement la vision des fonctions du travail puisque de « libération », le travail devient alors « aliénation ».
Enfin, le 19e siècle est marqué par le courant social-démocrate allemand, qui, contrairement au marxisme, valorise le salariat qui apparaît comme le canal de distribution des richesses, un facteur d’intégration sociale, et le vecteur d’un ordre social juste. L’État se voit alors assigné le double rôle de garantir l’emploi et de donner la possibilité à tous de bénéficier des richesses produites.
Facteur de production, essence de l’Homme, opérateur de la distribution des revenus, droits et protections, support d’intégration sociale… ce détour historique nous permet de comprendre la superposition des significations dont le travail est l’objet. Chaque couche, s’ajoutant à la précédente, renforce la centralité du travail.
La centralité du travail dans la vie des individus (que nous détaillerons dans une seconde partie), et dans notre organisation collective se décline sur plusieurs plans : économique et matériel, comme moyen de production ; social, comme fondement de l’ordre qui assigne la place de chacun dans la société ; institutionnel, avec un système de protection sociale étroitement lié au travail et fondant en partie le pacte républicain ; politique enfin, notamment dans une vision marxiste des rapports de force qui structurent la société. Par ailleurs, le travail est encadré et organisé par des règles juridiques, réalisé et vécu par des travailleurs, animé de gestes techniques et de représentations qui les guident.
Toutes ces dimensions sont à prendre en compte pour appréhender le travail concrètement.
Ci-après, nous listons une série de définitions du travail dont la diversité résulte également des différents points de vue qu’on lui porte (aspect technique, subjectif, physiologique, etc.) et champs disciplinaires qui s’en saisissent (sociologie du travail / des organisations, ergonomie, psychologie, anthropologie, économie, etc.).
Ces définitions qui mettent en lumière la pluralité des dimensions du travail, traduisent également, chacun l’aura noté, différents prismes idéologiques.
Ainsi, le travail, si complexe et central dans notre société, est le produit d’une construction socio-historique singulière. Cependant, il n’est pas arrivé à un état de maturité, comme le résultat fixe de notre histoire. Il continue de se transformer sous l’impulsion des changements anthropologiques, sociaux, politiques, techniques, économiques, ou environnementaux.
Il nous parait essentiel de souligner ici la dimension politique du travail, entendue à la fois comme manière de s’organiser collectivement, et comme espace de lutte entre différents groupes sociaux et idéologies. En effet, l’organisation du travail que nous connaissons aujourd’hui résulte des luttes sociales qui ont marqué les 19e et 20e siècles autour notamment des questions du partage de la valeur ajoutée, des conditions de travail (temps de travail, santé, représentation syndicale…), des valeurs associées au travail (par exemple produire une richesse monétaire ou produire une utilité sociale ?) ou encore de la place de la frontière entre le travail et le hors travail (Cf. par exemple les luttes féministes à la fois pour la participation des femmes au marché du travail et pour la reconnaissance du travail domestique). On peut également citer la naissance de la sécurité sociale, au cœur de notre pacte social et de notre organisation collective, qui résulte (entre autres) de la conjonction d’un contexte socio-économique (pays dévasté à la sortie de la seconde guerre mondiale) et d’une configuration idéologique et politique (solidarisme, État-Providence).
Ce sont donc les transformations d’hier qui ont façonné le travail d’aujourd’hui. En ce début de 21e siècle, de nouvelles transformations sociétales, économiques, technologiques et environnementales se font jour donnant lieu à de nouvelles luttes politiques et sociales. La régulation de la concurrence au sein d’une économie mondialisée, la digitalisation de tous les processus économiques et sociaux, le défi climatique, ou encore l’inclusion des personnes ou des groupes sociaux fragiles ou stigmatisés sont quelques-uns de ces sujets en tension d’où sortiront les nouveaux visages du travail. Un travail qui ne semble pas près de perdre sa centralité dans notre vie collective, malgré l’affaiblissement de la valeur travail au sein des nouvelles générations qui nous est régulièrement annoncé depuis plusieurs décennies.
Petite histoire du salariat Forme d’emploi ultra majoritaire dans notre société, le salariat demeure un mode d’organisation assez récent. Retracer son histoire permet de mesurer l’ampleur des transformations qui ont mené à son émergence et son essor. En effet, il aura fallu pour assister à l’essor du « rapport salarial » que s’opère une masse considérable de transformations sociales, politiques et économiques sur le temps long : développement de l’échange marchand dans les villes médiévales, recours accru à la monnaie, montée en puissance de la bourgeoisie, moindre rentabilité de la production à domicile et développement des manufactures, division croissante des tâches, naissance du système de production capitaliste, reconnaissance des liens de subordination mais aussi des droits individuels et collectifs des travailleurs, création du contrat de travail par les socialistes, etc. (pinard ; 2000). Le salariat moderne apparaît avec la révolution industrielle en lien avec la séparation du travail et du capital, ainsi qu’avec la distinction entre le travail social (prodiguant des revenus) et le travail domestique (pour la satisfaction directe des besoins de la famille) et la possibilité que ce travail social soit l’objet d’un échange marchand (Marchand ; 1998).
|
Dans nos sociétés occidentales, le travail remplit pour l’homme différentes fonctions. Dans le langage de Maslow, on pourrait dire qu’il participe de la satisfaction de l’ensemble de nos besoins : primaires (se nourrir, se loger, se soigner…), secondaires (être intégré socialement et reconnu pour sa contribution), et supérieurs (se réaliser, éprouver son pouvoir d’agir sur le monde).
La contribution du travail à la satisfaction des besoins primaires ou matériels est au centre de l’approche néo-classique, qui inspire largement les modélisations économiques que mobilisent les politiques de l’emploi. Nous allons voir que cette perspective est utile, mais ne rend compte que d’une partie des fonctions du travail pour l’homme. L’apport de la sociologie est indispensable pour comprendre comment le travail participe de la construction de l’identité sociale et de la satisfaction des besoins secondaires. Et nous verrons que la psychologie du travail, quant à elle, éclaire le rôle du travail dans la réalisation de soi : dans et par l’activité de travail l’homme éprouve son pouvoir d’agir sur le monde, et/ou constate qu’il ne peut que s’adapter à son milieu pour vivre.
Les politiques de l’emploi sont largement inspirées de modélisations économiques, dont les fondements théoriques ont été posés par l’« école néo-classique ». Son père fondateur Léon Walras, propose une théorie du marché dont l’objectif est de montrer comment, lorsque la concurrence est pure et parfaite, l’offre et la demande exprimées permettent d’atteindre un « optimum social », c’est-à-dire une situation dans laquelle la satisfaction des uns ne peut être accrue sans dégrader celle des autres. Dans cette modélisation, le travail est appréhendé comme un facteur de production, au même titre que le capital. Il est une source de revenus pour les ménages, qui choisissent de vendre une quantité plus ou moins grande de temps de travail aux producteurs, en fonction de l’utilité qu’ils retirent de la consommation à laquelle le travail donne accès, et du temps de loisirs (ou de repos) dont il les prive.
Uniquement abordé pour la satisfaction des besoins matériels qu’il permet, le travail n’est ici jamais recherché pour lui-même, ce qui se traduit par le fait qu’il n’est pas représenté en tant que variable dans la fonction d’utilité guidant le comportement des ménages. Il en va ainsi parce que la théorie néoclassique a une acception purement matérielle des besoins de l’homme : c’est un peu comme si elle ne tenait compte que de ses besoins primaires. Comme on va le voir maintenant, le travail a pourtant aussi des fonctions sociales et psychologiques.
On trouve, du côté de la sociologie, une toute autre conception du travail. Pour cette approche, l’homme est un être social, et la solidarité joue un rôle essentiel dans la satisfaction de ses besoins vitaux. Il est « lié aux autres et à la société non seulement pour assurer sa protection face aux aléas de la vie, mais aussi pour satisfaire son besoin vital de reconnaissance, source de son identité et de son existence en tant qu'homme » (Paugam, 2018). Durkheim montre que, dans les sociétés modernes, caractérisées par une forte division du travail, l’intégration d’individus au système social passe par leur intégration – directe ou indirecte – au monde du travail. A la différence des sociétés “traditionnelles” (au sens de Durkheim), où la solidarité se nourrit de la proximité et de la ressemblance, qui permettent l’émergence de valeurs communes à l’échelle de la communauté (village), les sociétés modernes se caractérisent par une solidarité de type « organique » : chacun a une fonction précise dans la société, interdépendante de celle des autres, et cette fonction lui confère une utilité sociale.
Ainsi, la spécialisation, par la solidarité organique qu’elle organise, fait du travail un vecteur privilégié d’intégration sociale. Mais, dans la division du travail, toutes les places ne se valent pas.
Paugam montre que la qualité de l’intégration sociale que permet le travail fait en priorité intervenir deux facteurs : la stabilité de l’emploi et la qualité du travail. L’intégration est « assurée » lorsque les deux critères sont réunis. Elle est « disqualifiante » lorsque l’individu ne peut se prévaloir ni d’un emploi stable ni d’un travail satisfaisant. Entre ces configurations extrêmes figurent des intermédiaires (intégration « laborieuse » et « incertaine »).
Dans une toute autre perspective, Hugues (1962/1996) montre que le prestige dont jouissent (ou non) les professions est largement décorrélé de leur utilité sociale. Certains métiers, qui prennent pourtant en charge des tâches vitales pour la société, sont socialement considérés comme du “sale boulot”, et font l’objet de jugements péjoratifs. Ces métiers ou fonctions sont jugés comme « salissants » d’un point de physique (travail au contact des déchets, des humeurs corporelles…) ou moral (surveillant de prison...). Ils ont pour caractéristique de nous confronter à « la précarité des êtres et des choses, à l’emprise d’une corporéité que nous nous évertuons à gommer » (Lhuilier, 2005, p.89) et/ou de solliciter nos pulsions agressives et le risque d'abuser de notre pouvoir sur autrui. Pour ne pas « se salir les mains » et préserver notre propre estime de nous, nous cherchons à déléguer ces tâches à d’autres tout en marquant une distance morale avec eux. Ce processus de séparation / distanciation répond à un besoin psychologique : « extirper le mauvais de nous ».
En abordant le travail sous l’angle de la satisfaction des besoins secondaires, la sociologie montre ainsi que les aspirations qui poussent l’homme à travailler débordent la question des besoins matériels. Le travail est également recherché pour lui-même, ou plus exactement pour la place qu’il permet d’occuper au sein de la matrice sociale. Mais, de ce point de vue, toutes les positions dans la division du travail ne se valent pas. Si le travail est à la fois source d’aliénation et d’émancipation, le curseur ne se place pas au même endroit selon que l’on exerce un métier prestigieux/ un « sale boulot », un emploi stable / précaire, un travail de qualité/ peu satisfaisant…
Pour la psychologie du travail, le travail contribue à la réalisation de soi, au-delà de la reconnaissance matérielle et de la reconnaissance sociale à laquelle il peut donner accès. Si nous nous accomplissons dans notre travail, c’est parce que sa valeur est reconnue par autrui, mais c’est aussi et peut-être d’abord parce qu’au travers de cette activité socialement utile nous nous y découvrons un pouvoir d’agir sur et dans le monde (Clot, 1999, 2008). Or, c’est en éprouvant son pouvoir d’agir sur le monde que l’homme se sent humain, vivant. La passivité, la résignation, le renoncement, tirent au contraire du côté de la pathologie, de la maladie.
Cette conception repose sur l’idée que la conscience se développe en « se frottant » au réel : un réel qui est à la fois matériel (monde des choses), social et culturel (monde des autres hommes). Privée de cette confrontation par et dans l’activité, la conscience s’étiole, les cercles psychiques se referment sur eux-mêmes. En ce sens, le fait que le travail s’impose à nous comme une obligation peut être vu comme un atout : devoir « gagner notre pain » pour vivre, nous oblige à « sortir de nous-mêmes » pour nous aventurer dans le monde des choses et des autres hommes. Dans cette « rencontre obligée », nous faisons l’expérience de ce dont nous sommes capables en situation.
Si l’activité de travail a une telle fonction psychologique, c’est parce qu’elle nécessite toujours un engagement subjectif. Même dans les métiers les moins qualifiés, les plus répétitifs, le travail ne se réduit jamais à l’application des procédures, des consignes, du prescrit. Le travail engage toujours une part d’intelligence pratique. « Le geste n’est jamais machinal », écrit Wisner (1995), « et c’est précisément pour cela que les objectifs de production peuvent être tenus ». Contrairement à l’illusion taylorienne, l’organisation du travail n'est pas seulement une affaire d’ingénieurs : les tâches sont constamment réorganisées en situation par ceux qui travaillent. Au travail, l’homme « y met de lui-même », et c’est précisément pour cette raison qu’il peut en sortir grandi.
Mais l’homme ne sort pas toujours victorieux de la confrontation à la résistance du réel qu’organise le travail. Il peut aussi en sortir meurtri, si ses efforts sont systématiquement voués à l’échec, et le font basculer du côté de la passivité, du renoncement, de la résignation. Or si l’épreuve (heureuse ou malheureuse) du travail se vit toujours individuellement, elle n’est pas une épreuve solitaire : le travail est une activité collective, dans laquelle les règles prescrites élaborées par la hiérarchie, les façons de dire et de faire mises au point par le collectif de travail et transmises par l’histoire du métier sont autant de points d’appui. Lorsque le réel est apprivoisé collectivement, il est possible d’éprouver au moins de temps en temps la fierté du travail bien fait, même si l’on fait un « sale boulot », que l’on occupe un emploi précaire… Mais sans collectif de travail, sans règles de métier, sans prescriptions sur lesquelles s’appuyer, que l’on soit éboueur ou médecin on ne peut qu’« errer seul devant l’étendue des bêtises possibles », et éprouver son impuissance face au réel.
La psychologie du travail montre ainsi que le travail a une fonction psychologique qui déborde les besoins matériels et de reconnaissance sociale. Le travail est l’un des leviers privilégiés par lesquels l’homme met ses désirs à l’épreuve du réel. Lorsque le social est à la fois contrainte et ressource, il peut être une occasion de sublimation.
Que ce soit au niveau individuel ou collectif, le travail dans notre société est donc caractérisé par sa centralité. Central dans la vie collective, il s’appuie sur de nombreuses représentations, divergentes voire antagonistes, qui s’affrontent pour influer sur son organisation. Central dans la vie personnelle, il représente pour l’individu un moyen de subvenir à ses besoins primaires, secondaires et supérieurs. Cependant, nous n’avons cessé d’insister sur la dimension fluctuante du travail, invitant à ne pas le considérer comme un élément figé de notre société. D’ailleurs, pour certains auteurs, nous serions depuis une vingtaine d’années dans un contexte de transformations mondiales comparables à la révolution industrielle (Pinard ; 2000). Dans cette perspective, le travail est susceptible de connaître des bouleversements, et son sens d’être une nouvelle fois réévalué (Pinard ; 2000).
Chamoux, M-N. (1994). « Sociétés avec et sans concept de travail ». Sociologie du travail, 36ᵉ année, hors-série, Les énigmes du travail. pp. 57-71;
Clot, Y. (1999). La fonction psychologique du travail, PUF.
Clot, Y. (2008). Travail et pouvoir d’agir, PUF.
Dejours, C. et Molinier, P. (1994). “Le travail comme énigme”. Sociologie du travail, 36ᵉ année, hors-série. Les énigmes du travail. pp. 35-44.
Fouquet, A. (1995). “Travail, emploi, activité : que partager ?”. Autres Temps. Cahiers d'éthique sociale et politique. N°4. pp. 17-24.
Friedmann, G. (1960). « Qu'est-ce que le travail ? » Annales. Economies, sociétés, civilisations. 15ᵉ année, N. 4. pp. 684-701
Gollain, F. (2001). « Penser le travail dans son historicité. Quelques réponses à Yolande Benarrosh », Revue du MAUSS, 2001/2 (no 18), p. 176-195.
Hugues, E. C. (1962/1996). Le regard sociologique : essais choisis. Editions EHESS.
Lallement, M. (2007), Le travail : une sociologie contemporaine, Gallimard.
Lhuilier, D. (2005). Le « Sale boulot », Travailler, n° 14, Vol 2.
Marchand, O. (1998). Salariat et non-salariat dans une perspective historique. Economie et statistique, n°319-320, Décembre 1998. pp. 3-11.
Méda, D. (2018). « Chapitre premier. L’avènement du travail », dans : Dominique Méda éd., Le travail. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », p. 7-42.
Paugam S. (2000). Le salarié de la précarité, PUF.
Paugam S. (2009). Le lien social, Que sais-je ?, PUF.
Pinard, R. (2000). La révolution du travail : De l'artisan au manager. Presses universitaires de Rennes.
Trentin B. (1997/2012). La Cité du travail: la gauche et la crise du fordisme, Fayard.
Wisner A. (1995). Réflexions sur l’ergonomie, Editions Octarès.

Étude
Et si le turn-over et l’attractivité en berne des métiers du prendre soin était lié à des transformations organisationnelles et managériales ?

Étude
Comment le care peut renouveler notre rapport à l’autre, à la société, à la nature et aux objets ?

Article
Les juristes nous interpellent sur le floutage des frontières entre travail et divertissement.
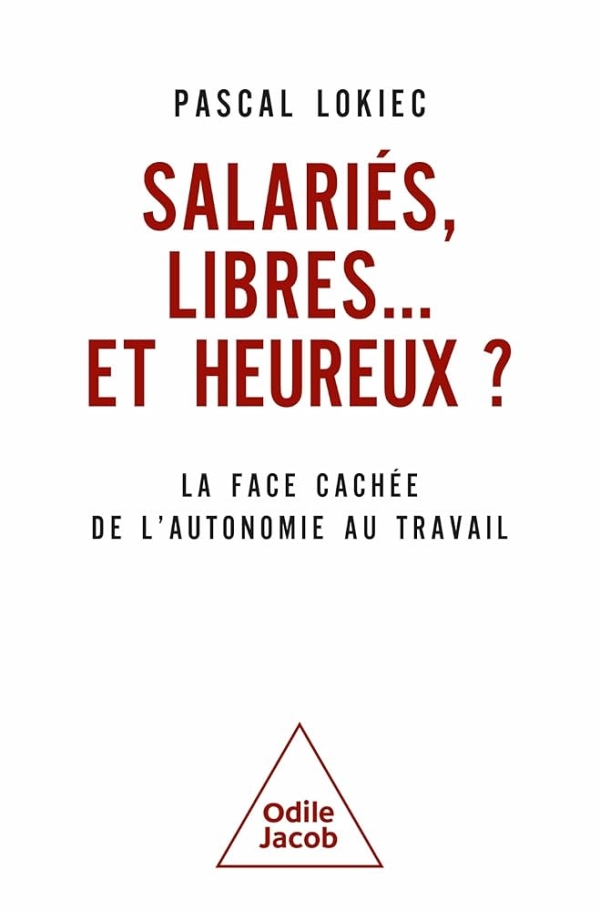
Article
Pascal Lokiec pose les termes d’un débat susceptible de concilier les intérêts de l’entreprise et le pouvoir d’agir des salariés.
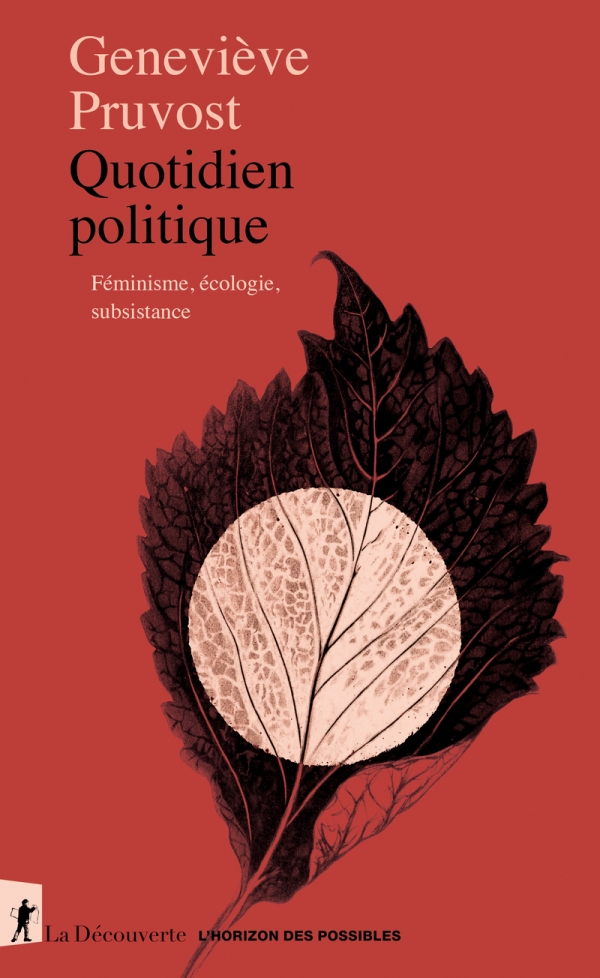
Article
Comment les acteurs publics peuvent-ils accompagner ces profondes transformations du rapport au travail ?

Article
Au-delà de nos activités rémunérées, la situation ne peut-elle pas nous amener à envisager différemment un temps présenté comme « libre » ?
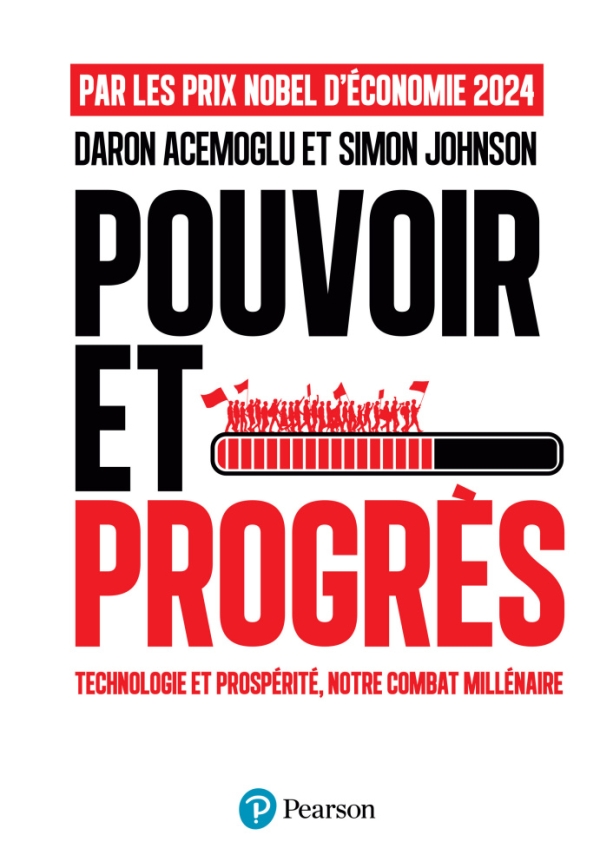
Article
Si l’IA peut automatiser des tâches répétitives et libérer du temps pour des activités plus créatives, elle menace également de nombreux emplois.

Article
Le défi de la transition économique est immense, complexe, car il implique des transformations des activités et des modèles.

Interview de Vincent Dubois
Professeur à l’Université de Strasbourg et membre du laboratoire SAGE
Retour sur le renforcement du contrôle et de la sanction des assistés sociaux depuis les années 1990, jusqu'à la mise en place d’une politique organisée du contrôle.