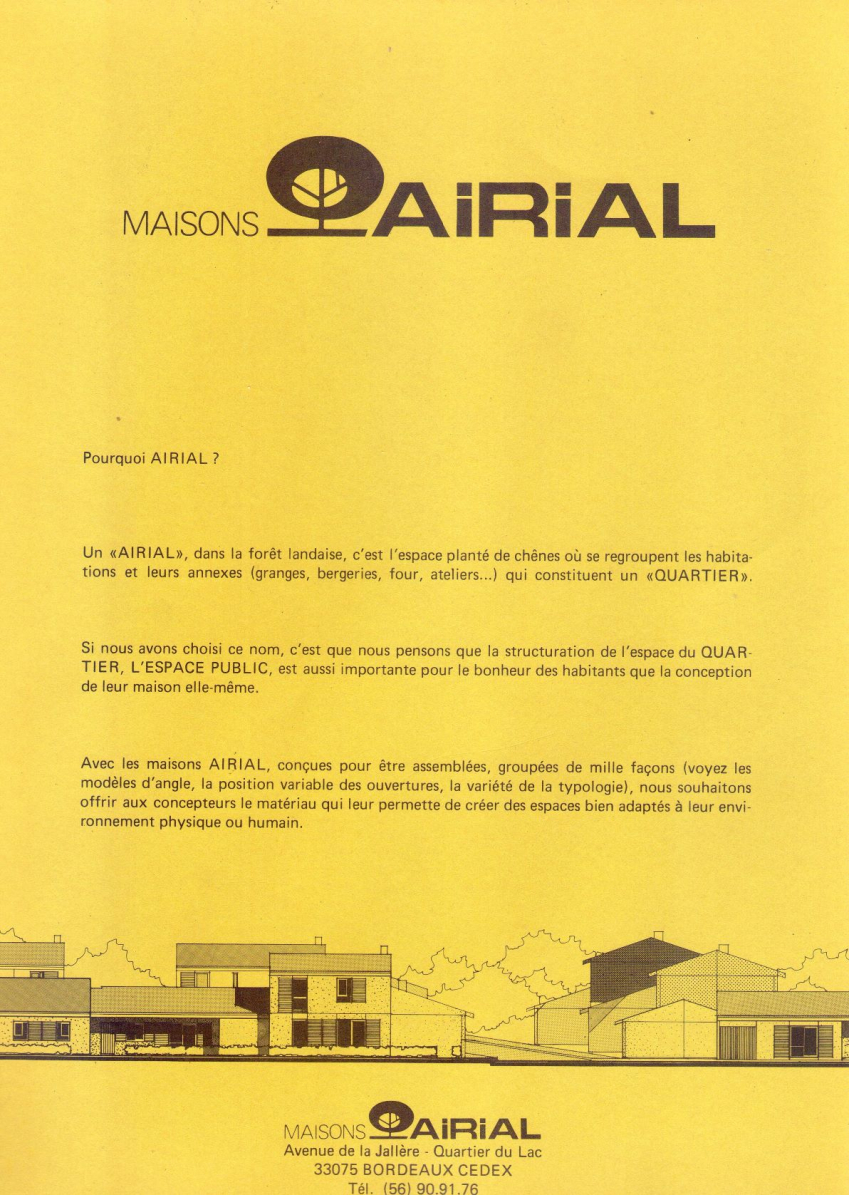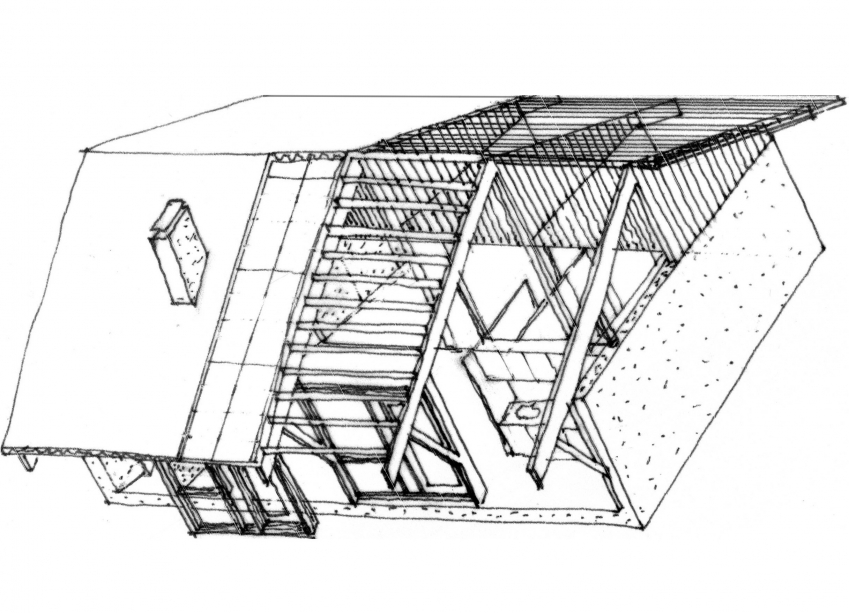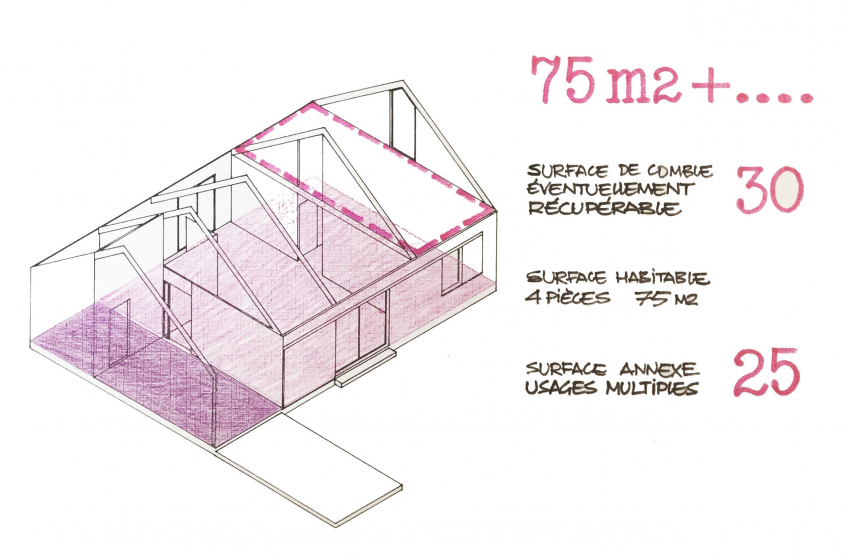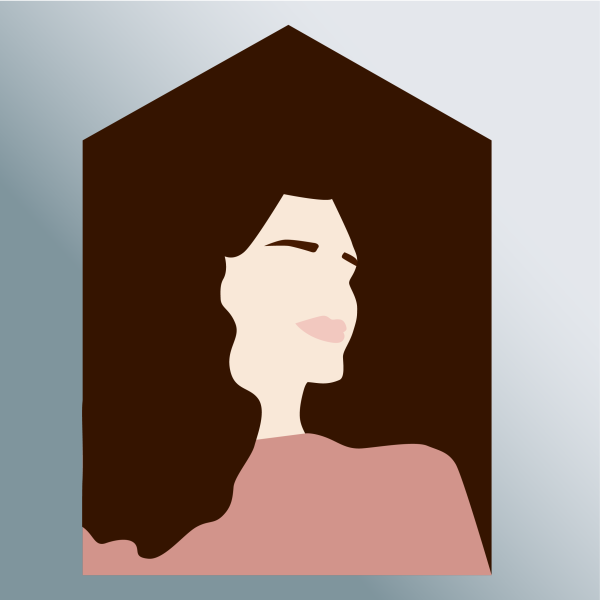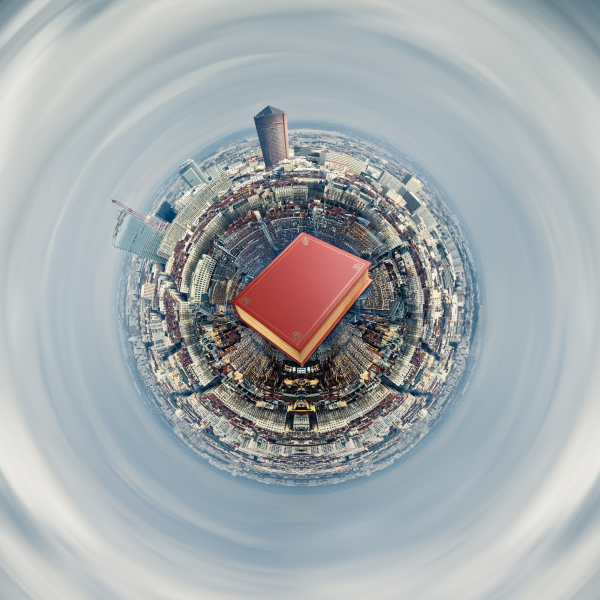Non, je pense que cela a changé maintenant, parce qu’il y a quand même beaucoup d’architectes qui rénovent des échoppes à Bordeaux. Donc ils ne peuvent pas avoir des grands discours sur la maison, et avoir cette production en parallèle. Mais il y a toujours ce discours sur : la maison induit la voiture. En ce qui nous concerne, à l’agence Salier-Courtois-Lajus, on était vus comme des gentils amateurs qui faisaient quelques jolies villas, alors qu’on faisait trois-cents logements tous les lundis matin, donc quand même des choses sérieuses ! Je pense que cela a un peu changé parce que la commande s’est réduite. La maison individuelle ne peut plus être au milieu d’un grand jardin, à trois-quarts d’heure du centre-ville, ou plus. Ce modèle n’est pas jouable. L’échoppe, en revanche, c’était vraiment un système intéressant à Bordeaux, parce que c’est dense.
Avec mes parents on habitait une échoppe de huit mètres sur huit, à étage, avec un jardin de huit mètres sur huit, c’était parfait. Ce n’était pas un quartier pavillonnaire de banlieue, c’était central. C’est à travers des choses comme ça, je pense, qu’on pourrait revenir à la maison. Il faut faire de la ville-ville, avec les maisons, pas uniquement de la banlieue, pas de la ville américaine. À Bordeaux il y a une vraie réflexion en cours sur l’échoppe, sur la maison de ville dense, qui peut être exemplaire : maison + jardin + densité. Et il existe des tas de propositions équivalentes dans toutes les villes, avec les maisons mitoyennes, etc. Reste le problème de la voiture qu’il faut régler, qui est en train de se régler par le transport en commun. Personnellement, je prends le tram pour aller à Bordeaux, je ne prends pas la voiture. Les gens commencent à s’y faire, alors qu’ils étaient tous contre au départ.