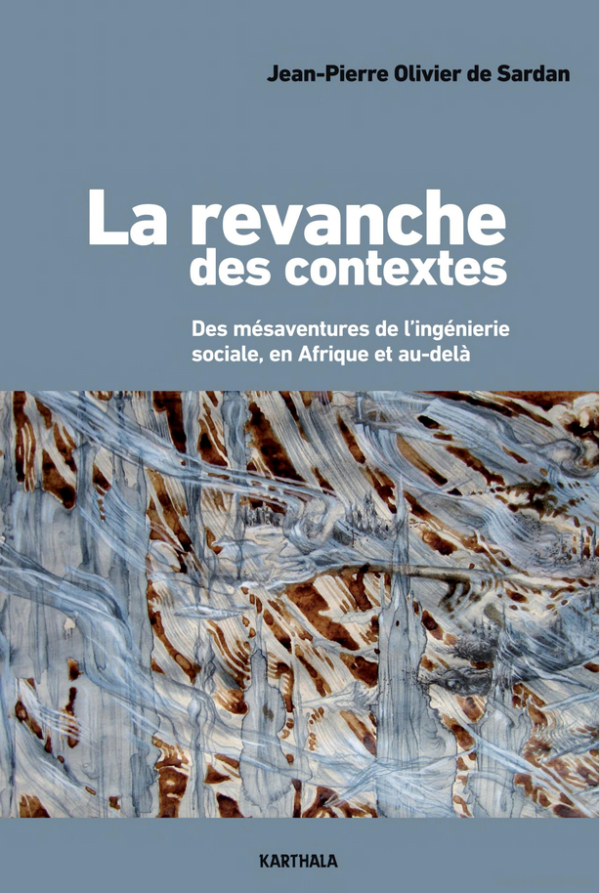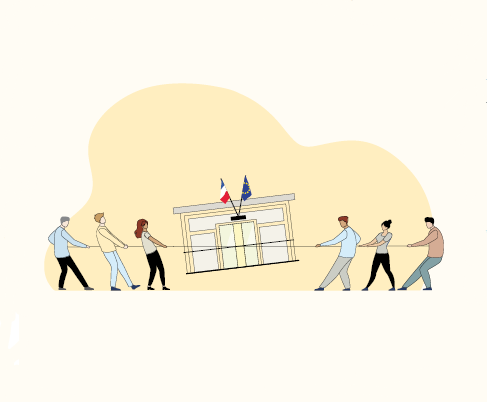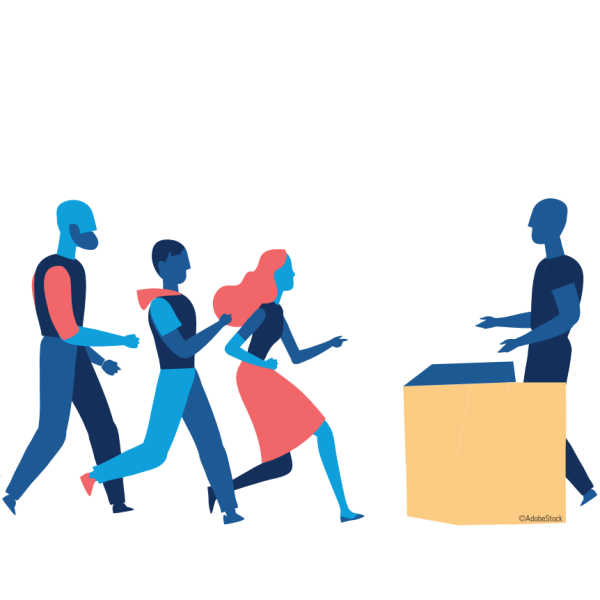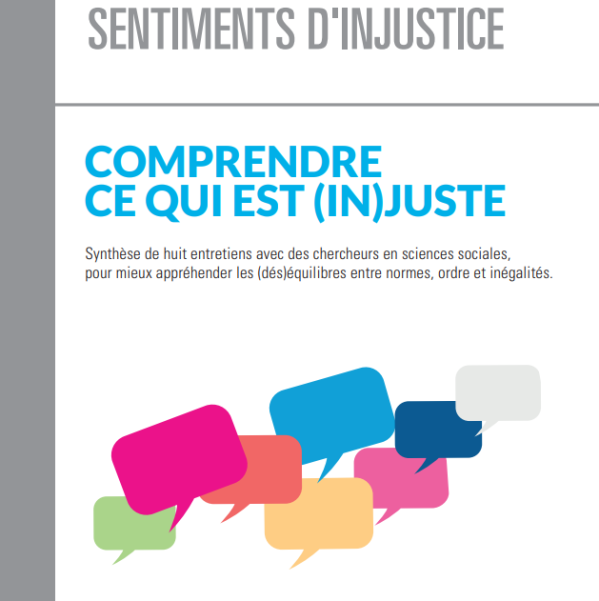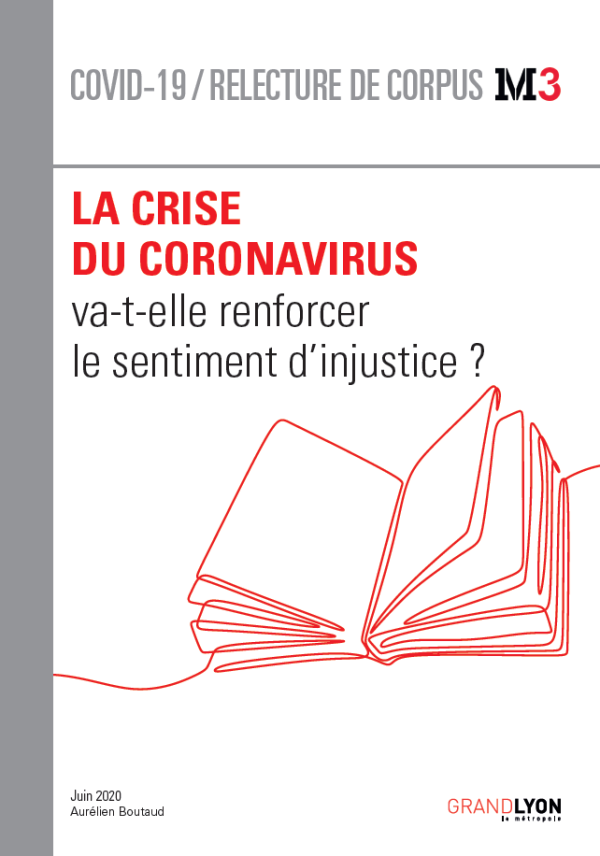Effectivement, la question de la théorie de la justice sociale est une question très vaste qui a été traitée par de nombreux penseurs depuis l’Antiquité. Elle décrit un principe d’équilibre entre différentes valeurs, comme l’égalité, la liberté, etc., dont on va essayer de s’accorder sur le fait qu’elles sont universelles ou au contraire contextualisées, la façon dont elles s’accordent ou non, laquelle prioriser, etc. Aujourd'hui encore, la question de la justice sociale est insondable : elle n’a pas de réponse simple et ne renvoie pas immédiatement à des objets sociaux identifiés. C’est une réflexion qui reste très théorique, qui s’en tient aux principes.
C’est donc un concept peu opératoire et un peu fourre-tout. Ainsi, au niveau des acteurs, rares sont ceux qui sont hostiles à la justice sociale mais personne n’y met la même chose. C’est pourquoi il est sans doute préférable de référer au sentiment d’injustice, qui se rapporte à une émotion vécue en réaction à des formes d’oppression. Pour autant, cela ne règle pas tout. Parce que si l’on peut assez facilement décrire ce qu’il y a sous les sentiments d’injustice, ceux-ci sont extrêmement divers, ce qui rend là encore la question complexe. Par exemple, les enquêtes sur les sentiments d’injustice au travail montrent que les sentiments d'injustice des uns ne correspondent pas nécessairement à ceux des autres et qu’ils ne peuvent donc pas trouver de solutions communes.
Mais on voit bien le rapport de l’un à l’autre : la notion de justice sociale est difficile à appréhender mais propose des normes d’équilibre entre les valeurs quand la notion de sentiment d’injustice s’appréhende bien à travers les émotions vécues mais ne donne pas de solutions collectivement partagées sur les réponses qu’il convient d’y apporter. Si je reprends l’exemple du monde du travail, on voit des syndicalistes parfois confrontés à des situations où ils doivent défendre des salariés qui expriment des sentiments d’injustice mais qui sont considérés comme « des canards boiteux » parce qu’ils ne travaillent pas bien, qu’ils sont défaillants, etc. Comment faire ici ? Quels principes prioriser ? Les défendre parce qu’ils ont les mêmes droits que tout le monde où moins les défendre parce qu’ils ne remplissent pas complétement leurs devoirs ? Ce sont des situations classiques, très concrètes, qui mettent en tension les principes d’égalité, de justice – ici justice salariale –, etc., avec le sentiment d’injustice vécue. Il y a donc une forme d’aporie.