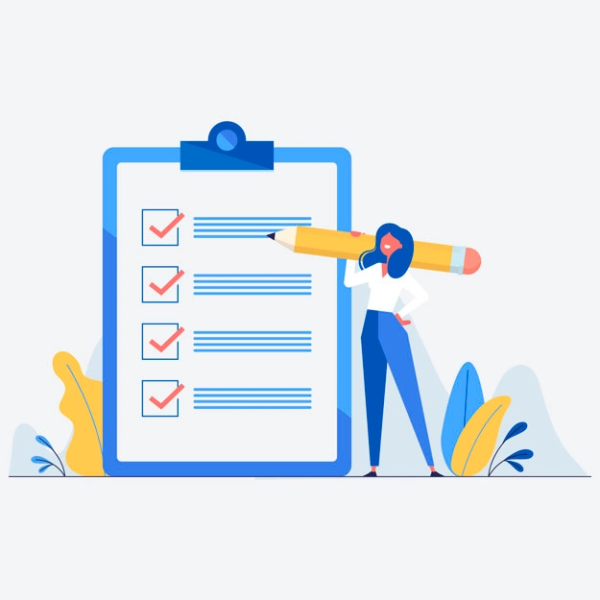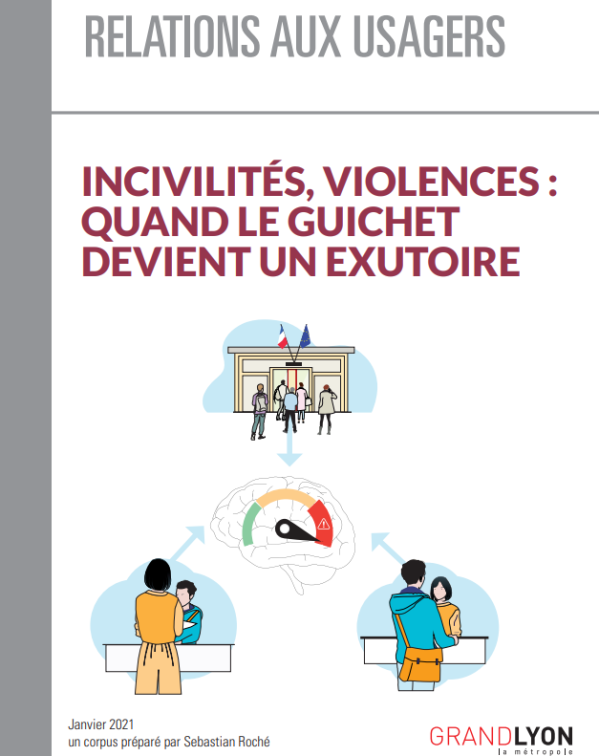Téléchargez ICI le PDF de l’ensemble des textes de ce dossier, et retrouvez ICI notre sommaire en ligne.
Il n’existe pas de société sans violence, et celle-ci est changeante. Elle se transforme concrètement, dans ses formes, dans ce qu’elle met en jeu, dans ce qu’elle exprime. Elle évolue aussi dans les représentations et les perceptions qu’elle suscite : chaque individu, chaque groupe, peut porter sur elle un point de vue qui lui est propre, et susceptible de varier dans le temps. La place même qu’elle occupe dans une société, l’importance qui lui est attachée peuvent connaître d’importantes variations, être ou non centrales dans le débat public.
La violence est ainsi à la fois objective et subjective, ce qui rend difficile toute définition quelque peu péremptoire. On peut en chiffrer certaines des modalités, le nombre de meurtres, de viols par exemple, ce qui va dans le sens d’une approche à prétention universelle car apparemment factuelle. Mais il suffit de demander qui définit ces modalités, les choisit, les reconnaît comme pertinentes, et comment sont produites les statistiques pour entrer dans l’espace du doute et de la critique.
Pour prendre la mesure de ce que nous appelons la violence, le plus simple est peut-être d’adopter une démarche d’abord historique. Nous nous limiterons ici au demi-siècle qui vient de s’écouler, à notre seul pays, et à la violence politique ou sociale.
Le déclin
À la fin des années 60, et jusqu’au milieu des années 70, la violence politique ou sociale en France était loin d’être un tabou. Non seulement les orientations révolutionnaires ou nationalistes de certains mouvements, éventuellement conjuguées sous des formes violentes, la guérilla et parfois même le terrorisme exerçaient un certain attrait, quand il s’agissait d’acteurs extérieurs à notre pays, mais la violence en elle-même pouvait trouver sa légitimation chez de grands penseurs et intellectuels. Les idées marxistes, anarchistes bénéficiaient d’une réelle influence, les luttes de décolonisation, l’expérience de la Chine de Mao ou du Cuba de Castro constituaient d’importantes références. Le « Che » entamait sa fulgurante et exceptionnelle carrière d’icône christique.
Même si les références idéologiques étaient souvent internationales, le cadre du soutien ou de la légitimité était pour l‘essentiel donné par l’État-nation : les projets de violence politique étaient généralement tendus vers la prise du pouvoir d’État.
Jean-Paul Sartre, déjà auteur en 1961 d’une préface sulfureuse au dernier livre de Franz Fanon, Les damnés de la Terre (éd. Maspero), invitait les « maoïstes » français du début des années 70 à se révolter sans exclure la violence. En 1977 encore, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, et à nouveau Jean-Paul Sartre, s’opposaient à l’extradition de Klaus Croissant, un avocat allemand compromis dans le terrorisme de la Fraction Armée Rouge, et en 1979, Foucault prenait parti pour la Révolution iranienne. En fait, une certaine légitimité de la violence vivait alors ses derniers feux.
Déjà, au lendemain de l‘attentat terroriste lors des Jeux olympiques de Munich (1972), quand un commando palestinien avait assassiné des athlètes israéliens, et dans le contexte de la lutte des « LIP », ces ouvriers de l’industrie horlogère menant un combat ouvrier non violent qui connut un immense retentissement, les « maoïstes» avaient fait le choix de rompre avec la tentation de la lutte armée, comme l’a expliqué leur leader Alain Geismar, dans L’engrenage terroriste (Fayard, 1981). En fait, le rejet de la violence politique et sociale se généralisait, en même temps que s’étiolaient les idéologies révolutionnaires, tiers-mondistes, marxistes. Les « nouveaux philosophes » de la fin des années 70 sont venus marquer ce tournant, en prenant une distance maximale avec le communisme et le marxisme et donc avec les régimes et les pensées non démocratiques que la plupart d’entre eux avaient encensés jusqu’à peu. Par la suite, divers acteurs, anarchisants ou anticapitalistes notamment, parlant de L’insurrection qui vient selon le titre d’un livre signé d’un « Comité invisible » (éd. La Fabrique, 2007) ou liés à une cause culturelle, végans par exemple, ont promu une certaine violence, parfois l’ont mise en œuvre, mais il a fallu attendre le mouvement des Gilets jaunes pour que ce soit avec une réelle compréhension dans l’opinion.
Au début des années 80, un cycle nouveau de violence sociale s’est ouvert avec la question dite des « banlieues ». Dans un contexte où le Front National, de groupuscule, devenait un véritable parti, et où naissaient, a dit Gilles Képel, Les banlieues de l’islam (Seuil, 1987), d’une part le racisme pouvait revêtir un tour meurtrier, suscitant en réplique, notamment, la
« Marche pour l’égalité, contre le racisme » de 1983, et d’autre part, une partie de la jeunesse issue de l’immigration oscillait ici et là entre divers types d’engagement, petite délinquance et violence émeutière – La Galère (Fayard, 1987) si bien analysée par François Dubet.
En même temps, le débat faisait rage, au sujet non pas tant de la violence que de l’insécurité. Celle-ci était-elle grandissante, comme l’affirmait la droite, ne fallait-il pas la distinguer du sentiment d’insécurité, sans lien démontré avec l’insécurité elle-même, comme le disait la gauche ? Le débat a été tranché, en fait, lorsque des chercheurs, à commencer par Sebastian Roché dans Le sentiment d’insécurité (PUF, 1993), ont introduit le thème des incivilités, ces innombrables actes qui façonnent l’inquiétude et l’exaspération de la population : impolitesse, crachats, insultes, menaces verbales par exemple. Le sentiment d’insécurité se nourrit en effet non seulement du terrorisme ou du crime, mais aussi de ces conduites qui n’apparaissent pas dans les statistiques de la police ou de la justice.
En même temps, la crise du modèle français d’intégration affectait l’École de la République, y compris sous la forme de violences scolaires, dont les travaux d’Éric Debarbieux, dans les années 90 (par exemple La violence dans la classe, ESF, 1990), montreront les liens étroits avec l’insécurité, les incivilités et la crise des « banlieues ».
Même si à gauche l’analyse mettait l’accent sur les sources sociales de ces violences, elles n’étaient pratiquement nulle part acceptées, justifiées et encore moins encouragées. La violence devenait un tabou, dans ses modalités politiques comme dans ses expressions sociales.
Le rejet
À partir des années 80, cette évolution s’est accentuée, et les modalités de la violence ont été vécues presque unanimement comme répulsives.
Un premier point, majeur, tient à l’essor de la religion au cœur de la violence politique. La révolution iranienne (1979), le soulèvement islamique en Algérie, durant près de dix ans (1991-2001), le terrorisme d’Al Qaeda puis de Daech n’ont guère bénéficié en France de soutiens intellectuels ou dans l’opinion, sinon très minoritaires, et en diminution après les attentats de 2015.
Les analyses les plus approfondies de la poussée de l’islam radical et du djihadisme, comme celles de Farhad Khosrokhavar (Radicalisation, éd. MSH, 2014) montrent que ces violences témoignent d’une mutation qui ne veut pas dire nécessairement que le rejet dont elles peuvent être l‘objet soit acté pour toujours, ni pour tous. Elles reposent, bien plus qu’auparavant, ou en tous cas visiblement, sur la subjectivité individuelle de ceux qui les perpétuent, et qui vont, ce qui est nouveau, jusqu’au martyrisme : les acteurs donnent leur vie, pour leur cause, mais aussi parce que la foi leur apporte les ressources morales et psychiques du passage à trépas.
À nouveau, la violence légitime ?
Mais à contre-courant de ces tendances, s’ébauche une certaine légitimité de la violence sociale ou politique tandis que symétriquement l’État perd une partie de son monopole légitime à user de la force.
Un premier pas dans ce sens s’est observé en 2005, suite au décès de deux adolescents issus de l’immigration. Pourchassés par la police, sans avoir commis de délit, ils s’étaient réfugiés dans un local électrique, où ils avaient été électrocutés. Durant trois semaines, la colère et l’indignation ont nourri des émeutes aboutissant à d’importants dégâts matériels. Ces violences expressives, et non instrumentales, ont généré une réelle compréhension dans de larges secteurs de l’opinion.
Un deuxième pas a été franchi quand, au lendemain de l’attentat du 7 janvier 2015 (12 personnes assassinées dans les locaux de Charlie Hebdo), des élèves ont refusé de participer à la minute de silence demandée dans les écoles de la République : pourquoi, laissaient-ils comprendre, les journalistes de Charlie Hebdo seraient-il impunis quand ils blasphèment, alors que pour les Juifs, ce serait deux poids deux mesures, et que par exemple Dieudonné, est lourdement sanctionné pour son humour sur les chambres à gaz ? La légitimité de la barbarie terroriste trouve ici un espace, modeste, mais réel.
Le Printemps arabe avait suscité de vives sympathies au sein des opinions démocratiques aussi longtemps qu’il était au plus loin de toute violence, son inversion vers des idéologies voire des pratiques violentes, principalement sous l’effet de la répression, les lui a aliénées. Par contre, et à une vaste échelle, la violence a trouvé une légitimité accrue avec le mouvement des Gilets jaunes, ce qui n’était pas le cas avec la tentation de la violence que l’on observe dans certains mouvements plus ou moins libertaires, anticapitalistes, ou défendant une cause précise, vegan par exemple.
Ce mouvement n’était pas violent en lui-même. Mais ses manifestations ont été ponctuées de violences avec lesquelles il a entretenu une relation complexe. Qu’il s’agisse d’activistes de l’ultra-droite, et, plus nombreux, de l’ultra-gauche –Black Blocs–, de Gilets jaunes voulant en découdre ou devenant enragés sur place, du fait de la répression, sans parler de quelques pilleurs, les Gilets jaunes ont bénéficié d’une médiatisation et d’un impact qui n’auraient jamais atteint un tel niveau sans la violence. L’idée s’est imposée : la violence paie – et peut-être même seule la violence peut payer. Certes, les annonces économiques d’urgence annoncées par le président Macron, et donc les résultats tangibles obtenus par le mouvement datent de décembre 2018, alors que la violence a occupé le devant de la scène durant de longues semaines ensuite. Mais jamais l’opinion et les médias n’auraient continué à s’intéresser comme ils l’ont fait aux Gilets jaunes sans les violences qui ont ponctué durablement leur mobilisation.
Symétriquement, la répression policière, perçue alors puis dans d’autres circonstances comme excessive, a suscité de vives critiques, mettant en cause ses méthodes et outils, et du coup, le monopole légitime de l‘usage de la force qu’elles incarnent a été écorné. Ainsi, la violence d’en bas retrouve une certaine légitimité pendant que celle de l’État s’affaiblit.
En même temps, paradoxalement, la violence est critiquée sur bien d’autres registres, puisque ce qui la lie à l’islam radical la disqualifie, sauf on l‘a vu dans quelques secteurs, que les violences faites aux femmes et aux enfants sont combattues, et que des campagnes fort actives dénoncent des violences policières éventuellement associées à du racisme.
Il faut donc admettre le caractère ambivalent, ou contradictoire, de la situation présente : nous sommes aujourd’hui écartelés entre deux logiques allant en sens opposé, l‘une qui revalorise la violence sociale et politique, l’autre qui en fait un tabou. Ces deux logiques ne peuvent être mises sur le même plan. La seconde, en effet, traduit un puissant mouvement de la société, qui exige des droits et des protections notamment pour les plus faibles, et qui met en avant des revendications n’ayant pas besoin de violence pour se faire entendre. La première, par contre, trouve sa source, vraisemblablement principale, non pas tant dans le sens que les acteurs veulent promouvoir, non pas tant dans leurs attentes en elles-mêmes, que dans la crise de légitimité qui affecte le pouvoir, en France comme dans d’autres pays. Quand la méfiance à son encontre est considérable, qu’il ne traite pas, ou mal, des demandes qui montent de la société, que la représentation politique est défaillante, que la répression, avec des excès, devient sa principale réponse et que les oppositions significatives sont aux extrêmes de l’arc politique, vite populistes et nationalistes, quand l’insécurité devient une préoccupation lancinante, alors l’espace de la violence d’en-bas s’élargit, et avec elle une certaine compréhension, une légitimité.
La violence qui regagne ainsi en légitimité n’est pas celle de groupes armés, elle n’est pas tournée vers la prise du pouvoir d’État ; elle n’a pas ses intellectuels organiques, qui en feraient l’apologie. Elle est plus l’expression d’une rage ou d’une colère, parfois aussi d’une haine qui témoignent des carences de la démocratie et de l’impéritie de ceux qui la pilotent. Pour l’instant, l’extension de la violence, son organisation et sa prise en charge idéologique par des acteurs pour la promouvoir, vers la guerre civile, la révolution, ou le chaos ne sont pas l’horizon le plus vraisemblable. Elles ne sont pourtant pas non plus à exclure complètement.
→ La violence est liée aux conflits sociaux qui traversent une société. L’acceptabilité de la violence est liée à une sensibilité sociale à son endroit qui évolue. → Depuis le déclin des grands courants révolutionnaires, son degré d’acceptation a diminué. → Cependant, ces dernières années, certains groupes ou mouvements sociaux tentent de la légitimer. |