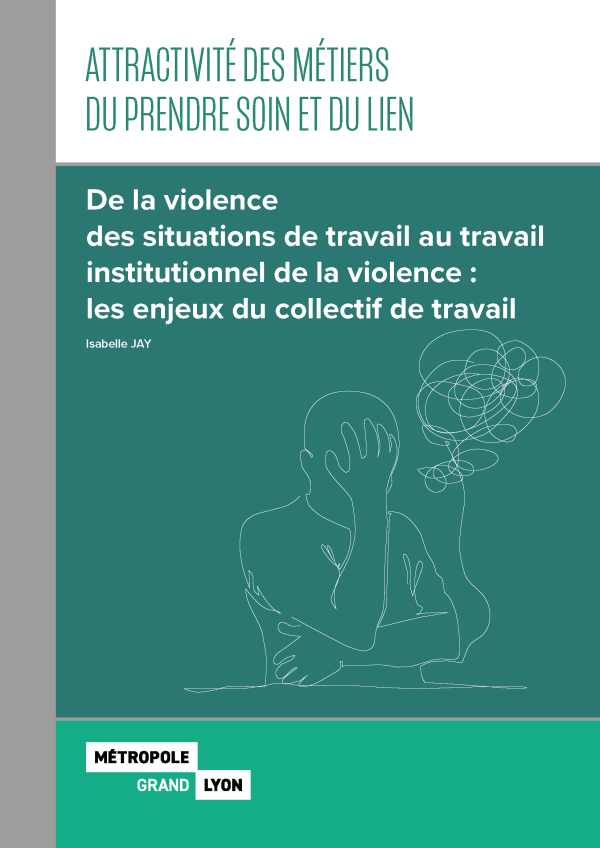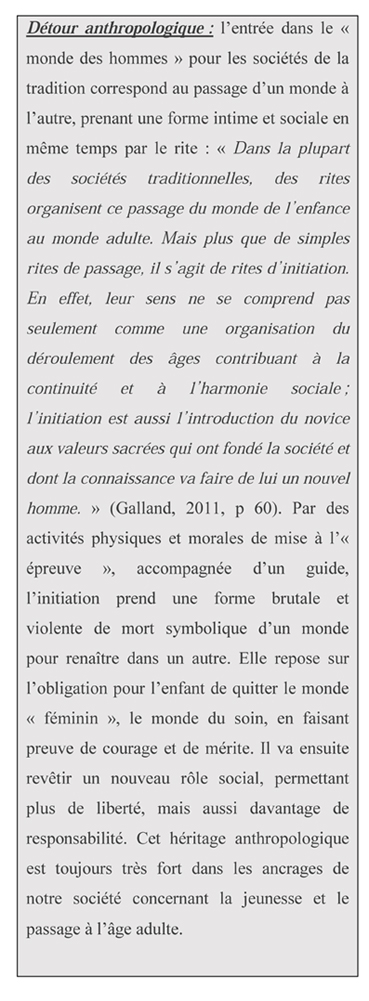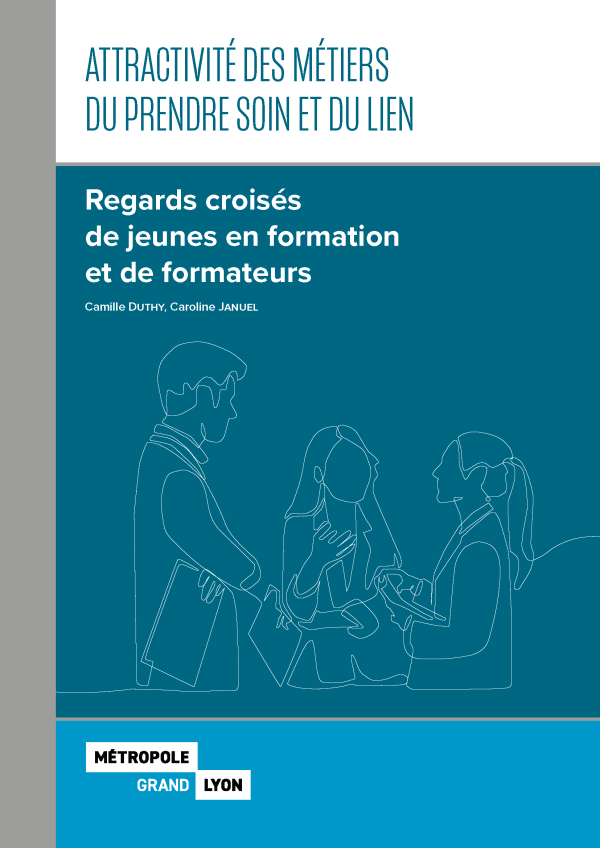« 23% des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne représentent que 2 à 3% de la population générale. Ce chiffre atteint 35 % chez les 18-24 ans. Sans soutien de la collectivité, ces jeunes les plus fragiles se voient contraints de faire appel au numéro d’urgence 115 ou aux dispositifs d’hébergement d’urgence, qui ne sont pas toujours adaptés à leur situation. » [2]. Des médias et des associations de lutte contre le sans-abrisme, reprennent ces chiffres et exposent les récits de personnes qui ont grandi dans les services d’aide sociale à l’enfance (ASE), expliquant des « sorties sèches » au moment de leur majorité et qui se sont ensuite retrouvées à la rue sans solution.
Comment expliquer ce phénomène ?
En France, l’âge médian du départ du domicile parental se situe autour de 23 ans, et de manière générale, les jeunes dépendent financièrement de leurs parents jusqu’à 25 ans (Robin, 2014). L’évolution sociale des trente dernières années a notamment fragilisé les conditions d’accès à l’emploi, rendant la jeunesse plus dépendante des ressources familiales. Pourtant, pour les jeunes pris en charge par les services de l’ASE, avoir 18 ans signifie devoir quitter prématurément son lieu de vie et accéder rapidement à l’emploi. À la majorité, l’obligation légale de prise en charge par l’ASE s’arrête, la loi n° 2016-297 relative à la protection de l’enfant, prévoit la possibilité d’une poursuite d’accompagnement sous la forme d’un document administratif, le contrat jeune majeur (CJM) signé avec la collectivité territoriale, sous réserve de certaines conditions [3] entre 18 et 21 ans.
Généralement, pour en bénéficier, ces jeunes doivent être prêts à transiter temporairement par une nouvelle structure, avoir un projet d’insertion, et accéder ensuite rapidement à un logement de « droit commun ». Les liens constitués pendant le placement prennent alors le risque d’être totalement interrompus. De nombreux jeunes n’y parviennent pas, refusent ou s’opposent à ce mode de prise en charge, ils se réfugient vers des familles inadaptées, et quittent les services ASE sans solution après 18 ans.
Pourtant, dans son article 7, la loi de 2016 prévoit de : « Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme » et entend donc de garantir la continuité des parcours. Paradoxalement, à la majorité, cette loi permet aussi un arrêt de l’inconditionnalité de la protection, et soumet cette continuité à des règles établies par les collectivités territoriales.
Ce système législatif favorise donc une « rupture » systématique du mode d’accompagnement et a un impact sur la continuité des parcours.
Dans ce contexte, comment est organisé le passage à la majorité des jeunes des services de l’ASE sur le territoire métropolitain ?
À la suite d’évolutions juridiques et dans un contexte financier contraint, ce passage est devenu pour l’ASE un enjeu fort, qu’il s’agit de préparer systématiquement entre 16 et 18 ans pour créer les conditions d’une prise d’autonomie des jeunes accompagnés, mais qui sera forcément plus brutale, que pour les jeunes qui peuvent s’appuyer sur leurs familles. La période d’adolescence entre 16 et 18 ans est un moment significatif de construction identitaire, généralement les modèles parentaux sont fortement ébranlés. Et par ses fondements de protection, le public accueilli par l’ASE est sujet à une vulnérabilité particulière à cet endroit.
Les méthodes actuelles pour préparer l’autonomie sont majoritairement tournées vers des aspects fonctionnels, dans le but de développer des compétences attendues par les services « majeurs ». Cet accès à l’autonomie, basé sur des contraintes administratives, et donc temporelles, engendre une forte tension entre deux logiques d’action des professionnels à l’adolescence: protection et activation (des compétences). Sauf si elle émane de leur volonté propre, cette préparation met bien souvent ces jeunes en situation de responsabilité précoce et se révèle, dans les faits, insécurisante. Ces méthodes rationnalisées sont peu à l’écoute des enjeux relationnels que ce passage pose entre les jeunes, leurs proches et les professionnels qui les accompagnent. L’aspect relationnel de l’autonomie impliquerait de garantir à la majorité (et au préalable) de la sécurité affective et un environnement un peu stable, assorti de l’assurance d’une permanence des liens constitués, qu’ils soient ou non professionnels.
À l’aide d’apports sociologiques, et par la mise en récit du vécu des bénéficiaires, se dessinent de nouveaux moyens de traduction des constructions sociales de ces parcours institutionnels, qui nous indiquent les véritables conditions de leur continuité. J’interroge la possibilité d’une « transition écologique » et méthodologique des pratiques d’accompagnement et d’écoute, pour laquelle j’aurai recours aux notions « d’habiter », de « care » et de « capabilités », pouvant constituer des premières sources d’inspiration. Se pose dès lors la question de l’évolution des pratiques d’accompagnement et l’expérimentation méthodologique de la participation des bénéficiaires. Comment recevoir la parole des personnes placées à l’ASE pour garantir, dans l’espace social, la continuité de leurs parcours ?
En première partie de cet article, j’apporterai un éclairage historique, politique et local concernant la question des jeunes majeurs à l’ASE du Grand Lyon Métropole. Ensuite, je mettrai en comparaison la méthodologie d’accompagnement actuelle et les récits de jeunes interrogés sur leur parcours de prise en charge ; et finalement j’amènerai des pistes de réflexion pour une écoute renouvelée de l’accompagnement par la reconnaissance d’une permanence des liens, comme engagement préalable.
Un enjeu budgétaire et politique entre l’état et les collectivités territoriales
Une catégorie spécifique
En 1974, le président Valéry Giscard d’Estaing abaisse la majorité civile de 21 à 18 ans. De cette transformation légale découle des dispositions spécifiques pour les personnes de 18 à 21 ans toujours suivis par l’ASE qui auraient, sinon, perdu tout moyen de protection après 18 ans. Sont d’abord concernés les jeunes de 18 à 21 ans accueillis sous un régime administratif encadrés par les départements (le CJM de l’ASE), et ensuite ceux placés sous protection judiciaire, confiés à la responsabilité de l’état (la protection jeune majeur (PJM) de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Ainsi naît la catégorie « jeune majeur ». Elle englobe une population difficilement qualifiable, tant elle comporte une diversité de profils d’individus, et donc de caractéristiques singulières. Ces personnes ont toutes en commun leur tranche d’âge (18 - 21 ans) et la manifestation d’une rupture familiale et/ou sociale au moment de la majorité, engendrant la précarité de leurs ressources. Majoritairement, cette population est prise en charge par les services ASE pendant la minorité, et est définie par sa vulnérabilité et, de ce fait, un déficit capacitaire à pouvoir vivre seul à la majorité.
La prévention : un enjeu social et économique
Dès les années 90, le Conseil Général du Rhône et la PJJ organisent conjointement l’intervention de l’ASE envers les jeunes majeurs par des méthodes préventives de développement de l’autonomie, visant en priorité l’insertion professionnelle. De manière générale dans les années 2000, la prévention devient incontournable dans les schémas départementaux de protection de l’enfance, et vise l’émancipation des personnes ; et parallèlement, elle devient aussi un mode de résolution de l’action sociale dans un contexte de rigueur budgétaire des services publics. À partir de 2002, l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, subit des modifications, et entre 2005 et 2010, dans un contexte politique sécuritaire, la direction de la PJJ opère une importante réorganisation structurelle. Une différenciation significative entre les champs « civils » et « pénaux » de la protection de l’enfance est instaurée par le législateur. La PJJ recentre son activité sur les mesures pénales de traitement de la délinquance, et en matière de protection des jeunes majeurs, n’intervient plus qu’envers ceux en grande difficulté [4]. Les budgets alloués pour les PJM sont considérablement diminués entre 2005 et 2009, et totalement arrêtés en 2011. Les juges ne peuvent donc plus les ordonner. Cette transformation du volet pénal de la protection de l’enfance et le retrait de l’état sur cette question, imposent alors aux départements la responsabilité financière unique de prise en charge. Et par raison économique, empêchent les juges de pouvoir ordonner des mesures de protection après 18 ans.
Une gestion rationnelle du mode d’hébergement
Les services ASE disposent de deux types de prise en charge financières à la majorité : soit le maintien sur une place « mineur » (foyer, maison d’enfants à caractère social (MECS), ou famille d’accueil) sur la base d’un prix de journée (environ 150 euros par jour) comme pendant la minorité, soit l’orientation en structure « majeur » avec le versement d’une allocation mensuelle (465 euros par mois) versée directement au jeune qui doit gérer son budget. Cette deuxième solution est largement plus économique, et donc encouragée. Actuellement, seul un système dérogatoire (organisé par des commissions supervisées par l’administration et soumis à des critères de vulnérabilités reconnues [5]) peut permettre de rester dans les lieux d’accueil « mineurs » après 18 ans. Majoritairement, l’action préventive envers les jeunes majeurs de l’ASE s’organise autour de leur accès rapide à l’autonomie. Le Plan Métropolitain des Solidarités (2017-2022) aborde l’autonomie des jeunes à partir d’une nouvelle tranche d’âge : les 16-21 ans, laissant entrevoir l’organisation de son anticipation dès les 16 ans des jeunes.
Le processus d’autonomisation à l’ASE : entre protection et activation
La protection, au sens législatif du terme, ayant disparu de la question « jeune majeur », être autonome dès 18 ans est donc devenu le principal levier pour continuer à bénéficier d’un soutien. Il existe donc une méthodologie d’intervention des professionnels de l’ASE pour préparer l’autonomie des futurs jeunes majeurs pendant leur parcours.
Méthodologie de l’autonomie à l’ASE : l’autonomisation.
Autonomie psychique :
D’abord caractérisée par un mécanisme « psychique », l’autonomie se décrit à travers la théorie freudienne [6] des cinq stades du développement de l’enfant, selon des tranches d’âges définies [7]. Chaque stade comporte ses besoins propres et ses limites en matière de développement et d’éducation, et il est souhaité idéalement que les enfants obtiennent dans chaque stade des acquisitions associées, donnant à voir s’ils s’inscrivent dans la « norme ». Ces phases se déroulent dans un rythme continu en respectant leur enchaînement progressif et le rythme des enfants. L’adolescence est caractérisée comme une période où s’opère « une construction psychique et physiologique », et où le jeune « constitue son estime ». Ce temps est défini à travers les dimensions de « la crise d’adolescence ». Des « régressions », des oppositions, peuvent prendre part à la construction, et sont aussi considérées comme composantes de l’autonomie. Ce mode d’apprentissage consiste à « inscrire dans la durée et rythmer la présence sociale » (Gardella, 2016) et l’action des professionnels à l’attention des jeunes s’opère dans une logique « d’intégration des modèles de socialisation qui se transforme en habitude. » [8]. La conservation, la répétition, la routine, l’adaptation des adultes au plus près des besoins, sont au cœur de cette dynamique, cherchant à favoriser ainsi des liens d’attachement sociaux construits. La temporalité d’intervention est longue et cherche à s’inscrire dans le temps. Cette forme d’activité est principalement guidée par une logique de protection.
Autonomie fonctionnelle :
Ensuite, l’autonomie étant un état à atteindre, un déplacement est nécessaire pour l’obtenir. C’est donc un processus qu’il faut organiser : l’autonomisation. Ainsi, plus majoritairement au moment de l’adolescence, apparaît une deuxième facette de l’autonomie, dite « fonctionnelle » qui prend appui sur le quotidien et « correspond ainsi aux compétences et habiletés sociales d’un jeune ». Les lieux d’accueil « mineur » sont chargés d’organiser par des gestes répétitifs le développement d’acquisitions pratiques et morales au moment de l’adolescence : « tâches domestiques quotidiennes, travail sur la responsabilisation », l’intervention éducative prenant la forme d’une « dynamisation sous-tendue par la prise en charge au quotidien » [9]. C’est donc ici une logique d’activation : provoquer l’autonomisation par des propositions quotidiennes et négociées avec les jeunes afin de développer des compétences individuelles. Cette activité consiste en continu à repérer les zones de vulnérabilité et les compétences, et à intervenir pour les transformer en capacité. Ces gestes pratiques, réguliers et progressifs, visent la sortie du rapport de dépendance aux adultes et à l’environnement. Il faut savoir « se réveiller seul, avec un réveil, faire sa toilette et s’habiller seul, gérer les horaires des repas, prendre les transports en commun… » [10] et demande de bonnes compétences relationnelles et intellectuelles. Il est largement diffusé et attendu des normes capacitaires (intériorité, adhésion, et gestion de conflits) dans différents domaines de socialisation, pour ensuite organiser de manière rationnelle l’orientation post-majorité.
Distance éducative
La relation éducative est contrainte de sortir du « principe de « l’obligé » [11] : il est entendu que le positionnement et la disponibilité des professionnels de structure « majeur » vont différer de ceux connus pendant la minorité. À l’adolescence, les travailleurs sociaux deviennent donc des « guides » et limitent leur intervention sur le principe que les jeunes doivent « se débarrasser du sentiment que les choses sont dues ». Pourtant, paradoxalement, « obligé n’est pas à entendre en un sens répressif, mais aussi en tant que « ça l’oblige », que ça lui crée des obligations, étymologiquement des liens. » (De Certeau, Giard & Mayol 1994). Les intervenants se confrontent alors au « souci institutionnel de « ne pas trop protéger » pour rendre « autonome »» (Gardella, 2014). L’intervention préventive de l’ASE en matière d’autonomie pour les 16-21 ans, laisse alors entrevoir une tension temporelle entre ces deux logiques d’action nécessaires à l’autonomisation. Une temporalité courte est accordée, dans un contexte fragile, occasionnant une accélération du rythme d’intervention, bien souvent inadaptée sur un plan émotionnel. Il s’agit alors pour les travailleurs sociaux de temporiser tout en accélérant, sans être sûrs de pouvoir assurer une réelle continuité, rendant anxiogène la relation des jeunes avec les adultes présents.
Comme l’explique Bertrand Ravon [12], l’intervention sociale visait l’autonomie des personnes comme un horizon, comme quelque chose toujours à atteindre progressivement, en présence d’un autre. À présent, l’autonomie se construit individuellement, prématurément, et encadrée par des règles collectives.
Pratiques professionnelles, moyens d’intervention et enjeu moral
Face à la rigueur budgétaire, il n’existe pas assez de structures d’accueil « majeur » pour répondre aux nombreuses demandes, engendrant peu de turn-over dans ces structures. Les places deviennent rares, et sont conditionnées par le degré d’autonomie. Les partenaires de la « majorité » et du « droit commun » ont de nombreuses exigences pour que les jeunes accèdent à leurs services, « [l]es compétences opérationnelles et pratiques devant être maîtrisées » [13]. Ils indiquent qu’une admission « suppose que le jeune soit largement avancé par rapport à ces compétences, ce qui n’est actuellement pas acquis. » [14]. Ainsi, à l’ASE, il est majoritairement encouragé de développer des places en logements autonomes pour adolescents depuis les lieux d’accueil. A destination non seulement des plus autonomes, mais comme un outil généralisé d’intervention. Avec l’intention entendue de les mettre à l’épreuve en amont de cet arrêt d’inconditionnalité, pour « percevoir et les sensations, et les difficultés qui naîtrons après leurs 18 ans » [15]. Ce système génère régulièrement l’orientation « la moins mauvaise possible », et prend la forme d’une économie de l’accès à l’autonomie par des normes de performance et de mérite, incompatibles bien souvent avec le contexte de vulnérabilité qui caractérise une part de cette population.
Vivre à l’hôtel.
Face à une recherche d’équilibrage du manque de places d’hébergement par les services ASE, s’est banalisée progressivement une nouvelle forme d’hébergement au moment de l’adolescence : l’hôtel. Les différentes vagues migratoires mondiales ont occasionné une augmentation significative du nombre de mineurs non accompagnés (MNA) sur le territoire métropolitain, contraignant la collectivité à une obligation plus importante de prises en charge [16]. De nombreux jeunes en rupture du système ASE et des MNA, sont placés dans des hôtels financés par l’ASE par manque de solutions adaptées. Il existe sur le territoire métropolitain deux dispositifs d’accompagnements éducatifs auprès des jeunes placés à l’hôtel [17]. Mais, beaucoup de demandes « urgentes » sont « en attente » dans ces services, ce qui veut dire que des adolescents, bénéficiaires d’une mesure de protection, sont livrés à eux-mêmes dans des hôtels. L’idéal d’un processus d’autonomisation sensé structurer le quotidien et favoriser l’autonomie par des gestes répétitifs en présence, se réalise ici dans des conditions très éprouvantes, voire impossibles. Ces jeunes « placés » à l’hôtel se confrontent à des situations extrêmes d’isolement dans des lieux où se forge l’errance. Ils vivent une réalité quotidienne instable, impliquant des situations hors normes pour la pratique et les fondements éthiques des professionnels de l’ASE : des mineurs « en danger » sont placés dans des lieux « dangereux ».
Ce type d’intervention conduit les équipes ASE à des situations de conflits quotidiens provoquant l’épuisement et la perte de sens. Le grand nombre de situations d’enfants, le manque de places adaptées aux problématiques et l’injonction massive de justification, découpent et morcellent leur activité. La continuité des parcours, demandée par la loi, devient un puzzle et une course contre la montre pour maintenir les jeunes dans le dispositif.
Du parcours institutionnel au parcours vécu
Le parcours : un « outil » de l’intervention sociale
La notion de parcours est ici centrale, il semble important de la définir, d’autant qu’elle a envahi le paysage des politiques publiques d’action sociale. Le terme « parcours » « vient de la racine latine currere, cursum, qui signifie “courir”, et qui a servi de base au mot “cours”. Selon la définition académique, le parcours est un “déplacement déterminé accompli ou à accomplir d’un point à un autre” ; c’est aussi ce qui correspond à l’espace, au chemin ou à la distance parcourus. Les parcours ont une dimension temporelle, induisant l’idée de la continuité. » (Robin, 2016). Dans les années 2000, le concept de « sécurisation des parcours » se développe dans le champ de l’insertion professionnelle. Progressivement, à l’appui de ce modèle, les politiques d’action sociale généralisent la notion de parcours qui vise à rendre l’aide apportée aux bénéficiaires plus « cohérente » et plus adaptée à la singularité de chaque situation, mobilisant les intervenants à la coordination de leurs actions pour éviter les ruptures de prise en charge. Ce cadre d’intervention vise à « lisser », fluidifier les étapes du parcours. Cette conception responsabilise d’avantage le bénéficiaire qui doit être garant de sa mise en mouvement, en échange de l’aide apportée par les professionnels, véhiculant une visée « performative ». Les individus les moins conformes à ce modèle peinent à être reconnus. Et les différents professionnels se confrontent, avec eux, à un phénomène de « mésinscription » (Gaillard, G. ; Henri, A.-N. ; Omay, O. 2009).
Un levier sociologique
En parallèle, sur un plan sociologique, le concept de « parcours » est considéré comme un nouvel axe de compréhension des phénomènes sociaux qui les traversent. Il prend une dimension différente de la forme institutionnelle que je viens de définir, car il n’implique justement pas l’idée de linéarité. Au contraire, il s’appuie sur les ruptures, les évènements, les bifurcations pour traduire des formes d’engagement liées à la subjectivité des acteurs, et permet « à postériori » de donner une dimension réflexive à leurs vécus. Ainsi, « sa portée sociologique réside également, dans « l’activité de mise en cohérence et de justification qui scelle l’appropriation personnelle d’un parcours et sa justification pour autrui ». En ce sens, le parcours présente une double dimension interactive et réflexive et peut être producteur de continuité par la mise en récit. » (Zimmermann, 2014, in Robin, 2016). À ce titre, François Dubet (1994) nous invite à voir le parcours de vie comme « une expérience sociale » jonchée « d’épreuves » qui amène l’individu à être sujet de sa propre existence. La finalité du processus d’autonomisation pensé par l’ASE devrait permettre d’atteindre, pour ces jeunes, une individuation et le statut de « sujet » - accomplissement de l’individu social moderne. Un individu, dont la forme aboutie serait un sujet libre mais aussi déterminé par la société.
Je n’aime pas ce mot, [autonomie], parce que je pense que c’est un fourre-tout. Moi, j’aime bien le mot responsable parce que je trouve que ça renvoie au jeune qu’il est sujet. J’aime bien renvoyer à un jeune qu’il est sujet, être acteur de sa propre vie, et qu’il peut faire des choix. Et quand il ne peut pas faire des choix, on est là pour voir avec lui, je pense notamment aux gamins en situation de handicap. (Entretien chef de service ASE, 2018)
Gilles Herreros (2007), parle de « l’advènement du sujet » comme une pratique d’enquête visant à faire advenir les modes de résolution par l’écoute des logiques subjectives des acteurs. Autrement que par son aspect introspectif et individuel en psychologie, la subjectivité ainsi traduite, met à jour les modes de construction du social par l’individu. « Ainsi se dessine un continuum qui attache l’une à l’autre la personne et la société » (p141).
Pour organiser leur intervention, les travailleurs sociaux de l’ASE effectuent plusieurs mouvements temporels en même temps : anticiper et projeter l’avenir selon des règles rationnelles, à travers l’histoire individuelle passée, pour construire le présent. Ils agissent au présent sur des risques, bien que de tels événements n’aient pas encore eu lieu. Ils construisent, en concertation avec leurs partenaires, des fictions de parcours qu’il faut impérativement mettre en place pour garantir la continuité du parcours. Même si, finalement, elles ne correspondent pas toujours au vécu des jeunes concernés.
Parcours vécus et permanence des liens
Donovan : une stratégie relationnelle
Donovan a été placé à l’âge de 6 ans dans la MECS Victor Hugo qui se situait dans la même commune que le domicile de sa mère. Il a construit ses souvenirs d’enfant entre la MECS, le domicile maternel, et l’école. Dans son discours, son placement s’inscrit dans la norme familiale car son frère aîné a lui aussi été placé. Sa mère rencontre de nombreuses difficultés. Elle nous a, en quelque sorte, délégué les décisions parentales, et nous avons naturellement développé une relation affective avec cette famille au fil du temps. Donovan explique que jusqu’à l’entrée au collège, il n’a pas conscience de sa situation d’enfant placé. Sa maison principale c’est la MECS. Et son domicile secondaire, chez sa mère. A l’adolescence, par souci de normalité, il s’interroge sur le bien-fondé de vivre à la MECS ou chez sa mère. A 16 ans, sur le fil de la délinquance et à la suite d’une énième « bêtise », il est réorienté brutalement par la direction de la MECS dans un autre foyer, parce qu’une place se libère dans un dispositif qui prépare l’autonomie. Donovan est alors déraciné contre sa volonté, il perd « son quartier ». Il se déscolarise, fugue, erre. Et finalement, il retourne chez sa mère et met fin au placement.
Ils ont pris cette décision parce que j’ai fait le truc à l’autre jeune du foyer, c’est pour ça qu’ils m’ont viré. Et apparemment, c’était pour me jeter vers l’avant, (faisant un geste avec la main), je ne sais pas quoi. Mais depuis le temps, que je voulais rentrer chez moi... Si tu veux me jeter vers l’avant, mets-moi chez moi plutôt que de me remettre dans un autre foyer. […] C’était nul, depuis tout petit j’étais à Victor Hugo. (Entretien Donovan, 2017)
Par cette réorientation, Donovan s’est senti « jeté en avant » de l’endroit qu’il considérait comme sa maison. Il revient finalement à 18 ans au service ASE, à travers la relation que l’on a construite ensemble pour demander un CJM, il ne peut plus rester chez sa mère. Ce retour à la majorité se déroule non sans pression pour trouver un lieu d’accueil, et pour qu’il accepte ensuite d’être accompagné, malgré son sentiment de trahison.
Eléna : une dépendance conflictuelle
Eléna est repérée comme enfant en danger à sa naissance et placée chez une assistante familiale, Jeanne, alors qu’elle a un mois et demi. Sa mère est schizophrène, et son père a des troubles psychiques non diagnostiqués. Ses relations familiales sont organisées par l’ASE à travers les mouvements des troubles parentaux. En réaction, Eléna développe des troubles du sommeil. Dans son discours, elle relie sa protection et les raisons de son placement à son lit, qu’elle situe dans la chambre de Jeanne. Les droits de visites avec ses parents se construisent dans un climat particulièrement conflictuel du côté maternel, en lien avec sa relation à Jeanne. Sa mère meurt brutalement alors qu’elle a 5 ans ce qui engendre progressivement une rupture avec sa famille maternelle. En grandissant, Eléna développe une attitude conflictuelle et autoritaire par peur d’être séparée de Jeanne. Elle construit une relation complexe de dépendance envers le service ASE qu’elle met constamment à l’épreuve.
Eléna: "Ben, Madame Kemali, elle voulait plus que je reste chez Jeanne, et Jeanne, elle s'est bagarrée pour que je reste chez elle.
Moi: "Et pourquoi Madame Kemali elle ne voulait pas que tu restes chez elle?
Eléna: "Je ne sais pas... peut-être qu'il y avait trop de liens." [...]
Moi: "Et pourquoi les liens c'est un problème?
Eléna: "Ben, je ne sais pas, par rapport au travail… Ben, pour Jeanne, dans son travail, il n'y a pas trop de liens qui se créent, parce que c'est un travail, et je ne sais pas quoi... (Entretien Eléna, 2018)
À ses 17 ans, après de nombreux évènements de mise en danger, souffrant de troubles psychiques, en conflit majeur avec Jeanne, Eléna est orientée par l’ASE en foyer et, opposée à cette décision, elle part dormir dans la rue. À son retour au foyer plusieurs mois plus tard, l’ASE contraint Eléna à une hospitalisation, puis la confie de nouveau à Jeanne, le temps de trouver un lieu transitoire qui accepte de l’accueillir. Elle réussit à partir, in-extremis, quelques semaines avant ses dix-huit ans grâce à un avis médical, une reconnaissance MDPH et une dérogation de l’ASE, dans un lieu de vie perdu au fond des Corbières, où le temps s’arrête. Ce qui stabilisera finalement Eléna dans ce nouveau lieu, c’est la possibilité de s’arrêter et de dormir.
Mathilde : une adaptation conforme.
Elle arrive du Rwanda à seize ans avec sa mère, désorientée, qui sort de prison. Peu de temps après leur arrivée en France, elle disparaît, laissant Mathilde a une sœur et un frère présents, mais qui ne peuvent pas l’accueillir. Ils la confient à l’ASE. Via les services de la préfecture, elle est d’abord accueillie dans un foyer d’urgence. Elle ne parle pas français, se sent perdue et pleure lorsqu’elle est seule. Elle regarde beaucoup la télé, et les éducateurs viennent lui parler. Plus elle est en contact, plus les solutions se trouvent. Mathilde a un tempérament tranquille, elle est souriante, et rapidement on lui trouve une MECS où elle restera plus de deux ans. Mathilde investit les espaces collectifs, aide les autres à résoudre leurs problèmes, et fait ce que les éducateurs lui demandent. Dans son discours, « ses éduc’ » sont des oncles et tantes, et l’ASE, des parents. Malgré sa grande adaptation au cadre institutionnel, Mathilde devra péniblement changer deux fois ensuite de lieux d’hébergement pour « continuer » son parcours à la majorité. Elle terminera son CJM à 21 ans, regrettant de ne pas garder plus longtemps le suivi de l’ASE.
En fait, le problème c’est qu’on arrive, on s’adapte, on s’attache à un endroit, aux personnes qui sont là, et ce qui est difficile c’est de toujours devoir changer. Parce que j’ai connu des gens, on était au même collège ensemble, ils changeaient quasiment toutes les années, et je me demandais : mais comment ils font ? C’est ce que je me dis maintenant quand j’y pense que c’est pour ça que les gens ils ne s’attachent pas, et qu’ils deviennent aussi durs en fait. Parce qu’ils se disent, de toute façon, on ne va pas rester ici tout le temps, on va changer dans quelques mois, donc c’est là qu’ils commencent à manquer de respect aux éducateurs les autres jeunes. On ne va pas rester longtemps ici, on va devoir partir, on va devoir rencontrer d’autres personnes, on va devoir s’adapter à de nouvelles personnes. Et ils se détachent de leurs côtés attachants. (Entretien Mathilde, 2018)
Autonomie relationnelle et permanence des liens
À l’aide de ces brefs résumés de récits, je tente de montrer que l’autonomie et la continuité se forgent conjointement dans la relation à l’autre, la permanence et dans un environnement précis. « Être un enfant placé, ce n’est pas seulement grandir ailleurs que chez soi, c’est être condamné à une absence de continuité telle que le mouvement, l’évolution, ne peut jamais se faire sans y perdre quelque chose : un monde, des liens, autant dire une partie de soi-même. » (Séverac & Moisset, 2015). La transition identitaire et relationnelle qui marque le passage à l’âge adulte permet la création d’un lien avec soi, cette transformation passe alors par la présence d’autrui-significatifs : « L’autonomie ne se forge pas dans le vide mais en s’appuyant sur des relations avec autrui, surtout lorsque ces autres sont « significatifs », c’est-à-dire que par leur présence et leur regard, ils ont contribué à faire de nous ce que nous sommes. » (Opcit). En ne garantissant pas actuellement ce besoin fondamental dans l’organisation du passage à la majorité, l’institution « met les jeunes en situation d’apprendre à se passer d’un dialogue intérieur qui est pourtant ce qui permet de trouver des voies de résolution, c’est-à-dire de pouvoir se reconnaître comme quelqu’un de capable d’y arriver par soi-même. Ce qui ne peut pas s’exercer, c’est précisément l’autonomie, dans sa déclinaison la plus fondamentale, l’autonomie relationnelle. (Opcit)
Dans cette recherche, j’ai mis à jour pour chaque jeune la fragilité de ses liens et le morcellement de son habitat, construits à travers des règles rationnelles de fonctionnement de service. Lorsqu’ils sont autorisés à rester c’est pour une durée temporaire, à la condition du mérite et de l’effort. La prise en charge ne prend pas fin lorsque le jeune n’en a plus besoin ou lorsqu’il fait le choix d’accéder à un logement autonome, comme cela se passerait dans un contexte familial classique, mais selon des règles temporelles en tension dans un contexte de vulnérabilité. Les choix ne semblent possibles que pour ceux qui possèderaient le bien marchand, c’est-à-dire les ressources financières nécessaires. Ainsi, globalement, par l’anticipation systématique de leur majorité et la prévision du changement de lieu d’accueil, l’institution renforce la vulnérabilité des jeunes accueillis, et fragilise ce qu’elle cherche parallèlement à construire.
Ouvertures méthodologiques.
Le logement. Oui, mais habiter son environnement d’abord
Depuis février 2019, la question « jeunes majeurs » de l’ASE devient une thématique transversale des politiques du « logement d’abord » et de la stratégie nationale du plan pauvreté. La protection de l’enfance s’assied à la table des discussions des champs du logement et du sans-abrisme. En matière de logement, le document de référence [18] concernant les sorties « sèches » de l’ASE, propose, de « faire de la question du « savoir habiter » un objectif éducatif dans l’accompagnement des jeunes avant la majorité ».
Habiter est une activité spécifiquement humaine, qui comporte une dualité significative entre subjectivité et socialité. Habiter demande à l’individu d’équilibrer, de relier vie sociale et vie intime. Habiter c’est autant avoir une adresse, un lien à la société, que détenir un lieu de repli intérieur, à soi. Observer « l’habiter » (c’est-à-dire la manière qu’un individu a d’habiter son monde), permet de repérer au même titre que le langage, une pluralité d’activités autant techniques qu’humaines. Sa caractérisation, à travers des temporalités, des logiques d’action et des environnements, est devenue l’aspect créatif de ma recherche. Il donne à voir les ancrages du parcours, définissant ainsi son périmètre, son contour. En observant ses points d’attaches, ses « attachements » par la manière qu’il a d’habiter, l’individu nous indique comment il est subjectivement relié à l’univers social et ainsi, il nous montre les termes de son inscription sociale. Autrement dit, sur ce plan, il s’est agi dans ma démarche, par l’analyse de récits de parcours, de comprendre la construction sociale de ces attachements depuis la perception que les jeunes ont d’habiter leur monde. Mathilde a construit les contours de son « habiter » autour des principes d’une maison collective qu’elle bricole dans son discours comme sa maison intérieure, parce qu’elle a pu se construire dans le temps. Dans le discours de Donovan, c’est son quartier le lieu de ses attaches parce qu’il rassemble ses deux lieux de vie dans l’enfance. L’éloigner de ce quartier a conduit à lui faire perdre ses repères. Et finalement, Eléna a construit les termes de son « habiter » dans un lit, d’abord pour gérer ses angoisses infantiles, ensuite en dormant dans la rue, et aujourd’hui elle exprime à travers le lit (d’hôpital, ou du lieu de vie) son mode de relation sociale, dévoilant un besoin de protection.
Afin de repérer les modes « d’habiter » des jeunes, l’observation des écologies sociales peut être un premier support : « L’étude singularisée de l’individuation exige ainsi d’aborder les écologies sociales personnalisées de chaque acteur, obligeant à reconnaître que si enrôlés dans une société, la plupart des individus affrontent les mêmes épreuves, tous les acteurs n’y sont pas également exposés et n’y apportent pas les mêmes réponses. » (Martucelli & de Singly, 2012). L’écologie sociale d’un individu correspondrait à son adaptation aux situations structurelles, il développe des logiques d’action pour être soit dans une bulle (Eléna), soit chercher à construire une digue (Mathilde), soit en situation intermédiaire dans une « niche », ce qui nécessite des stratégies (Donovan).
Capabilités et anthropologie conjonctive
Pour résoudre l’antagonisme entre logiques de protection et d’activation en amont de la majorité, et afin d’intervenir sur les sources de la vulnérabilité, je prends appui sur la théorie « d’anthropologie conjonctive » (Genard, 2009): la modernité serait passée d’une anthropologie « disjonctive », où l’individu serait capable OU incapable, à une anthropologie « conjonctive » où il serait capable ET incapable. Ce concept nous invite donc à penser la résolution de la vulnérabilité comme un « continuum» de protection et d’activation tout au long de la vie. Ainsi un grand nombre d’antagonismes internes à la condition humaine ne devraient plus s’opposer mais être perçus de manière conjointe : vulnérabilité/capacité, liberté/déterminisme, responsabilité/irresponsabilité, ordre/désordre. Le processus d’autonomisation pensé par l’ASE devrait pouvoir continuer à garantir en même temps protection ET activation au moment de la majorité. Plutôt que par une intervention systématique par l’anticipation des risques, dans le temps présent, les travailleurs sociaux pourraient se concentrer à mettre à jour les « capabilités » des jeunes, et réduire ensuite les risques futurs. Selon la philosophie politique de Sen, « [u]ne capabilité se définit comme « un ensemble de vecteurs de fonctionnements, qui reflètent la liberté dont dispose actuellement la personne pour mener un type de vie ou un autre » […]. Elle est un pouvoir effectif d’être et de faire, qui traduit la liberté d’accomplir des fonctionnements, c’est-à-dire des combinaisons d’états et d’actions qui vont du plus élémentaire (avoir de quoi manger, être en bonne santé) au plus complexe (être heureux, participer à la vie de la communauté). Ce pouvoir est fonction des capacités de l’individu mais dépend aussi centralement des ressources et des opportunités offertes par l’environnement social. » (1992, in Garrau, 2013).
Comme interroge justement Marie Garrau (2013), « ne faut-il pas consacrer plus de temps à la description et à l’analyse de ce qui est perçu et expérimenté par les sujets sociaux comme des formes de vulnérabilités, à un moment historique donné et dans une configuration sociale particulière ? ». En donnant la parole à ces trois jeunes avec qui j’ai pourtant vécu une relation d’accompagnement pendant dix ans, et seulement en changeant de posture, en les écoutant me raconter leurs expériences de parcours, ils m’ont apporté des indications très riches. À mon sens, il est possible de transformer la philosophie de la politique de continuité des parcours par la mise au récit des expériences vécues par les jeunes, et par les éléments subjectifs que ces récits révèlent.
La réception du care
Par sa définition du « care » (soin/sollicitude), Joan Tronto (2008) nous indique ici une nouvelle voie pour envisager les accompagnements : « Au niveau le plus général, nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre « monde », en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous les éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie. »
La pratique du « care » diffère de celle de la protection car elle implique majoritairement l’idée d’une charge pour celui qui protège. Pour se réaliser, le « care » nécessite, lui, de quatre phases : se soucier de, se charger de, accorder des soins, et recevoir des soins. Cette dernière phase mérite de l’attention face au mode actuel d’intervention car « faute de s’assurer que l’objet dont il a été pris soin réagit à la sollicitude dont il a bénéficié, nous pouvons rester dans l’ignorance de ces dilemmes et perdre la capacité d’évaluer l’adéquation du soin proposé. » (Opcit).
À travers les entretiens réalisés avec les jeunes, j’ai reçu d’autres points de vue du soin que je pensais avoir apporté. Ces jeunes m’ont beaucoup appris, et cette pratique m’encourage à leur donner plus régulièrement l’espace de dire comment sont reçus les soins, comment ils voudraient que l’on prenne soin d’eux, et nécessairement ce serait bien d’avoir les moyens d’y répondre. La demande de responsabilisation massive pendant la préparation de la majorité rend paradoxale la rigidité du mode de résolution déployé. Le sentiment de responsabilité individuelle ne peut se construire que si l’individu se sent relié à une forme de responsabilité collective.
Expérimentations et responsabilité collective
Le mode de transition actuel à la majorité favorise la construction d’un modèle d’habitat basé sur le « sans-abrisme », qui a ensuite des répercussions sur le reste de l’action sociale. Sur le terrain et à la table des politiques publiques, une porte s’ouvre sur de possibles expérimentations visant à la participation des bénéficiaires de l’ASE dans les réflexions. Le document de référence [19] du plan de lutte contre la pauvreté, concernant les sorties « sèches », propose ces différents axes de résolution : « l’accès au droit tout d’abord, avec l’idée d’un guichet simplifié administratif et d’un lieu unique d’ancrage pour les jeunes mais aussi d’un revenu universel de base dès 18 ans jusqu’à 25 ans, le droit à l’essai – permettre aux jeunes de choisir leurs parcours et de changer d’avis- comme pour tout jeune -et la nécessité d’une permanence des liens. »
Afin de garantir ces droits, il est impératif que les professionnels puissent répondre par des solutions adaptées et localisées, chercher à comprendre mieux l’environnement des bénéficiaires et les amener à s’y relier. La protection de l’enfance doit s’engager à garantir pour chaque enfant accueilli une place à la majorité, et lui donner le droit de rester là où il est, s’il en éprouve le besoin. Et en invitant les jeunes à raconter leurs expériences, il est possible de faire (re)connaître le rôle et le fonctionnement de la protection de l’enfance, l’expliquer, lui donner une meilleure image. L’image que renvoie la condition d’enfant placé pour l’individu lui-même, et plus largement pour la société, reste malheureusement très négative. À cet endroit, Numa Murard (2003), nous propose de changer l’esthétisme du « malheur », en déployant l’art de se comprendre et d’être en relation, et, ainsi, « de faire vibrer ensemble les responsabilités ».
Références bibliographiques
Castel, R. (1983), « De la dangerosité au risque ». In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 47-48, juin 1983. Éducation et philosophie. pp. 119-127.
De Certeau M., Giard L. & Mayol P. (1994), « L’invention du quotidien. 2. Habiter, cuisiner », Éditions Gallimard, 416 p.
Dubet, F. (1994), Sociologie de l’expérience, Paris, Éditions du Seuil, 273 p.
Gaillard, G. ; Henri, A.-N. ; Omay, O. 2009. Penser à partir de la pratique, Toulouse, érès, p. 137-209.
Galland, O. (2011), Sociologie de la jeunesse, 5ème édition. Paris : Armand Colin, 256 p.
Gardella, E. (2014), « L’urgence comme chronopolitique », Temporalités [En ligne], 19 | 2014, mis en ligne le 30 juin 2014. https://journals.openedition.org/temporalites/2764
Gardella, E. (2016), « Accompagner sans fin », SociologieS [En ligne], Dossiers, Relation d’aide et de soin et épreuves de professionnalité, mis en ligne le 16 juin 2016. https://journals.openedition.org/sociologies/5458
Garrau, M. (2013). « Regards croisés sur la vulnérabilité. « Anthropologie conjonctive » et épistémologie du dialogue. », Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], #13 | 2013, mis en ligne le 01 janvier 2017. https://journals.openedition.org/traces/5731
Génard, J-L. (2009), « Une réflexion sur l'anthropologie de la fragilité, de la vulnérabilité et de la souffrance ». Dans Destins politiques de la souffrance (pp. 27-45). Toulouse, France : ÉRÈS.
Herreros, G. (2007), « L’advènement du sujet », (pp 131-148) in De Gaulejac, V., Hanique, F., et Roche, P., La sociologie clinique. Enjeux théoriques et méthodologiques, Eres, 348 p.
Robin, P. (2014), « Des jeunes sortant de la protection de l’enfance font des recherches sur leur monde. Une recherche par les pairs sur la transition à l’âge adulte au sortir de la protection de l’enfance. ». Rapport collectif de chercheurs de l’OUIEP pour l’ONED déposé en décembre 2014.
Robin, P. (2016), « Le parcours de vie, un concept polysémique ? », Les Cahiers dynamiques, n° 67, 2016/1, p. 33-41.
Martuccelli, D. (2006), « Forgé par l'épreuve. L'individu dans la France contemporaine », Paris : Armand Colin, 480 p.
Murard, N. (2003). La morale de la question sociale, La Dispute, 278 p.
Martucelli, D. & de Singly, F. (2012), Les sociologies de l’individu, 2ème édition, Armand Colin, collection 128.
Séverac, N. & Moisset, P. (2015), « Au fondement de l’autonomie était un autre : Le travail identitaire des jeunes adultes en protection de l’enfance. », Vie sociale, 12, (4), 129-148.
Tronto, J. (2008), « Du care. » Revue du MAUSS, 32, (2), 243-265.