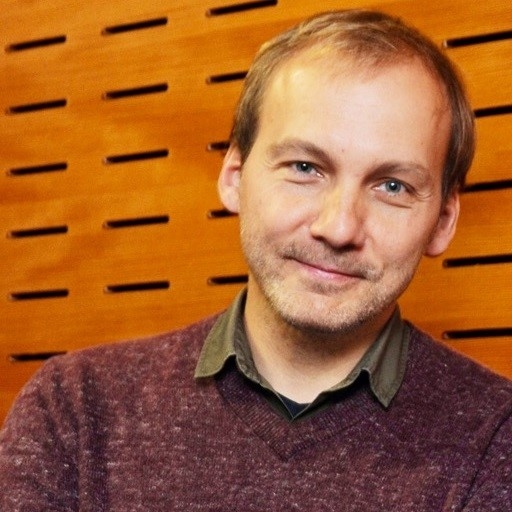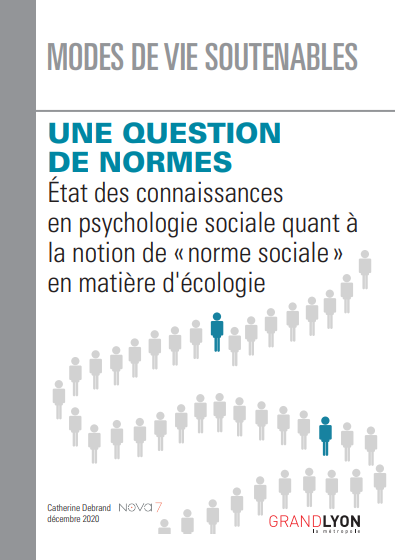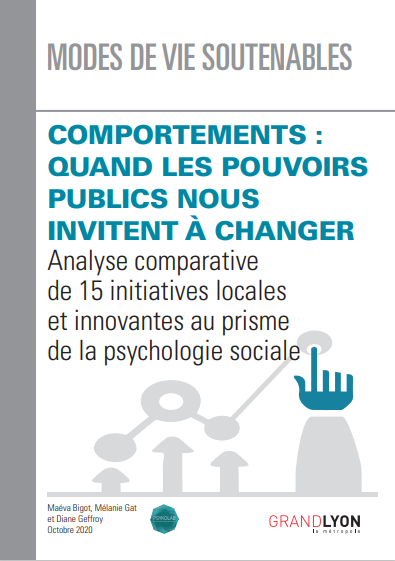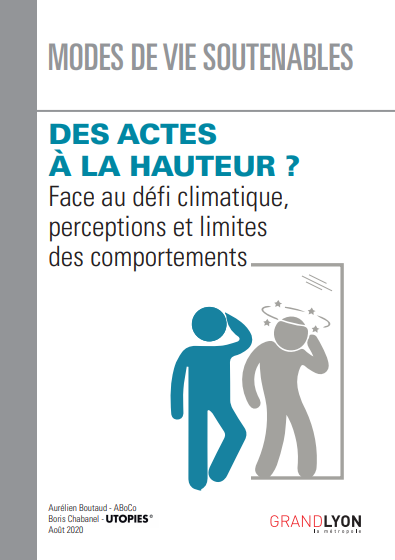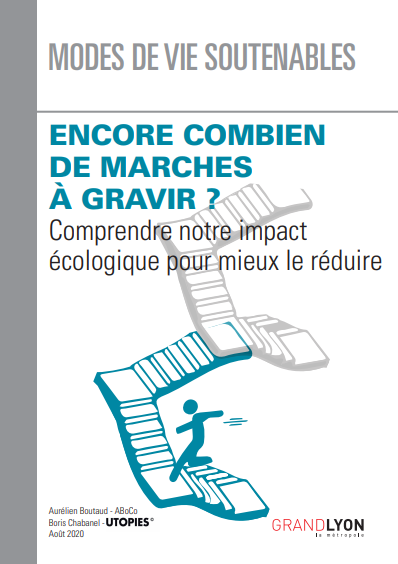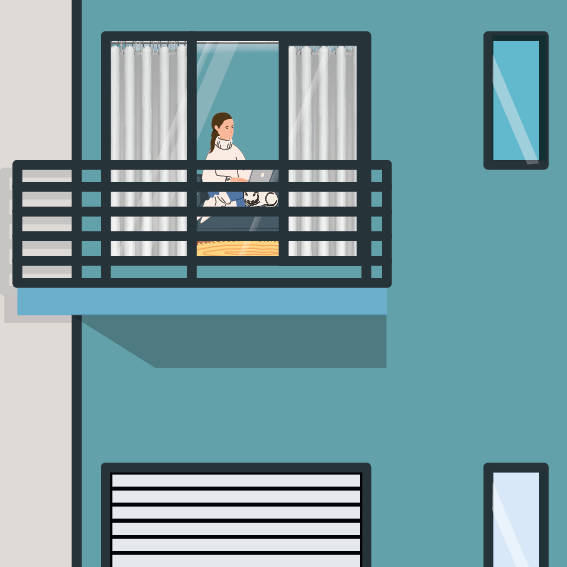J’en suis quasiment sûr pour le nudge parce qu’il peut être non transparent, c’est-à-dire ne pas s’accompagner d’une prise de conscience. Dans la philosophie du nudge (je vais caricaturer), il y a les gens rationnels qu’on appelle les econ et le commun des mortels qui, eux, ne sont pas assez bien pour mettre en place ce qu’il faudrait et qu’il faut donc guider, tel un père de famille, vers le comportement rationnel sans qu’ils en aient conscience. La prise de conscience est donc accessoire, voire non souhaitée. Dans le nudge, la finalité c’est le comportement en lui-même.
Cette question de l’absence de prise de conscience n’est pas réservée aux nudges. Avec d’autres stratégies on peut avoir le même problème. Avec l’hypocrisie induite, les effets sont hétérogènes : parfois ils renforcent l’attitude dans le sens souhaité, parfois non... alors que la théorie de l’engagement transforme progressivement les attitudes, donc il y a à la fois un changement de comportement et un changement du système de pensée pour aller vers une stabilisation et une généralisation du comportement. Et il s’avère que les normes et la transformation du système de pensée jouent un rôle important de pérennisation… Qu’il s’agisse des nudges ou d’autres techniques d’accompagnement au changement de comportements, une approche exclusivement cognitive (centrée sur la facilitation d’un comportement, par exemple) peut avoir un effet ponctuel mais échouera sur le long terme, voire pourra même parfois avoir un effet contre-productif. Finalement, il faut comprendre les normes comme une partie de l’environnement : pour aboutir à un changement de comportement, il est nécessaire d’étudier l’environnement autant que possible, pour voir s’il est favorable et s’il ne l’est pas, voir comment le rendre favorable.