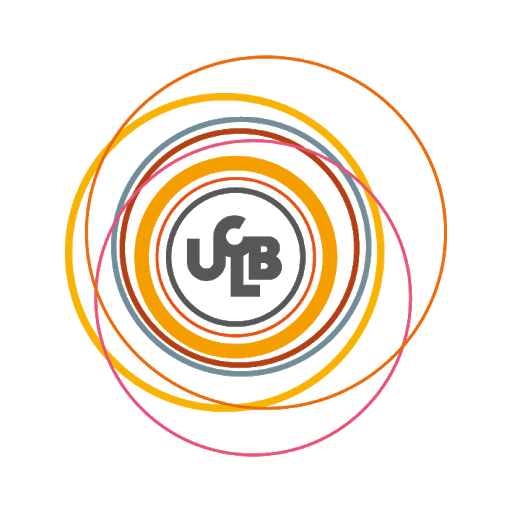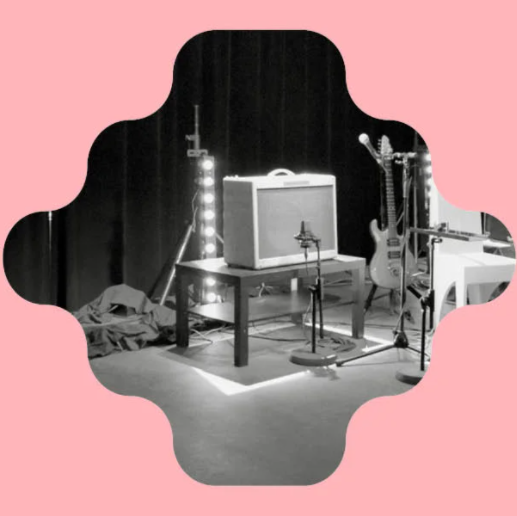Pourriez-vous présenter Nuits Sonores, pour expliquer d’où elles viennent, comment elles ont grandi et quelle place elles occupent dans le paysage des événements lyonnais ?
Nuits Sonores est un festival de musiques et de cultures électroniques, porté juridiquement parlant par l’association Arty Farty, créée en 1999 et qui en 2002 a organisé le festival Arty Farty, à la Sucrière (Lyon 2e). Dès sa constitution, la vocation de l’association a été la promotion des cultures électroniques et innovantes, musicales mais aussi dans le registre des arts plastiques et de la création. À la suite de cette première édition d’Arty Farty, nous avons pu retravailler notre projet à la faveur de l’alternance municipale. J’ai coordonné l’écriture de ce projet, avec Violaine Didier, qui était la fondatrice d’Arty Farty, et avec d’autres personnalités du champ culturel électronique lyonnais, comme le DJ Agoria par exemple.
Nous avons ensuite approché des partenaires, au premier rang desquels la Ville de Lyon. À la suite de plusieurs réunions de concertation, le projet a naturellement évolué, et a été validé par la Ville à l’automne 2002, pour une première édition en mai 2003. Le succès a été immédiat : environ 16 000 personnes étaient présentes la première année, dans les divers lieux que nous avions investis : Sucrière, Transbordeur, Halle Tony Garnier, Piscine du Rhône, etc. Dès le début, nous avons voulu pérenniser ce projet, pour inscrire le festival dans la durée, dans une ville qui n’avait pas de rendez-vous sur les cultures électroniques. Pour la deuxième édition en 2004, il a eu 29 000 spectateurs, 36 000 en 2005 et 47 000 en 2006. L’événement a donc grossi très rapidement et régulièrement.
Comment l’association est-elle structurée ?
Pour les 2 premières éditions, il n’y avait pas de permanents, aujourd’hui il y en a 2, quelques intermittents du spectacle et un CDD. L’association Arty Farty développe aussi des activités connexes, même si le festival est son activité principale et représente 90 % du budget.
Nous avons par exemple une activité de production de concerts et de soirées, qui s’appelle Échos Sonores. Ce sont des événements que nous produisons nous mêmes, dans plusieurs lieux de la ville, comme au DV1, à la Marquise, à la Plateforme, etc. Mais nous pouvons aussi en produire pour le compte d’autres structures. C’est le cas par exemple des Subsistances, pour Jazz à Vienne, pour Montreux Jazz Festival en Suisse, pour la Biennale de la danse ou pour la Biennale d’art contemporain l’année dernière, etc.
Nous développons aussi une activité de booking et de management d’artistes. Cela veut dire que nous nous occupons des tournées d’un certain nombre d’artistes, qui pour la plupart sont basées localement. Il y a par exemple Flore, Paral-lel, Jackin’ Phreak, etc. Notre catalogue est encore modeste, mais il va grossir car c’est une activité que nous voulons développer.
Enfin, nous avons une petite activité éditoriale avec l’édition d’un Guide des musiques électroniques de la Région Rhône-Alpes, réalisé en co-édition avec la Région Rhône-Alpes et Lyon Capitale. C’est un guide ressources, qui existe en édition papier et en édition web.
Jouez-vous un rôle pour faire émerger une scène musicale locale ?
Oui, notamment avec le Circuit électronique programmé dans le festival. Cette nuit-là est vraiment un espace de valorisation de la scène locale émergente. Mais nous ne sommes pas dans une manifestation de type tremplins rock. Nous faisons les choses différemment.
Les professionnels sont invités à notre Village Mixmove dans la Galerie des Terreaux, où viennent 800 à 1000 programmateurs et artistes. Nous y avons aussi notre centre de presse. Nous organisons des rendez-vous entre les artistes ayant préalablement envoyé une démo au festival Nuits Sonores et les professionnels (Démo Tape Sonore). C’est la personne qui s’occupe du Mixmove qui fait une présélection, ce qui permet à une trentaine d’artistes de rencontrer un jury, composé de professionnels, de journalistes de musiques électroniques, de directeurs de festivals, de directeurs de maisons de disques, etc.
C’est parce qu’il y a ce cadre propice au travail que les professionnels vont réellement écouter la démo et donner un retour immédiat à l’artiste. Nous avons mis en place cette proposition, parce que nous avons constaté que les programmateurs et les professionnels n’écoutent pas ou très peu les démos qu’ils reçoivent, car ils sont submergés.
Plus largement, nous essayons d’accentuer fortement toute la partie professionnelle du festival. Nous intensifions notre stratégie d’accréditation de professionnels au niveau national et international. En 2006, pour la première fois, il y avait beaucoup de professionnels, essentiellement européens, ainsi que des journalistes. Il est important pour nous de faire de Nuits Sonores un lieu de travail et d’échanges et pas seulement de concerts, même si cela reste évidemment au cœur de ce que nous faisons.
Qu’est-ce qui caractérise Nuits Sonores ?
Un point me paraît très important : nous avons construit le festival de manière à l’inscrire dans le territoire urbain. C’est une idée déterminante. Nous sommes aujourd’hui parmi les derniers festivals européens à se faire vraiment dans une ville et non pas sur un seul site, dans un champ à trente kilomètres du centre ou dans un parc d’expositions. Nous avons multiplié les lieux, nous sommes très présents dans la ville, c’est-à-dire dans les rues, dans les musées, dans les bars, dans les galeries d’art contemporain, dans les cinémas, dans les friches industrielles, dans les salles de concerts, dans les clubs. C’est pour nous essentiel.
Nous investissons environ quarante ou cinquante lieux chaque année. Et pour chaque édition, 50 % sont des lieux nouveaux, ce qui représente un très fort renouvellement. Depuis le début du festival, Nuits Sonores s’est installé dans approximativement 130 ou 140 lieux différents.
Il y a beaucoup de festivals qui fonctionnent comme cela à Lyon, la Biennale de la danse par exemple, investit tous les théâtres de l’agglomération.
Oui, mais elle va essentiellement s’installer dans des lieux institutionnels faits pour accueillir du spectacle vivant comme l’Opéra, la Maison de la danse, le Transbordeur, etc. Dans notre cas, nous alors sur les toits de la Gare de Perrache, à la Piscine du Rhône, à la Sucrière… Et nous avons été les premiers à y aller, cela dit sans triomphalisme aucun.
Nous sommes le premier événement grand public à installer des musiques électroniques dans la rue, rue de l’Arbre Sec, rue de la Platière, dans des parcs comme celui de la Visitation où il n’y avait jamais eu d’événement de ce type-là. Bien sûr, nous allons aussi dans des lieux identifiés comme le Transbordeur ou la Halle Tony Garnier.
Quelles sont les orientations artistiques de Nuits Sonores ?
Nous essayons d’avoir une programmation artistique extrêmement intransigeante et équilibrée, fondée sur plusieurs axes. Il y a d’abord un équilibre entre émergence et notoriété. Nous programmons environ 200 artistes par an, qui peuvent être des artistes très émergents, très undergrounds, et d’autres plus emblématiques. Nous essayons aussi de maintenir un équilibre géographique : il y a environ 30 à 40 % d’artistes locaux et régionaux, mais également une partie significative d’artistes nationaux et internationaux. Enfin, nous avons une programmation centrée sur les cultures électroniques au sens large. Nous allons sur toutes les musiques, cultures et esthétiques innovantes, sur le hip hop, les nouvelles formes de rock, les musiques expérimentales, etc.
Ne risquez-vous pas de vous enfermer dans un genre étroit ?
Entre la fin des années des années 90 et aujourd’hui, il y a eu une mutation culturelle, artistique et esthétique. On est passé de la techno stricto sensu à une approche des musiques électroniques et des musiques innovantes au sens large. Il y a eu un basculement très net. Aujourd’hui, les artistes relevant de la techno qui se produisent dans le cadre de Nuits Sonores, représentent à peine 10 % de la programmation. Il y a donc eu une très forte ouverture esthétique. L’équipe de Nuits Sonores reflète cet éclectisme nouveau, ce qui est à mon avis primordial. Depuis deux ans, nous allons jusqu’aux courants d’innovation dans le hip hop, dans le rock.
Par ailleurs, poser des étiquettes sur chaque disque ou artiste devient un exercice très complexe : est-ce de la pop électro ou du électro hip hop ? Dans quelle case va-t-on ranger tel ou tel… Nous sommes dans une ère de très fort métissage musical, tout se télescope. Beaucoup d’artistes vont faire simultanément de la pop ou de la chanson, avec des boucles électro. La chance que nous avons aujourd’hui, c’est d’avoir une circonférence artistique très large, que nous avons appelée « panorama des musiques électroniques », et que nous pouvons transgresser sans fin.
Nous ne risquons pas de nous trouver « bloqués » dans un genre, comme si nous faisions, par exemple de la country. Notre positionnement esthétique nous permet d’évoluer avec les évolutions des artistes et du secteur artistique en général. Ce qui nous fédère dans l’équipe, et ce qui fédère le public, c’est le caractère innovant de la création musicale. Nous ne sommes pas un simple reflet de la culture mainstream et du top 20 des ventes de disques en France, comme le sont les festivals mastodontes, qui prennent les quatre ou cinq têtes d’affiche ayant vendu le plus de disques. C’est le cas des grands festivals d’été où l’on retrouve Depeche Mode, Björk, Radiohead, et encore je parle là de trucs plutôt classieux... Ça n’est pas du tout ce que nous recherchons.
Quelle est la genèse des musiques électroniques, comment peut-on les qualifier d’un point de vue esthétique ? En quoi se distinguent-elles de la musique contemporaine ou des musiques de recherche comme celles produites par Grame ?
Il y a clairement une frontière commune entre Arty Farty et les structures comme Grame ou GMVL( Groupe de Musiques Vivantes de Lyon ) qui travaillent sur les musiques contemporaines. Des membres de Grame nous ont proposé de travailler ensemble et nous avons des projets avec le GMVL. Mais il faut trouver les bonnes choses à faire ensemble. Nous pouvons par exemple nous retrouver dans notre envie de travailler avec de mêmes artistes. Mais dans les formes de représentation scéniques, dans l’historique culturel, notre histoire est très différente de la leur. Nous ne nous revendiquons pas exclusivement l’expression de musiques savantes, nous nous intéressons aussi aux musiques populaires et grand public. Notre prisme est très large, allant des musiques savantes aux expressions musicales plus populaires.
S’agissant des origines de cultures électroniques, notre histoire est très confuse, elle a plusieurs sources, très différentes. On peut par exemple y associer les artistes fondateurs des musiques concrètes, mais aussi le groupe Kraftwerk. On peut aussi inclure Derick May et Jeff Mills. Cependant, l’acte fondateur, la révolution sur laquelle nous nous appuyons remonte à une vingtaine d’année, au moment de l’avènement mondial de la techno au milieu des années 80, à Détroit, Chicago, New York, Manchester, Berlin et Paris. Ensuite, ce « mouvement » n’est pas monolithique, au sein même de l’équipe Nuits Sonores, il y a des gens qui viennent du hip hop, d’autres issus de la scène techno, d’autres encore viennent des musiques expérimentales. Les musiques électroniques sont un champ d’exploration musicale, culturelle, qui pratique volontiers le cross over.
N’y-a-t-il pas en ce moment, un mouvement allant vers un assouplissement de ces frontières autrefois très marquées ? Par exemple, il y a de plus en plus de passerelles entre design et art contemporain. Est-ce que vous constatez quelque chose de similaire entre les musiques électroniques et la musique savante contemporaine ?
Il y a beaucoup d’artistes qui s’interrogent précisément sur toutes ces passerelles, des gens qui vont parler images, arts plastiques, musique, etc. Les interconnexions se produisent au niveau d’un réseau global, très largement européen. Nous n’en sommes donc pas à l’initiative, mais nous les répercutons.
Avez-vous des liens avec les acteurs des jeux vidéo ?
Nous n’avons pour l’instant que des liens théoriques, avec Lyon Game, par exemple. Nous ressentons, de la part de nos partenaires publics une volonté assez forte, pour employer leur vocabulaire, de transversalité et d’interaction entre ces différents secteurs. C’est a priori quelque chose d’intéressant et il paraît pertinent d’essayer d’opérer ces rapprochements, mais dans les faits, il n’est pas évident de trouver des actions à conduire ensemble. Nous n’en sommes qu’au stade de la réflexion, il y a des perspectives. Aujourd’hui, on ne peut pas vraiment dire qu’il y a un vrai travail de synergie opéré avec ce secteur-là. Nous nous rencontrons souvent, nous parlons et échangeons des idées régulièrement, mais nous ne sommes pas encore allés plus loin.
Nous avons cependant un dernier axe de développement au sein d’Arty Farty, qui dépasse les frontières du festival et que nous appelons Images Sonores. Il a vocation à mettre l’accent sur l’interaction entre les musiques électroniques, les cultures électroniques et l’image, donc au sens très large, image numérique, création, VJing, vidéo scratching, toutes ces nouvelles disciplines… C’est quelque chose qui nous paraît essentiel aujourd’hui. Nous avons démarré là-dessus début 2006, notamment dans le cadre du PLSI (Programme Lyonnais pour la Société de l'Information), et cela va devenir quelque chose d’important dans notre activité, car il y a une énergie créative phénoménale sur ces questions.
Est-ce que la bande-son d’un jeu vidéo n’est pas une voie toute indiquée pour un artiste venu des musiques électroniques ?
Vis-à-vis des grands éditeurs de jeux vidéo, on voulait qu’il y ait des rencontres entre des artistes électroniques prêts à faire des bandes son pour les jeux vidéo. Puisqu’il y a pas mal d’éditeurs de jeux vidéo à Lyon et aussi de nombreux artistes de musiques électroniques, ne pourrait-il y avoir des collaborations ? La perspective est pour nous intéressante, mais ça demeure encore exceptionnel, la plupart des bandes son de jeux vidéo sont faites par des créateurs qui travaillent en interne.
En fait, il n’y a pas plus de passerelles que ça. On n’a trouvé que des gadgets comme de mettre des stations de jeu dans les salles Nuits Sonores et en soi, cela ne nous intéresse pas sous cette forme. Ce qui est intéressant, c’est de multiplier les contacts, d’être présents, de dialoguer, ne pas nous ignorer mutuellement. Cela serait suicidaire aujourd’hui. Mais on ne peut pas faire de la transversalité à tout crin, il faut que ça ait du sens. Pensez-vous que le VJing peut participer au renouveau esthétique des musiques électroniques ?
Cela va faire dix ans, voire quinze ans, que l’on voit des VJ dans les raves, dans les soirées, etc. Mais il est clair qu’il y a un gros développement depuis deux ou trois ans. Il y a une démocratisation de la fabrication de l’image, qui suit avec quelques années de décalage, la démocratisation de la fabrication de la musique. Le principe du home studio qui permet de travailler chez soi, a été central pour les musiques électroniques. C’est comme cela qu’ont été faits la plupart des grands albums de l’histoire de la techno et des musiques électroniques, en bricolant à la maison.
Là où il fallait des moyens monstres il y a encore dix ans pour faire un film, court ou long, le numérique fracasse toutes les logiques de création en la matière. Le festival Cinéma Nouvelle Génération en témoigne clairement, leur projet étant de montrer comment la révolution numérique change la façon de faire du cinéma, jusque dans son esthétique évidemment. Je pense que c’est une révolution plus importante encore que l’apparition du parlant ou de la couleur. C’est fondamental. L’Institut Lumière lui-même s’équipe d’un projecteur numérique.
Nous savons donc, au vu de ce constat, qu’il va y avoir dans les années à venir une créativité très forte dans ce domaine. Beaucoup d’artistes sont apparus depuis trois ou quatre ans en travaillant sur ce créneau-là. Il y a une interaction cruciale entre musiques électroniques et création d’images numériques. Il serait donc inepte de ne pas être à l’écoute de ce processus et de ne pas nous en faire l’écho, via une section, que nous appelons Images Sonores.
En quoi consiste la programmation Images Sonores ?
Images Sonores est un parcours à l’intérieur et au-delà du festival, qui se décline sur trois axes :
Un axe de réflexion et de théorisation, pour poser des questions, etc. Cela a donné lieu en 2006 à un cycle de conférences au Palais de Bondy, sous la direction morale de Jean-Yves Leloup, avec de très nombreux invités : VJ, théoriciens, et autres acteurs qui s’interrogent sur ces questions.
Un deuxième axe qui aborde l’aspect industriel et technique, via des workshops et des rencontres entre des personnes qui travaillent aujourd’hui sur ces matériels.
Et puis évidemment un troisième axe, artistique cette fois, avec des démonstrations programmées dans les soirées Nuits Sonores, avec la venue d’artistes VJ ou vidéo scratcheurs, plus ou moins emblématiques de ce nouveau phénomène.
Est-ce que le VJing va, comme le DJing, pouvoir se faire « à la maison », avec des artistes qui vont en devenir des spécialistes ? Est-ce qu’on pourra aussi faire des jeux vidéo « à la maison » ?
On voit aujourd’hui qu’il y a des éditeurs de jeux vidéo presque aussi underground que certains labels de musique. Mais je crois que le processus de développement d’un jeu demande des moyens différents. Cela demande encore des investissements plus lourds. Aujourd’hui n’importe qui peut faire un album chez lui, s’il est un peu créatif. N’importe quel G5 un peu costaud rend la chose possible. Ça n’est peut-être pas tout à fait le cas des jeux vidéo…
Et n’y-a-t-il pas un moyen d’envisager un événement croisé, qui mêle musique électronique et jeux vidéo
On a été maintes fois sollicités, notamment par Lyon Game et par d’autres acteurs, pour mettre en place des choses. Nous avons donné des coups de main, pour des soirées avec des artistes. Tout est envisageable, et il est vrai que nous avons des centres d’intérêt complémentaires pour une partie importante du public. En simplifiant, le kid de dix-huit ans qui télécharge sa musique sur tel ou tel site de peer to peer, qui joue en ligne sur son ordinateur et qui va boire des coups avec ses potes étudiants dans des bars le soir, sera très probablement à Nuits Sonores. Mais cela fait tout de même plusieurs mois, voire plusieurs années que nous nous posons ces questions. On tâtonne, on réfléchit, on se rencontre de temps en temps, il y a des stimulis apportés par les collectivités. Mais aujourd’hui il n’y a jamais vraiment eu d’idée forte qui se soit imposée. Cela viendra peut-être.
Je pense qu’à terme, le développement du Mixmove dans le cadre de Nuits Sonores, permettra d’accueillir Lyon Game à un titre ou à un autre. À l’inverse, leur projet de festival du jeu vidéo, dont je ne sais toujours pas s’il va aboutir ou pas, mais si la réponse était positive, alors il serait vraisemblable qu’on y participe.
Comment vous situez-vous dans le paysage événementiel de l’agglomération ?
Nuits Sonores est le résultat de six mois de brainstorming, pour cerner ce dont nous avions envie, pour réfléchir à l’échelle de la ville, à son identité. Ce festival est fait pour Lyon, il ne pourrait pas être fait ailleurs aujourd’hui. La ville est à la bonne taille, son centre, relativement petit, permet d’être très facilement mobile. Nous voulions cette mobilité, pour faire un festival déambulatoire. Les TransMusicales de Rennes, dans leurs premières éditions, étaient un festival très urbain, aujourd’hui c’est différent, le gros du festival se tient dans le parc des expositions à onze kilomètres du centre, mais à ses débuts, sa grande qualité était d’être éclaté dans la ville. Je trouvais ça génial. Cela se fait de moins en moins car il est difficile de sécuriser des lieux qui ne sont pas faits pour le concert. Et puis en termes budgétaires, c’est plus complexe. Il serait beaucoup plus simple d’aller nous poser une semaine dans la Halle Tony Garnier ou à Eurexpo.
Ainsi, il y a un rendez-vous quotidien dans l’espace public. Cette année c’était Jeudi rue de la Platière, Vendredi rue Royale, Samedi rue de l’Arbre sec, Dimanche au Parc de la Cerisaie. Pour chacun de ces rendez-vous, il y a entre 2000 et 5000 personnes. Ça ne passe donc pas inaperçu… Ce sont des moments importants pour nous, ils ont leur place dans le programme.
Nous voulons cette effervescence urbaine… Il y a aussi une tendance à sortir des murs, mais ces questions se posent aussi beaucoup à la suite de Nuits Sonores. C’est par exemple le cas de Quais du Polar, qui cherche à investir des lieux inédits, etc. Je trouve cela très intéressant et je me réjouis que tout le monde le fasse.
En étant dans la rue, est-ce que vous ne vous privez pas de ressources en termes d’entrées ?
Oui, 50 % de la fréquentation du festival est gratuite. Mais les concerts payants marchent bien, ils permettent en partie de financer le reste. Nous avons une structure budgétaire intéressante : grosso modo, le festival s’autofinance à 60 %, par la billetterie et les bars, le partenariat privé (10 % environ). Le tiers restant provient de financements publics, Ville, Région, État.
Lorsque nous avons commencé, nous avions une structure budgétaire différente, il y a eu une montée en puissance de l’autofinancement qui est de plus en plus important chaque année, et depuis la création du festival, il a plus que doublé. La subvention de la Ville est stable, elle n’a pas bougé d’un centime depuis la première année, elle a toujours été exactement au même niveau. Du coup en pourcentage, la part Ville est maintenant à 25 %, ce que j’interprète comme un signe positif.
Ce fort autofinancement ne risque-t-il pas de peser sur la programmation, de vous orienter vers des choses plus commerciales ?
C’est une question d’équilibre, un événement qui a vocation à défendre des esthétiques non rentables, en particulier quand elles sont gratuites, et qui a aussi une vocation de développement de la scène locale, ces démarches-là doivent être aidées par un financement public.
Par ailleurs, je soutiens aussi que l’autonomie artistique, l’indépendance artistique de notre projet passe aussi par une indépendance économique. Nous ne sommes par exemple pas une structure en régie directe, ce qui n’est pas le cas de beaucoup d’autres événements ou institutions culturelles dans cette ville. Notre structure est totalement indépendante, nous avons la liberté de programmation, de communication, nous faisons les choses comme nous voulons les faire. Ceci est possible parce que nous assumons 70 % de notre budget.
Quels sont les liens que vous entretenez avec vos partenaires privés ?
Nous cherchons à faire un sponsoring intelligent. Les responsables de développement marketing des grandes marques sont tous intéressés par Nuits Sonores, qui leur permet une capitalisation en termes d’image très forte. Mais nous sommes intransigeants sur la non visibilité des marques dans l’événement. Il n’y a pas à Nuits Sonores de banderoles sur la scène ou dans les bars, le marketing est extrêmement minimal.
Nous essayons de conjuguer la propreté esthétique de l’événement, pour ne pas en faire une foire au marketing comme c’est le cas sur beaucoup d’événements aujourd’hui, tout en conservant ces partenaires, car ils peuvent contribuer au développement du projet et asseoir son indépendance économique.
Avez-vous la possibilité de produire ou de passer une commande auprès d’un artiste ou d’un groupe d’artistes… ?
Nous commençons à le faire, nous avons deux ou trois gros projets pour des œuvres scéniques, inscrites au programme de Nuits Sonores 2007. Il y a cependant une limite à cela qui est le coût très important de ce type d’activités. Nous n’avons pas de financement spécifiquement là-dessus. Avec une diversification sur l’image, nous allons aussi être en mesure de solliciter des participations auprès d’autres opérateurs, comme le Dicréam. C’est un fond de soutien à la création d’images numériques, co-piloté par le Ministère de la culture et le CNC, qui dispose d’une ligne budgétaire pour la création d’œuvres dans les événements.
Dans le cadre de votre volonté de faire le festival autrement, avez-vous initié aussi des expériences faisant participer le public ? Y-a-t-il des ateliers de pratiques artistiques ?
Dans le cadre du festival, ce qui pourrait être perçu comme l’équivalent de l’Art sur la Place pour la Biennale d’art contemporain ou du Défilé pour la Biennale de la danse, est ce que nous appelons le Circuit électronique. Tout d’abord parce que c’est gratuit. Le Circuit électronique se tient toute la nuit du Jeudi de l’Ascension. Il y a neuf étapes différentes dans la ville, soit neuf soirées, qui rassemblent environ 15 000 personnes au total. Chacune est portée par une structure locale, opérant toute l’année dans le champ des musiques électroniques.
Comment expliquez-vous le succès de Nuits Sonores ?
Je ne crois pas que Nuits Sonores aurait pu réussir ailleurs, car plusieurs facteurs se sont conjugués ici. Le premier facteur, et même si je fais preuve d’un manque de modestie flagrant, est que notre projet est bon. Ce que nous faisons, c’est quasiment, à la virgule près, ce que nous avions écrit. Nous ne nous sommes pas trompés, mais nous avons aussi beaucoup travaillé en amont.
Le deuxième facteur de réussite s’explique par la ville : nous étions dans la bonne ville, au bon moment. Il y avait une carence manifeste dans ce domaine-là localement, et il y a eu aussi un renouveau esthétique dans le secteur des musiques électroniques. Il y a eu un creux assez net à la fin des années 90, c’était une période de transition assez difficile.
Le troisième facteur est qu’il y a eu un accompagnement idéal de la part des partenaires publics. Il a été intelligent et bien dosé. Et je ne parle pas que d’argent, mais il a aussi rendu les choses possibles, il a favorisé les accès aux lieux, etc. Beaucoup de gens à l’Hôtel de Ville se sont investis pour que nos idées se concrétisent. Il fallait que les gens soient disponibles et il fallait aussi un certain volontarisme : aller mettre du son à la Piscine du Rhône, dans un équipement sportif donc, ça n’a rien d’évident pour une mairie au premier abord…
N’est-ce pas finalement le « label » Nuits Sonores qui attire le public, beaucoup plus que les têtes d’affiches ?
Oui, et nous n’attirons pas que les seuls aficionados, qui doivent être 2 ou 3000 à Lyon. Il nous faut donc aller chercher le public bien au-delà de ce cercle et au-delà de Lyon. Les gens viennent sur le label du festival et sur le fait qu’il y a une articulation artistique, un travail de défrichage, dans une atmosphère conviviale, festive. Les spectateurs viennent chercher ça, plutôt qu’une série de noms, ce qui est une chance pour nous. Nous ne sommes pas obligés de tomber dans la course en avant délirante dans laquelle sont les plus gros festivals européens aujourd’hui, qui font de la surenchère, des affiches gigantesques, des cachets délirants, etc. Nos plus gros cachets sont 25 fois inférieurs au plus gros cachet de ces gros festivals ce qui est bien sûr une chance pour nous.Pourquoi la ville s’est-elle investie comme cela sur les musiques électroniques ?
Je pense que nous avons su créer une certaine forme d’enthousiasme et nous avons réussi à faire passer le message que les musiques électroniques sont une pratique artistique, une culture, et pas un rassemblement de « teufeurs ». Une option qui n’était pas gagnée d’avance… Ces musiques méritaient aussi d’être défendues parce qu’il y a dans cette ville des artistes. Il y a un terreau proprement hallucinant, qu’il faut protéger au quotidien et qui doit pouvoir être montré à l’extérieur, au niveau international, dans le cadre d’un temps fort et symbolique comme Nuits Sonores.
Comme je me promène pas mal en Europe, j’ai pu me rendre compte à quel point Lyon n’existait pas sur la carte des cultures électroniques avant Nuits Sonores. Et à quel point la situation s’est transformée. Pour la première fois, à Cologne j’ai croisé des artistes lyonnais en show case. Aujourd’hui, il n’y a pratiquement pas un festival en Europe qui n’invite au moins un ou deux artistes lyonnais.
Des groupes comme le Peuple de l’Herbe, High Tone, ont été aussi porteurs, ou encore Agoria, qui est numéro un français sur son secteur. Il y a toute une génération d’artistes, comme Flore, Paral-lel, Hervé AK : tous ces gens-là signent des disques en Angleterre, en Allemagne. Ils sont reconnus dans leur secteur, même s’ils ne sont pas aujourd’hui des mégas stars. Il y a une scène des musiques électroniques et un vivier réel. Et pour le VJing, l’image, c’est la même chose, il y a des labels, il y a des activistes.
Comment expliquez-vous qu’autant d’artistes émergent sur ces disciplines à Lyon, alors qu’il n’y a quasiment aucune institution pour les montrer ou les former ?
Je pense qu’il y a une corrélation très nette entre les deux. Le hip hop, le breakbeat, la drum’n bass, le dub, la techno, toutes ces esthétiques sont nées dans l’alternatif qui pousse bien souvent là où l’institution a créé un climat susceptible de faire naître « autre chose ». Par ailleurs, et ce sont des artistes comme Agoria qui le disent, l’atmosphère de travail est bonne car il ne se passe rien… Il n’y a pas de clubs pour vous distraire du travail… Lyon n’a jamais été remarqué au niveau européen pour son excentricité ou sa vie nocturne débridée.
Cela pousse pas mal de gens dans l’underground à travailler de leur côté, en réseau, dans le milieu associatif. Aujourd’hui il y a un résultat très protéiforme. La situation demeure très difficile, beaucoup d’artistes ne vivent pas de leur pratique, mais ils sortent des disques, beaucoup de choses se passent et plus ici que dans toutes les autres villes de province. Et même dans une comparaison européenne, nous sommes dans la course. Avec le festival et les outils développés par Arty Farty, le studio du Peuple de l’Herbe aux Subsistances, les Subsistances elles-mêmes, la Biennale d’art contemporain, font que le contexte a changé et permet l’expression de nouvelles choses.
Vous avez plusieurs fois fait allusion au territoire de la ville, à l’Europe, mais est-ce que vous vous tournez par exemple vers Saint-Étienne ? Est-ce que vous avez envisagé d’y développer Nuits Sonores ?
Le développement d’Arty Farty et de Nuits Sonores en dehors de l’agglomération est une évidence et notre terrain de jeu naturel a une circonférence plus large que Rhône-Alpes : notre penchant naturel nous pousse à travailler au niveau européen, car c’est là que se trouve notre échelle artistique et professionnelle. Nous sommes dans une culture de grandes métropoles européennes. La carte qui nous intéresse passe par Berlin, Barcelone, Manchester, Londres, Paris, Lyon, Zurich, Cologne.
Hors de ça, il y a des villes et des ressources en Rhône-Alpes. Nous avons par exemple été à l’origine d’un guide régional des musiques électroniques. Car nous savons aussi qu’un artiste comme The Hacker qui vient de Grenoble ou des musiciens comme Brain Damage basés à Saint-Étienne, vus d’Allemagne sont considérés comme « lyonnais ».
Nous collaborons beaucoup en région. On y fait un peu partout des Échos Sonores, il y a des étapes de Nuits Sonores et une tournée de présentation du festival en mars/avril, où nous allons systématiquement à Saint-Étienne et Grenoble. Nous travaillons peut-être plus avec Grenoble qu’avec Saint-Étienne, en raison de la présence du label Goodlife, label pionnier avec The Hacker, Miss Kittin, Oxia. Pour Saint-Étienne, nous avons eu des touches pour des collaborations, notamment dans le cadre de la Biennale internationale du design qui pour l’instant n’ont pas encore abouti. Mais il est évident que nous sommes demandeurs de collaborations de cette nature. Cela dit, les artistes sont présents, il n’y a pas une édition de Nuits Sonores sur laquelle il n’y ait d’artistes stéphanois.
Il y a des collectifs d’artistes, comme Avatarium qui sont à la fois un festival et une structure, fonctionnant dans une dynamique proche de la nôtre. Il y a un ou deux disquaires, mais il n’y a pas énormément d’acteurs sur Saint-Étienne. Il y a bien sûr quelques artistes. Par contre, le public stéphanois vient massivement sur Nuits Sonores. Il est clair que ce territoire est complètement cohérent aussi pour nous. Le public de Rhône-Alpes représente à peu près 50 % de la fréquentation du festival, les 50 % restant venant d’ailleurs en France, Parisiens, Marseillais, et de l’étranger.
Peut-on dire que le festival vous permet de développer des activités comme le booking ou l’organisation de soirée et donc de structurer une activité à l’année ?
En effet, il y a une suite logique. Avec le festival, nous nous sommes assez vite aperçus que tous les éléments nécessaires au booking sont réunis dans un bureau comme celui de Nuits Sonores. Les acheteurs potentiels d’artistes, les salles, les clubs, les salles de concert, les autres festivals, etc, sont référencés ici. Nous travaillons avec eux, ainsi qu’avec les bookers internationaux et bien sûr les artistes. Nous avons donc toutes les clés pour le faire et à partir de là, il est tentant de s’y mettre. Et puis, en raison de la présence d’artistes locaux auxquels on croit, nous sommes aussi incités à aider à leur développement, en leur faisant bénéficier de notre réseau.
Vous vous dirigez plutôt vers une agence d’artistes ou un label ?
Non, le label aujourd’hui n’est pas dans nos priorités, ne serait-ce que parce que c’est une activité en décroissance, en raison du téléchargement. Nous n’éditons même pas de compilation des Nuits Sonores, car c’est économiquement suicidaire. Le disque c’est non, clairement, mais l’agence artistique, oui. Cela contribuera, au-delà du festival à pérenniser la structure et surtout l’équipe, ce qui est beaucoup plus difficile.
Actuellement, en pourcentage, nos frais de fonctionnement sont quatre à cinq fois inférieurs à ceux de n’importe quelle institution culturelle. Cela veut dire que, depuis le début, tous nos moyens ont été mis dans le festival, dans la programmation, dans la communication, dans l’aménagement des lieux, et quasiment rien sur les salaires ou l’équipement des bureaux. Depuis deux ans j’essaie de rééquilibrer un peu les choses, car passé un certain temps, le bénévolat et le volontarisme ont leurs limites. Il nous faut nous professionnaliser.
Aujourd’hui, il est clair qu’il faut développer un peu la part structure, et pour cela, une des voies possibles est de développer l’activité autour du festival. Cela ne veut pas dire que nous allons faire du merchandising à outrance ou faire tout autre chose. Mais le booking artistique, sur des artistes du cru, sont le cœur de notre métier. Le programme Images Sonores répond à cette même logique. Nous voulons donc créer des activités connexes, pour pouvoir structurer une équipe permanente.
Quelles sont aujourd’hui les perspectives de développement du festival lui-même ?
Actuellement, nous sommes très investis dans le développement international de Nuits Sonores, qui me paraît incontournable. Nous avons réussi, en quatre ans, à imposer cet événement comme le rendez-vous numéro un en France sur ce secteur. Nous voulons maintenant que ce rendez-vous existe au niveau européen, en développant le public international, et en développant la présence professionnelle internationale. C’est très important. Intellectuellement ça paraît une évidence de rechercher que cet événement soit international, cosmopolite, mixte. Qu’il soit un lieu de rencontres, de brassage… Ça fait du bien et je pense que cette ville en a besoin.
Envisagez-vous de développer l’accueil des professionnels, comme peut le faire la Biennale de la danse
Oui, mais plus que la danse, nous sommes un secteur carrefour, qui permet d’accueillir les gens qui travaillent dans le secteur musical, du disque et au sens très large, des musiques électroniques et nouvelles en général. On peut aussi accueillir les gens qui travaillent sur les nouvelles technologies. Nous nous posons la question de savoir comment accueillir les professionnels, que leur proposer dans le cadre de Nuits Sonores, etc.
Quelles relations entretenez-vous avec l’industrie ? Ne pourriez-vous pas trouver là aussi, des ressources nouvelles ?
Nous n’avons pas autant investi là-dedans que Grame, c’est une évidence. Cela dit, le Mixmove est le lieu du festival dédié à ces questionnements. Des fabricants viennent chaque année ici montrer et discuter autour de ce qu’ils font, aussi bien dans la musique que maintenant dans l’image, puisqu’il y a Images Sonores.
Des gens comme Pioneer, ou d’autres qui fabriquent des tables de mixage, l’Ircam même, avaient un stand ici. Nous avons donc des contacts et des relations avec ces acteurs, parce qu’ils sont intéressés par l’ouverture que nous pouvons leur procurer. Quand ils sont venus, ils étaient au milieu d’un environnement qui n’est pas du tout le leur, et ils ont beaucoup apprécié ça, c’était quelque chose de super intéressant.