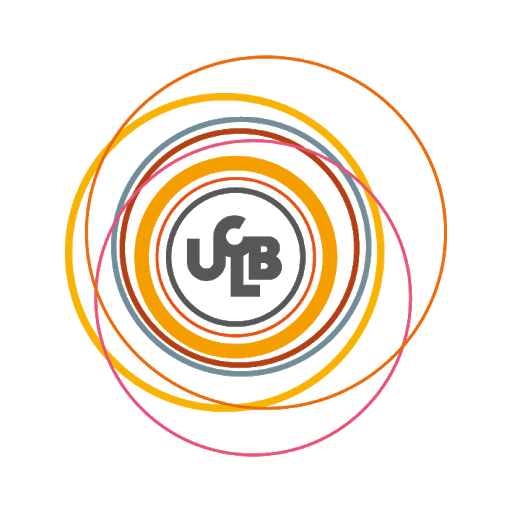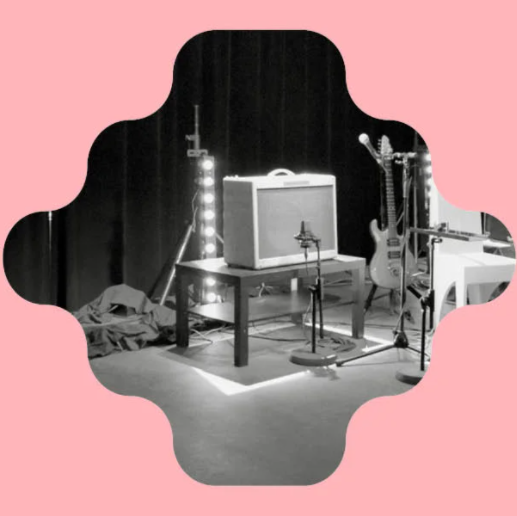Vous écrivez dans votre livre Mémoire année zéro que nous sommes guettés par "une inflation mémorielle" qui crée une "bulle" et pourrait déboucher sur un véritable krach, donc un chaos, qui nous condamnerait à un éternel présent sans conscience historique. Quels en sont les symptômes actuels ?
Chaque jour, on produit de la mémoire : celle-ci est non seulement devenue un sujet politique, intellectuel, mais aussi un objet culturel et économique. A travers nos ordinateurs, toutes les cartes mémoires que nous embarquons avec nous, nous enregistrons en permanence. Tout cela crée de la mémoire, et une capacité d’interpellation permanente. Un symptôme actuel parmi d’autres : le débat public est régulièrement scandé par la mémoire. C’est elle qui donne le "la". Il s’agit soit d’une mémoire à caractère historique –les lois mémorielles, par exemple -, soit d’une mémoire anniversaire. Il suffit de discuter avec les rédacteurs des grands médias : en plus des « marronniers », on célèbre désormais en permanence des anniversaires : les 25 ans de ceci, les 10 ans de cela. Ça peut prendre des proportions énormes, comme on l’a vu avec le mur de Berlin. Mais on peut aussi prendre le cas de célébrations traditionnelles, comme à Lyon avec la Fête des Lumières et le 8 décembre. C’est une très forte nécessité, rattachée probablement à des besoins identitaires.
Et puis il y a une mémoire plus sauvage et plus frivole, celle qui fait qu’on peut vous rappeler en permanence que, il y a deux ans, vous aviez dit telle ou telle chose. Internet crée des phénomènes très éruptifs. L’apparition de ce nouveau média a bouleversé le débat public, qui est sans cesse percuté par la mémoire. Avec ce rappel permanent du passé, c’est un peu comme si notre société avait le hoquet, tout se répète sans cesse. Cela remet en cause notre capacité à construire un avenir, à imaginer qu’un progrès est possible… C’est une vraie préoccupation.
Ce phénomène est encore amplifié par le fait qu’avec le numérique, nous sommes passés d’une mémoire de stock, forcément bornée par les capacités de notre cerveau et les espaces physiques de conservation, à une mémoire de flux, extensible dans l’espace et le temps, dynamique, que tout le monde peut alimenter !
Il y a deux crises qui s’additionnent : d’abord, la crise d’une forme de mémoire assez classique qui est à la fois celle des hommes et des livres, dans un cadre national qui traverse une crise identitaire. Cette mémoire a en effet été très perturbée ; un certain nombre de mensonges, d’interrogations ou de mythes s’y sont greffés. On a donc une société qui, par rapport à son histoire, à sa mémoire, a un problème de confiance. Est-ce qu’on m’a vraiment raconté la bonne histoire, est-ce qu’on m’a tout dit ?
A cette crise de la mémoire classique s’en ajoute une seconde, de croissance celle-là : la crise de la mémoire numérique. Avec Internet, on constate un nouveau phénomène inconnu jusque là : la capacité de ne rien oublier, de tout stocker en permanence. L’addition d’une crise identitaire dans la mémoire classique et d’une crise de croissance dans la mémoire numérique crée un phénomène de surplace et le sentiment que l’histoire s’est plus ou moins arrêtée. Plutôt que d’être orienté vers le progrès, on reproduit le passé.
Vous établissez un parallèle avec la crise économique actuelle. Et comme pour celle-ci, vous estimez que la solution passe par l’intervention de la puissance publique. Pourquoi est-ce à la puissance publique d’agir et comment peut-elle agir ?
On voit aujourd’hui des monopoles d’informations se construire. Et une masse croissante d’informations personnelles sont gérées par des groupes privés à des fins commerciales. Face à cela, c’est aux Etats d’intervenir. De tout temps, les Etats ont organisé des politiques de la mémoire : on a construit des bibliothèques et des archives nationales, on créé des musées, organisé des espaces où les témoignages du passé comme du présent étaient stockés, classés. Naturellement, les citoyens peuvent en faire une libre utilisation, en fonction de leurs besoins. Il paraît inimaginable que la puissance publique ne se saisisse pas tôt ou tard de la question de la régulation d’Internet. Elle a commencé à le faire en instaurant le dépôt légal du Web, qui s’ajoute à celui de l’édition et de la radio-télévision. Il faudra aussi mettre en place non seulement des outils mais des propositions de service public pour hiérarchiser les dispositifs de savoir qui sont sur Internet. Si j’ai, à travers une requête sur Internet, une liste de 25 pages de 10 propositions chacune, je suis bien en peine de pouvoir distinguer là-dedans ce qui est pertinent de ce qui relève du commercial.
Vous vous inquiétez pour les "digital natives" qui ne sauront peut-être plus distinguer le vrai du faux, le réel du virtuel. N’y a t’il pas là un enjeu éducatif ?
Oui, tout passe par l’éducation. Plus l’information se déploie dans le monde du virtuel ou du numérique, plus les dispositifs réels d’acquisition du savoir sont capitaux. Car c’est cela qui permet de faire naître un espace critique. La société ne repose pas seulement sur des consommateurs mais sur des citoyens et la vertu du citoyen, ce sont le sens critique et la capacité de choisir, que seules la culture et l’éducation peuvent offrir. En même temps il faut, sur Internet, développer des espaces où le savoir et l’information sont validés, garantis. Si tel site est labellisé avec par exemple un logo « ministère de l’Education nationale », je sais que je peux y aller ! Aujourd’hui, tout cela est en devenir.
Ces politiques du savoir numérique ne peuvent-elles pas se mettre en place aussi à l’échelle territoriale
Pour toutes les collectivités locales dont les budgets autour de l’éducation (lycées, collèges…) sont importants, qui disposent de réseaux Internet et qui investissent beaucoup sur les contenus, ce sont des éléments absolument capitaux et stratégiques. C’est la question de la production de données, de leur authentification, de leur labellisation, puis de leur référencement. En effet, même si l’on propose une information pertinente, on n’est jamais sûr d’être bien classés dans les résultats de requêtes des moteurs de recherches. C’est un vrai sujet : il ne suffit pas de développer sur Internet des espaces de savoir, encore faut-il que les conditions d’accès soient faciles, simples et transparentes.
Pourquoi ne doit-on pas s’en remettre aux moteurs de recherche existants, aux mains de firmes privées ?
On est bien obligés de s’en remettre à eux, puisqu’il s’agit aujourd’hui du seul mode d’accès à l’information. Mais le problème est que l’un de ces moteurs est en train d’installer un quasi monopole, ou, du moins, une position fortement dominante. Paradoxalement, on n’imagine pas que, dans le monde réel, 80% des bibliothèques, des librairies ou des kiosques à journaux soient placés sous la même bannière, la même marque. Or c’est bien ce qui se passe sur Internet : l’accès au savoir passe par un moteur de recherche quasiment unique, Google. Et si ce dernier est dans une telle position, c’est qu’il y a un vrai savoir-faire à la clé. Et la diversité, ce n’est pas que l’expression d’un souhait. Cela passe aussi par des mesures de régulation.
Quelles mesures de régulation pourraient être prises ?
Dans le monde réel, il existe des lois anti-trust pour éviter les positions trop dominantes et préserver une saine concurrence entre une multiplicité d’acteurs économiques. Il n’y a pas de raison que ce principe ne s’applique pas aussi au monde numérique. Jusqu’à aujourd’hui, les législateurs ou les régulateurs s’en sont peu occupé, sans doute pour deux raisons principales. D’abord pour une question de temps : tous les phénomènes que nous venons de citer sont assez récents, ils ont à peine 10 ans. Ensuite pour des raisons culturelles : globalement ceux qui nous dirigent vont assez peu sur Internet. C’est un problème générationnel. Mais quand les enfants de leurs enfants seront adultes, sera-t-il encore temps d’agir pour dénouer la situation ? Je suis absolument certain que la question de la création d’un habeas corpus numérique se posera, que la question du droit à l’oubli s’organisera.
Qu’entendez-vous par « habeas corpus numérique » ?
Aujourd’hui, toute une partie de notre activité - voire de nous-mêmes - est enregistrée sur Internet. Mes coordonnées bancaires, ce que je recherche sur les moteurs, ce que je raconte sur Facebook, Twitter, etc. Toute cette masse de données est déjà traitée et utilisée à des fins commerciales, pour nous adresser des messages publicitaires. Dans un deuxième temps, ces données peuvent aussi avoir un impact sur notre vie sociale. Aux Etats-Unis, 60% des directeurs de ressources humaines vont désormais sur Facebook avant de mener un entretien de recrutement. Il y a quelques mois, à la question « quel est le conseil que vous pourriez nous donner pour devenir président des Etats-Unis ? », Barack Obama répondait à des lycéens américains : « Pour commencer, je voudrais que vous tous fassiez attention à ce que vous postez sur Facebook, parce qu’à l’époque de YouTube, quoique vous fassiez, on vous le ressortira à un moment ou un autre de votre vie. ». Ce n’est pas qu’une boutade. Venant du président de la première puissance mondiale, qui a été le premier à utiliser massivement Internet pour se faire élire, cela n’a rien d’anodin. Demain, les citoyens diront stop ! L’idée qu’on puisse avoir des droits sur Internet, comme le droit à la gestion de sa mémoire et de sa propre histoire fera son chemin.
D’ailleurs, depuis que le livre est sorti, les colloques se multiplient sur le sujet. Google propose pour sa part un nouveau service Dashboard, qui permet de visualiser d’un coup toutes les informations personnelles stockées sur vous par Google, afin de mieux les contrôler. Les grandes sociétés du Net comme Microsoft, Yahoo ou Amazon commencent à proposer des rythmes plus serrés d’écrasement des données. C’est une question qui deviendra de plus en plus importante.
Vous avez signé une tribune dans le quotidien Le Monde intitulée "le pacte faustien". Pensez-vous vraiment qu’en passant un accord avec Google pour la numérisation d’une partie de ses fonds, la Bibliothèque municipale de Lyon a signé un pacte avec le Diable ?
En utilisant cette expression, il ne s’agissait pas de comparer Google avec le diable, mais plutôt de montrer que, comme dans la légende de Faust, sa promesse de nous offrir immédiatement la jeunesse éternelle via la numérisation se doublait en fait de conséquences beaucoup moins heureuses à plus long terme. En l’occurrence que Google prenne en main les destinées de notre héritage culturel. Je comprends tout à fait que, en l’absence d’autres financements, la bibliothèque de Lyon ait voulu faire appel à cette société pour la numérisation de ses fonds. Mais au-delà des enjeux locaux, face à un géant comme Google, je pense qu’il faut définir une véritable stratégie nationale, en gardant à l’esprit que c’est une société privée dont l’action n’est nullement désintéressée. Il n’est pas possible de confier à Google tout notre patrimoine sans contreparties ni garanties solides.
Pour vous, « cultiver » Internet, c’est aussi le « cartographier », en donner une représentation, l’urbaniser, y créer des repères, des labels.… En quoi est-ce important de « matérialiser » Internet ?
La cartographie d’Internet est, je crois, une idée très importante. Internet produit encore beaucoup de fantasmes, car nous ne le visualisons pas encore. Nous n’en avons pas une représentation concrète qui soit à notre portée. De ce point de vue là, nous sommes à peu près les égaux des Grecs ou des Romains de l’antiquité, qui savaient qu’un monde existait autour de la Méditerranée, sans pour autant en avoir une représentation précise. C’est quand on a commencé à cartographier qu’on a pu vraiment organiser les territoires. Je crois donc que la cartographie d’Internet est capitale parce que c’est à partir de ce moment-là qu’on verra un espace, une organisation du savoir. On pourra alors commencer à avoir une approche plus rationnelle, à ne plus seulement être dans un discours finalement très émotif.
Ne craignez-vous pas de passer pour pessimiste ?
Face à Internet je suis dans une situation un peu paradoxale dans ce livre. D’un côté, je pointe un certain nombre de déficiences, de manques ou de carences à combler. Et en même, avec l’INA, nous avons mis 25 000 heures en ligne gratuitement. On a donc une vraie stratégie sur Internet, qui est très ouverte, très disponible, très collaborative, avec la possibilité de faire tous les commentaires qu’on veut, d’exporter notre player etc. Mais ça ne m’interdit pas de penser que la production de savoir, la pédagogie, ça ne s’est jamais fait de façon spontanée. Il y a quelqu’un qui sait, il y a quelqu’un qui transmet. Une fois qu’on a la capacité de savoir, on peut dire « non je ne suis pas d’accord avec toi, je pense que telle chose est plus importante que telle autre ».
Ces dispositifs de pédagogie, d’appropriation du savoir, de hiérarchisation des connaissances passent par des dispositifs qui ne sont pas seulement à caractère horizontal. Un peu de verticalité, c’est absolument nécessaire. Car un excès d’horizontalité peut créer un phénomène de nivellement qui, pour moi, bénéficie toujours aux mêmes : à ceux qui savent déjà. Internet n’est pas simplement un espace neutre et gratuit, c’est aussi une économie qui génère beaucoup de profits. Il faut être très lucide sur cette forme de liberté en apparence absolue, qui en fait s’organise aussi selon une logique économique. Non pas pour la contester, pour l’abolir, car Internet est là, et c’est tant mieux ! Mais il n’est pas interdit d’y réfléchir, et il faut que l’esprit critique puisse s’exercer aussi dans cet espace-là. Je suis un optimiste d’action.