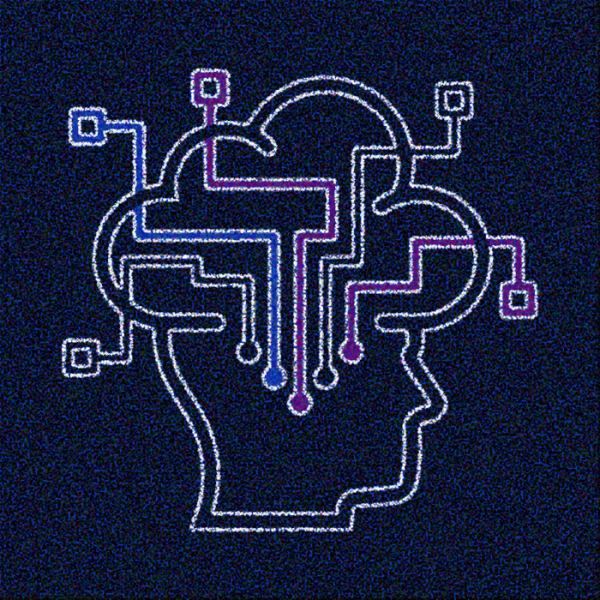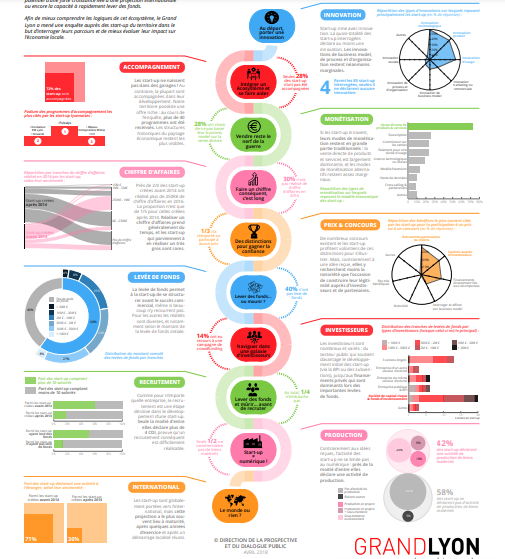Vous avez créé, il y a 6 ans une startup nommée Fluorem, pouvez-vous expliquer comment cela s’est passé ?
Au départ, nous étions deux chercheurs, Stéphane Aubert et moi-même, issus du Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique (LFMA) de l’Ecole Centrale de Lyon. Nous avons développé des logiciels de simulation d’écoulement. Nous avions des objectifs de recherche : les logiciels développés devaient nous aider à comprendre les phénomènes physiques. Il n’y avait pas sur le marché ou dans les laboratoires des logiciels qui permettaient de faire ce que nous souhaitions. Nous avons donc du développer ces logiciels.
Puis, une société nommée Cadoé est venue nous voir pour nous dire qu’elle avait développé une technologie particulière en mécanique des structures et qu’elle voulait développer cette technologie en mécanique des fluides. Nous avons donc développé un outil qui permet de faire de la « paramétrisation », c’est-à-dire des balayages de paramètres de formes et d’obtenir les solutions associées à ces paramètres. Cela permet de construire des bases de données qui seront ré-exploitées pour faire de la simulation, de la conception, du dessin, etc. dans le domaine de la mécanique des fluides.
Comme nous avions d’autres idées pour développer ces logiciels et que nous avions besoin de personnels, nous avons alors cherché des solutions. Au sein du laboratoire, les choses sont assez figées : bien qu’il y ait des étudiants en thèse, nous avons un recrutement tous les 10 ans ! Nous avons essayé de nous appuyer sur les structures existant à l’Ecole Centrale sans trop de succès, finalement, nous avons décidé de créer notre propre entreprise.
J’avais travaillé un an aux Etats-Unis et ce genre de pratique est très courant. De son côté, Stéphane Aubert a passé un an en Angleterre et son retour d’expérience a aussi été très positif. Aussi, cela nous a incité à tenter l’aventure ici. D’une part, on a constaté que, sur la technologie que nous voulions développer, nous étions vraiment en avance. D’autre part, nous avons vu que la création d’entreprise innovante par des chercheurs se faisait aisément à l’étranger. Dès que la loi sur l’innovation de 1999 a pu être appliquée, nous avons d’emblée créé Fluorem.
Avez-vous reçu des aides ? des soutiens ?
Des aides et des soutiens, vraiment beaucoup et c’est le grand point positif de cette expérience.
Au début, dans le cadre de l’Ecole Centrale de Lyon, nous avons fait faire une étude de marché pour voir si ce genre de société était viable et s’il y avait un marché pour ce type de technologie. La réponse étant positive, nous nous somme lancés avec le soutien d’un pré-incubateur (Créalys n’a existé qu’en fin de parcours) constitué de la Chambre de Commerce et d’Industrie et du service valorisation de l’Ecole Centrale de Lyon.
Nous avons été lauréats du premier concours sur l’innovation ce qui nous a permis de créer la société Fluorem en mai 2000 avec un appui fort du CNRS et de l’Ecole Centrale et un grand soutien moral de l’association Rhône Alpes Entreprendre qui jouera plus tard un rôle déterminant pour la survie de Fluorem. L’Ecole Centrale est rentrée au capital pour nous aider. En revanche, nous avons été freinés par la direction du Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique dont nous sommes issus.
Quelles en sont les raisons ?
C’est assez simple et logique. Quand un chercheur crée une entreprise, son poste n’est pas remplacé. En conséquence de quoi, le laboratoire perd un poste, potentiellement deux dans notre cas. La création d’une entreprise par un chercheur devient une amputation sans retour pour le laboratoire. De plus, il y avait des risques potentiels de concurrence entre Fluorem et le laboratoire. Nous avons donc décidé que Stéphane Aubert serait dirigeant de la société et que je resterais au laboratoire et serai consultant scientifique à Fluorem.
Notre idée était qu’une passerelle devrait être maintenue entre la recherche faite en laboratoire et la société. Mais malheureusement, au moment de la création de Fluorem, cela n’a pas pu se passer ainsi. Il y a eu une scission entre les deux. Fluorem a toutefois pu se développer.
Est-ce que le développement de ce genre de société est particulièrement difficile ?
Ce fut une galère sans nom. Avec Stéphane Aubert, on se dit parfois que nous ne recommencerions pas l’expérience. Nous avons vu un certain nombre de nos collègues dans le milieu de la création d’entreprises déposer le bilan. A l’Ecole Centrale, il y avait trois sociétés et Fluorem est la seule qui reste.
Les conditions de survie de ces sociétés sont extrêmement mauvaises. De plus, pour Fluorem, nous étions pionniers. Nous sommes arrivés à une époque où cette pratique de création d’entreprise était très peu répandue. Les investisseurs étaient très réticents. Et aujourd’hui, nous rencontrons encore cette appréhension de la part des investisseurs. En fait, il faut que le chiffre d’affaires de la société soit important pour qu’ils s’intéressent à vous. L’amorçage régional n’a pas les moyens de soutenir le développement de technologies très sophistiquées.
En 2003, nous avons fait entrer des investisseurs régionaux mais il nous aurait fallu le triple voire le quadruple de l’argent investi pour pouvoir nous développer plus largement.
Aujourd’hui, dans quelle situation vous trouvez-vous ?
Nous avons constitué une équipe d’ingénieurs hors paire, soudée, motivée et unie, même dans les pires moments. Nous avons réussi à développer et commercialiser notre technologie. C’est donc un transfert réussi. Nous avons en support de grands noms tels Airbus, Alcatel, la Snecma, Framatome, Valeo, Siemens VDO, etc. Ces grands groupes nous suivent sur le plan Recherche et Développement mais difficilement sur le plan production car nous sommes trop fragiles1 . Nous sommes dans une situation paradoxale. Fluorem est une petite société avec un fort potentiel technologique – les résultats en sont assez exceptionnels – sans aucun concurrent mais qui subit un échec économique. Certes, nous survivons et ce, avec moins de 10 personnes. Mais ce n’était pas la finalité : nous voulions aller sur le marché international. Nous sommes présents en Allemagne et en Italie, mais il nous faudrait aller aux Etats-Unis qui représentent 50% du marché… mais nous n’avons pas les moyens financiers.
Comment analysez-vous les freins institutionnels, financiers, sociétaux, etc. qui vous empêchent de vous développer davantage ?
Le point clé reste les capitaux : il nous faudrait un minimum de deux millions d’euros pour nous implanter aux Etats-Unis. Pour cela, il faudrait que notre chiffre d’affaires soit quasiment du même montant pour trouver des investisseurs qui suivent. Tant que l’on ne fait pas le chiffre d’affaires nécessaire, nous ne trouvons pas d’investisseurs supplémentaires et tant que nous n’avons pas d’investisseurs supplémentaires nous ne pouvons pas nous implanter aux Etats-Unis pour nous développer et augmenter notre chiffre d’affaires. En gros, nous sommes coincés.
L’amorçage est trop « petit » en France s’il est le fait d’ investisseurs qui ont une vision régionale voire nationale mais certainement pas internationale.
De plus, les sociétés française et européenne sont très conservatrices. On n’a de cesse de parler d’innovation. Mais, les industriels sont frileux car ils veulent minimiser leurs prises de risque. La notion d’innovation est contrebalancée par celle du risque. Si la peur du risque est trop grande, l’innovation est bloquée. Même chez ceux qui ont fait le pas de tester l’innovation et qui ont des retours probants, le frein existe. Utiliser Turb’Opty en R&D, c’est facile, mais changer une chaîne de conception dans un grand groupe, c’est risqué car il n’y a pas d’alternative et la chaîne devient dépendante de Fluorem.
Ce côté conservateur existe dans d’autres pays européens, en Allemagne notamment. Il paraît que pas du tout au Japon, pas du tout aux Etats Unis. Nous aimerions bien pouvoir le vérifier !
Aujourd’hui, comment les choses évoluent-elles pour vous, pour le laboratoire et pour Fluorem ?
J’ai réintégré le laboratoire en septembre 2005 et je passe à peu près 20% de mon temps à Fluorem.
Les choses ont considérablement évolué avec la nouvelle direction du laboratoire. La perception est différente : on a réfléchi à la façon dont une telle société pouvait profiter à un laboratoire et non pas le concurrencer voire lui nuire. Nous arrivons à mettre en place aujourd’hui ce que nous avions projeté avant la création de Fluorem. Nous développons des programmes dans lesquels le laboratoire et Fluorem interviennent conjointement. Nous nous complétons. Dans le cadre du pôle de compétitivité Lyon Trucks and Bus, nous avons également développé des programmes où le laboratoire est leader et où Fluorem est responsable de la technologie. Nous développons cela avec un certain nombre de partenaires universitaires. Il y a une distribution des travaux de recherche dans plusieurs laboratoires en France sur une base de l’intégration de la technologie par Fluorem. Il y a tout un équilibre qui se construit. Ce type de collaborations apporte des avantages et des moyens pour l’ensemble des partenaires. Cela donne au laboratoire les moyens de développer des travaux importants, des expériences et ça libère Fluorem d’une partie de l’activité de R&D, qu’elle était obligée d’assumer à cause de la déficience de relations universitaires.
Donc le bilan n’est pas si négatif ?
Si on parvient à fonctionner en lien avec le laboratoire, le bilan peut s’améliorer. Mais, nous sommes loin des ambitions initiales. Nous avons une technologie qui va être plus largement diffusée en France mais le développement international n’est toujours pas là. Six ans après la création de Fluorem, nous devrions être dans une situation stabilisée, confortable et ce n’est pas le cas. Mais peut être sommes nous trop impatients ? Nous pensions 3 ans, il en faut peut être 10 !J’ai l’impression en vous écoutant qu’il y a un décalage entre ce que l’on propose théoriquement aux chercheurs pour innover et sortir des laboratoires et ce qui se passe réellement sur le terrain ?
Pour répondre à cela, je préfère raconter une anecdote. Le projet CINEMAS (conception de logiciels) a été monté au départ par Fluorem avec quelques partenaires. Nous avons eu des échos très positifs des industriels. Cela se plaçait dans le cadre du pôle de compétitivité Lyon Trucks and Bus. Le processus s’est développé, le projet a grossi. Le projet a été validé sur le plan technique. Mais les représentants de l’Etat ont émis des inquiétudes vis à vis de la situation financière de Fluorem. L’Etat était donc hésitant à s’engager car Fluorem était trop fragile. Finalement, cette difficulté s’est résolue en plaçant le laboratoire porteur du projet, ce qui n’est pas illogique vu la taille du projet. Cette situation est complètement paradoxale : les industriels mettent de l’argent dans ce projet et prennent le risque, en revanche, les organismes d’état sont plus frileux. C’est sans doute là que le bât blesse. L’Etat dit d’un côté aux chercheurs de s’investir dans la création de sociétés innovantes mais ensuite, il rechigne à mettre de l’argent dans les projets proposés car les sociétés en question n’ont pas assez les reins solides. Pour une raison simple : il applique les mêmes règles pour tous. Le remède est simple, lui aussi : assouplir les règles pour les sociétés qui ont le statut de Jeune Entreprise Innovante.
Notre technologie est considérée comme stratégique et nous avons du mal à la développer. Il y a des considérations économiques qui priment sur des considérations stratégiques.
Autre exemple encore : il y a eu un fond d’amorçage, spécialement dédié à la création de logiciels. L’Etat y est largement majoritaire mais il y a également des investisseurs privés. Aujourd’hui, ce fonds ne fait pas d’amorçage : il fait du développement car les investisseurs privés ne veulent pas prendre le risque de l’amorçage. Il ne remplit donc pas sa fonction parce que les critères des investisseurs privés dominent sur ceux de l’Etat. Il est vrai que l’amorçage est à risque et que sa rentabilité est insuffisante. S’il n’y a pas une volonté de l’Etat de financer cet amorçage, il ne peut pas se faire sur des fonds privés. L’amorçage est la clé de voûte du problème des entreprises innovantes. En Rhône-Alpes comme partout ailleurs en France, il est nécessaire que les fonds alloués à l’amorçage soient plus conséquents, d’un facteur 10 pour un même nombre de projets soutenus.
L’émergence des pôles de compétitivité, des clusters peut-elle améliorer l’innovation ?
Il y a deux ans, le principe était de déposer un projet auprès, par exemple, de l’ADEME qui l’étudiait. Ensuite, l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a été créée et elle-même examine les projets. Aujourd’hui on a mis en place des pôles de compétitivité et l’ANR sera plus sensible aux projets labellisés. En d’autres termes, aujourd’hui, on a trois couches de formalités administratives au lieu d’une. Il faut donc ne présenter que de gros projets pour que l’investissement soit « rentable ».En revanche, l’idée de concentrer des acteurs privés, publics, des associations, des centres de recherche est très intéressante. Pour le projet CINEMAS, le pôle de compétitivité nous a apporté de nouveaux partenaires, ce qui est très profitable. Mais c’est un peu tôt pour tirer des conclusions, il faut attendre un peu que tout se mette en place. Au-delà de toutes les aides financières proposées, qu’elles seraient à votre avis les dispositions à prendre pour donner envie aux chercheurs jeunes ou pas de prendre le risque de l’innovation ?
On est dans un système qui ne va pas changer rapidement. L’une des aides qui a été très efficace pour Fluorem est venue du CNRS. Ce dernier avait ouvert des postes d’ingénieurs dédiés à la valorisation. A Fluorem, nous avons eu, un an avant la création de la société, un ingénieur qui est venu préparer le transfert de cette technologie. Cet ingénieur est resté au laboratoire un an après la création de Fluorem puis il a été intégré à la société. Ce type d’aide est particulièrement profitable. C’est sans doute une disposition à intensifier.
Au niveau des laboratoires, il ne faut pas non plus que ces derniers perdent un poste quand un de leurs chercheurs crée une société. C’est sans doute un point à ajuster. Pour le laboratoire, c’est une perte sèche pas seulement en terme de ressource humaine mais aussi en terme de production de travaux de recherche, d’encadrement de doctorants, de collaboration etc.
Il y a, à côté de cela, de nombreuses mesures utiles et efficaces. Par exemple, le statut de Jeune Entreprise Innovante est un statut très intéressant car il limite le poids des charges sociales pendant 7 ans après la création de la société.
Au delà de ces points spécifiques, il y a d’un coté des structures très rigides qui s’ajustent à coup de lois et de décrets, ce qui crée d’autres rigidités et de l’autre coté des hommes qui en ont conscience et qui forment un formidable réseau de soutien autour de la création pour en minimiser le poids. Pour la région, l’association Rhône Alpes Entreprendre et la CCI en sont, à mon avis, les socles et les bons points d’entrée pour les jeunes.
Et sur la formation des doctorants ou des ingénieurs, pensez-vous qu’il faille améliorer les choses ?
Il y a déjà à l’heure actuelle des partenariats : par exemple, l’Ecole Centrale et l’EM Lyon ont des accords pour faire des cours communs. Le discours est véhiculé : on parle d’innovation tous les jours. Mais, l’innovation ne doit pas être seulement dans le discours mais plutôt dans la réalité des entreprises. Pour l’instant, ce n’est pas tout à fait le cas. Il faut agir auprès des dirigeants et des responsables techniques des grands groupes pour qu’ils passent du discours au concret, au réalisé. De plus, dans un environnement économique incertain, les entreprises vont avoir un réflexe de protection et vont refuser l’innovation et la prise de risque.
Ce n’est pas un problème de l’excellence de la recherche scientifique, ce n’est pas un problème de motivation, c’est essentiellement un problème d’argent en Rhône-Alpes comme dans d’autres régions.
C’est vrai que pendant très longtemps, on avait en France une très bonne recherche fondamentale et appliquée et très peu de transfert technologique. Pendant longtemps, la recherche française a alimenté les entreprises américaines. Si on reprend le cas de Cadoé, cette société a été absorbée par une société américaine. On sait que Fluorem pourrait suivre la même voie et disposer des moyens pour développer sa technologie. C’est une vraie question de choix. Jusqu’à aujourd’hui, notre idée a plutôt été contraire : développer une technologie en France et montrer que c’est possible.
Est ce possible ?
Nous pensons encore que oui.