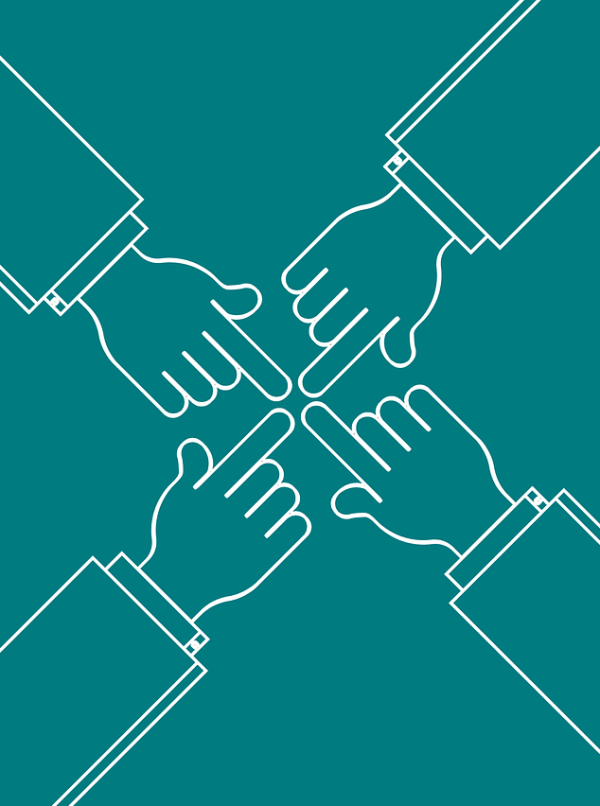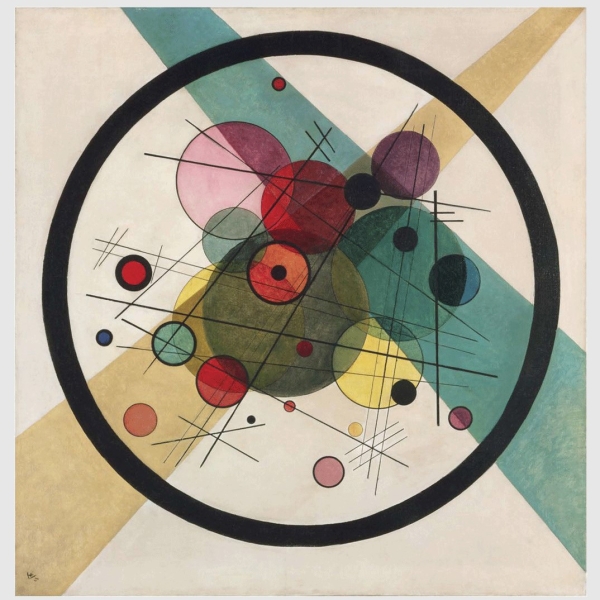Je pense que les financements de ce type recèlent un grand potentiel d’innovation largement inexploré, à condition d’envisager largement le concept de partenariat public privé, et non de le réserver aux contrats de partenariats publics-privés tels qu’ils existent actuellement dans notre droit positif. Envisagé dans une acception plus large (on pourrait parler de partenariats publics-privés « mous », par analogie au droit « mou » ou « soft law »), ces partenariats permettent à une collectivité d’impliquer une entreprise privée dans la fourniture d’un service public selon des modalités qu’elles définissent. La ville de Paris a financé le service Véli’B en mettant à disposition de Decaux les panneaux publicitaires en contrepartie de quoi, il s’engageait à fournir les vélos dans Paris dans un premier temps, puis dans la petite couronne désormais. Bien sûr, pour que cela intéresse une entreprise il faut un marché publicitaire suffisant, donc ce montage est plutôt réservé aux grandes villes comme Lyon ou Marseille.
À l’usage, cette répartition a évolué d’une part pour impliquer davantage le citoyen et le responsabiliser dans l’utilisation des vélos et d’autre part pour assurer l’extension du système aux communes proches (Paris a du s’impliquer et financer ces extensions pour assurer l’interopérabilité du système qui n’aurait pas été forcément garantie si les appels d’offres des communes voisines avaient été remportées par d’autres prestataires que Decaux). Le dispositif Paris Plage a aussi été conçu à l’origine pour ne coûter qu’un euro par parisien, à charge pour les partenaires privés de contribuer à son financement par l’octroi de dons en espèce, mais aussi en nature (organisation de manifestations culturelles…).
Ces partenariats se retrouvent sous d’autres formes à l’étranger. En Roumanie, la ville de Constanta a ainsi proposé un service de vélos en libre accès en s’associant à une banque : les vélos portent une affiche publicitaire de la banque qui les fournit. Afficher ainsi son engagement social contribue à lui donner une image positive. En Allemagne, ce sont les services ferroviaires nationaux qui ont développé une offre de service de transports alternatifs par ce biais, le financement par voie budgétaire étant trop difficile. Bien sûr, ces montages suscitent des critiques. Certains parlent de marchandisation des collectivités territoriales. Mais n’est-il pas temps que les mentalités évoluent ? En période de réduction des dépenses publiques, les élus locaux manquent d’argent et ne sont plus en mesure de financer seuls un certain nombre de services. Ces montages permettent à la collectivité de continuer à proposer des services améliorant la vie des citoyens tout en leur assurant une certaine pérennité.