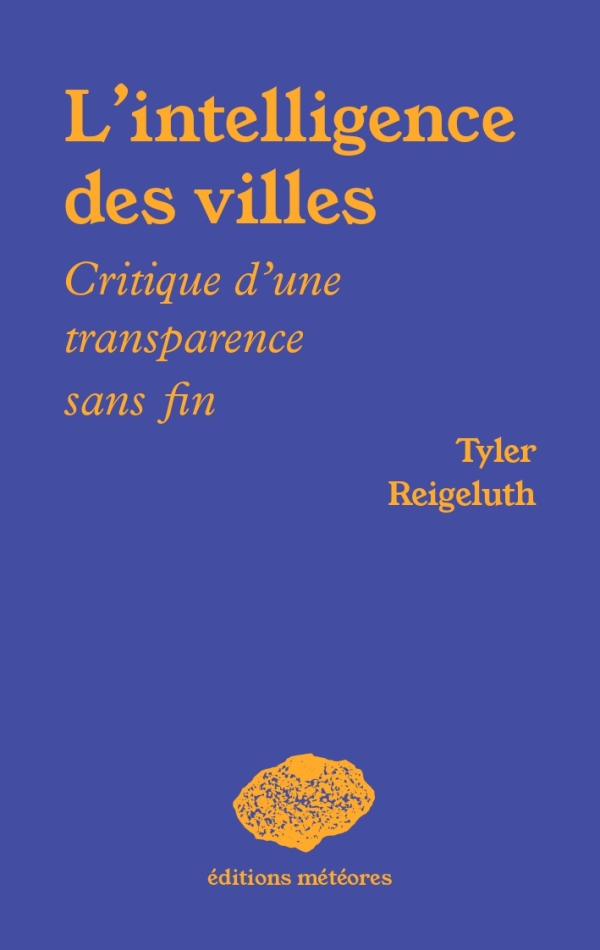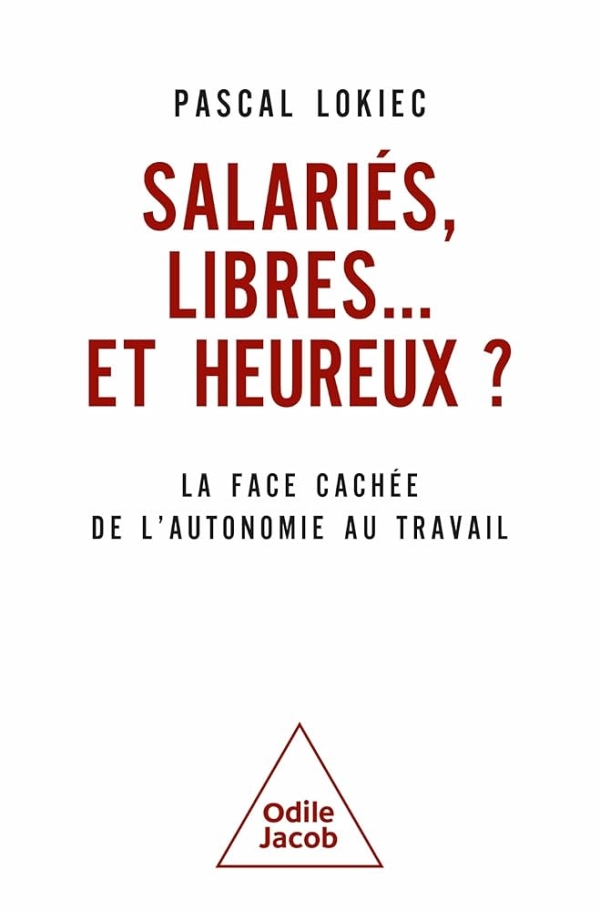De quelque côté que l’on regarde, le « jour » est partout lié au Soleil, à sa lumière, à ses révolutions. Le terme même du « jour » français est issu du latin dies, lui-même issu de la racine indo-européenne *dei — qui signifie « briller », et qui donne aux langues qui en sont issues à la fois le jour (giorno, ou la terminaison « di » des jours de la semaine français), et les dieux (Zeus, Dionysos).
Dès l’origine, ce mot de « jour » prend deux significations. D’une part, comme espace de temps qui s’écoule entre le lever et le coucher du Soleil, donc comme outil de mesure, le substantif latin diurnum prenant le sens de la ration journalière ou de l’étendue de terrain qu’un attelage pouvait labourer en une journée de travail ; d’autre part, comme clarté donnée par le Soleil, source de lumière.
Dans les panthéons antiques, deux dieux incarnent cette ambiguïté : le Khépri égyptien et le Phanès grec. Dieu du Soleil naissant et du renouveau qu’il implique, Khépri est « celui qui vient à l’existence ». Il représente donc à la fois « ce qui est en devenir » et le cycle continu du temps, son éternel recommencement. Phanès, présenté par la théogonie orphique comme le dieu primordial de la création, permet la mise en ordre du chaos, notamment par sa mise en lumière des ténèbres. Le Soleil symbolise ainsi ce qui permet de lever le voile des vérités méconnues, comme dans le mythe platonicien de la Caverne : en un mot, il incarne une certaine idée de l’intelligence.
Plus récemment, dans L’intelligence des villes, critique d’une transparence sans fin, paru en mai 2023 aux éditions Météores, Tyler Reigeluth, philosophe et maître de conférences à l’Université catholique de Lille, travaille à déconstruire la smart city en tant qu’outil de synchronisation et comme archétype d’une transparence spectaculaire et technosolutionniste. Cette transparence placerait l’intelligence en surplomb des agents sociaux, là où l’auteur défend l’hypothèse d’un territoire accordant une juste place à l’intelligence de ses habitants.
En laissant de côté les sujets habituels associés à la smart city, l’ouvrage se concentre sur la forme d’intelligence à laquelle renvoie la notion de smart. Il laisse ainsi de côté :
Jour : fragment du temps
Pour aller plus loin, nouveau détour par la sémantique. Dans sa première acception, le jour est le moment où la lumière du Soleil éclaire une seule partie du globe terrestre lors de sa rotation. Par extension, le jour désigne le temps nécessaire à une révolution terrestre autour du Soleil : 24 h. Le jour est alors compris comme élément de temporalisation, comme mesure (le fameux « pain de ce jour » du Pater Noster catholique, le travail journalier), comme cycle ou évènement marquant une rupture (un mardi à 15 h dans L’An 01 de Doillon, un 14 juillet 1789 chez Vuillard.
Ce temps astronomique a déterminé jusqu’à nos temps biologiques. Alors que l’académie Nobel a récompensé en 2017 Jeffrey C. Hall, Michael W. Young et Michael Rosbash pour leurs travaux de médecine sur les rythmes circadiens, soit les rythmes biologiques d’environ 24 h, la philosophie et les sciences sociales s’attardent-elles aussi sur ces sujets, soit pour s’inquiéter d’une accélération sociale (Harmut Rosa dans Accélération), soit pour l’appeler de leurs vœux (Alex Williams et Nick Srnicek dans leur Manifeste accélérationniste — à ne pas confondre avec le courant violent de l’extrême droite portant le même nom).
Si nos temporalités procèdent d’une source unique, le Soleil, celui-ci est alors le principe de synchronisation de nos cycles. C’est d’ailleurs, la « synchronisation du réseau technique », soit l’uniformisation des cycles, qui semble à Tyler Reigeluth la caractéristique principale de la smart city.
L’une naturelle, l’autre artéfactuelle : en un sens, les légitimités de ces deux synchronisations s’opposent. A priori anthropocentrique, la synchronisation smart voit néanmoins ses limites mises en évidence par les artistes, depuis les hacks présentés par Alain Damasio dans Furtifs jusqu’à la performance de
Simon Weckert mettant en échec la synchronisation des déplacements opérée par Waze. « L’internet des choses tend à faire du tissu urbain un système intégral d’adressage (…). Les systèmes modernes de cadastrage, de zoning et d’adressage ne se contentent pas de découper un espace que l’on pourrait découper autrement ; ils produisent un espace dans lequel les choses et les gens occupent une place… L’équivalent temporel de l’adresse est l’horaire qui formalise la ritournelle, (…) en produisant un ordre, on produit aussi une anticipation de ce qui devrait venir après ».
Des Lumières jusqu’à l’occultation de l’ordre social
Fondement historique de notre approche de la politique, « La philosophie grecque est indissociable du Soleil. Condition de toute visibilité, le Soleil y occupe une place centrale dans le domaine de la connaissance, où il est l’incarnation physique du critère du savoir (…) Sans lumière, pas de formes, pas de monde à regarder. La lumière est la condition d’existence des choses du monde », écrit la philosophe Emma Carenini, qui souligne qu’ici, « Le Soleil n’est pas du tout pris dans son rapport au temps, mais dans son rapport à l’espace. Il ne sert pas à marquer le temps ; il sert à construire des modèles grâce au jeu de l’ombre et de la lumière ».
Emma Carenini va plus loin encore en désignant par démocratie la pleine « publicité des manifestations essentielles de la vie sociale ». À cet égard, Tyler Reigeluth écrit que « l’action gouvernementale doit être visible, elle doit exprimer une certaine rationalité, on doit pouvoir suivre ses enchaînements causaux comme on suivrait ceux d’un mécanisme (…) À beaucoup d’égards, les discours et projets de smart cities témoignent d’un aboutissement de cette logique d’une transparence technologique du monde. La ville intelligente avec tous ses capteurs, données et prédictions serait celle où il n’existerait plus de zones d’ombre, plus de secrets, où tout serait immédiatement visible et accessible (…) Il me semble que cette conception de l’intelligence est encore celle qui gouverne les projets de la smart city : une fonction qui englobe et surplombe, qui s’exerce sur, qui opère sur les choses ».
En son nom même, la smart city s’attache à une vision de l’intelligence rarement définie. Tyler Reigeluth explore diverses acceptions et en mesure les implications. L’« ennuagement » dont procède la smart city s’apparente selon lui à une verticalisation de l’intelligence, qui « produit un certain ordre gestionnaire (…), les quartiers populaires ne sont que très faiblement considérés comme des viviers de cette nouvelle intelligence ». Une intelligence plus proche du sens anglo-saxon, « l’intelligence » comme « renseignement ».
Par ailleurs, « les données produites par des capteurs et des logiciels sont renvoyées sur des serveurs délocalisés pour traitement. La ville ne peut pas compter sur elle-même ». L’intelligence n’est alors pas dans la ville, mais chez ses prestataires de service, dépossédant à la fois certains pans de la population, mais aussi les pouvoirs publics, de la participation à cette intelligence.
Plus encore, cette intelligence tend à une optimisation de fonctionnements qui ne sont pas réinterrogés. Leur naturalisation masque le fait que les technologies participent à la construction d’une réalité sociale. « Plus que simplement représenter l’espace, elles le produisent », écrit Reigeluth, qui oppose à cette vision la « pratique spatiale » comme rapport entre l’habitant et l’espace qu’il habite et contribue à produire par sa manière de l’habiter. Une intelligence impalpable pour les smart cities.
Ainsi, l’auteur reproche à la smart city de mobiliser une intelligence de Shadocks, dont la finalité n’est pas explicitée, et contribuant par là à une naturalisation de l’ordre social existant.
La vision de l’intelligence associée à la smart city tend donc à faire de l’habitant une variable sous optimale d’un système fonctionnel. Cette vision de l’usager comme élément défectueux d’un ensemble technique (incapable de régler le thermostat correctement…) questionne là encore la vision de l’intelligence portée par la smart city, réactualisée dans les smart buildings, et toile de fond de tous les débats liés à l’IA.
L’intelligence y est basée sur la transparence et le temps réel qui, réactivant l’utopie architecturale illustrée par la maison de verre de Pierre Chareau ou le design des magasins Apple, prétend être en phase avec le réel et participer d’une autorégulation sociale. Reigeluth critique avec Canguilhem cette vision et appelle à « établir la norme à partir de laquelle on évalue cette intelligence », et donc à « déterminer la finalité qu’elle servirait ». Est-ce que la ville rend ses habitants plus intelligents, ou une ville devient-elle intelligente parce que ses habitantes le sont ?
La Ville, champ de bataille entre intelligences collective et artificielle ?
Pluraliser les intelligences, démocratiser les villes. « Face aux imaginaires contemporains de l’intelligence qui nous donne l’impression qu’elle serait dans quelque chose (…) on peut encore rétablir l’intelligence du lien, de la relation, du va-et-vient entre les machines et les organismes, entre les infrastructures et les habitants », écrit Tyler Reigeluth. Pour cela, à l’instar de Fanny Lopez, l’auteur plaide pour l’instauration de ce que Simondon nommait des « points-clefs techniques », opérateurs de visibilité de la technique et de son rôle dans nos sociétés.
De ce point de vue, les balades urbaines des infrastructures du numérique organisées par Le Mouton numérique apparaissent porteuses d’une reconquête d’une intelligence du geste technique. Cette veine est explorée par Laure Dobigny et Gabriel Dorthe, qui plaident pour un passage « des bâtiments intelligents aux utilisateurs intelligents ».
In fine, voilà pourquoi Tyler Reigeluth plaide, avec les géographes Maria Kaika et Erik Swyngedouw, pour une compréhension de l’intelligence non pas dans les choses, mais de l’écosystème des relations sociotechniques qui les constituent.
Selon lui, la smart city « transforme la ville en un lieu de consommation d’infrastructures déconnectées de leurs conditions de productions historiques et géographiques. Ouvrir et fermer le robinet : rien de plus spontané dans notre pratique contemporaine de la consommation d’eau. Et pourtant, ce geste s’insère dans un réseau d’infrastructures et de pratiques de maintenance qui veillent sans cesse à la continuité de sa distribution. La permanence d’une certaine forme urbaine au travers de ses infrastructures est toujours le résultat précaire d’un processus de maintenance, généralement invisibilisé, confiné aux temps morts de la vie citadine, cantonné au hors champ de la scène urbaine. (…) La maintenance n’est pas l’après-coup de l’infrastructure, mais son processus indissociable. (…) Il s’agit ni plus ni moins d’une nouvelle expérience de la technique à cultiver ».
Sans cette pratique collective de soin, la technique risque de maintenir l’usager dans un rapport passif à l’infrastructure, n’ayant aucun rôle à jouer dans son fonctionnement. Pourtant, une autre vision reste possible, à partir d’une intelligence non plus verticale, mais distribuée, non plus encapsulée dans une technique, mais diffusée dans les relations sociales qu’elle suppose : sa maintenance.
Comme le Soleil qui n’offre nulle part la même lumière, « l’intelligence de Bruxelles ne sera jamais celle d’Hanoï, qui ne sera jamais celle de Lima. Au Moyen-Âge, certains villages italiens, construits à flanc de colline, orientaient leurs ruelles et leurs fenêtres dans le sens des vents estivaux dominants ; un système de ventilation et de régulation thermique encore efficace aujourd’hui et qui invite à laisser la place aux idiosyncrasies locales, aux solutions low tech dont l’intelligence réside dans l’économie des moyens, l’efficacité éprouvée par les temps des matériaux et des pratiques ». L’exemple des attrape-vent dont dépend, au même titre que les qanats, la ville de Yazd en Iran est éclairant.
Dans cette veine d’une intelligence plurielle, les travaux de M. Brodey au sein de l’Environmental Ecology Lab à la fin des années 1960 ouvraient la voie à une relecture de l’intelligence artificielle, non plus à partir d’une augmentation momentanée de l’humain, mais d’une amélioration durable de celui-ci. Des travaux exhumés par l’influent critique de la technique Evgeny Morozov : « L’intelligence, loin d’être enfermée dans nos cerveaux, naît des interactions avec notre environnement. »
Pour un éloge de l’imperception
En plaidant pour une appropriation citoyenne des techniques, l’auteur renoue avec la critique de Rancière d’une démocratie pour l’heure inexistante, puisque basée sur un postulat d’inégalité des intelligences, et appelle à un passage de la ville intelligente à la ville intelligible. Rejetant le rêve panoptique et nécessairement totalitaire d’un monitoring total de la ville, jusque dans ses moindres recoins, le philosophe Tristan Garcia fait l’éloge de l’imperception comme mode d’accès à la pensée.
L’imperception, soit « l’ensemble des phénomènes cognitifs par lesquels un être vivant se rapporte à ce qu’il ne trouve pas devant ou autour de lui. Soit qu’il retienne quelque chose qui a disparu (rémanence), soit qu’il s’illusionne sur ce qu’il sent (mirage), soit qu’il se représente quelque chose qui n’est pas présent (imagination) l’important est qu’il se rapporte à un vide, un silence, un creux, une disparition, un défaut, un manquement, quelque chose de hors-champ », soit la capacité à se projeter vers ce qui pourrait être. Et si le Soleil était avant tout l’auteur des ombres les plus élégamment portées ?
Pourrait-on s’ouvrir à de nouvelles définitions de l’intelligence, sortie de sa verticalité et de son analogie lumineuse, pour mieux nous former à l’art des nuances du clair-obscur ? Passer de l’énergie du jour, force solaire en action, à un apprivoisement des dynamiques (force en puissance) depuis des ombres pour l’heure obfusquées, débusquer les fragments hackés d’un futur qui résiste, pour inventer les polarités politiques de demain ? Plutôt qu’à une intelligence panoptique, verticale, synchronisée et uniformisante, Tyler Reigeluth nous invite à reconsidérer les intelligences vernaculaires, celles des situations et des humains qui les vivent, comme un appel à démocratiser nos rapports techniques, à les approfondir et donc à négocier, en commun, les fins qui les sous-tendent.