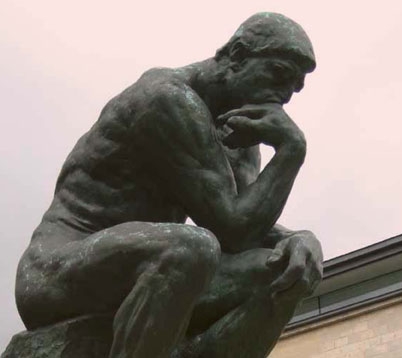Participation
Ce terme a été essentiellement employé en France pour désigner une série de dispositifs et de choix politiques. Le Général de Gaulle l’a introduit dans le vocabulaire de l’action publique, à travers les dispositifs intéressant les salariés aux résultats de leurs entreprises. L’intérêt fut, dès le départ, pour le politique, de dessiner une alternative au conflit de classe. La notion de participation porte l’espoir d’une collaboration harmonieuse de chacun à la réussite des projets lancés par un pouvoir central fort.
Néanmoins, la participation s’est développée dans la société civile sous des dehors plus conflictuels. Les acteurs des Groupes d’action municipale (GAM), des mouvements ouvriers (le conflit des LIP par exemple) ou des luttes urbaines (le quartier de l’Alma-Gare à Roubaix) l’ont considéré comme une évolution à imposer par des rapports de force, au sein de l’entreprise et de la vie politique locale. Leur discours a été repris par le Parti Socialiste, qui a inscrit dans son programme de 1981 un impératif de participation suffisamment large pour fédérer les différents mouvements de gauche qui s’en réclamaient (de Lutte Ouvrière à la Section française de l’internationale ouvrière – SFIO-la gauche autogestionnaire aux chrétiens démocrates).
Dès son accès au pouvoir, le gouvernement socialiste a été confronté à une crise urbaine majeure (émeutes des Minguettes). Il a choisi d’y répondre par la participation (sur les bases du rapport Dubedout). Ce lien entre politique de la Ville et participation ne se relâchera pas, et la participation sera imposée par l'État central, avant d’être assimilée par les pouvoirs locaux. Cette très rapide institutionnalisation a fait de la participation un impératif bien souvent dicté « d’en haut » aux élus locaux comme aux habitants, sans que le véritable pouvoir de chacun soit toujours bien défini.
Empowerment
Très en vogue en France depuis quelques années, la notion d’empowerment, bien décriteexposée par Marie-Hélène Bacqué et Carole Biewener dans L’empowerment, une pratique émancipatrice, est née aux États-Unis, au sein d’une philosophie politique spécifique. L’action publique corrige a posteriori ce qui naît de l’initiative d’un pouvoir d’en bas, pluriel et conflictuel. Les individus, en défendant leurs intérêts propres, produisent un ordre social spontané. Il est légitime qu’ils forment des groupes de pression. Les institutions interviennent dans un second temps pour entériner et garantir les compromis sociaux issus des négociations entre communautés. L’action publique corrige a posteriori ce qui naît de l’initiative d’un pouvoir d’en bas, pluriel et conflictuel.
La notion d’empowerment, apparut dans les années 1960, désignait pour désigner l’auto-organisation des défavorisés en groupes de pression, afin de défendre leurs intérêts et de remettre en cause les inégalités (économiques, de genre, de race, ou de territoire) dont ils étaient victimes. Leur action se développait au sein de communautés de personnes partageant les mêmes situations et problématiques (on parle de Community Based Organization, ou organisation communautaire). Les premiers exemples furent le mouvement de défense des femmes battues, et celui pour l’accès aux droits civiques des américains noirs.
L’empowerment est donc le mouvement d’une communauté pour s’organiser et motiver ses membres à agir, afin d’être capable de se mettre en capacité de prendre du pouvoir. Il s’agit, par la discussion, d’amener de nouvelles personnes à se reconnaître dans cette communauté, puis de leur transmettre des outils intellectuels et des savoir-faire leur permettant de transformer collectivement leur situation. C’est un travail au long cours, qui construit un rapport de force permettant d’imposer aux institutions les problématiques, l’expertise et les choix d’individus et de communautés minoritaires dans le débat public.
Activation
La notion d’activation est très liée à la politique sociale, plus particulièrement à la gestion du marché de l’emploi. Elle a émergé en Suède dans les années 1950, pour désigner un ensemble de dispositifs favorisant la mobilité professionnelle des salariés. Orientation, formation et aide à la mobilité ont favorisé le retour à l’activité des chômeurs en contrepartie du maintien d'une société de plein emploi.
Cette notion s'est transformée en intégrant le modèle social anglais qui met l’accent sur la responsabilité personnelle des individus dans leur situation sociale. Dans cette perspective, les droits sociaux ne doivent être accordés que sous conditions, aux individus qui ne peuvent pas compter sur le marché (du travail, de l'assurance...) pour améliorer leur situation. L'activation implique alors des dispositifs d'orientation et de formation, mais aussi de sélection des publics bénéficiaires et de vérification de leur incapacité réelle à subvenir à leurs besoins. Elle se fonde sur des réductions et retardements des indemnités, et sur des encouragements à la reprise d’emploi, même peu qualifié (work first). Il s’agit de rendre actifs les inactifs (chômeurs, porteurs de handicap, femmes au foyer). Les États doivent organiser et stimuler le marché du travail afin d’y réduire le nombre d’inactifs.
Cette logique de conditionnalisation des aides est encouragée par les instances internationales (Organisation de coopération et de développement économiques –OCDE-, UE) qui mettent les pays membres en concurrence sur la base de leurs taux d’actifs. Si elle produit une action sociale plus attentive aux spécificités de chacun, elle trouve ses limites lorsqu’elle aboutit à stigmatiser les inactifs. Jugés responsables de leur sort, ils sont soumis à un devoir d’agir - fondamentalement différent du pouvoir d’agir - dans un contexte de rareté croissante de l’emploi.
Contribution
La notion de contribution peut représenter une piste novatrice pour la puissance publique. Ce terme a été utilisé dans les réflexions mutualistes du XIXème siècle. Il a été remis au goût du jour par les réseaux électroniques. Conçus par des techniciens utopistes, comme le souligne Fred Turner dans Aux sources de l’utopie numérique, ces réseaux sont fondamentalement bâtis sur une logique de contribution. Chacun peut apporter sa pierre à un projet autonome, sur la base du volontariat et indépendamment de son statut social : c’est ainsi qu’ont été développés les logiciels libres. La spécificité initiale de cette logique tenait au fait que le projet ne pouvait devenir la propriété d’aucun de ses contributeurs, qu’il soit privé ou public : il restait un bien commun.
Depuis, les géants du Web ont compris tout le profit que pouvait générer une multitude de petites contributions générer ce modèle. Facebook fournit un support gratuit, sur lequel seront collectées les pour une multitude de petites contributions bénévoles, qui sont ensuite collectées et monétisées.
La puissance publique peut-elle recourir à s’inspirer d’un tel modèle de production de la valeur ?
C’est ce qu’imagine l’OCDE, qui, dans son rapport de 2014 Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique : Ensemble pour améliorer les services publics, invite à réfléchir à des formes de partenariats entre pouvoirs publics et individus bénévoles. De tels partenariats présenteraient la double garantie de servir l’intérêt général (puisque les projets contributifs ne peuvent être asservis à, puisqu’ils ne pourraient être asservis à des intérêts privés)s, et d'être innovants, puisque branchés sur les besoins et les compétences de la population.