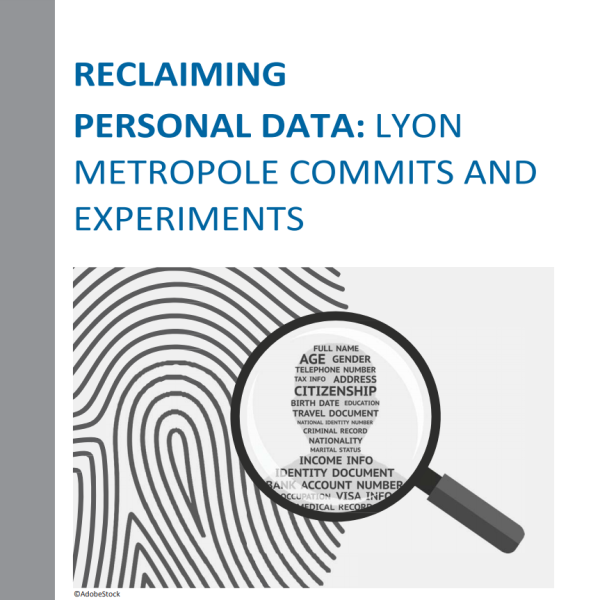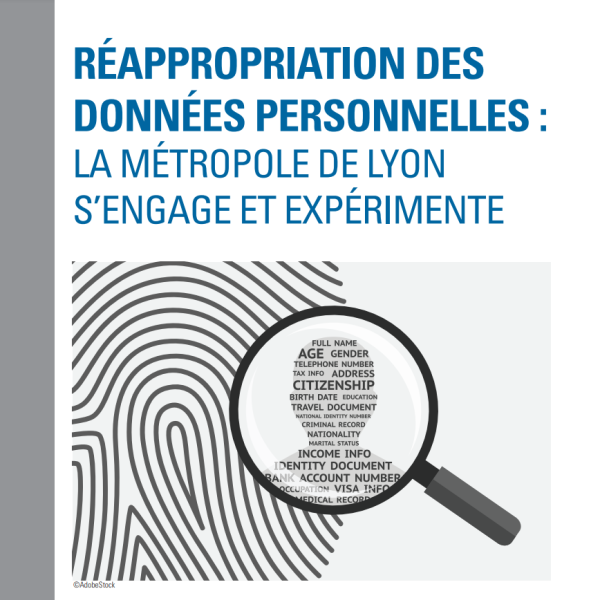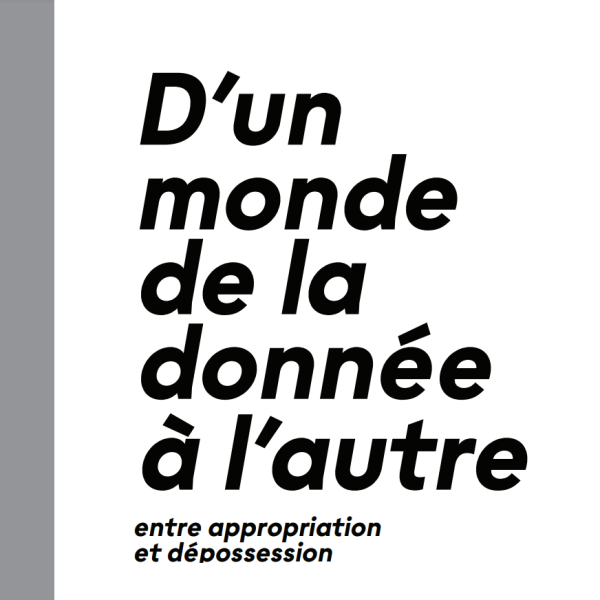Il y a beaucoup à travailler sur la culture de la donnée au sens large, et ça fait partie d’un de nos axes stratégiques. Au travers de ses compétences, comment la Métropole de Lyon peut-elle accompagner cette culture de la donnée ? Comment garantir l’inclusion numérique des collégiens, des personnes en difficultés, en situation de handicap, âgées, etc. ?
Par ailleurs, la Métropole mise depuis plusieurs années sur une co-construction public-privé-citoyens de la ville intelligente. Comment, via ses multiples projets, proposer des services toujours plus adaptés aux usagers ? Le Self Data peut être une des réponses, c’est pourquoi il est intégré dans la démarche Métropole intelligente. En accompagnant les citoyens dans la reconquête de leurs données, en les mettant en situation de co-construire des services, on rend un meilleur service public. Il s’agit d’explorer concrètement plusieurs cas d’usages pour faire la preuve du concept. Il me parait important de « relire » les politiques publiques que l’on porte à la lumière du Self Data, pour trouver des axes de développement en accord avec le service public : égal accès, continuité du service public…. On peut établir un parallèle avec le développement durable qui est intégré complètement aux politiques de mobilité, de développement économique, etc.
Il y a aussi un axe de développement intéressant à explorer même s’il peut paraitre antinomique : considérer la donnée personnelle comme un bien commun, une évolution étudiée notamment par le juriste Alain Supiot et l’essayiste Evgeny Morozov. En connaissant mieux ses données personnelles, le citoyen pourrait partager, de façon anonyme et volontaire, celles qu’il souhaite avec des personnes partageant les mêmes intérêts, par exemple pour optimiser le traitement d’une maladie, un trajet… On comprend bien l’intérêt dans le champ de la santé par exemple : croiser de nombreuses informations de patients (ex. des éléments de leur dossier médical) peut permettre des études macro et mettre au jour des informations utiles pour les patients. L’idée n’est pas de partager les données personnelles mais que les citoyens autorisent, s’ils le souhaitent et de manière anonyme et sécurisée, à ce qu’elles servent un intérêt général, un enjeu de santé publique, de mobilité, de meilleure gestion de l’énergie… Et à aucun moment, le tiers qui analyse les données ne doit pouvoir remonter aux identités. Ces méthodes de cohortes notamment épidémiologiques existent déjà, il s’agirait de les étendre, de les simplifier et là encore, de davantage co-construire avec les intéressés.
Enfin, nous devons veiller à ne pas récréer des monopoles ou de dépendances à des acteurs privés. Interrogeons-nous collectivement : est-ce à un acteur privé de porter la base technologique qui va permettre de valoriser les données personnelles ? Est-ce que ce n’est pas à la puissance publique de porter le Self Data, par exemple en fournissant à chaque nouveau-né un espace privé sécurisé et digne de confiance ?
D’autres collectivités, comme La Rochelle par exemple, vont mener des expérimentations en lien avec le Self Data, certaines le pratiquent déjà en Europe et sont regroupées dans le mouvement « MyData ». J’espère que la preuve du concept sera faite rapidement sur la métropole. Il fallait passer par cette échelle territoriale mais elle présente aussi des limites. L’enjeu est tel que l’Etat et l’Europe doivent s’en emparer, nous devons réagir rapidement et collectivement.