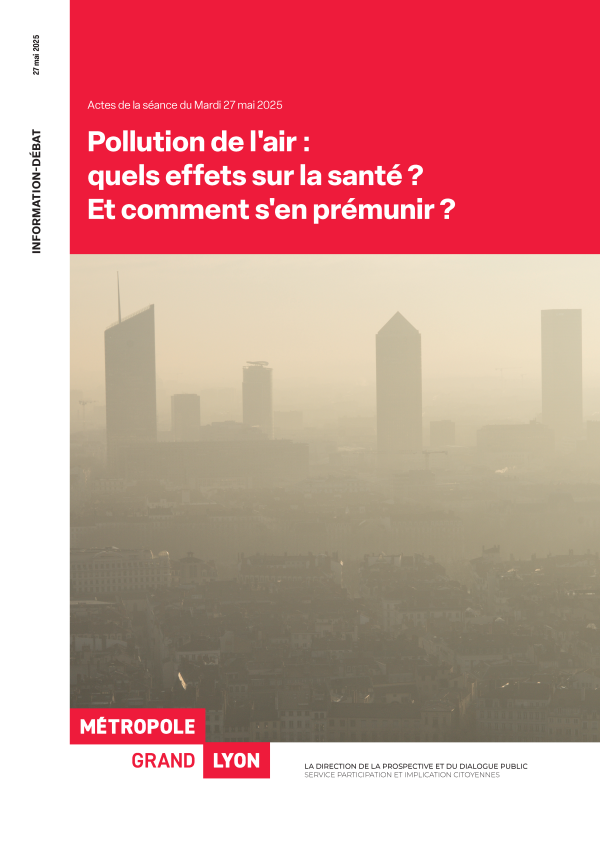Lorsque j’ai pris mes fonctions, il y avait une euphorie autour du développement touristique de la ville. Barcelone se félicitait d’être devenue la quatrième destination touristique d’Europe, de drainer chaque année 8 millions de visiteurs, d’avoir un secteur touristique contribuant à hauteur de 15 % au PIB de la ville, etc. Ce que j’ai constaté sur le terrain était beaucoup moins réjouissant : des propriétaires poussaient les locataires à quitter leurs logements afin de vendre les immeubles à des promoteurs hôteliers, des commerces en pied d’immeuble étaient investis par la mafia pour accueillir des activités de blanchiment d’argent, le trafic de drogue et la prostitution se développaient… Au 19ème siècle, Barcelone voulait montrer au monde son industrie et sa technologie. Qu’allions-nous montrer maintenant ?
D’autre part, le développement de l’industrie touristique a eu des répercussions négatives sur la qualité de l’air et les conditions de mobilité : de grands bateaux de croisière stationnent sur le port et utilisent leurs propres générateurs électriques, ce qui engendre une pollution importante. De grands autocars touristiques sillonnent continuellement la ville et génèrent de la congestion. Nous avions écarté de Barcelone les camions liés à l’industrie dans les années 1980 ; le tourisme les a réintroduits dans les années 1990 avec une ampleur encore plus forte ! Enfin, le développement du tourisme ne bénéficie que très peu aux habitants. En effet, Barcelone n’a pas misé sur un modèle « Bed & Breakfast » qui leur aurait permis de disposer de revenus complémentaires, en accueillant chez eux des touristes. Ce sont de grandes chaines hôtelières internationales qui captent l’essentiel des revenus. La philosophe Marina Garcés1 a développé le concept « d’industrie extractive » pour qualifier cette dérive du tourisme. Elle fait l’analogie entre l’industrie touristique de Barcelone et l’industrie pétrolière des pays en développement : les ressources du territoire sont extraites et exploitées sans que la population locale ne puisse en bénéficier.
La non-gestion du tourisme de masse constitue donc la première dérive que j’ai observée. Face à cela, j’ai imaginé que nous pouvions bâtir le modèle d’une grande ville dont la dimension humaine ne se perde pas dans le processus de globalisation. En tant que conseillère municipale de Barcelone, j’ai organisé des événements festifs pour que les habitants réinvestissent les lieux de trafic et chassent ainsi les dealers. J’ai mené une campagne de fermeture des appartements touristiques pour redonner sa fonction résidentielle au logement, ce qui m’a valu des menaces de la part de la mafia.
Le second glissement, moins visible, n’en était pas moins important. L’administration avait pris l’habitude d’orchestrer des transformations urbaines à un rythme important. La construction s’est industrialisée. Barcelone a été prise dans une machine infernale, qui construisait sans arrêt, en cherchant à se faire une place dans la compétition mondiale entre les villes. J’ai tiré la sonnette d’alarme en expliquant qu’on ne maîtrisait plus la ville, que cette machine vivait seule, au profit d’intérêts privés, indépendamment de la politique et des citoyens. Ceux-ci commençaient à prendre de la distance vis-à-vis de l’administration parce qu’ils sentaient qu’ils avaient perdu leur capacité d’incidence sur le futur de la ville.