Repenser les métiers du prendre soin à l’aune des théories du care

Étude
Et si le turn-over et l’attractivité en berne des métiers du prendre soin était lié à des transformations organisationnelles et managériales ?
Interview de Bernard GAZIER
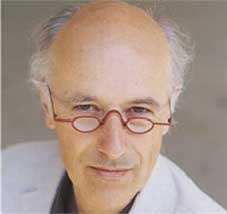
<< Le territoire est devenu le lieu naturel de mise en coordination d'un ensemble de politiques de développement économique et de sécurisation des parcours >>.
Bernard Gazier a réalisé des travaux d’expertise, auprès du Commissariat général du plan, de la Communauté Européenne, de la Banque Mondiale, du Bureau International du Travail et de l’OCDE.
Il est notamment l’auteur, en français, des ouvrages suivants : La crise de 1929, PUF, collection Que sais-je ?, 1983 (7ème édition 2011) ; Economie du travail et de l'emploi, Dalloz, 1992 ; Les stratégies des ressources humaines, la Découverte, 1993 (4ème édition 2010) ; Tous sublimes, vers un nouveau plein emploi, Flammarion, 2003 ; L'introuvable sécurité de l'emploi, Flammarion, 2006; John Maynard Keynes, PUF, collection Que sais-je ? 2009.
Interview réalisée dans le cadre de la démarche « Grand Lyon Vision Solidaire ».
Comment définissez-vous la flexisécurité ?
Définir la flexisécurité pourrait constituer en soi un vaste chantier. Disons, pour simplifier, qu’il existe deux définitions, l’une étroite qui n’est pas suffisante ni légitime, et une autre plus élargie qui n’est pas miraculeuse, mais qui permet cependant de poser le débat. La première se résume en l’échange négocié entre partenaires sociaux et chefs d’entreprise, partant du postulat que les premiers demandent plus de sécurité et les seconds plus de flexibilité. Or, la mobilité peut être une sécurité pour l’employé et l’entreprise a grand besoin de sécurité, notamment de sécurité juridique. De fait, la réalité n’est pas si simple. Gösta Rehn, le célèbre inventeur du modèle solidaire suédois des années 1950, pensait que les travailleurs devaient préférer « la sécurité des ailes à celle de la coquille d’escargot ». La mobilité peut procurer la sécurité. C’est pourquoi, je préfère évoquer une définition plus large qui prend en considération la complexité de ce que peut revêtir la notion de sécurité pour les entreprises, et les notions de parcours et d’employabilité pour les salariés. En anglais, la notion de flexisécurité s’exprime simplement, c’est l’évolution du job protection à l’employment protection. La définition étroite n’est pas convaincante car elle repose sur la mythologie d’un marché du travail atomisé entre des entreprises et des salariés individualisés, une image qui correspond partiellement à la réalité du Danemark qui abrite majoritairement des PME. Or, la flexisécurité n’a pas bien fonctionné au Danemark dans notre crise, les entreprises ont beaucoup licencié, mais les salariés n’ont pas retrouvé de travail pour autant. Pour être efficace, la flexisécurité doit s’adapter aux réalités locales et bien sûr concerner l’entreprise, mais aussi le territoire dans une approche globale. Ce qui est apparu pertinent dans la crise, c’est l’adaptation interne à l’entreprise. Par exemple, lorsque les exportations se sont effondrées en 2008 en Allemagne, le maitre mot n’était pas de licencier, mais au contraire, de garder les salariés en entreprise. Des mécanismes de chômage partiel, que l’on peut appeler mécanismes de flexisécurité interne, ont été mis en œuvre avec succès puisque le chômage n’a pas augmenté alors que la production baissait de 6%. La flexisécurité ne peut fonctionner que si on met en marche, tout autant que des mobilités sur le marché du travail, un système de flexibilité interne dans l’entreprise, notamment par le chômage partiel, et dans un même temps par des dispositifs qui permettent d’identifier les compétences, les ressources utilisables à l’échelle du territoire, et de développer les reconversions et formations les plus pertinentes.
Sous entendez-vous que le territoire local soit l’échelon le plus pertinent pour envisager des stratégies de flexisécurité ?
C’est une évidence. Aujourd’hui, la question de la flexisécurité n’est pas suffisamment examinée sous l’angle des compétences qui intéressent le territoire et des solidarités qui peuvent jouer à cette échelle. Il est nécessaire de penser à la fois les ajustements possibles au sein de l’entreprise et le développement des ressources utiles localement. Le territoire est devenu le lieu naturel de mise en coordination d’un ensemble de politiques de développement économique et de sécurisation des parcours. C’est à cette échelle que se réalisent des choses extrêmement concrètes, et vitales. La relation entre l’emploi et la mobilité est le résultat de décisions prises par les entreprises et les gens, mais elle dépend de politiques stratifiées, et donc de responsabilités partagées. En France, le « social » relève de la compétence du Conseil général, la « formation professionnelle » de celle de la Région, et « les politiques d’emploi et de chômage » de l’Etat. Cette stratification est source d’inefficiences voire d’incohérences. Par exemple, il est actuellement trop compliqué d’organiser le retour à l’emploi pour une personne qui perçoit le RSA.
Quel territoire faut-il retenir pour conduire une politique de flexisécurité : la région, le département, l’agglomération ou la ville ?
Cela dépend. Sur ces questions, la Région est un échelon tout à fait pertinent notamment du fait de ses compétences. C’est elle qui peut probablement le mieux tisser des liens entre les écoles d’apprentissage, les entreprises, le milieu de la recherche, et agir pour favoriser la création d’activités et d’emplois. A l’évidence, la Région a un rôle majeur d’animation de réseaux dans ce domaine. Par exemple, elle peut animer des accords de branches territoriaux où l’Etat négocie avec l’entreprise la mise en place d’un processus de chômage partiel et dans un même temps financer les formations qui permettront aux personnes de retrouver un emploi sur le territoire. La Région est la mieux placée pour d’une part conduire ces politiques et d’autre part, attirer des activités, faciliter la reprise d’entreprise, ou encore favoriser la recherche. Car bien évidemment, pour conduire des politiques de sécurisation des salariés, il est nécessaire de développer les activités et l’emploi. Il faut trouver l’équilibre entre ces deux jambes pour bien marcher !
Cependant, tout n’est pas question de compétence, la taille, l’effet de masse est primordial. Et aujourd’hui en France certaines régions n’ont pas une masse critique suffisante pour attirer et créer une dynamique entre le monde économique et ceux de l’université et de la recherche. En France aujourd’hui, on appelle « région » des territoires qui n’en sont pas. A l’inverse, des agglomérations comme le Grand Lyon, puissant et diversifié, représentent un potentiel comparable à certaines Régions. La relation de complémentarité avec la Région s’étudie alors différemment même si elle est probablement tout aussi importante. Enfin, les territoires ont leurs propres spécificités. Par exemple, à Grenoble, en simplifiant à outrance, l’emploi est aussi bien dans la micro électronique, que dans la fabrique de l’huile de noix, des secteurs d’activité bien différents.
L’Autriche est-elle toujours un exemple et pourquoi ?
L’Autriche connaît actuellement le plein emploi, elle a un taux de chômage qui n’excède pas 4%. C’est la vraie success story de l’Europe !
Adossée au dynamisme exportateur de la Bavière, elle a su développer des activités complémentaires et des compétences transférables par l’apprentissage. Elle met en œuvre un dialogue social permanent et a beaucoup innové dans le domaine de la sécurisation des parcours. Elle abrite 8 millions d’habitants, une grande ville centre, Vienne, et est entourée de montagnes. Elle est en ce sens comparable à Rhône-Alpes avec ses 6 millions d’habitants, Lyon et les Alpes. Elle pourrait être une source d’inspiration…
N’y a t-il pas des écueils à éviter dans une approche territoriale de la flexisécurité ?
Si le territoire est incontestablement l’échelon pertinent, il convient toutefois d’éviter que les territoires riches produisent des mobilités riches et que les territoires pauvres produisent des mobilités pauvres. Le transfert ou la solidarité entre territoires, doit être garanti aujourd’hui au niveau national et de plus en plus au niveau européen.
Comment concrètement mettre en œuvre des stratégies de flexisécurité à l’échelle des territoires ?
Aujourd’hui, dans un contexte encore peu décentralisé, il s’agit d’abord d’inventer des mécanismes pour mieux coordonner les dispositifs nationaux ou européens. Mais de multiples innovations sont à l’ordre du jour.
Par exemple, il y a un intérêt véritable à travailler sur les horaires de travail et d’ouverture des commerces et des services à l’échelle d’un grand quartier comme la Part Dieu ou d’une ville pour ne pas « coincer » des personnes dans leur évolution de carrière, dans leur emploi. Par exemple, en Italie, la question des horaires des crèches est abordée à l’échelle de certaines municipalités. Ces stratégies participent pleinement des politiques d’égalité sur un territoire. On sait que des personnes, et notamment des femmes, peuvent être contraintes de travailler à temps partiel, voire même de refuser certains emplois, avec de lourdes conséquences en termes financiers, mais aussi de déroulement de carrière.
La flexisécurité est-elle réellement une réponse à l’insécurité des salariés ?
La meilleure façon de créer de l’insécurité est de continuer de faire ce qui se fait en France aujourd’hui. Des gens qui se sentaient protégés par leur contrat à durée indéterminée le sont de moins en moins, même ceux qui ont suivi des formations, si leurs compétences ne sont pas validées et transférables d’une entreprise à une autre. Et, à côté de ces personnes, d’autres sont durablement dans des contrats précaires, en intérim, en contrat à durée déterminée, etc. Quand on ferme une entreprise où les gens se sentaient en sécurité, on provoque de la colère ; une colère d’autant plus importante que l’information est souvent tardive ; elle arrive parfois au moment où l’entreprise ferme.
Aujourd’hui, en dépit des multiples dispositions légales, on n’anticipe pas suffisamment les restructurations. Elles se déroulent trop souvent dans un climat de rupture et d’extrême violence sociale. Il s’y ajoute une injustice particulièrement criante et souvent méconnue pour les salariés des sous traitants, les personnes qui étaient en contrats précaires et qui disparaissent totalement de l’écran radar. Il en résulte une situation génératrice d’angoisse pour tout le monde.
La priorité est de ne laisser personne sur le bas-côté de la route, et d’envisager pour chacun des solutions à l’échelle du territoire, de dépasser l’entreprise. Il s’agit de favoriser les mobilités et les parcours professionnels en offrant les mêmes garanties aux personnes en intérim ou en contrat à durée déterminée qu’aux personnes en CDI. On peut comprendre que l’entreprise ne puisse seule apporter des solutions à tous et qu’elle se préoccupe prioritairement de ses salariés permanents. C’est pourquoi, les questions d’évolution de l’emploi et des mobilités doivent se poser à l’échelle d’un territoire et dépasser la seule enceinte de l’entreprise pour mutualiser les ressources et anticiper au mieux les besoins de demain.
C’est parce qu’aujourd’hui nous ne savons pas organiser des mobilités professionnelles que le sentiment d’insécurité se généralise.
La flexisécurité participe t-elle de la mixité sociale ?
La flexisécurité entendue au sens large a un effet immédiat sur la mixité et la réduction des inégalités. En effet, elle permet de prendre en compte les capacités de mobilités des salariés qui en ont le moins, notamment des femmes. En se révélant pertinente pour l’économie, elle conforte également la solidarité.
Les syndicats sont-ils prêts à travailler sereinement sur la flexisécurité ?
Les syndicats français, et notamment leurs élites, comprennent l’intérêt de sécuriser les parcours et d’organiser les mobilités. Ils sont hostiles, à juste titre, à l’égard des versions étroites de la flexisécurité. Cependant, ils sont en concurrence les uns envers les autres, ce qui les enferme souvent dans un jeu entre une position trop conciliante et la surenchère. Par ailleurs, ils se concentrent encore sur les négociations nationales, interprofessionnelles ou de branches, et s’investissent plus difficilement dans les stratégies locales, notamment parce que leurs structures n’ont pas été construites dans cette perspective.
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) créée dans les années 1990 devait permettre d’éviter les plans sociaux, en engageant des études prospectives et des actions concertées sur les besoins de l’entreprise, les métiers qu’elle allait devoir abandonner et au contraire les nouveaux métiers dont elle aurait besoin. Cependant la GPEC n’a jamais pu fonctionner de manière satisfaisante à ce niveau d’une entreprise seule. Par exemple, les firmes automobiles font face à une demande particulièrement instable. On achète une baguette de pain tous les jours y compris lorsque l’on rencontre des difficultés économiques, mais on peut aisément reporter l’achat d’une nouvelle voiture de six mois ou un an si on est pessimiste. Or, dans ce secteur instable, la compétition entre la France et le Japon a contraint durant les années 1990 les fabricants à rechercher des gains productivité de 10% par an avec peu de perspectives de développement des ventes (2% en moyenne). Ce qui veut dire que chaque année, hors activités nouvelles, pour atteindre ces résultats, les entreprises auraient dû afficher une diminution de leur personnel de 8%. Négocier sur une telle perspective revenait à afficher froidement la possibilité d’une contraction de moitié des effectifs dans un délai de 5 ans ! Les responsables ont préféré s’en tenir au constat de l’instabilité du secteur, ont eu recours au remplacement des départs à la retraite par des embauches d’intérimaires, et n’ont donc pas développé de GPEC.
Aujourd’hui, la GPEC revient, mais, de manière bien plus logique, au niveau des territoires et devient la GPECT, avec T comme territoriale. Dans une réflexion plus globale et dans le souci d’aider les personnes en sécurisant leur parcours professionnel, et les entreprises (notamment les PME) en leur assurant la disponibilité des compétences nécessaires, les employeurs et les syndicats sont alors plus aisément partie prenante. Ce n’est certes pas facile de réunir autour d’une même table, les syndicats, les chefs d’entreprise et des économistes, pour réfléchir aux questions de l’emploi et des compétences à l’échelle d’un territoire, mais c’est pourtant une démarche qui se révèle indispensable.
Des initiatives émergent, et par exemple à Toulouse, une démarche de GPECT a été engagée pour anticiper le vieillissement de la population, mieux cerner les emplois qui seront libérés et ceux qui devront être supprimés ou créés.
Dans un contexte de mondialisation et de crise économique, comment conduire une réflexion prospective quand les entreprises n’ont pas plus de six mois de lisibilité de leur activité ?
Ce qui est important n’est pas de permettre à chaque entreprise d’anticiper en détail ses propres besoins à l’horizon de plusieurs années, mais de lui apporter des garanties en termes de formation et d’accompagnement partagé des salariés.
Aujourd’hui, les personnes qui travaillent en Région dans ce domaine, que ce soit les services concernés de l’Etat, les représentants des collectivités ou des syndicats, multiplient les réunions d’instances enchevêtrées sans moyen réel de décision et d’action. Il conviendrait de mieux répartir les responsabilités et d’être plus actifs dans la décision. Par exemple, Pôle emploi a une compétence en matière de formation et de placement des chômeurs, qui appelle bien des efforts de coordination avec les autres partenaires locaux. On pourrait envisager que les politiques d’emploi soient confiées à la Région, déjà maître d’œuvre des politiques de formation continue, des liens entre les activités de recherche – développement et les entreprises. Nous sommes dans un système encore trop centralisé. L’Etat devrait se focaliser sur des fonctions de contrôle et de solidarité en garantissant les redistributions entre territoires pour éviter des inégalités.
N’est-ce pas à l’Europe d’être le garant de la solidarité entre régions ?
L’Europe d’aujourd’hui est une construction institutionnelle incomplète : elle est monétaire, mais elle n’est pas (ou trop peu) budgétaire. Or, pour assurer un rôle de stabilisation macroéconomique et de solidarité entre les différents membres, il faut tenir les deux leviers.
De plus, l’égoïsme des régions est aujourd’hui une vraie menace pour l’Europe. L’exemple de la Belgique avec le conflit entre la Flandre et la Wallonie, et l’une des régions qui ne veut plus être solidaire de l’autre, est en ce sens éloquent. La position de la Catalogne envers les autres régions espagnoles est un autre exemple qui confirme ce danger.
Par ailleurs, l’Europe connaît actuellement un terrifiant déficit de démocratie. Toutefois, elle progresse de crise en crise, et j’espère qu’elle va enfin aider la Grèce à sortir de la course folle à l’austérité dans laquelle le jeu des marchés financiers et la gestion inutilement moralisatrice et à minima de la spirale de l’endettement l’ont enfermée, et qu’elle pourra reprendre sa progression vers plus de démocratie et de responsabilités. Ce qui n’exonère pas les Etats et les Régions de renforcer leurs efforts en faveur d’une meilleure cohésion économique et sociale.
L’économiste Bernard Gazier est professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et ancien membre « senior » de l’Institut universitaire de France. Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, professeur agrégé de sciences économiques (doctorat obtenu en 1979 et agrégation en 1983), il est économiste du travail et spécialiste des politiques de l’emploi. Depuis une quinzaine d'années, il travaille plus particulièrement sur les « Marchés Transitionnels du Travail », perspective de réforme du marché du travail et de la protection sociale qu'il a introduite en France à la suite des travaux de l'économiste allemand Günther Schmid.

Étude
Et si le turn-over et l’attractivité en berne des métiers du prendre soin était lié à des transformations organisationnelles et managériales ?

Étude
Comment le care peut renouveler notre rapport à l’autre, à la société, à la nature et aux objets ?
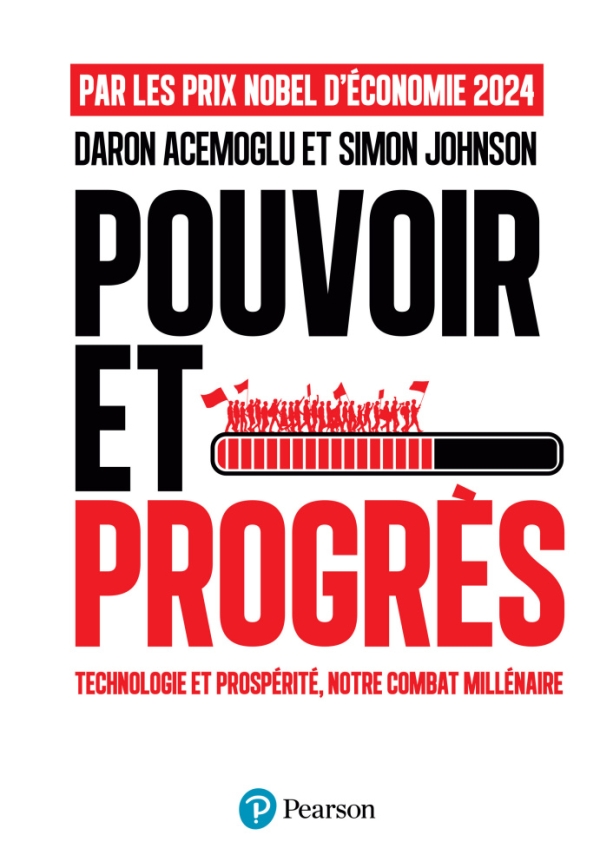
Article
Si l’IA peut automatiser des tâches répétitives et libérer du temps pour des activités plus créatives, elle menace également de nombreux emplois.

Article
Le défi de la transition économique est immense, complexe, car il implique des transformations des activités et des modèles.

Dossier
Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?

Étude
Comment expliquer le manque d'attractivité des métiers du prendre soin ? pourquoi on candidate, on tient, on s’en va ? Retrouvez la synthèse des enseignements des différentes enquêtes conduites sur ces questions.
Texte de Patrice RAYMOND
Un point de vue critique du système de péréquation redistributive des recettes des collectivités.

Étude
60 tendances pour questionner les exigences de l'organisation et le besoin d'harmonie au travail.

Article
Décryptage des perspectives ouvertes par les Scop, à travers les analyses croisées des parcours des entreprises Hélio-Corbeil et Solyver.