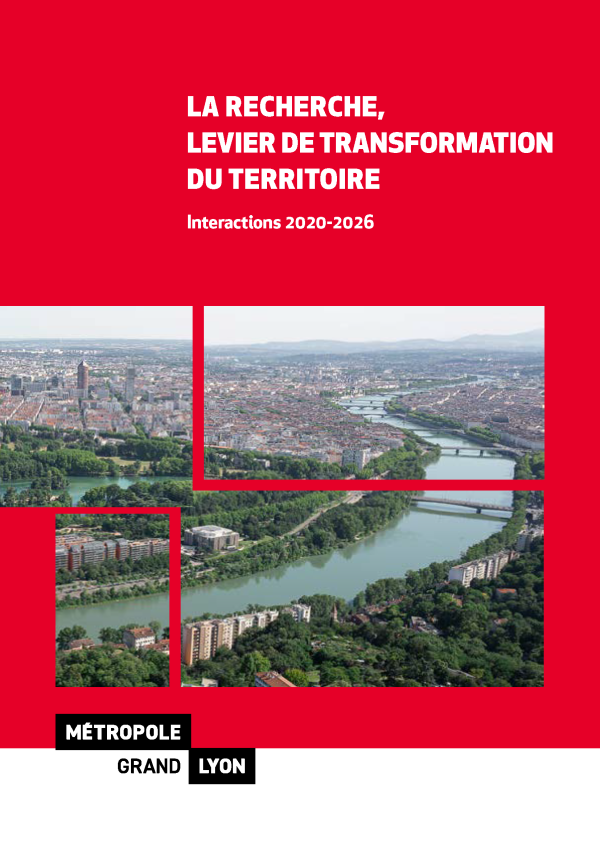Pourquoi, au début des années 70, le service de l’Assainissement de la Communauté urbaine a-t-il sollicité un laboratoire de l’INSA de Lyon ?
Nous sommes allés voir l’INSA parce que nos formules de calcul n’étaient pas adaptées à un gestionnaire d’une grande infrastructure comme Lyon.
Quand on a un réseau ramifié, avec un tronc, des branches principales et secondaires, c’est simple. A Lyon, le réseau est maillé. C’est tellement compliqué qu’on ne sait pas faire sans ordinateur, modélisation et simulation. Nous ne pouvions pas utiliser les modèles développés aux Etats-Unis qui s’appliquent aux premiers réseaux, ramifiés ; il a fallu avoir des modèles extrêmement plus compliqués.
Pour dimensionner les réseaux, on utilisait à l’époque une formule, la circulaire 1333 d’un dénommé Albert Caquot qui se basait sur des séries de pluies de Paris Montsouris. C’était inadapté à Lyon !
Le dimensionnement se faisait à la règle à calcul et à la calculette, avec des formules extrêmement simplifiées qui nous donnaient des valeurs de débit de pointe, mais n’indiquaient absolument pas la dynamique de réseau. On ignorait si le réseau pouvait passer ce débit et comment il fonctionnait. Ces formules convenaient pour dimensionner un nouvel ouvrage, mais n’étaient absolument pas adaptées pour gérer un réseau et voir s’il était correctement dimensionné pour les pluies. En 1977, une nouvelle instruction technique du ministère de l’Intérieur a remplacé cette formule 1333 pour dimensionner les collecteurs.
Si je vous comprends bien, la situation lyonnaise a exigé la création d’outils « sur mesure »…
Exactement ! Il nous a paru important d’avoir une modélisation pour savoir pourquoi nous avions des zones d’insuffisance ; une modélisation qui puisse nous permettre de réaliser des simulations sur le réseau existant, en tenant compte des pluies diverses. Pour cette raison nous avons choisi, au service de l’Assainissement, le slogan : « agir en connaissance des conséquences ». Il nous fallait pouvoir simuler, observer les conséquences, et ensuite réadapter le réseau à partir des connaissances acquises. Je simule telle pluie, je fais tourner mes modèles, qui vont me dire que nos réseaux sont ici en surface libre, ailleurs en charge, en charge partielle ou débordent. S’ils débordent, nous pouvons modifier artificiellement le réseau et refaire une simulation, jusqu’au moment où il fonctionne bien.
Concrètement, comment s’est réalisée la coopération avec l’INSA ?
Quand je suis entré à la Communauté urbaine, en 1976, Daniel Seguin, étudiant de l’INSA avait réalisé sa thèse sur l’évaluation des coefficients d’imperméabilisation à prendre en compte dans des calculs, en fonction des typologies d’urbanisme. Bernard Chocat s’est lancé à son tour dans une thèse qui consistait à réaliser un modèle mathématique d’hydrologie. Il travaillait déjà avec Guy Peyrreti, à l’époque jeune ingénieur docteur lui-même en géologie qui a été, du côté de la Communauté urbaine, le premier lien avec l’INSA.
Nous avons réfléchi avec Bernard Chocat à l’organisation d’une base de données et au développement de modèles. Le premier fichier SERAIL, c’était en 1978 ; la première « simul » a dû tourner cette année-là. Ce qui est assez drôle, c’est que les Directions Départementales de l’Équipement avaient ressenti le même besoin que nous et mis au point un logiciel national d’hydrologie, RERAM. Les logiciels SERAIL et RERAM sont pratiquement sortis en même temps ! Il y a eu, ensuite, plusieurs versions de SERAIL, développées avec ICARE. On a vendu SERAIL à Bordeaux dans les années 1987-88.
Comment les élus ont-il perçu cette collaboration avec le monde de la recherche ?
Il faut savoir que SERAIL, de 1978 à 1985, on l’a pratiquement développé en cachette. Nous en avons parlé aux élus que quand nous avons eu besoin d’ICARE, autrement dit des besoins informatiques externes. C’était en gros au moment où SERAIL a marché, nous les avons mis devant le fait accompli. Nous avions dépensé un peu d’argent, mais tu ces dépenses en attendant d’avoir un outil opérationnel. Du coup, on ne nous a jamais mis de bâton dans les roues jusqu’au moment où l’on a pu faire valoir des outils de simulation uniques en France.
Le directeur général des services techniques, Fernand Pauwels était-il au courant de ces recherches ?
Oui, ainsi que le directeur de l’Assainissement, André Poncet.
Peut-on dire que ce sont les inondations, donc des catastrophes, qui ont suscité le besoin de mieux dimensionner le réseau et d’en passer par des simulations ?
Nos anciens avaient réalisé des collecteurs largement dimensionnés à Lyon ; il y en avait pratiquement un sous chaque rue et le réseau fonctionnait bien. Sauf qu’avec la grande explosion urbaine des années 50/60, on a fait convergé toutes les eaux de l’Est lyonnais, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin…, dans le centre ville. Les grands collecteurs structurants, situés sous la route de Genas, la rue du 4 août, le cours Tolstoï…, se sont mis à exploser les uns après les autres.
Exploser ?
Lors des pluies abondantes, il y avait des zones de débordement, cela faisait sauter les tampons, inondait les maisons. On avait donc besoin d’outils pour savoir pourquoi ces zones-là étaient des zones d’insuffisance. C’est un peu comme un périphérique : si toute la circulation routière pénètre en centre ville, vous êtes sûr d’avoir un bouchon gigantesque ! Les modélisations nous ont permis de construire les collecteurs d’interception, pour éviter que l’eau aille vers le centre.
Les inondations nous ont aussi permis de caler les choses. A Bron par exemple, notre ingénieur avait augmenté la capacité du tuyau là où une inondation s’était produite. En réalisant des simulations, on lui a démontré que l’endroit inondé n’était pas la cause de l’inondation : la cause se situait plus loin. Quand un bouchon se crée, il y a refoulement. Nous lui avons conseillé d’investir où il le fallait et on a économisé des millions de francs ; autrement, on aurait continué à investir à un mauvais endroit…
La simulation s’est donc révélé rapidement un bon outil ?
En une simulation, nous avions récupéré tout l’argent dépensé pour développer le modèle et engranger les données ! Ensuite, à partir de SERAIL, on a créé le premier système d’information géographique (SIG) communautaire.
Comment ?
En 1984, on a commencé à exprimer le besoin de mettre en relation notre base de données réseaux pérennes avec une base descriptive superficielle ; donc de faire une base de données du sol. C’est à ce moment-là que tout le monde s’est aperçu de notre avance ! Nous étions la première collectivité de France a développer ce type d’outil. Nous avions anticipé à tel point qu’en 1986, nous avions rencontré nos collègues qui s’occupaient des plans, fonds de plans, cadastres, en leur disant que s’ils ne faisaient pas une base de données, nous, on allait la faire ! Je m’explique : notre base de données initiale contenait bien une description des ouvrages (collecteurs, regards, chutes, etc.) ; par contre elle n’intégrait pas la description du bâti et des surfaces. Nous avions modélisé, en 5 ans de travail de saisie, avec un Techtronics acheté en 1980 (premier ordinateur graphique de la Communauté qui était associé à une table à digitaliser et un écran graphique), les 50 000 bassins versants du territoire communautaire, à partir de photographies aériennes, et avions intégré la surface du bassin versant drainé, la typologie d’habitat, le coefficient d’imperméabilisation des sols, etc. C’était très difficile à modifier. Nous avions donc ressenti le besoin d’avoir une base de données descriptive de la surface des sols. La Communauté urbaine a décidé en 1986 de se lancer dans sa base de données, de créer un système d’information géographique. On a donc décidé d’abandonner SERAIL.
Ces réalisations pionnières du service de l’Assainissement sont liées à la coopération avec des structures de recherche…
Oui, c’est lié à la proximité d’une grande école et aux personnes, au fait que des gens étaient volontaires. Nous nous sommes enrichis mutuellement. Si Bernard Chocat est aujourd’hui un « Pape » de l’hydrologie en France, c’est que nous l’avons aidé. Il a fait sa thèse parce qu’il trouvait le sujet intéressant ; à partir de là, nous avons toujours mis à disposition des mesures ou des lieux. A l’inverse, notre niveau de compétence, nous l’avons obtenu grâce aux universitaires. La Communauté urbaine a connu, grâce à la collaboration étroite avec des laboratoires, des avancées importantes dans la gestion de son système d’assainissement : assistance pour la réalisation ou la modélisation du réseau d’assainissement, meilleure connaissance de l’impact des déversoirs d’orage, définition de modes opératoires pour la gestion des ouvrages de rétention-infiltration, choix des techniques de mesure dans le cadre de l’autosurveillance, application de méthodes scientifiques pour la validation de données de mesure ou d’analyse, étude de nouvelles techniques de prévision de pluie…
Une fois que Daniel Seguin et Bernard Chocat à l’INSA se sont emballés pour l’hydrologie et ont créé une cellule hydrologique au sein du Laboratoire Méthodes de l’INSA, il y a eu des étudiants qui ont fait des projets de fin d’études, soutenus des DEA, passés des thèses. On s’est culturé par ce biais. Tous les 2 ou 3 ans, un thésard produisait.
Par qui étaient choisis les sujets ?
Ils étaient chaque fois cosuivis. J’ai fait partie de très nombreux jurys de thèses, ce qui m’a extrêmement enrichi. L’INSA nous a aidé à résoudre les questions que nous nous posions, nous aidant à trouver des réponses au « comment pourrait-on faire ? ». Nous avons aussi beaucoup travaillé avec ICARE, avec Françoise Barré qui s’est beaucoup investie.
Comment s’emballe-t-on pour ce type de questions ?
C’était un sujet assez vierge. On était des pionniers, et on découvrait l’informatique et ses capacités. Quand je suis arrivé à la Communauté urbaine, on utilisait encore les machines à calculer à manivelles ; je me souviens aussi de gens à la comptabilité qui travaillaient avec les bouliers. Avant l’ordinateur, tout le dessin était à la plume. Mes premiers dessinateurs faisaient les plans — magnifiques ! — à l’encre noire, et à l’encre rouge pour la partie projet. La révolution informatique entre 1975 et 1995 a été incroyable !
Les premières cartes que j’ai fais tourner sur ordinateur étaient des cartes graphitées, à la mine de crayon ; les suivantes ont été des cartes perforées, que l’on avait perforé soit chez un géomètre soit à l’INSA, et qu’on entrait ensuite dans la machine. C’était le début du début… Les premières cartes à dessiner automatiques sont apparues aussi. Nous avons pu commencer à faire le plan du réseau d’assainissement. Ensuite, pour réaliser des simulations, il nous fallait d’énormes ordinateurs. On a tourné avec l’UNIVAC de l’INSA, avec l’IBM d’ICARE et sur l’ordinateur du centre universitaire de Lyon Saint-Etienne. Lancer une simulation prenait deux ou trois jours de machine. Les autres services n’avaient aucun outil.
Les relations avec l’INSA se sont faites exclusivement dans le domaine de l’assainissement. Pourquoi le service communautaire en charge de l’eau potable n’a-t-il pas tissé semblable lien avec le monde de la recherche ?
A l’Assainissement, on a la chance d’être en régie directe avec un important bureau d’études, intégré, donc de faire les études, le suivi de la réalisation des travaux, et l’exploitation. Ayant les trois casquettes, nous avons facilement pu construire ces systèmes. Sans un bureau d’études, nous aurions fait faire. L’eau potable était aussi en régie directe, mais la politique de l’eau est resté très dépendante des bureaux d’études, et notamment du cabinet Merlin qui avait développé des modèles et possédait, du coup, les modèles de toutes les communes. Grâce à la capacité de conception de SERAIL, on a pu se passer des bureaux d’études qui étaient, avant la création de la Communauté urbaine, en contrat avec les communes.
Notre chance aussi, c’est que nous sommes partis de rien, il a même fallu qu’on refasse le plan de recollement ! Les modèles en assainissement n’existaient pas, contrairement à l’eau potable où c’est beaucoup plus simple puisqu’on est en conduite fermée et qu’il n’y a pas de pluie. Aujourd’hui, le Grand Lyon a aussi une modélisation du fonctionnement du réseau d’eau potable.
Les besoins de recherche sont-ils plus forts dans l’assainissement que dans les autres services urbains, voirie et propreté ?
Certainement, parce que la pluie est un phénomène aléatoire. Depuis fort longtemps, l’hydraulique est un sujet de réflexion et d’ingénierie, pour l’étude des écoulements dans les ouvrages, la mesure des débits, etc. On compte de grands maîtres, comme le français Henry Bazin à la fin du 19ème siècle, Colebrook et bien d’autres.
Dans les autres services urbains, la recherche est nécessaire, mais pas à un tel niveau, sauf peut être en matière de circulation automobile, où l’on rencontre les mêmes problèmes qu’en hydrologie. La Voirie aurait sans doute pu accomplir ce que nous avons fait en termes de simulation pour savoir comment mieux fluidifier le trafic. L’Etat a d’ailleurs développé des logiciels qui ressemblent à ceux d’hydrologie. Un trafic routier est assez analogue à un écoulement de fluide, avec des pertes de charge, des ralentissements à certains endroits, d’autres où l’on peut faire du stockage. J’ai d’ailleurs proposé que l’on réalise un logiciel de voirie qui intègre les chantiers, pour connaître les pertes de charge et ne pas faire en sorte que l’on réalise des chantiers de manière simultanée. Aujourd’hui, le PC CRITER de la direction de la Voirie permet ce genre de modélisation.
Pour revenir aux années 80, que se passe-t-il après l’abandon de SERAIL ?
Vous n’aviez plus de logiciel de simulation de l’assainissement ?
Bernard Chocat a considéré que les ordinateurs personnels commençaient à être efficaces et il s’est lancé dans la réalisation d’un logiciel pour PC, ce qui a donné naissance au logiciel CEDRE.
Au passage, on a obtenu pour le faire les premiers contrats CIFRE de France à travailler directement dans une collectivité. Il s’agissait de contrats de recherche avec l’ANRT, l’Association Nationale de la Recherche Technique. Ils étaient réservés à des industriels, mais nous avons pu démontrer que nous, service de l’Assainissement, étions un service public à caractère industriel et commercial. L’ANRT a accepté de conventionner avec nous et nous avons embauché deux contrats CIFRE, Laurence Lupin et Catherine David, toutes deux docteurs ingénieurs.
CEDRE était très bien pour concevoir des réseaux neufs, mais ne pouvait remplacer SERAIL. En 1993, nous avons alors pris la décision de nous lancer dans un logiciel capable de communiquer avec d’autres bases de données. Comme cela coûtait très cher, on est parti avec deux concepteurs techniques, l’INSA et SOGREAH, un développeur informatique, la société ALISON et des maîtres d’ouvrage/utilisateurs, le Grand Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg. Ils ont financé le tout et défini le cahier des charges des fonctions, en décidant donc de concevoir un logiciel national, CANOE. Il existait des logiciels nord-américains, mais nous av préféré nous relancer nous-mêmes. On a commencé les modélisations en 1994, le logiciel a été opérationnel à cette date et a remplacé CEDRE. Là encore, nous avons connu plusieurs versions. Aujourd’hui CANOE est utilisé tous les jours, soit pour faire de la modélisation générale, soit pour faire des projets de dimensionnement. Avec CANOE, nous sommes capables de simuler l’évolution de la ville pour connaître son impact sur le système d’assainissement et décider ensuite des modifications de réseaux. On sait par exemple déjà comment fonctionnera le réseau en 2012, quand on mettra en service la station d’épuration de La Feyssine. Dans cette station, les chercheurs auront à leur disposition une halle, ou laboratoire de recherche.
La mise à disposition par le Grand Lyon d’un laboratoire dans une de ses stations d’épuration, c’est un pas de plus dans votre coopération avec le monde de la recherche ?
Pas exactement, car la direction de l’Eau a toujours mis des sites, des équipements et du matériel à disposition des chercheurs. C’était déjà le cas de l’Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine, l’OTHU, sorte de laboratoire de recherche hors les murs constitué par un ensemble d’appareils de mesure installés sur le système d’assainissement du Grand Lyon. Il a été créé en 1998 parce qu’on a considéré qu’il fallait monter une structure pérenne qui permette aux chercheurs de travailler sur des sites et des données, plutôt que de définir pour chaque nouvelle étude des procédures d’analyse qui ne servaient qu’une fois. Il fallait aussi un site pérenne qui puisse profiter à un biologiste, à un hydraulicien, à un mécanicien des fluides, etc. On s’est mis d’accord sur les données et les paramètres pour avoir une fiabilité dont profitent tous les chercheurs qui travaillent sur ces sites et ces données.
L’OTHU est véritablement une co-construction, une structure faite pour nous aider à réaliser ce que l’on veut réaliser ; les recherches partent des besoins locaux, de la mise en lien de nos besoins avec ce que peuvent produire les laboratoires.
Pour revenir à la future station d’épuration de La Feyssine, nous avons tenu compte dans le cahier des charges de la proximité des laboratoires de la Doua et décidé de donner aux chercheurs un espace où ils pourront développer des pilotes, autrement dit des stations d’épuration miniatures pour effectuer des tests. Grâce à des robinets, ils pourront par exemple obtenir l’eau à toutes les étapes de l’entrée à la sortie des ouvrages.
On parle de technologies « alternatives » en matière d’assainissement : d’où cela vient-il ?
Nous en parlons et en réalisons depuis 30 ans ! A Lyon comme ailleurs, on est parti du courant hygiéniste qui repose sur le principe suivant : les miasmes venant du sol, il faut faire circuler l’eau dans la ville à la manière du sang circulant dans le corps, donc collecter et rejeter très vite en aval de l’agglomération. Cela s’est traduit par la construction de tuyaux, pour que l’eau et l’assainissement pluvial ne restent pas. Pourtant, on s’est aperçu assez vite que cette politique de transport, collecte et rejet massifs était idiote, car il faut des tuyaux toujours plus gros qui demeurent, malgré tout, insuffisants. Nous savons aussi que les eaux pluviales, une fois mélangées aux eaux usées, deviennent sales. Elles provoquent en cas d’orage, en se déversant dans les ruisseaux et rivières, un effet de choc : l’oxydoréduction, ou consommation d’oxygène par les bactéries entraîne la mort des poissons et la réduction de la biodiversité ; l’effet de stress, en raison de rejets fréquents d’eau de pluie provoque, à terme, une sélection de la faune et de la flore… Par effets cumulatifs, avec les PCB notamment, des toxiques stables vont se retrouver dans la chaîne alimentaire. Les toxiques que Lyon rejette sont présents jusqu’à la Camargue et dans la Méditerranée !
Il faut aussi penser que la gestion des conduites enterrées est un vrai casse tête, tellement c’est complexe. Enormément d’argent a été dépensé par la Communauté urbaine pour son réseau d’assainissement : il représente de 4 à 5 milliards d’euros !
C’est considérable !
Oui, cela témoigne qu’on a été très riches. Mais nos enfants auront-ils suffisamment d’argent pour entretenir ce patrimoine ? Ne faut-il pas concevoir des solutions différentes pour réduire les coûts, des techniques plus adaptables, alternatives au tuyau ? A la direction de l’Eau, nous pensons qu’il faudrait révolutionner nos modes de faire, transformer notre vision des choses, revenir à des techniques plus simples.
Autre constat : en matière de réalisation d’infrastructures pluviales, nous avons suivi le même chemin que d’autres infrastructures, routières par exemple. En les planifiant, nous les avons rigidifiées, rendant difficile tout retour en arrière. Or, avec le réchauffement climatique, nous avons tout intérêt à réaliser des ouvrages qui puissent être adaptatifs, donc à abandonner une programmation trop rigide.
Quel est le rapport entre le réchauffement climatique et les techniques alternatives d’assainissement ?
Les techniques alternatives sont modulables, elles permettent de s’adapter aux situations et aux usages. Sur le site de la Porte des Alpes, nous avons réalisé des bassins-lacs en plusieurs phases, sans être obligé d’investir pour la totalité de l’urbanisation prévisionnelle. Si l’on avait choisi la solution du tuyau, il aurait fallu en mettre un énorme, tout de suite, en prévision de l’urbanisation future. Donc un investissement considérable, perdu en cas de changement de politique ! Le Grand Lyon conçoit et réalise aujourd’hui des places prévues pour être inondées en cas de très gros orages, ce qui évitera d’inonder des zones commerciales ou d’habitat. Ce n’est pas si gênant, car personne n’ira sur ces places un jour de gros orage… Toujours à la Porte des Alpes, nous avons réalisé dans la même perspective deux terrains de football inondables, utilisés par l’Université Lyon 2. Bref, les techniques alternatives permettent le multi-usage, le multifonctionnel, de penser et réaliser l’aménagement urbain en fonction des différents types de pluviométrie — la petite pluie banale, la pluie plus forte et la pluie extrême — ce qui suppose d’admettre éventuellement qu’une chaussée soit inondée, mais en prévoyant un piétonnier légèrement surélevé pour préserver les piétons… C’est un nouveau paradigme.
D’où vient il ?
Tout simplement de la limite de l’usage des tuyaux ! En l’occurrence, les modélisations nous ont été fort utiles en montrant que lorsqu’on transfère de grands débits d’eau, on peut inonder des zones avales qui n’auraient pas été inondées sans ce transfert. Avec du transfert d’eau dans un collecteur, on peut créer une inondation catastrophique. Il est donc préférable d’utiliser les aménagements de surface et d’inonder un peu partout. Par ailleurs, nous savons que tout ce que l’on construit sera un jour insuffisant, qu’il est impossible de trouver une parade à un épisode pluvial exceptionnel. Un jour, la gare de la Part-Dieu sera certainement inondée… Ce qu’il faut, c’est que la crise ne devienne pas catastrophe, et pour cela anticiper quelles zones seront inondées. En matière de gestion des eaux pluviales, nous sommes dans la nécessité du changement.