Parc de Parilly et domaine de Lacroix-Laval. Les années départementales

Étude
Les grands parcs apparaissent comme des espaces à part, qui proposent une nature organisée par l’homme et reflètent les préoccupations des époques qu’ils traversent.


Vous êtes ici :

Texte de Philippe DUJARDIN
Tag(s) :
Publié in Gilles Bertrand et Ilaria Taddei (dir.), Le Destin des rituels, École française de Rome, 2007 — Philippe DUJARDIN
« Nous pouvons l’affirmer sans exagération : depuis 15 ans, nous avons sous les yeux un vrai prodige.
Rien de plus inexplicable que l’origine et que la perpétuité de cette fête. Aujourd’hui, comme à la date mémorable du 8 décembre 1852, point de préparation, point d’organisation, point de caractère officiel.
À peine la nuit tombe-t-elle qu’apparaissent quelques cordons lumineux sur les étages des maisons qui bordent la Saône, puis la ville entière s’embrase comme par enchantement. »
L’auteur de ce texte, rédigé en 1868 sous le titre L’illumination du 8 décembre à Lyon, est Joannès Blanchon. À la date de cette relation, Blanchon est rédacteur à La Gazette de Lyon, quotidien légitimiste fondé en 1845, rédacteur en chef de L’Écho de Fourvière, hebdomadaire politique et religieux, qu’il a fondé en 1863, secrétaire de la Commission de Fourvière depuis 1853.
Plus de 150 ans après l’événement initial, consentons, comme Joannès Blanchon, à nous étonner. Mais au constat de « l’inexplicable » de l’origine et de la perpétuité, nous substituerons une triple interrogation : sur les conditions d’apparition de la manifestation, sur les conditions de pérennisation de ce surprenant rituel, dit de « l’Illumination du 8 décembre », aujourd’hui désigné comme « fête des Lumières », sur les métamorphoses ou avatars qui ont été les siens et partant, sur le sens que l’on peut prêter, dans un tel contexte, au terme « profanation ».
Le motif est celui de l’inauguration d’une statue de la Vierge, coiffant le clocher d’un lieu de culte sis sur le plateau de Fourvière. Ce lieu de culte, communément désigné comme Sanctuaire de Fourvière ou chapelle de Fourvière, consiste, en fait, en une double chapelle, l’une, dédiée à Saint Thomas de Cantorbéry, l’autre, à Notre-Dame de Bon-Conseil.
Le clocher de cet édifice menaçant ruine, sa rénovation est autorisée par le cardinal-archevêque Maurice de Bonald, fils du philosophe traditionnaliste Louis de Bonald. Un membre de la confrérie de Notre-Dame de Fourvière, François Desgeorge, propose, lors d’une réunion de ladite confrérie, le samedi de Pâques de l’année 1850, de faire du clocher un gigantesque piédestal supportant une statue en bronze doré, de telle sorte « que son éclat rayonnerait aux quatre points cardinaux et que pourrait la saluer de loin l’étranger qui a entendu parler des merveilles de ce sanctuaire vénéré ».
Voulue d’échelle « colossale », la statue de bronze revêtue d’une épaisse couche d’or mesure cinq mètres de haut. Autrement colossale sera, en 1856, la statue de Notre Dame du Puy, coulée dans le bronze des canons pris lors de la bataille de Sébastopol. La fonction de telles statues est donc immédiatement sémaphorique : elles signalent et situent, dans une géographie urbaine, une éminence et un lieu de dévotion. Mais ces statues ont, tout autant, une fonction « sémiophorique » : elles portent un sens, elles délivrent un message. Les membres de la confrérie de Notre-Dame de Fourvière n’ont-ils pas demandé au maire de Lyon l’autorisation d’ériger cette statue colossale « comme un monument solennel de reconnaissance » et Joannès Blanchon ne compare-t-il pas la statue de la Vierge lyonnaise à un « phare dressé dans les orages » ?
Signal visuel pour la région tout entière, la statue est présentée comme le gage de la protection que la Vierge est censée accorder à Lyon. Le socle de la statue atteste de la protection de la Vierge lors de différentes épidémies : non pas celles de la peste, comme le voudrait l’insistant « on-dit » lyonnais, mais celles du choléra qui menacent encore le Nord et le Sud de l’Europe dans les années 1830-1850. La sauvegarde est aussi celle que la Vierge accorde à sa cité contre « la fureur des guerres civiles ».
Notons que la disposition de cette statue de la Vierge déroge aux usages cultuels et liturgiques de la tradition catholique. En effet, l’effigie de la mère — Vierge de protection tendant ses mains vers la ville — se substitue à la croix de son fils normalement posée au faîte du clocher. Dans les milieux catholiques eux-mêmes, ce dispositif inhabituel a nourri le soupçon de « mariolâtrie ». Le débat rebondira, 40 ans plus tard, lié cette fois à la symbolique de la basilique de Fourvière.
Les circonstances peuvent se résumer dans un double contretemps, double contretemps qui s’avérera être une insigne « faveur du ciel ».
Premier contretemps : l’effigie « colossale » doit être installée le 8 septembre 1852, l’occasion de la célébration liturgique de la Nativité de la Vierge. Mais la Saône est en crue, l’atelier du fondeur est inondé et le travail de fonte n’est achevé qu’au mois de novembre. Les autorités laïques et cléricales concernées décident de reporter l’inauguration de la statue, de la fête liturgique du 8 septembre à la fête liturgique la plus proche, soit le 8 décembre, fête de la Conception de la Vierge.
Le programme festif du 8 décembre reste identique à celui prévu pour le 8 septembre. Processions, messes, bénédiction de la statue à midi ; en soirée, pause de lampions autour de la chapelle et de la statue, feux de Bengale, sonneries de fanfares, tirs de fusées bleues et blanches, une gigantesque formule dédicatoire LYON À MARIE et deux dates 1643-1852 étant censées s’inscrire en lettres de plusieurs mètres de haut sur les flancs de la chapelle.
Second contretemps : le mercredi 8 décembre 1852, la foule est bien présente lors de la bénédiction de la statue, à la mi-journée. Mais, en raison des intempéries, le maître de cérémonie décide, à 6 heures du soir, de reporter les illuminations au dimanche 12 décembre.
Clercs et laïcs s’empressent de faire connaître le message : les festivités prévues sont annulées et différées. Or, le ciel se découvrant vers 7 heures, l’illumination commence, à l’initiative « privée », familiale, des dévots de Marie. Blanchon en donne le récit suivant :
« Le soir venu, une pluie abondante ayant abattu le vent, le ciel se dépouille et revêt sa brillante parure d’étoiles ; le calme le plus parfait règne dans l’air ; et Fourvière, ô regrets amers ! se dérobe dans la plus complète obscurité ; et fidèles au contre-ordre, les hommes qui voulaient naguère donner l’exemple imposent silence à leur enthousiasme.
Tout à coup apparaissent à quelques fenêtres inconnues des lignes de feu. L’excellent maître des cérémonies les aperçoit et court en toute hâte dans les maisons d’où part ce signal imprévu. “N’avez-vous pas connaissance, dit-il, du renvoi de l’illumination ? — Et vous, Monsieur l’Abbé, lui est-il répondu, ignorez-vous le prodige qui s’opère ?” Et, le conduisant sur un balcon, on lui montre la ville, qui s’était embrasée en un instant. On court chez Son Éminence, qui ne se doutait de rien ; on l’amène sur sa terrasse. À la vue d’un spectacle si ravissant, le vénérable prélat ne peut retenir ses larmes. L’Archevêché revêt une brillante parure, quelques flammes du Bengale s’allument sur les toits de la chapelle de Fourvière, la statue de Marie apparaît, et la grosse cloche de Saint-Jean, cet éloquent interprète des joies publiques, est lancée à toute volée. »
Les festivités religieuses, mais aussi les festivités civiles qu’autorise le régime du Concordat, reportées au dimanche 12 décembre, donnent lieu, dans le fil de l’heureux précédent du 8, à d’intenses préparatifs. On dresse l’apparat des devises enflammées, des emblèmes, des flammes de Bengale, des fusées étoilées, des transparents — ainsi du « magnifique transparent, représentant la Sainte Vierge au milieu de deux anges » disposé dans la cour de la préfecture. À ce dispositif quelque peu gâté, le jour dit, par un vent violent, s’ajoute l’extraordinaire de la réception par le gouverneur militaire de Lyon, de Castellane, d’un personnage hors du commun, l’émir Abd el-Kader.
À l’illustre prisonnier, l’Empereur avait lui-même annoncé, le 16 octobre, sa remise en liberté et garanti un traitement digne de son rang. La visite de l’émir, en route vers la Turquie, est ainsi rapportée par L’Annuaire administratif de la Ville de Lyon et du Département du Rhône, dans son édition de 1853 :
« Abd el-Kader, arrivé à Lyon ce jour même avec sa nombreuse suite, par les paquebots de la Saône, semblait avoir été convié providentiellement à cette solennité religieuse, afin d’emporter, en quittant la France, sur le scepticisme religieux qu’il attribuait au peuple français, des idées toutes différentes de celles qu’avait malheureusement gravé dans son esprit toute cette écume de bandits révolutionnaires, d’hommes tarés et pervertis dont la France n’avait cessé d’infester le sol africain pendant les années qui suivirent la conquête.
Le célèbre enfant du désert, que les autorités civiles et militaires entourèrent, du reste, de soins et de prévenances, parut profondément ému de tout ce que la ville de Lyon lui présenta dans la soirée de si touchant, de si unanime dans sa foi religieuse. Les chants sacrés que les chœurs nombreux se renvoyaient d’une rive à l’autre de la Saône, au milieu des feux de toute espèce, au bruit de la grande voix de toutes les cloches, l’aspect majestueux de la statue de Marie, illuminée par une éblouissante batterie électrique, toute cette immense manifestation religieuse enfin, parut impressionner vivement l’émir Abd el-Kader qu’on vit à une croisée du quai des Célestins, un instant comme absorbé, le front appuyé sur ses mains… Le 42e régiment et les dragons avaient organisé sous ses fenêtres des chœurs et des chants religieux adaptés à la fête lyonnaise. Le lendemain, Abd el-Kader quittait Lyon en ajoutant à ses adieux ces paroles : “C’est aux prières du clergé que la France devra son salut” ».
C’est ainsi, dans le hasard d’un double contretemps, dans l’heureuse fortune de la visite de l’illustre prisonnier que l’Empereur avait consenti à élargir, que s’origine la conversion d’un cérémonial d’inauguration en un geste inaugural ; geste inaugural d’une étonnante série, puisque ses effets courent de 1852 jusqu’à nos jours.
La conversion du geste d’inauguration en un geste inaugural d’une suite quasi ininterrompue de 1852 à 2005, a pour condition immédiate une « entrée en légende », le terme « légende » devant être entendu dans son sens littéral : legendum ou legenda, ce qui doit être rapporté, ce qu’il faudra dire de.
L’entrée en légende a sans aucun doute été nourrie par la lettre du cardinal-archevêque de Lyon placardée dès le 9 décembre à la porte de toutes les églises et reproduite par les feuilles publiques :
« Un des jours les plus consolants de notre épiscopat, et qui nous fait oublier bien des jours mauvais, sera, sans contredit, le 8 décembre 1852, fête tout à la fois de l’Immaculée Conception de Marie et l’inauguration de la nouvelle statue de Notre-Dame de Fourvière.
Notre cœur ne perdra jamais le souvenir du ce spectacle magnifique que notre ville archiépiscopale a étalé hier soir à tous les regards. Cette pieuse et brillante manifestation n’a pu lui être inspirée que par cet amour traditionnel pour la Mère du sauveur qu’elle a reçu de ses ancêtres, et qu’elle conserve comme un de ses plus beaux titres de gloire. Ce témoignage de piété filiale nous a d’autant plus profondément touché, qu’il a été spontané, unanime. Il a été pour nous une preuve éclatante que les malheurs des temps, les commotions politiques, les circonstances difficiles qu’il a fallu traverser, n’ont point altéré cette foi que Lyon a reçue aux siècles apostoliques, et cette confiance en Marie qui lui a été apportée avec la foi. »
De ce témoignage immédiat du cardinal-archevêque attestant publiquement de son émotion et de la consolation tirée de la « pieuse et brillante manifestation », on retiendra qu’il rapporte cette dernière au passé plurimillénaire d’une Église héritière directe des temps apostoliques, ainsi qu’à la longévité et à la qualité de la piété mariale lyonnaise, caractères qui avaient notamment autorisé un culte liturgique précédant de plusieurs siècles la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception. Mais on retiendra, aussi, qu’il installe l’événement dans le registre interprétatif de la « spontanéité » et de « l’unanimité ». Les commentaires écrits des dévots de Notre-Dame de Fourvière n’auront de cesse de conforter cet argument, tout en le complétant par une interprétation du phénomène moins pondérée que celle du cardinal : il en ira d’un « prodige », d’un « effet surnaturel », d’un « miracle ».
Les relations journalistiques et les informations archivistiques attestent, bien évidemment, de la préparation soignée d’une manifestation que beaucoup avaient escomptée automnale et qui était attendue avec impatience depuis que, le 25 novembre, avait été enfin achevée la pose de la statue, volontairement voilée jusqu’à son inauguration. Rien ne fut moins spontané que cette inauguration que Le Courrier de Lyon annonçait en ces termes : « Cet élan pieux, qui va se propageant partout et recrutant dans toutes les classes de la société lyonnaise de nombreuses adhésions, imprimera à la solennité qui se prépare un caractère que nous appellerons exceptionnel. »
Mais aussi têtus que soient les faits, la « légende » est là qui s’autorise bien de ce qui peut légitimement la nourrir : l’indocilité d’une partie des fidèles lyonnais aux consignes de la hiérarchie laïque et cléricale qui avait élaboré le programme cérémoniel et cru bon d’en différer, le 8 décembre, la partie festive.
Au titre des conditions de l’entrée en légende de l’Illumination du 8 décembre 1852, il faut bien inscrire cette aptitude à « maintenir » : maintenir un ordonnancement, et spécialement son moment de publicisation festive, malgré les aléas climatiques, malgré les consignes officiellement transmises. Soigneusement préparée, comme en tant d’autres occasions de l’ancien ou du nouveau régime où l’illumination est un moment quasi obligé du cérémonial urbain, civil, religieux ou militaire, l’illumination du 8 décembre 1852 ne pouvait prétendre ni à l’originalité, ni à la spontanéité, ni à l’unanimité.
Mais il est bien vrai que son déclenchement fut, en quelque sorte, « anonyme » et « populaire », que ses acteurs surent jouer de circonstances climatiques a priori éminemment défavorables, comme ils surent se montrer indociles aux consignes reçues. À un double titre, le déclenchement de l’illumination opère « à contretemps ». En d’autres termes encore, il a lieu « envers et contre tout ». Et plus précisément, il relève d’une inversion du protocole cérémoniel : au lieu que les illuminations particulières répondent au signal de l’autorité ecclésiale, c’est l’autorité ecclésiale qui aura répondu au signal des simples fidèles.
La condition de l’entrée en légende tient donc à la mise en oubli ou, du moins, en omission, du temps de la préparation, de la mobilisation, qui avait été nécessaire et pour le 8 septembre et pour le 8 décembre 1852. Elle tient, par ailleurs, à la confusion, volontairement entretenue, de deux ordres de réalité : le principe de l’illumination, le déclenchement de l’illumination. Le paradoxe que condense si bien la formule de Joannès Blanchon « Tous complices, mais tous surpris », se dénoue si l’on consent à rétablir une chronologie de la mobilisation et à distinguer la cause (l’ordre cérémoniel) et l’occasion (le jeu avec les éléments climatiques et les consignes officielles).
L’entrée en légende tient, encore, à une réalité plus difficilement préhensible et énonçable : celle d’un quasi-escamotage. N’y a-t-il pas, en effet, escamotage du moment cérémonie liturgique au profit d’un moment que Blanchon lui-même pourra qualifier de « quelque peu profane » ? En d’autres termes, n’y a-t-il pas escamotage de la fin, celle de l’honneur que l’on rend à la Vierge, au profit du moyen, celui de l’illumination, escamotage de la visée sous le procédé ?
De cette entrée en tradition, c’est-à-dire en transmission et réitération, on peut soutenir le paradoxe qu’elle fut quasi immédiate. Le caractère imprévisible, inopiné, du retentissement de la soirée du 8 décembre, a pour effet de constituer les cérémonies officielles du 12 décembre en « premier renouvellement de la brillante fête du 8 ». Le 12 vient attester « qu’en un seul coup, la manifestation a conquis les privilèges et les honneurs d’une fête officielle. » L’événement légendaire serait donc contemporain de son « entrée en tradition » !
Quoi que l’on pense de ce paradoxe, les sources — manuscrits et textes édités de Joannès Blanchon déposés aux archives de Fourvière — font apparaître qu’il aura suffi de trois éditions pour que la certitude soit ancrée de la pérennisation de l’Illumination du 8 décembre. Les doutes initiaux ont été nourris de trois types d’interrogation. L’enchantement est-il renouvelable ? Pourquoi s’exposer à une déchéance du processus et aux sarcasmes éventuels qu’elle entraînerait ? À quoi bon la profusion et le dispendieux d’une telle opération ? Les éditions de 1853, 1854 (année mémorable de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception) et 1855 auront suffi à convaincre les promoteurs du rituel que la fête serait, en fait, à jamais « éclatante et vouée à la perpétuité ».
Mais il nous faut à présent nous dégager du témoignage de Blanchon et de ses contemporains, aussi précieux et impliqué soit-il, pour rendre pensables la réitération plus que séculaire du dispositif cérémoniel mis en place entre le 8 et le 12 décembre 1852. Penser les conditions de la pérennisation d’un objet a priori voué à un sort éphémère — celui d’une célébration liturgique et d’un cérémonial d’inauguration somme toute assez banals — ne peut s’effectuer, telle est la gageure, que sous des ordres de réalité multiples et hétérogènes.
La première condition de cette pérennisation est tout simplement anthropologique, pour autant que l’on désigne par là ces traits invariants ou quasi invariants de l’espèce humaine, traits qui échappent aux spatialisations et périodisations que se doit de mettre en exergue la démarche historienne. On peut, plus simplement, désigner cet ordre de réalité comme esthésique : soit celui qui a trait au rapport sensible que les humains entretiennent au monde. Ce rapport esthésique, construit dans la nuit du 8 décembre 1852, est rendu possible par ce qui aurait dû desservir et l’opération de l’inauguration et sa reconduction festive.
Ce rapport sensible tient à un effet de retournement, retournement d’un inconvénient patent en un avantage insigne. L’inconvénient de la date est manifeste : comment organiser une festivité publique lors d’une soirée hivernale, quand ses acteurs peuvent être exposés à la pluie, à la neige, au vent, au brouillard, aux inondations, voire à la combinaison de quelques-unes de ces conditions météorologiques, comme la presse l’atteste tout au long de cette histoire ?
L’avantage tient au fait que la date du 8 décembre permet de jouer d’une symbolique élémentaire et par là même très puissante : celle du rapport de l’obscurité hivernale à la lumière. Ce n’est donc pas sous l’effet du hasard ni du génie des agences de communication que l’on a vu apparaître depuis peu, dans les instruments de publicité de l’événement, une référence explicite à une symbolique dite du solstice d’hiver et de la pleine lune, comme en atteste une pleine page de l’hebdomadaire Télérama en décembre 2001.
La deuxième condition tient à l’attractivité du site. Il y a une attractivité symbolique du site, constituée de temps immémorial, attractivité religieuse, mais aussi attractivité profane. Le site est là, d’abord, comme lieu haut, éminence morphologique. Or, c’est bien ce lieu haut qui a été l’un des points majeurs de la présence romaine et de ses reliefs. Il est, également, à la charnière des XVIIIe-XIXe siècles, constitué en haut lieu profane, point de passage obligé de visiteurs aussi prestigieux que Stendhal ou Michelet. Il faut avoir considéré, de cette éminence naturelle que constitue le plateau de Fourvière, la ville et l’immense panorama de la plaine du Dauphiné, mais aussi le panorama des Alpes qui s’y dévoile par temps favorable. La symbolique du lieu haut/haut lieu est telle que clercs et laïcs ne cesseront de se disputer le privilège du « point de vue » remarqué et remarquable au cours XIXe siècle.
Dans la première moitié du XIXe siècle, la conception d’un clocher constituant le gigantesque piédestal d’une statue de cinq mètres de haut a, parmi tant d’autres buts, celui d’une revanche sur le « malheureux observatoire » édifié par un particulier, en 1831, à quelques dizaines de mètres du sanctuaire. Dans la seconde moitié du siècle, c’est une tour métallique à vocation de restaurant panoramique qui vient se porter à la hauteur des tours qui flanquent la toute nouvelle basilique de Fourvière. Dans le dernier quart du XXe siècle, la hauteur du premier gratte-ciel lyonnais, soit la tour du Crédit Lyonnais, sise dans le nouveau quartier décisionnel de la Part-Dieu, est étalonnée sur celle du plateau de Fourvière et de ses édifices religieux, de telle manière qu’il n’y ait pas de suréminence de l’une par rapport aux autres.
L’attractivité religieuse tient à un passé légendaire. Le site d’édification de la double chapelle est, supposément, celui d’un oratoire érigé au Ve siècle, sur le lieu même où aurait coulé le sang des martyrs lyonnais. Ces assertions sont invérifiables, ou controuvées par l’Histoire, mais la légende est là, qui amalgame la mémoire d’une ville capitale de trois provinces de l’Empire romain et celle du baptême de l’église chrétienne d’Occident dans le sang des martyrs lyonnais. Par contre, on sait, de source historiquement sûre, que le site est cultuellement investi depuis le XIIe siècle : six siècles d’histoire religieuse y sont donc sédimentés. Le site est notamment investi sous l’espèce des pèlerinages mariaux : on va y implorer la protection de la Vierge ou lui rendre hommage pour ses bienfaits.
Le « Vœu des Échevins », prononcé en 1643, dans le fil du vœu de Louis XIII confiant la France à la garde de la Vierge-Marie, s’inscrit dans cette tradition. Appelant la protection de la Vierge contre les méfaits de la peste, les échevins lyonnais s’engagèrent à monter à Fourvière chaque 8 septembre, afin d’offrir à la Vierge un cierge de sept livres et un écu d’or. Mise à mal par la Révolution, la pratique a été restaurée à l’occasion du bicentenaire du vœu, en 1843. La « tradition » est suffisamment assurée pour qu’elle se soit imposée aussi bien à un Raymond Barre, initialement réticent, qu’à l’actuel maire de Lyon, qui a pourtant inauguré son mandat, en 2001, en faisant publiquement état de son appartenance à une obédience maçonnique.
Le troisième type de conditions a trait à la nature des groupes d’acteurs impliqués et à la qualité de leur mobilisation. Les acteurs qu’il convient de considérer, ici, ne sont pas tant des clercs que des laïcs. Ceux-ci sont membres d’une confrérie, la confrérie de « Notre Dame de Fourvière », dont le cardinal de Bonald a autorisé la reconstitution. Ils sont, aussi, membres de la très influente « Congrégation des Messieurs », qu’inspire et dirige, depuis 1802, la Compagnie de Jésus. Ces confrères sont ceux-là qui ont présidé aux travaux de restauration de ladite chapelle de Fourvière et donc à l’érection de la monumentale statue de la Vierge.
Ce sont les mêmes qui, regroupés dès 1853 au sein de ladite Commission de Fourvière, n’auront de cesse, par rachat des terrains, par destruction de certains édifices, de s’assurer de la propriété du « domaine de Fourvière » — du site et de son bâti — et d’y garantir un usage cultuel exclusif. Les laïcs qui siègent dans cette Commission jouissent donc d’un statut proprement hors du commun : ils sont propriétaires du site, mais aussi de la basilique même qu’ils feront édifier aux côtés de la chapelle, en application d’un vœu formulé durant la guerre franco-prussienne de 1870.
Ce sont ces mêmes confrères, tous membres du patriciat lyonnais, qui n’auront de cesse de contrer l’influence des réseaux républicains et socialistes en créant le quotidien Le Nouvelliste en 1869 — réplique à celle du Progrès dix ans plus tôt — et en fondant les Facultés catholiques de Lyon en 1870. Leurs héritiers ont récemment converti le statut de leur vénérable Commission en celui d’une Fondation, la Fondation de Fourvière, dont le maire de Lyon est membre de droit.
Un quatrième type de conditions de la pérennisation tient, paradoxalement, à la politisation dont le rituel a très rapidement pâti et profité. Il est licite de traiter d’un surinvestissement idéologique et politique de ce rituel dans la période qui court de 1852 à 1905. Les enjeux, il est vrai, sont considérables. Ils portent sur la nature des régimes, impériale puis républicaine, combattue plus ou moins ouvertement, selon la conjoncture, par des monarchistes qui, formant l’entourage du Comte de Chambord, opposent encore très franchement une souveraineté et un droit d’origine divine à toute idée de souveraineté nationale et à toute référence à de prétendus de droits de l’homme. Lucien Brun, président de la Commission de Fourvière, conseiller politique du Comte de Chambord, professeur de droit aux Facultés catholiques, fait ainsi inscrire en exergue à La Revue catholique des institutions et du droit « Le droit c’est la conformité à l’ordre divin ».
Les enjeux portent sur la politique de ces régimes, selon qu’elle est favorable ou non au principe de l’existence des États pontificaux, favorable ou non à la liberté de l’enseignement congrégationnel. Au plus fort de la crise qui affecte le pouvoir temporel de la papauté, alors que les fils du patriciat lyonnais s’enrôlent dans le corps des zouaves pontificaux, la relation du 8 décembre 1867 peut être exposée comme celle de la résistance à « la vague de l’impiété » et la possible inauguration « d’un nouveau temps des martyrs ».
C’est aussi toute une conception organique et hiérarchique de la société qui trouve dans le protocole des cortèges, des processions, des pèlerinages qui se rendent à Fourvière son actualisation et son moyen d’ostension. À dater de 1880, à mesure que les autorités municipales exigent le retrait des insignes religieux, interdisent les processions, prohibent les rassemblements, le dispositif cérémoniel du 8 décembre fournit aux catholiques ultramontains le moyen d’actionner le principe de visibilité que leur contestent les autorités. La « manifestation » du 8 décembre fournit l’occasion de dénoncer l’emprise de l’hydre maçonnique, de la Ligue de l’enseignement ou les méfaits de la libre-pensée. Elle se pose comme un contre 14 juillet, cette fête étatique « octroyée », « licencieuse », « faisant mémoire du sang et du crime ». À la fête étatique, les catholiques opposent les propriétés d’un rituel autochtone et authentique, décent, spontané.
Cet investissement politique aura atteint son paroxysme en 1903. La confrontation, devenue coutumière, des manifestants et des contre-manifestants, tourne à l’affrontement mortel : un manifestant catholique, Étienne Boisson, chevalier de Saint Grégoire le Grand, succombe des suites d’une agression subie lors de la défense du palais archiépiscopal. L’agression est imputée aux « Apaches », c’est-à-dire « aux militants des sociétés de libres-penseurs et aux émeutiers internationalistes ».
La loi de séparation des Églises et de l’État adoptée, le désinvestissement de l’événement peut s’amorcer. Ce désinvestissement est, à l’échelle locale, l’effet de la politique de pacification des relations entre cléricaux et anticléricaux que tend à mettre en œuvre Édouard Herriot dès son accession à la magistrature municipale. Il est, dans l’après-Première Guerre mondiale, induit par la multiplication et la fragmentation des espaces symboliques de référence. À gauche, les commémorations de la révolution d’Octobre ou de la mort de Jaurès s’ajoutent à celles de la Commune de Paris ou du 14 juillet, tandis qu’à droite, les commémorations des anciens combattants ou la célébration de Jeanne d’Arc fournissent les motifs de la mobilisation patriotique/nationaliste.
C’est dès le départ de la Troisième République qu’apparaît un autre facteur de pérennisation du rituel, celui de sa marchandisation. De cette instrumentalisation commerciale des Illuminations, la presse fournit une attestation dès 1875. La formule mise au point consiste à faire jouer aux Illuminations la fonction de prologue d’une « quinzaine commerciale » conduisant jusqu’aux fêtes de fin d’année. Il s’agit littéralement de « faire étalage », le grand étalage précédant les étrennes du Nouvel An. Les modalités de la mobilisation commerciale sont simples : jouer de l’éclairage urbain et tout autant des vitrines décorées mises au concours, le décor des métiers de bouche étant particulièrement prisé.
Les effets de cette emprise commerciale sont considérables : la géographie de la fête change, passant de la « Sainte colline » et des bords de Saône à l’intégralité de ce territoire que l’on nomme à Lyon, la presqu’île, soit l’espace compris entre la rivière, à l’Ouest, le fleuve, à l’Est. Le sens de la fête change. Le principe est celui de l’abondance que signalent « les amoncellements de victuailles chez les bouchers, les charcutiers » ; celui de « l’exposition générale de jouets et d’articles pour les étrennes » ; et dans les temps nouveaux que décrira Zola dans Au Bonheur des dames la profusion des « grands magasins luttant de luxe et d’élégance ».
Du même coup, l’appropriation de l’espace festif ne dépend plus des dévots de Marie. Il ne dépend plus, non plus, de ceux qui reconnaissent là, sous enrôlement marial, l’espace de la « patrie » lyonnaise. La ville devient à elle-même son propre spectacle ; la foule devient à elle-même son propre spectacle. Se trouve ainsi paradoxalement actualisé le programme festif « républicain » que Jean-Jacques Rousseau exposait ainsi dans sa Lettre à D’Alembert sur les spectacles :
« Quoi ne faut-il aucun spectacle dans une République ? Au contraire il en faut beaucoup. C’est dans les Républiques qu’ils sont nés, c’est dans leur sein que l’on les voit briller avec un véritable air de fête. À quels peuples convient-il mieux de s’assembler souvent et de former entre eux les doux liens du plaisir et de la joie, qu’à ceux qui ont tant de raisons de s’aimer et de rester à jamais unis ? […] Plantez au milieu d’une place un piquet couronné de fleurs, rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête. Faites mieux encore : donnez les spectateurs en spectacle, rendez-les eux-mêmes acteurs ; faites ainsi que chacun se voie et s’aime dans les autres, afin que tous soient mieux unis. »
Cette situation, à tant d’égards étonnante, va induire l’idée, bonhomme, d’une polarité originale, entre un « 14 juillet d’été » et un « 14 juillet d’hiver ». Mais elle va, aussi, entraîner des jugements précocement désapprobateurs, comme en témoigne cette formule empruntée à l’édition du Courrier de Lyon du 10 décembre 1880 : « L’usage dégénère, on danse, on rit, comme aux vogues ! ». La presse n’a cessé de porter trace de ces jugements qui vont de la restriction ou de la réserve à la condamnation de ce qui est pensé ou vécu comme une profanation du sens du rituel originel. À ce point se dévoile un paradoxe des plus stimulants et de grande portée. Le paradoxe est celui de l’altération du sens du rituel comme condition de la pérennisation du rituel : il ne fait guère de doute, en effet, que le rituel a trouvé, dans son expression marchande, l’un de ses plus sûrs volants d’inertie.
Or, quel autre rapport construire que de radicale incongruité entre la célébration de la conception immaculée de la Vierge et l’exhibition d’articles de bouche, de lingerie ou d’ameublement ? Sous quelles autres catégories que celle du mélange, voire de la confusion des genres, penser cette relation journalistique d’une séquence de la soirée du 8 décembre :
« Nos compliments aux charcutiers qui ont su intelligemment profiter de la dévotion à la Vierge pour faire de splendides étals. Saint Antoine, le patron de la corporation, est représenté sous toutes les formes. Il est enchâssé dans les hures, les jambonneaux et les pieds de cochon ».
Le dernier des types de conditions qui mérite d’être évoqué ne relève pas de la politisation, de l’idéologisation, ou de la marchandisation. Il faut traiter de la « communalisation » de la fête. Dire « communalisation » n’est pas user d’un néologisme : ce terme a été employé dès 1842, communaliser signifiant « mettre sous la dépendance d’une commune, un terrain, une opération ».
La communalisation du rituel ressortit à une instrumentalisation de la fête par la collectivité publique territoriale, en l’espèce la Ville de Lyon. On entrevoit les prémisses de cette instrumentalisation sous la Troisième République et dans l’entre-deux-guerres. Mais, pour autant que nos sources permettent de l’établir, c’est dans les années 70 du XXe siècle que cette communalisation s’institue : communalisation « faible », jusqu’au départ du mandat municipal de Michel Noir en 1989, puis communalisation « forte », de 1989 à nos jours.
La communalisation faible est celle qui, de 1970 jusqu’à nos jours, permet de penser le 8 décembre comme un attracteur symbolique. Cet attracteur appelle à lui toutes sortes de manifestations, notamment celles qui ont rapport à l’inauguration des équipements urbains, justifiant ainsi la désignation journalistique du 8 décembre comme la « Saint Équipement ».
Ce sont ainsi succédées les inaugurations du tunnel de Fourvière (1971), de l’éclairage du dôme de l’Hôtel de Ville (1972), de la rue Saint-Jean piétonnisée (1978), de la place Louis Pradel (1982), du plan Lumière (1989), de la place des Terreaux rénovée (1994). Mais cette journée peut être, aussi, l’occasion de la tenue de manifestations scientifiques : les Entretiens du Centre Jacques Cartier ; de manifestations sportives : la SaintéLyon, course pédestre nocturne reliant Saint-Étienne à Lyon ; de manifestations culturelles : le Festival musical du Vieux Lyon ; d’opérations politiques fortes : déclaration publique de Michel Noir rompant avec le RPR, en 1990 ; voire, d’opérations symboliques majeures : la commémoration du Bicentenaire de la Révolution se jouant étrangement, dans sa dimension symbolique la plus forte, non pas le 14 juillet, mais bien entre le 8 et le 10 décembre 1989.
C’est avec Michel Noir, dont le mandat de maire est inauguré au printemps 1989, que l’on accède au temps d’une communalisation forte qui mérite, à son tour, d’être scandée. Le laps de temps à prendre en compte est relativement court, mais déjà les temps considérés ne sont plus les mêmes.
La politique désormais conduite ressortit à une visée, celle du rayonnement national et international d’une ville prétendant au statut d’eurocité et dont l’attractivité touristique est supposée être effet et condition de ce statut d’eurocité. Les moyens politiques mis en œuvre sont humains, par implication directe d’un adjoint de la mairie centrale, et financiers, le budget de la manifestation (hors contribution directe des services techniques de la mairie) s’élevant progressivement à plus d’un million d’euros.
Les moyens techniques relèvent d’une politique volontariste de communication, induisant la création d’une désignation « fête des Lumières » (« Lumières » se substituant à « Illuminations »), d’un logo, d’une procédure de labellisation. Mais il en va aussi, désormais, du déploiement d’une ingénierie, de la manifestation des savoir-faire constitués des éclairagistes publics, des savoir-faire, en cours d’invention, des métiers neufs de la lumière (architecte-lumière, concepteur-lumière, designer-lumière…), savoir-faire et compétences mis au service de l’esthétisation pérenne ou éphémère de la ville.
Au regard de ce contexte, la périodisation peut ainsi se concevoir. Une première période « d’événementialisation » de la fête court de 1989 à 1991, un scénographe étant censé fournir le motif et les moyens d’un « événement » mémorable en centre-ville. À la fin du mandat municipal écourté de Michel Noir, on entre dans une deuxième période, qui court de 1992 à 1998, que l’on peut désigner comme la politique des « temps forts ».
La visée des « temps forts » est de permettre l’inscription des neuf arrondissements lyonnais dans le processus festif. On fera donc « tourner » la fête dans les arrondissements, un arrondissement se voyant proposer chaque année d’être le site électif d’une opération majeure, les neuf arrondissements de Lyon étant censés trouver successivement leur compte dans cette politique de valorisation territoriale. Mais, finalement, ils n’y trouveront pas tous leur compte, puisque la stratégie est infléchie à nouveau en 1999 : la formule adoptée est, cette fois, celle d’un « Festival Lyon Lumières ».
Formule festivalière qui a notamment pour effet que, désormais, le « 8 » se décline sur quatre jours, de telle manière que la fête mobile soit nécessairement précédée ou suivie d’un week-end ! Même si l’appellation « festival » n’apparaît plus dans la communication officielle des éditions 2002 et suivantes, l’idée festivalière est bien là. À preuve, la brochure de l’édition 2003 « Lyon l’allumée » : dès le premier paragraphe du texte réservé au « Mot du maire », le terme « festival » est employé, la manifestation étant dépeinte comme un « festival d’émotion et de plaisir partagé ».
Nous sommes bien dans un temps nouveau de la manifestation, le temps festivalier. Sur l’aire, hautement concurrentielle, de la mise en renommée des villes, Lyon peut désormais prétendre au statut de site d’un festival de la lumière. Et qui plus est, Lyon peut prétendre échapper à l’imitation et/ou à la concurrence, au motif que l’originalité du festival se trouve garantie par l’absolue singularité d’une fête « unique au monde », la fête populaire du 8 décembre.
Nous sommes dans l’en-cours d’un processus de transformation de la formule d’un rituel dont nous ne pouvons soupçonner ni les modalités ni le terme. Mais la vue cavalière proposée sur 150 ans d’évolution de cette formule permet d’interroger un tel processus sous l’angle de ses avatars. Elle invite, également, à interroger la notion même de profanation.
C’est du sens religieux hindouiste de l’avatar désignant l’incarnation, ou la réincarnation d’une entité divine qu’est advenu, par importation et extension, le sens aujourd’hui usuel de « métamorphose, transformation », mais qu’est advenu, aussi, le sens familier de « mésaventure, malheur ». C’est à la deuxième acception que l’on fera immédiatement appel pour tenter d’interpréter l’évolution plus que séculaire des Illuminations du 8 décembre.
Penser une évolution comme avatar invite à produire une pensée du même et du distinct, du continu et du discontinu. C’est à cet exercice que l’on peut et doit s’exposer si l’on veut échapper aux a priori ou aux commodités des jugements de l’altération ou même de la trahison ; jugements supportés par le schème, très partagé, de l’extinction inévitable d’une énergie initiale ou encore de la perte irréversible d’une qualité originelle. Or, penser la transformation-conversion de la Fête de L’Illumination (ou des Illuminations) en fête des Lumières sous l’angle du « même » ne relève pas du paradoxe ou du forçage de la réalité.
Le même — ce point est décisif — est tout d’abord celui du maintien d’un geste. Geste étonnamment simple, modeste, domestique, de la pose de lumignons sur un rebord de fenêtre, plus rarement sur un possible balcon, à l’orée d’une nuit hivernale. Le même est celui de la composition, aléatoire dans sa densité spatiale, dans sa durée, puisque dépendante des intempéries, d’une « scénographie » urbaine.
Une ville se donne à voir « comme jamais », chaque fenêtrage, chaque immeuble, chaque rue, composant l’élément d’un décor sans maître d’œuvre. Le même n’est plus seulement celui d’un rapport « esthésique » que tout un chacun a loisir de susciter, dont tout un chacun a loisir de bénéficier. Le même est celui de l’« esthétisation » d’une cité, d’une cité d’échelle métropolitaine, à l’initiative de ses habitants. Esthétisation d’un effet patent et reconnu et cependant d’un coût nul pour la collectivité, d’un coût insignifiant pour le particulier.
Le même est celui de l’enchantement, de la « féerie », que procure « l’invu », soit le jamais vu ou le peu vu, de la relation entre la faiblesse vacillante de la source lumineuse et le cadre urbain révélé et magnifié par la généralité des points de luminescence. Le même est celui de la singularité d’une « faveur », celle qui a valu à Lyon d’entretenir de 1852 à nos jours la « petite flamme » du rituel. Le même est celui de la capacité de rayonnement de « la ville à grand rayon d’action » du XIXe siècle, de la ville tête de réseau européen ou international du XXIe siècle.
C’est sur ce fond que peut se poser et se penser le distinct. Le distinct des moyens déployés, de la modestie sans pareille du lumignon à la « débauche contrôlée de lumière » que prétend organiser et maîtriser EDF, société nationale partenaire de la manifestation. Le distinct des statuts et positions des personnes, du maître de cérémonie, consentant à compléter la liturgie dévotionnelle par une célébration festive au commissaire artistique contemporain, mettant à concours les espaces publics à valoriser et organisant des résidences d’artistes. Le distinct des positions et prétentions d’une cité, de la cité se définissant « capitale de la dévotion mariale », se réclamant du titre de « seconde Rome », mettant en exergue sa « Montagne sainte », à l’eurocité, laïque et humaniste, s’affichant chef-lieu d’une métropole aux contours sans cesse élargis.
Le distinct des opérateurs, du faisceau convenu des associations, comités de quartiers et commerçants à celui des artistes et des métiers reconnus ou en cours d’invention de l’ingénierie de la lumière. Le distinct des ressorts de l’appartenance, de la foi vouée à la personne de la Mère du Sauveur et aux énoncés dogmatiques d’un corps ecclésial, à la fierté citadine des membres d’une agglomération cosmopolite. Le distinct des investissements consentis, des souscriptions populaires et de la prodigalité redoutée des origines à la munificence des budgets d’échelle festivalière. Le distinct des concernés, des Lyonnais et de leurs voisins géographiques immédiats aux cohortes de touristes français et étrangers mobilisées par les tour-operators. Le distinct de la durée, de la séquence d’une unique soirée aux quatre soirées susceptibles désormais d’attirer de trois à quatre millions de visiteurs.
De cette relation du continu au discontinu, du même au distinct, il est permis de faire apparaître deux conditions paradoxales. La première des conditions paradoxales est celle de la mise en oubli, ou à tout le moins de la mise en effacement, d’une part, des origines strictement religieuses du rituel, d’autre part, de la conflictualité qu’il a générée. Le désinvestissement religieux et politique du rituel, ou encore la neutralisation de sa charge idéologique, ont, sans doute aucun, permis l’élargissement de son appropriation populaire et autorisé une interprétation contemporaine d’un étonnant syncrétisme : la célébration permet désormais d’évoquer aussi bien la fête chrétienne de la Sainte Lucie, la fête juive de Hanouka, la symbolique maçonnique de la lumière, voire de faire référence à l’Âge des Lumières.
La seconde de ces conditions a déjà été désignée. Elle est celle de l’altération, puisque l’ouverture d’un espace marchand au sein de la configuration initiale n’a pas pu ne pas provoquer la dénonciation d’une confusion ou d’un mélange des genres, confusion et mélange funestes à bien des égards, mais heureux à d’autres, puisqu’ils assurent au rituel ce que nous avons pu désigner comme un remarquable volant d’inertie.
Il est permis, à présent, d’enrichir cette réflexion sur les aspects paradoxaux du processus du maintien par la métamorphose en recourant à deux notions venues d’horizons interprétatifs distincts : celui de la translation et celui de la profanation.
La conversion d’un événement éphémère en rituel de très longue durée relève d’un pouvoir de translation. La translation, dans le cas du 8 décembre lyonnais, est quasiment matricielle.
Le terme « translation » désigne, en effet, dans la langue liturgique, le report d’une cérémonie religieuse d’une date à une autre du calendrier. Il en va bien, à Lyon, d’une translation initiale, puisque cette inauguration de la Vierge dorée, ainsi qu’on nomme familièrement cette statue à Lyon, n’aurait sans doute jamais fait mémoire si, en 1852, une cérémonie prévue le 8 septembre — fête de la Nativité — n’avait été reportée au 8 décembre — fête de l’Immaculée Conception.
Mais la translation a pu aussi désigner le transfert d’un objet d’un corps de langue dans un autre corps de langue. En d’autres termes, le sens de « traduction » qui s’est conservé dans la langue anglaise, a existé puis s’est perdu dans la langue française. Toutefois, on ne prêtera pas au terme translation le sens convenu de « traduction ». On lui prêtera la double acception suivante : déplacement dans le temps et actualisation d’une langue au fil du temps. Ce qu’il convient de penser est la relation du même d’une langue au distinct des langages que particularisent et actualisent en permanence les groupes et les individus qui en usent.
De même doit-on s’efforcer de penser la particularisation et l’actualisation permanentes à laquelle est soumise toute opération rituelle. Le rituel ne se perpétue que de supporter une double contrainte. Il ne peut pas ne pas parler le langage de son temps ; il doit tout autant garantir l’effet de permanence attendu de ses adeptes. La translation est bien, à ce titre, un opérateur de tradition, puisqu’elle permet de répondre à la double contrainte de l’immutabilité et de la mutabilité. Le paradoxe s’éclaire, voire s’estompe : le distinct devient condition du même, le discontinu condition du continu. D’un tel paradoxe la formule, à la fois littéraire et politique, a pu être exposée par le prince Lampedusa dans l’épilogue du roman Le Guépard, que Luchino Visconti porta à l’écran avec le talent que l’on sait : « Si nous voulons que tout demeure inchangé, il faut que tout change ».
La seconde interprétation dérive logiquement de la première et se trouve appelée, en tout état de cause, par les énoncés que l’historien ne peut pas ne pas relever au fil de son enquête, énoncés afférents au registre de la « profanation ». Trois des sens de ce terme seront mobilisés de sorte que soit problématisée une relation à l’événement initial et aux avatars qui ont été et sont les siens.
La première des acceptions du terme profanation est celle, familière, que l’on peut emprunter au Dictionnaire de l’Académie française, dans son édition de 1835 : « Irrévérence grave contre les choses de la religion ou contre les choses qui sont d’un respect général ».
Il ne fait pas de doute, qu’à la charnière des XIXe-XXe siècles notamment, un certain nombre d’actions — destructions d’insignes et emblèmes des dévots de Marie, bris de vitrines décorées, tenue de tel congrès de la libre-pensée le soir du 8 décembre, organisation de contre-cortèges — ont relevé du registre du défi et de la provocation à l’égard des « Illuminés du 8 décembre ». Il en va bien « d’une irrévérence grave à l’égard des choses de la religion ». Il n’est pas jusqu’à l’initiative récente, en 2002, d’une association du 7e arrondissement de Lyon qui ne puisse être inscrite dans le fil de cette histoire. La conversion de la fête des Lumières en Fête de la Fraternité et de la Laïcité et l’exhibition escomptée de bustes de Marianne colorés le long du parcours proposé, ont réactivé, ou prétendu réactiver, la polarité Marianne/Marie qui a ordonné l’espace public lyonnais dans les premières décennies de la
IIIe République.
Le cardinal Albert Decourtray, en 1991, aura eu d’autant moins de mal à déplorer « le caractère païen de la fête » que la dénonciation de son dévoiement s’est trouvée appuyée par les nombreux partisans, croyants ou agnostiques, d’une expression du rituel, sinon recueillie, du moins paisible, familiale et, en tout état de cause, non carnavalesque. La dénonciation du cardinal apparaît même prémonitoire : la possible référence aux saturnales romaines ou aux cultes celtes du solstice d’hiver, qui se trouve appelée par certains instruments de communication publique en 2001 relève bien, rhétoriquement au moins, du registre de la « paganisation ».
Une seconde acception du terme « profanation » mérite d’être rapportée à l’étymologie de l’adjectif latin profanus. Le préfixe pro- permet de désigner ce qui se tient devant ou à l’extérieur du fanum, fanum qui ne désigne pas nécessairement un édifice, mais tout emplacement dédié aux dieux. La relation que rend pensable cette source latine n’est pas une relation d’offense, mais, plus simplement, une relation d’extériorité, opposable à la relation d’inclusion du fanaticus, celui-là même qui est au service du temple. Est profane, donc, cela qui ne peut franchir certaines limites ou seuils à raison d’un statut personnel, d’un genre (féminin ou masculin), de l’appartenance à une « nation » ou religion étrangères.
Par extension, sont profanes telle activité, telle fonction, pensées incompatibles avec le service de tel culte. C’est précisément à cette relation d’extériorité ou d’étrangeté que nous ramène, non pas la liturgie inaugurale qui s’achève avec les vêpres de l’après-midi du 8 décembre 1852, mais la partie festive de ce cérémonial. L’auteur de la mise en exergue de cette possible « extériorité » ou « étrangeté » n’est autre que Joannès Blanchon dont il faut, à nouveau, citer les mémoires :
« L’addition de cette fête nocturne au programme de la grave bénédiction du matin, vivement patronnée par l’abbé Jutet, avait, au premier abord, paru à l’autorité ecclésiastique un peu profane et ce n’est pas sans peine qu’on avait obtenu la mention sur l’affiche de la solennité. »
Il est du plus grand intérêt, à ce point, de relever que l’Illumination du 8 décembre ne relève pas seulement d’un processus initial de translation ; mais qu’elle relève, originellement, d’un ordre de pratique jugé « quelque peu profane » et obtenu « non sans peine ». Ce que Joannès Blanchon a pu désigner dans un de ses manuscrits comme « l’addition d’une fête insolite de nuit… à la grave bénédiction du matin » relève de la « profanité », si l’on veut bien user de ce terme du moyen français, encore employé par Voltaire et remis au jour par Paul Claudel, pour désigner « le caractère de ce qui est profane ».
Or, si le 8 décembre 1852, rien n’est mentionné qui soit profanatoire ou profanateur, quelque chose est là cependant, à quoi nous devons l’entière histoire du 8 décembre, qui ressortit non à la gravité, non à la dignité requise par une solennité religieuse, mais qui se tient sur ses bords ; qui ressortit à la « profanité » des procédés communs, ordinaires, de la réjouissance publique. En résumé, il n’est pas de 8 décembre praticable et pensable, au sens où cette tradition s’est constituée, sans que soit extraite de la sacralité liturgique la « profanité » de l’illumination. Le 8 décembre, en d’autres termes, aura été initialement empreint du sceau de la profanité.
De la relation de la « profanité » à la sacralité, il est possible, à présent, de demander une intelligence paradoxale aux travaux du linguiste Émile Benveniste et aux réflexions récemment produites, dans son sillage, par le philosophe contemporain Giorgio Agamben.
Là où l’histoire des institutions, des mœurs, de la langue, ont construit une relation d’opposition, ou encore d’antinomie, entre l’ordre du sacré et l’ordre du profane, ces deux auteurs rétablissent un sens latin perdu, qui autorise une pensée de la relation du profane au sacré, ou de la profanité à la sacralité, qui est de l’ordre de la transitivité. Telle est la troisième acception que l’on peut donner du terme « profanation », celle du retour d’un objet qui a été consacré à son « extérieur », à son dehors spatial, ou encore à ses destinataires, à son « public ».
Le sens latin perdu est le premier des sens que délivre la forme verbale profanare : « rendre à l’usage profane une chose ou une personne qui n’est plus sacrée ». Benveniste assure : « Le problème en latin n’est pas de qualifier ce qui n’est pas sacré, mais ce qui n’est plus sacré ».
Et Agamben, quant à lui, propose ce commentaire : « Alors que consacrer (sacrare) désignait la sortie des choses de la sphère du droit humain, profaner signifiait au contraire leur retour au libre usage des hommes ». En d’autres termes, le rétablissement du sens premier de la forme verbale permet de construire une relation de transitivité spatiale et temporelle : un objet a été extrait de la sphère de la profanité, séparé/consacré, avant de faire retour à la profanité.
Mais Émile Benveniste ne rend pas seulement compte d’un sens perdu. Il rend compte d’une « étrangeté » : étrangeté d’une amphibologie, c’est-à-dire d’un double sens, le verbe profanare ayant pu signifier souiller, mais aussi consacrer. L’étude de la langue du rituel, celle du culte d’Hercule spécialement, lui permet d’éclairer ce qui se présente comme une apparente contradiction : profaner est « rendre une offrande apte à la consommation ». C’était satisfaire aux conditions de certains rituels sacrificiels que de « consacrer » une offrande puis de la « profaner » en la consommant. La profanité ne se pense plus seulement dans une relation d’écart, spatial ou temporel, à la sacralité, l’adjectif profanus désignant ce qui a été mis hors de l’enceinte sacrée et rendu à l’usage commun. La profanation peut être pensée comme ce moment de l’opération rituelle où une oblation est consacrée puis rendue apte à la consommation des fidèles.
Et telle est bien la moralité que l’on peut tirer de la série des avatars du 8 décembre lyonnais.
Le 8 décembre n’a pas été dévoyé ou profané sous l’effet de ce que l’on désigne aujourd’hui comme son instrumentalisation commerciale, partisane, communale. Il est originellement profane et il l’est à un double titre. Il l’est au titre du moyen qu’il se donne pour magnifier la Vierge immaculée : l’illumination publique relève d’un ordre de pratiques qui n’est pas religieux, mais commun à toutes sortes de manifestations. : c’est ainsi, notamment, que la République avait été honorée en 1848 et le nouvel empire le 2 décembre 1852… Il l’est, au titre de ce que l’on a pu désigner comme l’escamotage de la fin par le moyen, le moyen de l’illumination prévalant sur l’objet du culte.
En affichant sa profanité, le rituel du 8 décembre délivre une leçon majeure d’anthropologie qui a trait aux relations qui ne sont pas d’exclusion, mais bien d’intrication de la sacralité et de la profanité. La sacralité est afférente à ces dispositifs, ces objets, ces moments, ces personnes, que des humains soustraient à la profanité pour les distinguer de l’ordre ordinaire des choses. Mais cette sacralité ne vaut qu’à faire retour sur cela, qui la supporte matériellement, sur ceux qui en sont les médiateurs, sur ceux qui en sont les bénéficiaires. La profanité désigne donc cet espace-temps qui est à la fois à l’amont et à l’aval de la sacralité, ce « lieu-moment » d’où cela vient et où cela fait retour.
En guise de non-conclusion : étonnons-nous, une fois encore ! Étonnons-nous de la surprenante plasticité de ce rituel, ayant enduré pareils investissements, pareilles métamorphoses, sans cesser d’enchanter les uns, sans cesser de générer la réactivité des autres ! Étonnons-nous de l’éminent pouvoir d’archive de ce rituel, en qui se stratifient mémoire religieuse, mémoire commerciale, mémoire politique, mémoire technique, mémoire artistique. En ce sens, le rituel est à lui-même sa propre archive. Nouveau paradoxe : paradoxe de l’archive vive ?
Archives
Presse
Mémoire et thèse
Articles
Ouvrages

Étude
Les grands parcs apparaissent comme des espaces à part, qui proposent une nature organisée par l’homme et reflètent les préoccupations des époques qu’ils traversent.

Article
Issue de l’héritage du musée d’histoire naturelle de Lyon, le musée des Confluences n’a rien d’un long fleuve tranquille.
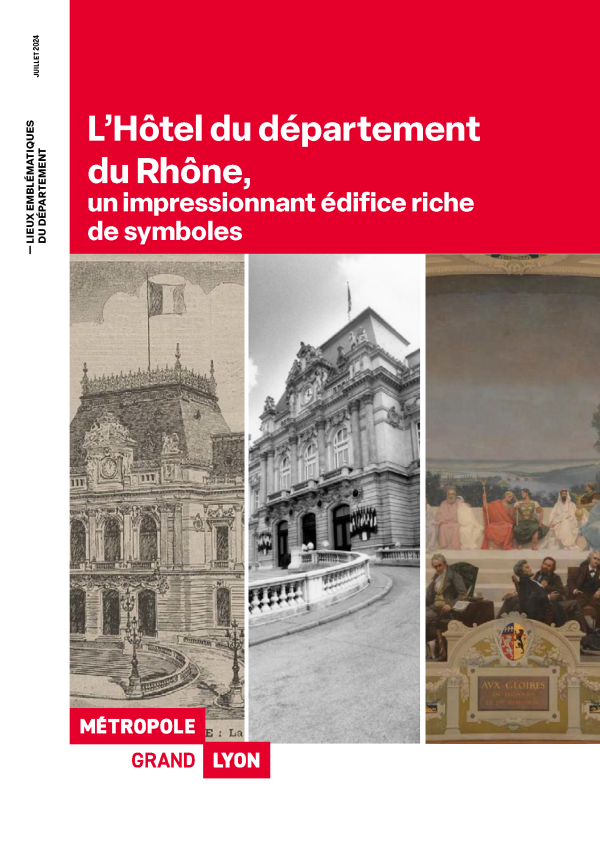
Étude
L’Hôtel du département du Rhône a la particularité d’abriter à la fois le Département du Rhône, collectivité territoriale, et la Préfecture du Rhône, service de l’État dans le département.
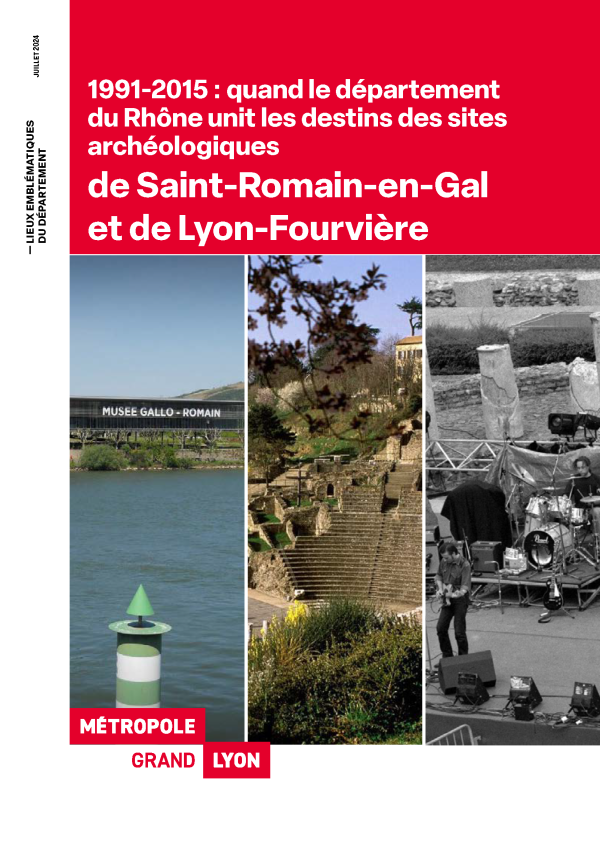
Étude
Dans le récit de la constitution des sites archéologiques de Saint-Romains-en-Gal et de Fourvière, prenons conscience de la valeur des traces civilisationnelles qui nous sont données à voir.

Étude
Le Grand Lyon bouillonne d’initiatives, de projets, d’envies de faire et d’inventer : puisse ce guide aider, encourager et multiplier ces enthousiasmes !

Interview de Marie-Claude JEUNE
Ancienne conseillère pour les arts plastiques à la DRAC Rhône-Alpes
"L’art dans la ville est aujourd’hui plus diffus, mais aussi à mon sens plus concernant".

Interview de Charles Picq
"La danse a amené à la ville une façon de soigner son vivre ensemble".

Article
Comment s’est déroulée l’aventure de la création et de l’installation de la nouvelle collectivité ? Pour quelles raisons ces deux institutions décidèrent-elles à la fois fusionner et de se séparer ?