Les matériaux, un enjeu d’avenir pour les territoires

Dossier
Notre quotidien, notre économie, nos services publics dépendent de matériaux et des chocs sont à prévoir. Quels sont les risques à anticiper ? Un sujet à saisir pour les collectivités.


Vous êtes ici :

Article
Tag(s) :
Depuis plusieurs années, la question de l’acceptabilité s’est invitée dans les politiques publiques de transition énergétique, à l’image du rapport du CESE de 2022 : Acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique : transition subie, transition choisie ?.
Changer les comportements pour rendre les pratiques durables est l’enjeu de nombreuses politiques de transition, qui parlent alors d’acceptation, ou d’acceptabilité, comme d’une étape incontournable à la mise en œuvre de dispositifs incitatifs ou contraignants. Une utilisation récurrente de ce mot d’ordre qui pousse Patrick Jolivet, directeur des études socio-économiques à l’Ademe, à déclarer qu’« il est temps de parler d’autre chose que d’acceptabilité sociale ». Celui-ci souligne un positionnement trop binaire entre « pour » et « contre », cachant le fait que des nuances dans les infrastructures proposées (ex. taille des mâts des éoliennes) peuvent avoir une grande incidence sur la réception des projets.
Pourquoi parle-t-on autant d’acceptabilité ? L’usage récurrent de cette « notion fourre-tout » serait révélateur d’un contexte de prolifération des innovations technologiques, qui pousserait à recourir aux sciences sociales, et notamment les sciences comportementales, pour « faire passer la pilule » de projets controversés.
À moins que l’acceptabilité sociale ne soit la première étape vers une reconnaissance des usagers/citoyens (leur expertise d’usage, leur attachement aux lieux, leur point de vue politique) sur les innovations qui les concernent ?
Pour y voir plus clair sur l’acceptabilité d’innovations technologiques (et non sur l’usage de l’acceptabilité au sens large comprenant par exemple l’adhésion à des politiques publiques), revenons sur l’historique de ce terme, les différentes définitions qui s’opposent pour la définir, puis sur ses mécanismes explicatifs.
Le problème de l’acceptabilité a toujours existé. Comme l’écrivent Boris Alexandre et ses coauteurs du Laboratoire d’Étude des Mécanismes cognitifs de l’Université de Lyon, les humains ont continuellement modifié et amélioré leurs outils au fil des générations. La diffusion d’innovations d’une part, comprises ici au sens de nouvelles idées, produits, services ou comportements, et l’installation d’infrastructures d’autre part, sont des problèmes inhérents à la vie humaine. Pensons au tabac : les mouvements sociaux antitabac existent depuis environ quatre siècles, avec une variété de raisons de ne pas accepter son usage. C’est vrai aussi de l’usage de l’automobile, qui fut critiquée dès son invention. D’ailleurs, l’échec des innovations est la règle et non l’exception.
Le rejet (passif) d’une innovation est en effet la norme sur le marché. 95 % des nouveaux produits de grande consommation lancés sur le marché nord-américain échouent, de même pour 90 % de ceux lancés sur le marché européen. La même règle vaut pour les innovations qui relèvent du style de vie : combien de modes et de contre-cultures à la durée de vie éphémères ? Suivant ces premiers points d’analyse, les problèmes d’acceptabilité sont inévitables, de tout temps.
Si le problème de l’acceptabilité est probablement aussi ancien que l’innovation technique, l’usage du terme est plus récent. Le terme « acceptabilité » naît au milieu du XIXe siècle sous la plume de Proudhon : « L’entrepreneur n’a plus à s’occuper de l’argent ; il ne s’agit pour lui que d’établir sa propre productivité, autrement dit l’acceptabilité de ses produits ». Il est ensuite repris dans Propaganda par le père de la publicité Edward Bernays en 1928 : « Ce livre se propose d’expliquer la structure du mécanisme de contrôle de l’opinion publique, de montrer comment elle est manipulée par ceux qui cherchent à susciter l’approbation générale [public acceptance] pour une idée ou un produit particulier. ».
Le terme connaît le succès à partir des années 1970. La première publication scientifique utilisant le mot « acceptabilité » date de 1956 et traite des farines animales. Le premier document issu des Archives nationales françaises mentionnant le terme dans son titre date de 1979.
Jusqu’alors, le mot « acceptation », au sens proche, était beaucoup plus fréquemment utilisé. Le succès du mot « acceptabilité » atteint son sommet au début des années 1980 pour y rester un long moment. Au Québec, où de grands projets ont occasionné de nombreux conflits, l’acceptabilité est une notion évoquée par les pouvoirs publics depuis les années 1990, en particulier au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, une institution publique dédiée à l’acceptabilité.
En anglais, l’une des premières publications scientifiques utilisant le terme « acceptable » concerne la planification des forêts, s’intitule Limits of Acceptable Change et paraît en 1985. Des auteurs considèrent que le problème de l’acceptabilité naît avec le souci écologique et le développement des énergies renouvelables.
L’usage de la notion d’acceptabilité est devenu fréquent dans de nombreux domaines. La notion est convoquée par une variété de disciplines scientifiques (ergonomie, sociologie des innovations, sciences de l’environnement, médecine, gestion des forêts, etc.) et de nombreux professionnels (scientifiques, psychologues, juristes, entrepreneurs, managers, consultants, membres d’ONG et politiques). Le dénominateur commun de ces acteurs est qu’ils appartiennent au groupe des experts.
Comme l’écrit Pierre Batellier, spécialiste de science de l’environnement, le succès du mot « acceptabilité » repose sur sa définition suffisamment floue et malléable, qui permet de l’utiliser dans une variété de contextes. « Acceptabilité » est donc un mot fourre-tout du domaine de l’expertise, comme « communication », « information » ou encore « éducation ».
L’imprécision du sens du mot « acceptabilité » et son caractère abstrait permettent à des experts variés de posséder un langage commun. Un article de la revue Vertigo, rapporte ainsi que de nombreux chercheurs utilisent la notion d’acceptabilité en la redéfinissant selon leurs besoins. Ainsi, en conservant le terme même redéfini, ils continuent de s’inscrire dans une communauté plus large avec qui le dialogue est possible.
Enfin, si en français l’usage du terme « acceptabilité » est dominant, l’usage d’« acceptation » (acceptance) est plus fréquent en anglais. Parallèlement au succès de l’acceptabilité, des chercheurs anglophones ont aussi repéré la croissance importante de l’usage de la notion de social license (autorisation sociale), qui possède un sens proche. Entre 1997 et 2002, les médias canadiens avaient utilisé le terme de social license dans 10 articles ; entre 2013 et 2015, dans 1 000 articles ; en 2016 uniquement, dans 2 000 articles.
Le succès de la notion d’acceptabilité et des mots voisins ne signifie pas l’absence de critiques à son égard. Certains scientifiques, et en particulier des chercheurs en sciences sociales, expriment un rejet très marqué de la notion. À la manière des sociologues Yann Fournis et Marie-José Fortin, ils la jugent « embarrassante ». Au travers du terme « acceptabilité », ils perçoivent une injonction : celle « de faire passer la pilule » de l’innovation.
Pour les technicistes, les ingénieurs résolvent le problème, mais les humains sont parfois irrationnels au point qu’ils refusent les solutions que l’on propose à leurs problèmes. Ce décalage est souvent nommé problèmes d’acceptabilité. Dans des réunions interdisciplinaires, certains ingénieurs se tournent parfois vers moi et me disent : vous, les “sociologues” (…), que pouvez-vous faire pour régler ce problème ? Les chercheurs en sciences sociales se trouveraient investis d’une responsabilité principale : ils seraient les techniciens de l’acceptabilité. -Lévy, 2013
Comme l’évoquent plus haut Proudhon et Bernays, les entreprises doivent être constamment à l’écoute du public pour vendre leurs produits. Selon les chercheurs les plus critiques de l’acceptabilité, en participant à rendre une innovation acceptable, le chercheur se substituerait au publicitaire et au chargé de relations publiques. Le rôle des sciences sociales serait-il de documenter les résistances et les facteurs de consensus pour faire accepter une innovation ? Outre le refus de ce rôle, des scientifiques dénoncent aussi le modèle vertical de la diffusion des innovations sous-entendue par l’idée d’acceptabilité : d’un petit groupe de spécialistes à la masse des citoyens.
Les critiques de la notion d’acceptabilité remettent aussi en cause le biais de nombreux experts qui seraient « néophiles », c’est-à-dire, favorables a priori aux innovations. Ils sont ainsi d’autant plus soucieux de la lenteur, à leurs yeux, de la diffusion des innovations, ou du fait que des populations puissent les ignorer, s’en désintéresser, voire les rejeter. Le risque est alors de considérer obligatoirement le défaut d’acceptabilité d’une innovation comme une forme d’irrationalité.
De plus, les experts ne sont pas neutres : certains travaillent en lien avec les grands groupes industriels, par exemple dans les domaines de la chimie et de l’énergie en général. Cela les conduit parfois à avoir des affinités, voire à défendre sciemment ou non des innovations qui s’avèrent nuisibles.
Ces erreurs adviennent d’autant plus que les savoirs profanes sont méprisés. L’historien Jean-Baptiste Fressoz a montré combien le savoir pratique des citoyens a été progressivement dévalorisé au cours du 19e siècle, au profit du savoir des experts. Cela a conduit à ce que les pouvoirs publics adoptent un biais pro-innovation, suivant ainsi les experts, et à sous-estimer les effets à long terme de certaines innovations, omettant le savoir profane qui aurait pu les mettre en lumière. En reprenant les propos de Jean-Baptiste Fressoz, favoriser l’acceptabilité constituerait ainsi à la fois une manière de devenir réflexifs sur une innovation, de prendre en compte des risques, mais aussi de passer outre, de les normaliser et de stimuler l’innovation.
Tout en intégrant ces critiques sur le fait que la diffusion de la notion d’acceptabilité n’est pas neutre, on peut également émettre l’hypothèse que l’intérêt croissant pour la question de l’acceptabilité renvoie plus généralement à une transformation du champ politique d’au moins deux ordres :
Autrement dit, les moyens d’expression de l’(in)acceptabilité sont beaucoup plus nombreux, et les motifs de discorde se sont eux aussi démultipliés.
Le terme « acceptabilité » reste assez peu défini dans le discours public. De nombreuses définitions coexistent, sans que l’une d’entre elles ne fasse consensus. Pour l’essentiel, ces définitions visent à décrire un phénomène vertical (top-down) : une innovation proposée par des experts doit impacter une population et un territoire donné. Toutefois, une fois ce socle commun posé, les approches divergent, moins en raison de contradictions, que du fait qu’elles abordent l’acceptabilité selon des points de vue différents. Quatre lignes de tensions se dessinent, au travers desquelles on retrouve des éléments de définition.
Une première synthèse consiste à rassembler les différentes définitions selon un gradient d’acceptabilité, de l’assentiment tacite au soutien/rejet actif. À une extrémité, il existe des formes d’acceptabilité qui sont passives et minimales — certains parlent alors d’acceptation. Une population peut vivre avec une innovation technique sans le savoir ou sans y prêter attention et donc sans la contester. De nombreuses pollutions sont peu sensibles, des dispositifs sont enfouis, secrets, etc. Inversement, à l’autre extrémité, le refus d’une infrastructure peut être très vif et entraîner des mobilisations de longue durée, à l’instar des Zones à défendre (ZAD).
En plus de l’acceptabilité passive et du rejet, il existe aussi des formes de soutien actif aux innovations que l’on peut graduer : du consentement, à l’assentiment, à l’adoption, à l’approbation et à l’appropriation. En général, on parlera ainsi d’échelle et de seuil d’acceptabilité. Pierre Batellier décrit cet écart entre attitude et comportement, mettant en lumière une variété de postures de (non) acceptation vis-à-vis d’une innovation donnée.
Une autre manière de synthétiser les définitions de l’acceptabilité revient à se demander à quel moment les scientifiques portent leur regard sur elle.
Pour résumer ces trois phases du rapport d’un individu à une innovation, Marlène Bel propose dans sa thèse de doctorat de différencier l’acceptabilité a priori, l’acceptation lorsque l’individu est confronté à l’innovation et l’appropriation lorsqu’il en fait usage dans le temps quotidien et de façon durable.
Dans le domaine de l’ergonomie, Éric Brangier et Gérard Valléry reprennent la même définition.
A priori : une bonne partie des études de psychologie sociale et de marketing sur l’acceptabilité se concentrent sur les représentations d’une innovation par un groupe d’usagers avant qu’il n’y ait eu d’usage même ponctuel de celle-ci. À ce stade, les représentations pertinentes sont de l’ordre de l’utilité perçue, de la facilité d’usage perçue et des influences sociales (par les médias ou les proches), c’est-à-dire des informations et des normes partagées au sein d’un groupe.
À l’arrivée de l’innovation : d’autres études abordent la phase d’usage d’une innovation, depuis les premiers essais de prototypes par des personnes-tests en laboratoire, jusqu’aux usages répétés in vivo. Le design peut avoir un rôle à jouer assez important, dans la veine des travaux de Don Norman sur le rapport émotionnel aux objets quotidiens. À ce stade, l’utilité perçue et l’utilisabilité — certains auteurs parlent alors d’acceptabilité pratique et non sociale — deviennent cruciales. Toutefois, les erreurs d’analyse sont encore probables : les utilisateurs ne sont pas nécessairement tous capables d’estimer ce qui sera jugé comme bénéfique par les promoteurs de l’innovation, en particulier en fonction des contextes variés de leur utilisation. Ensuite, après usage récurrent, l’individu ou le groupe peuvent s’approprier plus fortement l’innovation, ou au contraire venir à douter de son utilité, etc.
Dans la durée : sur le temps long, l’acceptabilité d’une infrastructure peut fortement varier au gré des transformations des rapports entre les gestionnaires de celles-ci et les populations impactées. Le géographe Maarten Wolsink avance que l’évolution typique de l’acceptabilité d’une infrastructure suit une courbe en forme de U. Au départ, l’acceptabilité est élevée relativement à un second temps, celui du choix du site d’implantation, durant lequel l’acceptabilité diminue en particulier chez la population directement concernée. Finalement, les hauts niveaux d’acceptabilité initiaux réapparaissent, après que l’infrastructure a été installée depuis un certain temps.
Un troisième gradient classe les approches de l’acceptabilité en fonction de la prise en compte en priorité de facteurs individuels ou collectifs.
Du point de vue individuel, les chercheurs notent que de nombreuses personnes sont prêtent à accepter des innovations si elles contribuent explicitement à leurs intérêts : financiers, statutaires, d’autorité et de reconnaissance. Au contraire, la remise en cause d’acquis accroît la probabilité de résistances.
En général, les critères d’âge, de genre, de revenus et de niveaux de diplôme ont un impact sur le degré d’acceptabilité des individus et des ménages. Mais il faut aussi prendre en compte le temps qu’un individu prend à s’informer et échanger à propos des innovations et projets variés, et enfin ses compétences en lien avec l’innovation discutée.
Également, les individus diffèrent dans leurs rapports à des projets et des innovations en fonction des phases de leur trajectoire de vie. Comme de nombreux chercheurs l’ont montré, les individus vivent parfois des moments clés, des tournants (ex. déménagement) qui vont leur permettre d’adapter leurs attitudes et leurs pratiques, et donc d’adopter plus facilement une innovation.
Le plus souvent, les problèmes d’acceptabilité qui font grand bruit concernent des projets de large échelle. Corinne Gendron préfère à ce titre réserver la notion d’acceptabilité sociale à une échelle collective et non des individus : « L’acceptabilité sociale est donc d’abord une question de jugement collectif, plutôt que de préférences individuelles ». Plutôt que des intérêts, ce sont des valeurs et des croyances partagées qui sont en jeu.
Cette double échelle n’est pas sans créer de tensions : un grand projet peut présenter le désavantage de proposer des bénéfices peu visibles à un grand nombre d’individus, par exemple une énergie moins carbonée, tout en impactant avant tout une minorité de cette population sur un territoire local (les externalités négatives), qui n’en tire pas nécessairement de bénéfices compensatoires. Le rapport entre la population bénéficiaire et la minorité en question dépend de l’échelle du territoire. Il existe aussi à l’inverse des problèmes liés à des innovations qui concernent toute la population, comme les usages de l’automobile, mais acceptés et soutenus par des groupes d’intérêt locaux.
Une dernière manière de classer les différentes approches de l’acceptabilité suppose de comparer les enquêtes de l’acceptabilité anticipée et concrète, aux définitions idéales de l’acceptabilité comme norme.
Nous avons abordé jusqu’ici les approches de l’acceptabilité en actes. Inversement, une définition plus idéale de l’acceptabilité a été proposée par Corinne Gendron. Pour la chercheuse, il s’agirait de l’« assentiment de la population à un projet ou à une décision résultant du jugement collectif que ce projet ou cette décision est supérieur aux alternatives connues, incluant le statu quo ».
Cette définition suppose des enquêtes, des délibérations entre acteurs de bonne volonté, compétents, disposant d’un temps suffisant pour se consacrer à un projet, qui soient honnêtes et rationnels et qui puissent avoir le pouvoir partagé de décider du futur du projet (ou de son arrêt).
Une autre forme idéale d’acceptabilité est définie par Julie Caron-Malenfant et Thierry Conraud, lorsqu’ils proposent que l’acceptabilité soit « le résultat d’un processus démocratique par lequel les parties construisent ensemble les conditions à mettre en place, pour qu’un projet, programme ou politique s’intègre harmonieusement, et à un moment donné, dans son environnement économique, naturel, humain et culturel ». Une fois noté le caractère idéal, voire utopique, des deux définitions citées ci-dessus, il n’en reste pas moins qu’elles fournissent un horizon normatif intéressant.
Ces deux définitions sont d’ailleurs elles-mêmes décomposables, selon qu’elles décrivent un processus ou un résultat, pour reprendre une distinction de Pierre Batellier.
Le processus idéal d’acceptabilité cumule la bonne gestion des parties prenantes, la co-construction du projet dans le dialogue, des interactions entre le promoteur du projet et le public et finalement des processus d’évaluation et/ou de décision publique.
Du point de vue de l’acceptabilité-résultat, on insistera plutôt sur l’avancement sans heurts du projet, le respect des normes institutionnelles qui font consensus, mais aussi sur l’évaluation positive du projet par le public.
Dans la recherche scientifique, l’intérêt pour l’acceptabilité d’innovations techniques et le changement social ont conduit des chercheurs à proposer des théories plus exhaustives pour expliquer ce phénomène, voire l’encourager.
Albert Bandura est l’un des psychologues les plus importants du 20e siècle. Il a proposé un modèle dit de l’auto-efficacité. L’idée de Bandura est que le passage à l’acte, par exemple dans l’usage d’une innovation, dépend très fortement d’une auto-évaluation de la personne à propos de ses capacités à l’utiliser. Pourquoi l’individu essayerait-il d’agir s’il était persuadé d’en être incapable ? La personne dotée d’un haut degré d’auto-efficacité dans un domaine spécifique va ainsi être plus prompte à adopter une innovation du même domaine. Bandura insiste aussi sur le fait que l’expérimentation avec une innovation est plus efficace pour la rendre acceptable (voire adoptée), que l’observation de tiers l’utilisant. Toutefois, le modèle de Bandura prend peu en compte les spécificités de chaque innovation.
Au contraire, c’est l’objet du modèle le plus célèbre dans le domaine de l’acceptabilité, le TAM pour Technology Acceptance Model (Modèle d’Acceptabilité technologique). Il a été élaboré par Fred Davis et ses collaborateurs depuis 1989. Comme Bandura, Fred Davis tente ainsi de prédire l’acceptabilité future d’un individu : ce dernier utilisera-t-il ou non une innovation ? Davis, spécialiste du management, souligne que l’utilité perçue et la facilité d’utilisation sont des variables déterminantes pour qu’un individu accepte une technologie. Si l’usage d’une innovation paraît facile, alors elle sera adoptée et inversement.
À ces deux premiers critères peuvent s’en ajouter d’autres pour compléter le modèle. Des chercheurs ont voulu prendre en compte l’intentionnalité de l’usage futur d’une innovation (« Utiliserez-vous ou non cette innovation régulièrement ? »). Également, la facilité d’usage d’un objet dépend de l’appréciation qu’un individu fait de ses capacités (auto-efficacité). D’autres critères ont pu également être pris en compte, comme le confort, l’attrait, le prix, etc. De nombreux chercheurs ont bien repéré qu’il manque des facteurs importants au modèle TAM, notamment psychologiques, sociaux et organisationnels, voire politiques.
En France, dans une veine similaire, le sociologue et consultant Philippe Mallein a créé la méthode CAUTIC (Conception Assistée par l’Usage pour les Technologies, l’Innovation et le Changement), afin d’évaluer l’acceptabilité d’une innovation. Les facteurs clés pour prédire l’usage ou non d’une innovation par un individu seraient le sens qu’il lui confère, les avantages qu’il envisage, ainsi que la facilité d’usage perçue, mais aussi la simplicité et la valeur ajoutée perçue. Si l’innovation n’a pas de sens pour un individu, ou bien si elle lui paraît désavantageuse, alors il va la rejeter. Ces modèles psychologiques sont centrés sur les individus.
D’autres modèles s’intéressant à la diffusion des innovations intègrent mieux le contexte social. L’auteur le plus important pour l’analyse de la diffusion des innovations, et donc de leur acceptabilité, est le sociologue Everett Rogers. Dans son ouvrage classique Diffusion of innovations, Rogers reprend peu ou prou les caractéristiques favorables à la diffusion d’une innovation technique : avantage relatif, compatibilité, risque perçu et complexité de l’innovation, la possibilité d’expérimenter avant de l’adopter et l’observabilité. À partir de ces caractéristiques, Rogers envisage cinq phases pour qu’un individu adopte une innovation :
À l’inverse, un individu sera d’autant plus résistant à adopter une innovation qu’il juge désavantageuse, avec un coût élevé, incompatible avec son mode de vie, risquée et sans possibilité d’être testée.
Le manque de confiance en soi (ou d’auto-efficacité) joue aussi un rôle négatif. Là où Rogers va beaucoup plus loin que d’autres, c’est qu’il intègre le rapport collectif à l’innovation. Il remarque combien les membres les plus favorables aux innovations dans un groupe sont souvent perçus comme déviants par rapport aux normes de ce même groupe.
À la suite des travaux de Paul Lazarsfeld et Robert K. Merton, il rappelle également le rôle déterminant de leaders d’opinion (ex. un médecin à propos de médicaments), qui vont faire le relais entre des informations, par exemple issues des médias, et les décisions des individus qui les consultent.
De ce fait, alors que les médias jouent un rôle important pour les « early adopters », c’est plutôt le bouche-à-oreille qui prend le relais pour diffuser largement une innovation. Enfin, à la suite du psychologue Kurt Lewin, Rogers constate que des opinions très affirmées changent difficilement par des campagnes dans les médias par exemple, mais dépendent avant tout d’échanges interpersonnels, en tête-à-tête. Comme Lewin l’écrivait, un individu est d’autant plus prêt à changer que le groupe auquel il appartient, notamment son ménage, sa famille et ses proches, a déjà changé, entre autres en acceptant une innovation. Ainsi, pour changer un individu, mieux vaut partir du groupe que de la personne elle-même. C’est un effet en apparence paradoxal du conformisme.
Ces constats appliqués à d’autres projets comme des infrastructures de transition énergétique (éolien, barrage) nous rappellent que la force des minorités intransigeantes est un phénomène à ne pas sous-estimer, tant dans la promotion des innovations (le groupe des innovateurs pionniers), que dans leurs rejets (ex. zadistes). Ces minorités sont d’autant plus influentes qu’elles parviennent à mobiliser l’attention médiatique. Alors qu’une innovation laisse une population indifférente pour l’essentiel, une controverse médiatique peut changer cet état de fait, au risque de polariser les opinions.
Pour finir, des sociologues et anthropologues spécialisés dans l’étude de l’innovation ont mis le doigt sur l’importance des acteurs non humains — techniques ou vivants — qui doivent accepter une innovation pour que cette dernière réussisse. Avec Bruno Latour et Michel Callon, Madeleine Akrich a insisté sur le fait que le succès des innovations dépend de la capacité des acteurs à accorder leurs fonctionnements, de manière à ce que la relation entre toutes les entités devienne fluide, sans heurts.
Dans cette perspective, la notion d’acceptabilité est poussée jusqu’à ses limites. Par exemple, il s’agit d’éviter la surpêche de coquilles Saint-Jacques pour leur laisser le temps de se reproduire, sinon, et la pêche et les coquilles disparaîtront.
Dernier mécanisme explicatif, les enquêtes d’opinion indiquent des différences dans l’acceptabilité de la transition écologique en fonction de critères socio-économiques. Une enquête de 2023 de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) montre que les mesures environnementales, dont contraignantes, sont plus acceptées par les catégories sociales favorisées et les ménages franciliens.
Par exemple, 57 % des Franciliens sont favorables à l’augmentation de la taxe carbone contre seulement 20 % des résidents des communes rurales. On sait également que les partis politiques écologistes remportent des succès avant tout en centre urbain. Cela n’est pas surprenant si l’on prend en compte que les individus qui vont adopter de manière plus rapide une innovation ont généralement des niveaux de revenu et de diplôme plus élevés.
Ce résultat général a été confirmé : toutes choses égales par ailleurs, les moins diplômés et les plus âgés dans une population sont les moins enclins à accepter des infrastructures plus « durables ». Dit autrement, les urbains très diplômés ont plus confiance dans les innovations écologiques que les ruraux peu diplômés. De plus, ce mécanisme est circulaire : des partisans de l’écologie et des innovations considèrent plus légitimes des institutions et des innovations de la transition écologique, que des individus qui y sont réticents. Or, la proposition par une institution vue comme peu légitime, combinée à de nouvelles innovations mal perçues, risque de redoubler la réticence et le procès en illégitimité.
Il n’y a alors rien d’(ir)rationnel à soutenir ou à lutter contre l’innovation écologique de ce point de vue : c’est avant tout le fruit d’expériences passées et souvent oubliées. Comme le rappellent Sofiane Baba et Emmanuel Raufflet, l’acceptabilité sociale dépend de croyances, de perceptions et d’opinions. Cela ne signifie pas que la population serait une masse irrationnelle qui pourrait s’émanciper de ses émotions dans un cadre adéquat, mais que l’ensemble de la population ne partage pas les mêmes expériences et donc les mêmes émotions en relation avec la transition énergétique.
L’analyse par l’attachement émotionnel à un lieu est à ce titre intéressante pour estimer l’acceptabilité d’un projet. Dans une enquête sur 25 cas d’infrastructures dans une dizaine de pays européens, un groupe de chercheurs a identifié les blocages potentiels des projets en cas de manque de transparence, d’absence de compensation pour les nuisances occasionnées par le projet (ex. baisse d’impôts, création d’emplois, etc.) et d’effets visibles et sensibles de l’infrastructure, en particulier si l’attachement au paysage et au territoire est fort.
Ce dernier facteur expliquerait les très grandes différences d’acceptabilité de l’éolien en fonction des sites considérés. Inversement, en cas de faible attachement, ou d’une stigmatisation associée à un territoire, l’éolien ou d’autres innovations perçues comme écologiques peuvent être plus facilement acceptés, car jugés valorisants. On retrouve ici un enjeu de l’ordre des émotions.
Alors que l’acceptabilité sociale est appréhendée par une partie des chercheurs comme un moyen de « faire passer la pilule », les démarches de participation citoyenne mises en place par les pouvoirs publics sont régulièrement dénoncées comme un instrument de l’acceptabilité de projets venus « d’en haut ».
La littérature est partagée sur ce constat. D’un côté, dans la continuité des auteurs cités précédemment, la sociologue Magali Bicaïs considère que les techniques d’acceptabilité d’une innovation (marketing, design, sondages, etc.) peuvent dépolitiser les enjeux, en laissant croire que l’on tient compte des opinions de la population, alors qu’il s’agit de les étudier pour mieux les manipuler par des discours positifs et d’anticiper ce qui peut être toléré. Le recours à la participation citoyenne serait une technique parmi d’autres pour faire accepter des projets ou innovations techniques, un pis-aller en l’absence de débat démocratique sur les technologies.
D’autres auteurs tentent de voir le verre à moitié plein : pour eux, il existe très peu de débats démocratiques sur les choix technologiques et les innovations en général, et dans ce contexte, la logique de l’acceptabilité a au moins pour fonction de prendre en compte les usagers, à défaut de s’adresser à eux en tant que citoyens. Comme l’écrivent Marie-José Fortin et Yves Fournis, rendre un projet acceptable suppose justement le soutien des populations, ou du moins, l’absence d’opposition.
En ce sens, prendre en compte les citoyens par des démarches participatives serait même un plus. Alice Friser et Stéphanie Yaves considèrent ainsi l’acceptabilité comme un processus démocratique prenant positivement le relais de la démocratie représentative : « Ces instances, que nous qualifions d’instances participatives de démocratie intermédiaire, ne peuvent que difficilement jouer le rôle pacificateur qu’on leur prête, car elles deviennent des lieux de débats où s’affrontent des visions du monde qui devront, ultimement, faire l’objet d’arbitrages ». Le risque de la manipulation et de la pacification des individus serait dès lors limité.
En somme, selon les positions, la recherche d’acceptabilité est soit le chaînon manquant entre la publicité/le marketing et la vie publique, soit entre la démocratie représentative et la démocratie participative.
Dans cette seconde position, la frontière entre techniques d’acceptabilité et participation devient floue. Au Québec notamment, la notion d’acceptabilité sociale est utilisée comme moyen de promouvoir la participation des citoyens à la vie politique, de manière régulière. Cela demande de constituer des espaces de discussion organisés de manière à co-définir l’intérêt général. De la sorte, les organisations privées et publiques intègrent les opinions et même certains mouvements sociaux à la prise de décision sur la transition écologique et au-delà.
Cela implique enfin de repenser les postulats associés à la participation citoyenne. Pierre Batellier liste ainsi dans un article douze postulats « à déconstruire » s’agissant de l’acceptabilité sociale, qui enjoignent à considérer autrement les démarches de concertation.

Dossier
Notre quotidien, notre économie, nos services publics dépendent de matériaux et des chocs sont à prévoir. Quels sont les risques à anticiper ? Un sujet à saisir pour les collectivités.

Étude
Une synthèse des quatre études de prospectives des matériaux et de leurs implications pour les collectivités locales.

Étude
Un aperçu des tendances réglementaires, économiques et d’usage qui ont une influence sur la consommation à la hausse et à la baisse de matériaux, avec trois focus : se loger, se déplacer, se meubler.

Étude
Une exploration des innovations en cours de procédés techniques, illustrée par quatre exemples : la lithographie des circuits intégrés, la fabrication de panneaux photovoltaïques, la récolte de la laine, et le remanufacturing.

Étude
Un panorama de huit filières bouleversées par les évolutions de matériaux : construction-bois, textile, papier-carton, métallurgie, chimie, automobile, énergies renouvelables et électronique.

Étude
Un panorama de la consommation de dix matériaux : bois, fibres textiles, caoutchouc, ciment, plâtre, terre cuite, verre, composites, plastique et métaux.

Interview de Jean Haëntjens
Économiste et urbaniste
Une « économie des satisfactions » pourrait-elle inspirer un nouveau modèle de société, moins consumériste et plus écologique ?

Texte de Geoffroy BING
EveryAware, Noisetube, « Citoyens Capteurs », Safecast, Airprobe, Airwaves, CATTFish ?
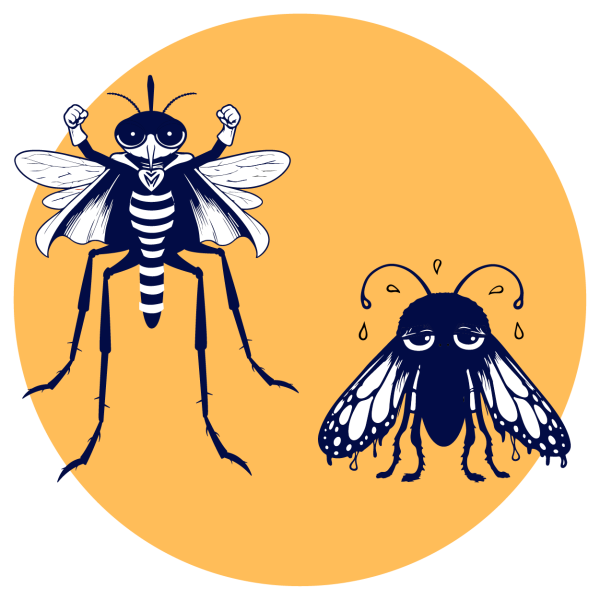
Article
Comment l’Anthropocène favorise certains êtres vivants, tout en précipitant la disparition d’autres ?