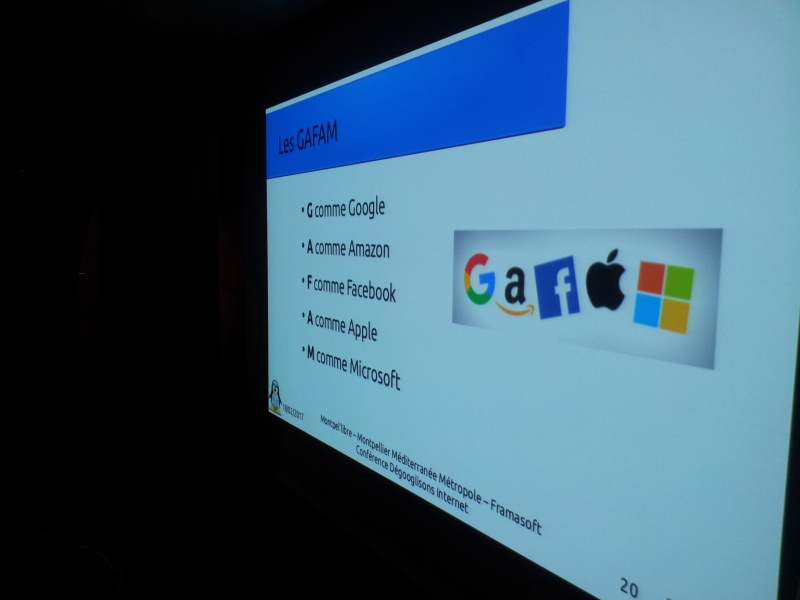Je crois qu’un des problèmes de la pensée politique contemporaine est qu’elle est souvent piégée par de mots qui ont une forte charge idéologique. Je pense à des mots comme capital, travail, pouvoir, modernité, productivité qui sont implicitement associés à des postures critiques.
Si vous posez comme postulat que le travail (du latin tripalium, supplice) est une activité exécrable, humiliante, qui met le salarié sous la dépendance d’un patron avide, vous arrivez vite à la conclusion qu’il faut le réduire ou s’en affranchir en instaurant un revenu universel. C’est le cheminement logique. Le problème est que le revenu universel, on ne sait pas le financer. Surtout si parallèlement, vous souhaitez réduire le PIB, donc les recettes de l’État, qui en dépendent. Si vous posez que le travail peut être aussi, dans certaines conditions, une activité formidablement épanouissante, vous parvenez à des conclusions politiques totalement différentes.
Une réflexion est aujourd’hui ouverte sur la nécessité de revisiter les mots de la politique. Elle est particulièrement vive dans le monde de l’urbanisme. Je pense au livre de Francis Beaucire sur La ville prise aux mots, à celui de Jean-Marc Offner sur les Anachronismes urbains, ou à un colloque de Cerisy qui a réuni, en 2019 les meilleurs spécialistes français de l’aménagement. Tous ces auteurs auraient pu mettre en exergue de leur propos cette phrase de Camus : « Mal nommer les choses, c’est ajouter à la misère du monde ». Il me semble que certains mots sont comme des perturbateurs doctriniens. Ils portent une telle charge doctrinale qu’ils perturbent sérieusement la prise de décision.
Dans mon essai, je me suis efforcé de revisiter des concepts comme consommation, production, capital, autorité, sens, en essayant de les affranchir de leurs charges idéologiques. La nature, par exemple, c’est aussi un capital, elle a été modelée par l’Homme, c’est du travail accumulé. Il ne faut donc pas « condamner le capital » mais s’intéresser, de façon différenciée, aux principaux capitaux naturels, techniques, culturels, socio-politiques et éthiques accumulés par les sociétés humaines. Et regarder comment on pourrait, dans chaque cas, améliorer leur conservation, leur valorisation, leur répartition, leur statut juridique et leur transmission.