Cycle Veille M3 / Le temps « libre », luxe en déclin ou friche fertile pour cultiver le changement ?

Dossier
Comment résister au grignotage et à l’envahissement de ce temps par les écrans ?
Interview de Pascal Michon

Nos sociétés se construisent autour de nombreux rythmes : celui du travail, des enfants, du cycle « naturel » du corps humain… Mais comment ces rythmes se sont-ils imposés à tous ? D’où viennent-ils ? Comment déconstruire les rythmes ?
Entretien avec Pascal Michon, philosophe et historien, fondateur du site Rhuthmos, spécialiste de la généalogie du concept de rythme dans les sciences de l’homme et de la société, en philosophie et en poétique.
Auteur de nombreux écrits sur le sujet, son dernier ouvrage vient de paraître, Problèmes de rythmanalyse, 2 vol., Paris, Rhuthmos, 2022.
Qu’est-ce que le rythme ?
D’abord, il faut se libérer de l’idée que le rythme existe par lui-même, dans la nature. À chaque fois que l’on dit qu’il y a du rythme quelque part, c’est nous qui appliquons aux phénomènes observés des notions qui ont été conçues, bricolées, élaborées de manière assez complexe parfois, et souvent mélangées et hybridées. La périodicité, le cycle, la vitesse, la continuité, la période ne sont que des projections humaines. Il faut éliminer l’illusion qu’il existe des rythmes exogènes à l’homme, qui s’imposent à lui et à l’organisation des sociétés. On trouve ce genre de croyance par exemple dans certaines visions religieuses monothéistes. Pour saint Augustin, Dieu est rythmique, le Paradis est rythmique et donc il faut se préparer rythmiquement à la vie après la mort, notamment en respectant un certain nombre de rituels et de manières de vivre. Il y a eu aussi des visions « panrythmiques » d’orientation cette fois plutôt panthéiste, notamment au 19e siècle, visions selon lesquelles l’homme et la société devaient s’aligner sur les grands rythmes cosmiques et naturels. Cette naturalisation du rythme, on la trouve encore au 20e siècle, jusque dans la vision, par ailleurs critique, d’Henri Lefebvre. D’une manière étonnante, lorsqu’il s’agit de différencier les bons des mauvais rythmes, celui-ci défend encore les rythmes « cycliques » des sociétés rurales qu’il oppose aux rythmes « linéaires » qui se sont imposés dans les sociétés industrielles et urbanisées.
À partir du moment où l’on pense que les concepts ne sont pas dans la nature, comprendre ce qu’est le rythme revient à faire l’histoire de ses emplois et à choisir une définition qui convient à nos besoins et aspirations. On rentre alors dans une longue enquête portant sur plus de 2500 ans de productions théoriques très enchevêtrées mais que l’on arrive petit à petit à décortiquer et à classer.
Comment résumer cette histoire de la conception du rythme ?
En simplifiant, on peut dire qu’il y a eu trois grandes conceptions ou trois grands paradigmes du rythme dans l’histoire occidentale.
La plus ancienne de ces conceptions est celle des philosophes matérialistes et atomistes grecs qui sont les premiers, semble-t-il, à avoir utilisé théoriquement le terme rhuthmos. Ce terme est formé à partir du verbe « rhein » qui veut dire couler et du suffixe « –thmos » qui indique une modalité. Il signifie donc au départ la modalité du flux, la forme de quelque chose en mouvement. Chez Démocrite et les premiers philosophes matérialistes, il désigne les formes impermanentes constituées par l’agglutination des atomes, telles qu’elles apparaissent aux yeux de l’observateur. Cette acception, qui est encore celle que l’on trouve chez Lucrèce, a disparu en gros à la fin du 1er siècle avant JC pour réapparaître vers la fin du 17e et surtout au 18e siècle, même si c’est sous d’autres noms. On repère ce paradigme encore de nos jours, par exemple dans les neurosciences. Quand celles-ci parlent de « rythme », elles visent bien sûr d’abord des oscillations, des cycles et des fréquences, par exemple celles que l’on repère sur un électroencéphalogramme, mais en même temps, les recherches les plus récentes essayent de comprendre comment sont organisés des flux cérébraux formés de milliards de boucles d’interaction entre des populations de milliards de neurones. C’est alors qu’elles ont affaire à des rhuthmoi, des configurations fluantes ou des formes fondamentalement transitoires telles qu’elles apparaissent à l’observateur.
La deuxième conception, la plus fréquente aujourd’hui, a été élaborée par Platon. Celui-ci avait une vision idéaliste et autoritaire du point de vue politique et éthique. Du coup, l’idée qu’il puisse y avoir des « formes » fluantes et dépendantes de l’observation ne lui plaisait guère. À ses yeux, les formes, les Idées, existent en effet par elles-mêmes et les hommes doivent chercher à s’en approcher en dépit de leurs imperfections. C’est pourquoi Platon réduit le rhuthmos, qui était jusque-là une manière de fluer ou une forme momentanée d’une entité fluante, à une structure métrique, définie selon des proportions rationnelles. Selon lui, le rythme est une succession de temps forts et de temps faibles qui ont des rapports arithmétiques, succession qu’il retrouve dans la danse, le chant ou encore la poésie. Cette conception est celle qui s’est imposée en Occident et qui domine toujours aujourd’hui.
Les sons qui produisent des formes, une illustration du rhuthmos
Pendant plus de 2000 ans, c’est d’abord la médecine qui a diffusé ce modèle métrique. Assez vite, des médecins grecs d’Alexandrie l’ont utilisé pour mesurer le pouls et en faire un instrument de diagnostic. Cette pratique s’est ensuite répandue dans l’Empire romain puis, au cours du Moyen Age, dans le monde arabo-persan. Elle s’est encore renforcée à partir du 18e et surtout du 19e siècle, quand la médecine puis la physiologie ont commencé à bénéficier d’instruments de mesure et d’enregistrement sophistiqués. Bien sûr, certains médecins considéraient ce rythme comme naturel, pendant que d’autres le voyaient comme un simple instrument de mesure. On retrouve ici la même opposition philosophique que partout ailleurs.
Entre les 3e et 6e siècles de notre ère, la métrique a pénétré la cosmologie néo-platonicienne puis le Christianisme avec saint Augustin et Boèce. Ceux-ci ont posé les bases d’une vision de Dieu, du monde et des hommes, totalement métrifiée, vision qui a dominé la culture occidentale pendant tout le Moyen Âge. Cette approche métrique du monde s’est perpétuée à l’époque moderne à travers des philosophes, plus ou moins éloignés du christianisme, comme Schelling ou Hegel. Celui-ci associait ainsi explicitement la dialectique ternaire qu’il voyait à l’œuvre dans l’histoire aux formes décrites par les dernières théories métriques.
Parallèlement à ces deux canaux, le modèle métrique est bien sûr passé également dans la théorie de la littérature et la théorie musicale. On le trouve tout au long de l’Antiquité puis de nouveau, après une éclipse, à la fin du Moyen Âge, quand les modèles de découpage arithmétiques sont de nouveau mis à profit pour stabiliser les polyphonies de l’ars nova et encadrer les formes poétiques nouvelles écrites de leur côté en langue vulgaire. Extrêmement puissant dans les arts pendant la période moderne, le modèle métrique n’a finalement été remis en question qu’au milieu du 19e siècle pour la poésie et au milieu du suivant pour la musique.
Puisque nous parlons d’art, il faut noter qu’un usage un peu particulier est apparu en architecture juste avant notre ère. Vitruve a alors utilisé la notion métrique de rythme pour rendre compte de l’harmonie ou du manque d’harmonie d’un bâtiment. On voit l’innovation : il ne s’agissait plus ici de mesurer un mouvement dans le temps comme en musique ou en poésie, mais de fonder une esthétique spatiale. Toutefois, à l’instar de ces arts du temps, Vitruve faisait reposer cette esthétique sur des rapports arithmétiques rationnels entre les différentes parties d’une construction. La métrique était donc désormais appliquée à l’espace. Cette conception, reprise à la Renaissance par Alberti, s’est répandue en Occident pendant toute la période moderne et n’a cédé la place que lorsqu’à partir du 18e siècle, les rythmes d’un bâtiment sont devenus à leur tour des successions de pleins et de creux, de fenêtres et de murs, ou de colonnes et de vides, envisagés désormais selon le déplacement temporel du regard du spectateur. Cette retemporalisation n’a toutefois rien changé à la base métrique de cette rythmique.
Un fois qu’on a pris conscience de ces divers canaux de diffusion, on comprend mieux pourquoi le schéma métrique est devenu dominant au cours des 19e et 20e siècles, période pendant laquelle, en plus des domaines qu’il avait déjà conquis, il a fini par pénétrer en psychologie, en économie et même dans les sciences sociales. Son histoire explique pourquoi quand on parle de rythme, aujourd’hui, les gens pensent métrique et numération.
Il existe toutefois un troisième paradigme, certes très minoritaire, mais qu’il convient de ne pas oublier. Celui-ci a été inauguré par Aristote au 4e siècle, s’est maintenu encore quelques centaines d’années puis il a disparu à la fin du 1er siècle après JC. Avec la maturité, Aristote s’est détaché de l’approche rythmique de son maître Platon, surtout lorsqu’il s’est intéressé aux rythmes du langage. En travaillant sur les techniques rhétoriques des orateurs de la Cité, puis sur le théâtre et la poésie qui y étaient des pratiques courantes, il a tout d’abord mis l’accent sur leurs effets de « re-présentation » (mimésis), c’est-à-dire sur les manières dont un auteur ou un acteur recrée les choses du monde et les actions des hommes tout en mettant en lumière leurs structures profondes. Ce sont ces manières et leurs effets d’illumination qui, notait-il, provoquent la katharsis, c’est-à-dire le plaisir de comprendre les problèmes et éventuellement d’imaginer l’avenir. Or, ni les uns ni les autres ne peuvent s’expliquer simplement par des successions de syllabes longues et brèves, ou de temps forts et faibles. Il faut prendre en compte l’ensemble des configurations fluantes des discours, c’est-à-dire reprendre la notion de rhuthmos physique pré-platonicien mais en l’appliquant cette fois au langage. En refondant la Poétique sur le rythme, dans ce troisième sens très particulier, on peut alors comprendre comment on fabrique de la littérature, comment on la consomme et ce qu’elle nous fait. On peut ébaucher une théorie de la valeur artistique qui ne soit pas une simple théorie du plaisir esthétique. On peut même envisager une théorie éthique et politique assez démocratique très différente de la vision platonicienne.
Quels sont les problèmes posés par ces conceptions divergentes du rythme ?
Le problème le plus gênant résulte de la domination du modèle métrique. L’usage d’un tel modèle n’est pas en lui-même un problème quand il reste purement méthodologique. De très nombreuses sciences, que cela soit de l’homme, de la société ou de la nature, ont besoin de mesurer l’évolution des phénomènes dans le temps et pour cela de découper métriquement les durées en question. Ce qui pose un problème, c’est quand on commence à penser que ce qui n’est qu’un outil d’observation existe dans la réalité des choses qu’on observe. À partir de là, le point de vue méthodologique se transforme en une vision du monde ou une idéologie qui peut servir des intérêts et des objectifs éthiques et politiques bien particuliers.
Chez les économistes, par exemple, lorsqu’il apparaît au milieu du 19e siècle que l’économie ne se développe pas de manière régulière mais suivant des cycles plus ou moins périodiques, avec les conséquences sociales que l’on connaît, Marx utilise cet argument pour alimenter sa critique du capitalisme. La réponse des économistes libéraux est très instructive. Après un moment d’hésitation devant ces phénomènes dérangeants, ils vont commencer à soutenir que ces rythmes sont tout à fait « naturels » et que les dégâts causés par les crises récurrentes font partie, nolens volens, de la « respiration » ou de la « vie » de l’économie. Introduisant un modèle néo-darwiniste (peu conforme du reste à l’original), ils vont soutenir que ces crises font mourir les entreprises les plus faibles, provoquent du chômage et de la pauvreté, certes, mais que cela profite aux entreprises les plus fortes qui vont pouvoir se développer et embaucher des travailleurs. Ces crises feraient donc partie intégrante des rythmes profonds qui scandent le développement économique. Pour Marx, puisque les rythmes économiques sont sociaux et historiques, il est légitime d’intervenir. Pour les libéraux, ces rythmes sont naturels et donc il faut, au contraire, laisser faire. Derrière cette conception du rythme, il y a donc, on le voit, des implications très concrètes et très politiques… La vision métrique, celle qui domine aujourd’hui, est clairement une vision idéaliste, naturaliste et libérale, qui pousse à concevoir le réel comme rationnel et métrique.
Cette naturalisation des outils a, par ailleurs, pour effet d’interdire toute approche rythmique non orthodoxe. Dans les sciences de la vie, par exemple, la chronobiologie a permis de faire des découvertes très importantes. Mais aujourd’hui, lorsqu’un chercheur veut appeler « rythme » l’organisation non périodique des échanges d’impulsions entre poissons électriques, on lui dit que cela n’est pas du rythme. De même, lorsque les neurosciences ont affaire à des organisations fluantes de milliards d’interactions entre des populations de milliards de neurones, elles s’interdisent le concept de rythme, qui est associé depuis le début du 20e siècle aux mesures par électroencéphalographie, alors qu’elles pourraient très bien l’utiliser avec un très grand profit si elles connaissaient son passé rhuthmique ancien.
Tous ces problèmes résultent de la domination métrique et de sa naturalisation. À ceux-là, il faut encore ajouter, il est vrai, une autre difficulté, liée cette fois aux divergences entre les paradigmes anti-métriques eux-mêmes, ceux que j’appelle rhuthmiques. Si on les observe dans la longue durée, on voit que ces deux paradigmes sont la plupart du temps restés séparés en Occident. Face à la métrique dominante, les conceptions rhuthmiques naturalistes et anthropologiques n’ont pas réussi à s’associer, sauf dans de très rares cas comme, par exemple, chez Aristote et, plus près de nous, Diderot, Goethe ou Nietzche. Au 20e siècle, ces deux visions sont restées extrêmement éloignées l’une de l’autre. Je pense, par exemple, à l’opposition dans les années 1960-1970 entre, d’une part, Benveniste, Barthes et Meschonnic, et de l’autre, Morin, Serres, Deleuze et Guattari. Nous sommes là devant un autre défi qui sera certainement assez difficile à relever.
Quelle vision du rythme soutenez-vous de votre côté ?
En ce qui me concerne, j’oppose l’idée d’« organisation du mouvant » ou rhuthmos à celle d’« ordre arithmétique du mouvement » ou métron. Si l’on adopte ce point de vue, on obtient un concept beaucoup plus englobant que le concept métrique de rythme, qui n’est d’ailleurs pas supprimé mais intégré dans le précédent. Dans tous les phénomènes fondés sur de grandes quantités d’interactions enchevêtrées, on a affaire à des organisations fluantes, que l’on pourrait appeler « holistes », bien que des successions linéaires périodiques puissent très bien faire partie de l’image globale. C’est ce qui se passe lorsqu’on observe des populations de neurones, de bactéries ou encore d’animaux grégaires, comme les bancs de poissons ou les vols étourneaux. Mais c’est aussi ce qui se passe, lorsqu’on aborde un poème et que l’on prend en compte à la fois les échos, les interactions prosodiques, qui font sa matière même, et les structures métriques linéaires imposées par le style de versification adopté.
La murmuration, le mouvement complexe de la multitude d’étourneaux comme phénomène rythmique
La poésie, depuis le 19e, avec Baudelaire puis les symbolistes et Mallarmé, a réussi à se débarrasser des normes métriques et de versification. Le poème en prose, le vers libre et les balbutiements syntaxiques mallarméens sont désormais organisés comme des systèmes d’échos, d’oppositions, de reprises, de silences. Chaque poème se déploie bien entendu linéairement, comme tout discours, mais il doit aussi s’entendre pour ainsi dire perpendiculairement. Ce que les poètes de cette époque mettent au jour est fondamental : dans tout poème, mais c’est en fait valable pour tout discours, l’auditeur suit une série lexicale organisée de manière syntaxique mais, en même temps, il perçoit, grâce à sa capacité auditive, à sa mémoire et au-delà à son corps entier, des interactions prosodiques extrêmement complexes d’un vers à tous les autres ou d’une partie du texte à toutes les autres. D’une manière remarquable, les écrivains de cette époque, abandonnent pour décrire ce phénomène la métaphore de la « mélodie », qui a été utilisée jusqu’à Verlaine et Bergson, et choisissent de l’appeler « rythme ». Ce rythme, on le voit, est donc un système global d’interactions dans un médium fluant composés de myriades d’éléments de toutes tailles : phonèmes, accents, mots, structures syntaxiques, vers, strophes, texte.
La genèse des fleurs du mal de Baudelaire
Aujourd’hui, il y a beaucoup d’artistes qui sont attirés par cette vision des choses et qui cherchent à substituer à la notion métrique une notion rhuthmique du rythme. Par exemple, certains musiciens de l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) fabriquent de la musique à partir de « grains sonores » qui sont, pour moi, typiquement des « populations » d’éléments pris dans des interactions. De même, j’ai été frappé ces dernières années par le fait que certaines chorégraphes comme Maguy Marin à Lyon, ou Elise Lerat à Nantes, introduisent dans leurs chorégraphies non seulement de nombreuses variations non métriques, ce qui était déjà courant depuis le 20e siècle, mais aussi des expérimentations sur les associations possibles, les oppositions, mais aussi les indifférences entre les rythmes propres à chacun des danseurs, les uns par rapport aux autres, mais aussi par chacun par rapport au rythme global de la pièce. Le rythme est alors clairement un ensemble global complexe d’interactions de corps dansants.
En ce qui concerne les sciences sociales, plutôt que d’emprunter, comme il est souvent fait, le concept de rythme à la musique, ce qui nous confine quoi qu’on en dise dans la métrique (sauf, on vient de le voir, pour une certaine partie de la musique contemporaine qui s’est développée à la suite de Boulez et de son concept de « temps lisse »), il me semble ainsi plus productif de faire jouer le concept de rythme tel qu’il est né au sein des nouvelles pratiques poétiques dans la deuxième moitié du 19e siècle, tel qu’il a été ensuite élaboré sur des bases linguistiques et poétiques dans les années 1960-1980, et tel qu’il est aujourd’hui de nouveau questionné et utilisé par un certain nombre d’artistes contemporains. À partir de là, on peut aussi le faire jouer dans la description des phénomènes sociaux actuels et même confronter ce concept réformé aux dernières découvertes de certaines sciences de la nature, qui d’une manière étonnante adoptent, elles aussi, une perspective à la fois radicalement dynamique et radicalement corpusculaire. Bien sûr, loin de chercher ainsi à renaturaliser le concept, mon espoir en faisant cela est, au contraire, de susciter des échanges entre ces différents points de vue sur la base de leurs soucis formels et méthodologiques communs. Pour le dire vite, il s’agirait de rapprocher à nouveau les deux visions du rhuthmos, celle héritée de Démocrite et celle héritée d’Aristote.
Qu’est-ce que cette vision non métrique peut nous apporter sur la compréhension du monde et la manière d’agir dessus ?
On comprend assez vite ce que l’approche rhuthmique peut nous apporter si l’on pense à l’histoire récente de la vision qu’elle veut contester. Celle-ci a eu des effets extrêmement importants au 20e siècle, notamment dans le monde du travail. Quand, dans les premières décennies du siècle, il s’est agi d’augmenter la productivité, le taylorisme a fait florès aussi bien dans le monde capitaliste que dans le monde socialiste. Les corps des travailleurs ont été soumis à des disciplines entièrement métrifiées. Durant la même période, les régimes fasciste et nazi ont également utilisé extensivement la métrique pour mettre en forme les corps et les esprits, et plus généralement pour organiser la vie sur un modèle hyper-autoritaire.
Ces dernières formes métriques ont disparu avec l’effondrement de ces régimes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais la métrique a continué à régenter d’autres façons les sociétés développées jusqu’aux toutes dernières décennies du siècle. On a alors assisté conjointement à l’explosion du bloc socialiste, à l’abandon (ou au moins le déplacement géographique) du taylorisme, au basculement des sociétés occidentales dans le néolibéralisme et à une révolution des transports et des communications. Cette conjonction nous a fait passer d’un monde métrique, métrifié, réglé, scandé, à un monde ouvert, interconnecté, tissé de flux.
Contrairement à ce que prétendent certains auteurs comme Hartmut Rosa, ce passage ne s’est pas fait toutefois par une simple accélération des techniques, des modes de vie et des changements sociaux, mais il a été orchestré par des décisions politiques, par la mise en place de nouvelles normes juridiques et par l’essor de certaines techniques bien particulières. La métrique du travail, les trois huit, le travail à la chaîne, demeurent, par exemple en Chine ou dans les pays ateliers, qui se sont transformés en usines du monde. En Occident, la société et l’économie se sont, en revanche, départies de ces rythmes et reposent désormais plutôt sur des organisations en flux tendu ou en temps réel fondées sur une multiplication inédite des interconnexions.
Alors, l’ennemi c’est la métrique ou le flux ?
L’ennemi n’est plus aujourd’hui la métrique. C’est un problème du passé, en tout cas pour ce qui nous concerne dans les sociétés développées. Mais ce n’est pas le flux par lui-même non plus. Notre principal défi, c’est la dissolution ou la liquéfaction d’un monde devenu flexible et réticulaire à la fois. Dans les années 1970, beaucoup de penseurs critiques réagissaient contre un monde systémique et métrique organisé selon une division stricte du temps, la répétition des tâches, la division du travail, etc. Nous vivons, au contraire, dans un monde où les temporalités se croisent à cause de la disparition des frontières entre le domicile et le travail par exemple, ou bien à cause des flux continus de sollicitations et d’exigences qui nous arrivent, et qui demanderaient, justement, à être un minimum régulés… Nous sommes constamment pris dans des croisements, des chevauchements et des enchevêtrements de rythmes multiples.
Comment faire, dès lors, pour que ces rythmes fluides ne nous écrasent pas ? Comment faire pour qu’ils n’entraînent pas un burn out, un surmenage ou une dépression ? Comment faire pour qu’ils nous permettent, au contraire, de nous épanouir et de développer une vie organisée, même si elle est souplement organisée ?
Les études sociologiques montrent que nous ne sommes pas égaux face à ces défis-là. En simplifiant un peu, les gens qui sont « sur-occupés » sont aussi souvent les mieux dotés pour faire face à ces nouveaux problèmes. Ils ont pu faire les études qu’il faut, ils ont les outils technologiques, l’argent, les métiers et les ressources sociales qu’il faut, et ils sont tout à fait capables de jongler avec ces rythmes. Ils peuvent ainsi très bien vivre à toute vitesse, quitte bien sûr à s’arrêter de temps en temps car, ça aussi, ils le peuvent et le choisissent. À l’inverse, ceux qui sont en bas de l’échelle ont beaucoup plus de mal à harmoniser les rythmes auxquels ils sont confrontés, d’une part parce qu’ils ont moins de connaissances, moins d’outils techniques et moins d’argent, mais aussi parce qu’ils ne peuvent pas choisir leurs horaires de travail qui sont par ailleurs de plus en plus hachés. Aujourd’hui, ces travailleurs sont très nombreux dans les services, la logistique, le commerce, toutes les activités fondées sur le « juste à temps ». Je pense par exemple aux livreurs à vélo ou aux conducteurs de taxi mais aussi à la caissière qui travaille le dimanche et/ou un peu le matin et un peu le soir… Pour moi, la vitesse et l’accélération ne posent donc pas des problèmes par elles-mêmes. Les vrais problèmes, ce sont, d’une part, ce que Christophe Bouton appelle la « norme de l’urgence » et, d’autre part, les inégalités face à cette norme.
Que faire ? Nous aurions alors besoin de nouveau du rythme métrique pour réguler, voire ralentir, le rythme fluide ?
On ne pourra pas revenir au monde systémique et métrique, c’est terminé. Eric Zemmour y croit, pas moi. Il n’est pas possible de revenir en arrière. Cela dit, ce n’est pas une raison pour accepter la liquéfaction du monde comme s’il s’agissait d’un phénomène naturel qui n’aurait aucun lien avec les choix politiques qui ont été fait ces quarante dernières années.
Mais une telle remise en question ne pourra se faire, à l’évidence, comme le proposent de leur côté certains essayistes à la suite de Rosa, par le simple « ralentissement » de nos sociétés et économies ou même, a minima, par la création d’« îlots de décélération ». Il faut plutôt chercher à redonner de la « consistance » à ces flux, c’est-à-dire des intensités qui permettent aux individus de développer leurs capacités à agir et à exister.
D’une manière générale, il ne s’agit ni de s’opposer aux transformations qui ont eu lieu et continuent de se produire de manière typiquement réactionnaire par un retour en arrière dans un passé métrifié idéalisé, ni de les accepter de manière assez défaitiste tout en y ménageant quelques espaces-temps que l’on imagine faussement plus vivables, mais de les retourner à notre avantage en agissant de telle sorte que leurs effets pervers soient endigués au maximum et que leurs bénéfices soient beaucoup mieux partagés socialement.
Comment lutter contre l’atomisation des formes collectives et la déstabilisation des individus provoquées par la généralisation des rythmes fluides ?
Dans les années 1990-2000, certains ont défendu l’idée que les « multitudes » allaient s’organiser par le bas pour résister aux rythmes écrasant du monde fluide. Les États ne pouvaient rien faire pour s’opposer à la mutation du capitalisme en cours car ils en étaient parties-prenantes. C’était la thèse défendue par Toni Negri et Michael Hardt. L’histoire ne leur a pas donné raison. D’une part, les multitudes ne sont pas devenues des forces suffisamment organisées pour peser sur l’évolution des sociétés. De l’autre, même si les États ont participé à la mise en place du monde flex-réticulaire, il n’y a aucune raison de renoncer à établir des arbitrages et des choix collectifs, négociés, partagés à propos de ces rythmes et cela à toutes les échelles.
À l’échelle de la famille, il est déjà tout à fait possible de se donner un certain nombre de normes temporelles. D’ores et déjà de nombreux parents régulent assez strictement l’usage par les enfants des écrans, des consoles, des smartphones, etc. de manière à les isoler un peu de ces flux et à les aider à retrouver une certaine intensité dans leur rapport au monde. Certains organisent des moments de « recondensation » du temps en sanctuarisant un après-midi entièrement consacré aux enfants, une soirée pour l’un des conjoints ou en se mettant à 80% pour dégager du temps à soi.
À l’échelle des villes ou des régions, on a vu apparaître, en Italie puis dans d’autres pays, de nombreuses expériences de « politiques temporelles », impulsées en particulier par des femmes, qui ont, tout d’abord, tenté de faciliter la synchronisation des rythmes pour faciliter l’organisation des activités quotidiennes qu’elles étaient les premières à assumer. Ces politiques ont ensuite rapidement visé les rapports entre les activités en continu et les moments d’arrêt comme le dimanche ou la nuit, mais aussi l’immense question des mobilités qui implique, quant à elle, des conséquences environnementales et climatiques déterminantes.
À l’échelle nationale (ou régionale selon les pays), je pense que les syndicats et les partis politiques conservent des capacités et des responsabilités fondamentales tout particulièrement en ce qui concerne le droit du travail. Il suffit de penser à la réduction encore possible du temps de travail, au travail le dimanche, au droit à la déconnexion, au droit au télétravail, aux horaires d’ouverture des commerces et des services publics, à la rémunération de la pénibilité des travailleurs nocturne ou en rythme décalé, etc. Par ailleurs – et je suis d’accord sur ce sujet avec Christophe Bouton –, ils devraient aussi mieux réguler le système économique capitaliste en pénalisant les entreprises qui orchestrent l’urgence organisationnelle, en établissant un impôt progressif sur les sociétés pour contrecarrer l’exigence de rentabilité à très court terme, et en facilitant au contraire la création d’un actionnariat durable, lui-même en prise sur les temporalités longues dont la prise en compte nous est désormais imposée par les transformations environnementales en cours.
Et puis, il y a aussi bien entendu les organisations internationales, l’Union européenne en ce qui nous concerne, mais aussi l’ONU et les autres organisations. Il ne serait certainement pas inutile que ces corps se saisissent à leur niveau des questions de temporalité et de rythme, notamment parce que ces questions ne peuvent pas être dissociées des enjeux internationaux contemporains, que cela soit les relations commerciales ou les questions climatiques.
À tous les niveaux, nous devons viser à établir les conditions d’une meilleure individuation, ou pour le dire autrement d’un pouvoir d’agir de chacun sur sa propre vie. Il ne faut rien nous interdire. Toutes les organisations sociales, quelle que soit leur nature et leur échelle, doivent permettre à chacun et à tous de s’émanciper dans ce monde fluide. C’est un enjeu démocratique qui engage en fait tous les acteurs.
Prendre en compte toutes les échelles d’action possible permet d’éviter à la fois l’impasse de la théorie des « multitudes », qui s’autolimite tout en pactisant parfois avec l’adversaire en espérant naïvement hâter son déclin (comme lorsque Negri a appelé à voter pour le référendum européen de 2005), et celle de la théorie de « l’accélération » défendue par Hartmut Rosa à la suite de Virilio, pour qui « l’accélération » serait tellement rapide qu’on ne pourrait cette fois rien faire du tout et que, mis à part quelques « îlots de décélération », nous irions donc tout droit vers un effondrement apocalyptique.
Le rythme métrique et notamment sa dimension cyclique, a largement permis de décrire la nature et, en partie grâce à cette efficacité descriptive, a dominé la pensée occidentale. Que lui opposer en forme d’alternative ?
La chronobiologie montre bien qu’il y a des cycles dans le fonctionnement de la nature. Ils ne sont pas parfaits, il y a toujours des décalages, mais c’est la réalité des choses. C’est un rythme, ce sont des oscillations c’est-à-dire des temps forts et des temps faibles, ce sont des cycles c’est-à-dire des périodes entre des temps, peu importe comment on le nomme. Ce n’est pas contestable. Néanmoins, quand on étudie ce sur quoi les naturalistes travaillent aujourd’hui, on se rend compte que la nature ne se limite pas à des rythmes métriques, cycliques, numériques, bien au contraire je dirais.
Mieux on la comprend dans le détail, plus on y trouve des formes de fonctionnement qui s’éloignent de cette conception métrique. J’échange par exemple avec un chercheur qui travaille sur des poissons électriques qui n’ont pas d’yeux et vivent dans la vase. Ces poissons se situent les uns par rapport aux autres, localisent leur nourriture, trouvent un partenaire sexuel, etc. grâce à des impulsions qui forment des successions linéaires non oscillatoires. Or, bien que les chronobiologistes lui rétorquent qu’il ne s’agit pas de rythmes (au sens admis jusqu’ici), il insiste pour les considérer globalement comme tels (ce qui bien entendu change la définition du terme mais ouvre sur la saisie de phénomènes qui échappaient jusque-là à la mesure).
Le rythme non métrique de la nature : les poissons électriques
J’y ai déjà fait allusion, les avancées dans les neurosciences constituent un autre exemple de cette mutation en cours. Dans le cerveau, il y a des milliards de neurones interconnectés et, quand il y a échange entre deux populations de neurones, les signaux vont dans un sens et repartent instantanément dans l’autre. Ce phénomène de « réentrée », comme l’appellent Gerald Edelman et Giulio Tononi, crée des centaines de millions de boucles ou de tourbillons neuronaux qui, toutes les 200 millisecondes, font apparaître une petite scène consciente. Ces scènes se succèdent les unes les autres si rapidement qu’elles produisent en fin de compte un flux de conscience qui nous apparaît comme continu. On voit ici que le cerveau fonctionne à partir de flux qui ne sont pas organisés de façon métrique.
En fait, le schéma du rythme métrique est utile mais certains chercheurs ressentent aujourd’hui la nécessité de s’en départir pour comprendre autrement le vivant. C’est particulièrement vrai pour tous les scientifiques qui sont confrontés à des « populations », que cela soit des populations d’animaux chez les éthologues, de cellules chez les biologistes, ou de neurones pour les neurobiologistes.
Le rythme dans sa définition métrique et numérique ne peut pas expliquer comment fonctionne un banc de poisson, un vol d’étourneaux ou un amas de neurones. Ce sont des populations interconnectées dont les interactions fonctionnent à toute vitesse. Elles produisent des formes, des moments critiques et des bifurcations sans décideur central. Selon moi, on est devant une forme rythmique, un rhuthmos. Or ce modèle, il semble bien qu’on puisse aussi l’appliquer au fonctionnement de notre société.
L’approche rythmique est donc une théorie de la complexité ?
Autrefois, les sciences sociales ont partagé avec la biologie et la cybernétique la notion de système. Celle-ci impliquait une organisation différenciée qui, grâce à des échanges internes mais aussi avec le milieu externe, assurait sa reproduction. Aujourd’hui, il me semble que l’approche rythmique va au-delà de cette vision apparentée à la notion d’organisme et se rapproche en effet des théories de la complexité. Si elle est conçue comme rhuthmique, la rythmanalyse permet en effet de penser et décrire de grandes populations qui avancent ensemble en interagissant. Donc plutôt que de systèmes, je parlerai plutôt de populations dont tous les éléments sont en interaction constante et qui entretiennent de ce fait des relations organisées et souvent assez stables. C’est le mouvement général ou plutôt les techniques rythmiques qui organisent ce mouvement, avec leurs forces et leurs tensions, qui font que les individus singuliers ou collectifs, qui y apparaissent et y durent un certain temps, possèdent une certaine puissance d’agir et d’exister.
Pour décrire cette qualité individuante des différentes formes rythmiques, j’ai emprunté au poète Ossip Mandelstam le concept de « rythmicité ». Dans un article de 1920, celui-ci remarquait que, pendant la révolution de 1917, les masses avaient coordonné leurs rythmes. Grâce à de fortes interactions entre toutes leurs composantes, elles avaient réussi à renverser le pouvoir tsariste et, ce faisant, à faire émerger des individus plus conscients et agissants. Mais il mettait en garde les Bolcheviques pour la suite car, disait-il, à défaut de conserver cette « rythmicité », on aurait « le collectivisme sans la collectivité ». Il ne s’était pas trompé. Ainsi, pour lui, seule une collectivité possédant une forte rythmicité permet aux individus de s’épanouir entièrement. À cela, il faut, me semble-t-il, ajouter bien sûr que cette rythmicité doit se mesurer au niveau des formes d’interaction sociale, mais aussi au niveau des formes d’usage des corps et des formes du langage.
Ainsi aujourd’hui, nous avons le plus souvent affaire à des sociétés ou des groupes à très faible rythmicité, c’est-à-dire à des ensembles où les corps sont de plus en plus souvent branchés sur le marché et la consommation, où les discours sont réduits à l’information et au divertissement, et où le conflit est noyé dans l’échange économique, la judiciarisation et le jeu de partis politiques hors-sols. Les individus y sont indépendants mais très peu autonomes.
Il existe ainsi tout un ensemble de techniques à rythmicité négative qui empêchent les individus de se développer et d’agir. Ces techniques sont, d’une part, toutes celles qui participent de la liquéfaction extrême des choses. L’urgence, qui s’est imposée depuis les années 1990, est clairement une norme, une discipline ou, mieux, une technique rythmique organisant les activités des corps, du langage et de la socialité selon des manières qui réduisent à la fois la variété et l’intensité de nos vies. À cela, il faut toutefois ajouter tous les projets et parfois pratiques politiques visant à imposer une loi définie sur des bases intégristes, qu’elles soient religieuses ou laïques, ou encore mélangeant les deux. Dans ces projets et pratiques, les manières corporelles et langagières sont alignées sur des modèles fixistes définis autoritairement par un petit nombre d’hommes, pendant que la séparation et le conflit sont devenus les seuls critères éthiques et politiques, aux dépens de l’alliance et du mélange. Souvent, ce n’est pas un hasard, ces pratiques en reviennent des formes métriques strictes.
Par quoi passe l’imposition des rythmes d’organisation des sociétés alors ?
Je viens d’évoquer très rapidement les rythmes du langage mais, comme ils sont en général laissés de côté par les sociologues, il vaut la peine de s’y arrêter un peu. Les rythmes du langage, la façon d’organiser le discours, l’échange, c’est-à-dire la qualité langagière sont déterminants pour la qualité de l’individuation, c’est-à-dire de la construction des individus, mais aussi des sociétés. Les manières de se parler, de se comprendre, de partager les discours et de les faire circuler entre les individus, détermine en grande partie comment on accède au sujet et comment on vit ensemble.
Dans les médias traditionnels et maintenant les réseaux sociaux, on peut repérer, par exemple, deux grandes tendances opposées. D’une part, c’est plutôt le cas des médias traditionnels et de la télévision « globale », on cherche à fluidifier les discours en passant d’un thème à l’autre sans jamais vraiment approfondir. On « fait couler l’information ». L’objectif de ces manières de parler est double : d’une part, il s’agit de rendre le discours compatible avec les réquisits du marché, il faut qu’il soit produit et consommé en masse ; d’autre part, il s’agit d’éviter de provoquer des contradictions, des protestations, des contractions, qui pourraient ralentir le flux d’informations voire amener à contester la logique dominante de la fluidité elle-même. Parallèlement, c’est plutôt le cas cette fois des réseaux sociaux, même si certaines chaînes de télévision en participent également, on voit aussi se développer des logiques langagières très agressives, qui utilisent les dénonciations, les fausses nouvelles, les attaques personnelles proférées sur le ton du bateleur ou du bonimenteur. Dans ces cas, à l’inverse des précédents, les discours se contractent et se figent, ce qui était fluide devient visqueux voire carrément pâteux, mais on voit bien que cette tendance n’est que l’image inversée et solidaire de la précédente. Or, si les manières de parler permises, recommandées ou imposées se limitent à la liquéfaction ou à la contraction du discours, on aura bien du mal à bâtir un meilleur vivre ensemble. Par ailleurs, l’accession des individus au sujet en sera d’autant plus difficile.
Ce type de considération sur le langage renvoie en fait à une forme de modèle de société qui, pour le coup, est très concret.
Tout à fait. C’est la dernière dimension importante dans cette affaire : celle des rythmes même de la socialité, ou pour le dire autrement, celle de l’organisation temporelle des interactions entre individus, qu’ils soient singuliers ou collectifs. À ce niveau, les anthropologues comme Evans-Pritchard l’ont montré, l’individuation est d’autant plus forte que la société permet et même favorise l’alternance du conflit et de l’alliance. Pour obtenir un individualisme puissant mais non replié sur lui-même, il faut que les acteurs puissent s’associer et s’opposer régulièrement sans que cela se bloque. Il faut une sorte d’équilibre rythmique des relations. Il faut que les individus puissent s’opposer entre eux et aussi aux divers groupes auxquels ils appartiennent, à certains moments, sur certains sujets, tout en restant en mesure, à d’autres moments, de s’associer de nouveau entre eux et de participer pleinement à ces groupes. On retrouve cette idée, sous une forme peut-être un peu moins élaborée mais cette fois placée explicitement sous l’égide du concept de rythme, dans le cours de Roland Barthes au Collège de France où il introduit la notion d’« idiorrythmie ». Un groupe ou une société idiorrythmique permet à chacun de trouver un rythme de vie propre, à distance du groupe autant que nécessaire, mais sans jamais tomber dans la marginalisation.
L’ « anarchie ordonnée » d’Evans-Pritchard et l’« idiorrythmie » de Barthes nous offrent ainsi deux manières, fondées sur des observations anthropologiques et historiques, de définir les qualités éthiques et politiques d’un rythme social. À nous aujourd’hui de prolonger théoriquement et pratiquement leurs intuitions.
Bibliographie indicative :

Dossier
Comment résister au grignotage et à l’envahissement de ce temps par les écrans ?

Article
Les chercheurs analysent l’évolution de nos loisirs, rappelant à quel point l’animation de temps non productifs pèse lourd dans la gestion d’enjeux collectifs.

Dossier
Comment agir pour ne plus seulement subir ce « quotidien » ?
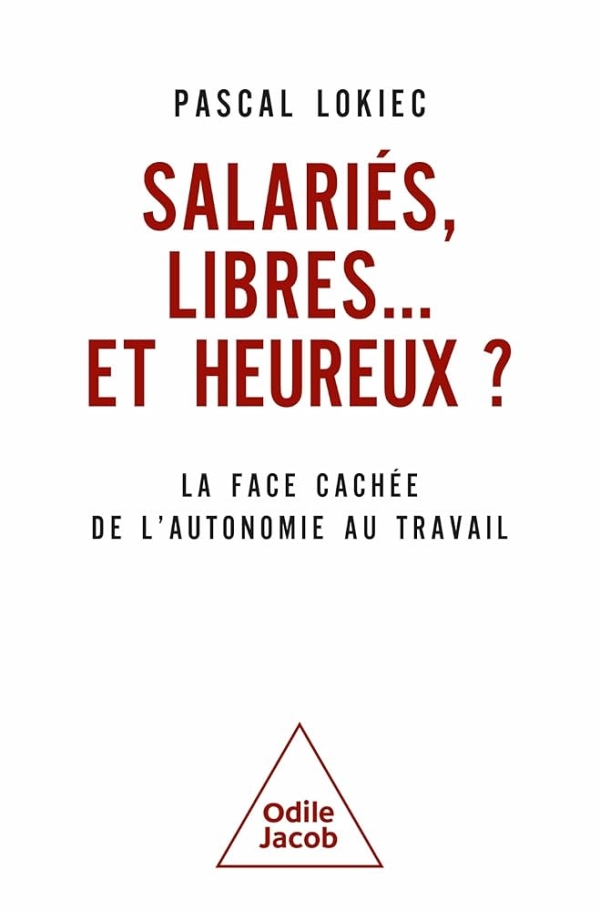
Article
Pascal Lokiec pose les termes d’un débat susceptible de concilier les intérêts de l’entreprise et le pouvoir d’agir des salariés.

Article
Au-delà de nos activités rémunérées, la situation ne peut-elle pas nous amener à envisager différemment un temps présenté comme « libre » ?

Article
Renverser le rapport au temps pour changer les rapports de force et les hiérarchies sociales ?

Article
Accélération, intensification, charge mentale, épuisement… Quand on évoque les rythmes de vie contemporains, ces mots ne sont en effet jamais très loin.

Article
Dans une perspective démocratique, la politique est-elle une « technique » réservée aux sachants ou un « art » ouvert à toutes et tous ?

Article
Avec "Tout noir" le secteur de la littérature jeunesse offre un aperçu des bagages culturels avec lesquels évolueront les citoyens de demain.