Histoire du service Arbres et Paysage au Grand Lyon

Interview de Frédéric Ségur
Responsable de l'Unité Arbres et Paysage
"La place et la fonction du végétal dans la stratégie de développement urbain me semblent encore à réévaluer"
Interview de Jérémy Camus

La recherche de la sécurité alimentaire est à la base de la structuration des premières cités.
Aujourd’hui, la question se pose à nouveau : des crises systémiques sont-elles susceptibles de nous confronter dans un futur proche à un risque de pénurie ?
Au-delà de l’approvisionnement, comment garantir à chacun le même accès à une nutrition de qualité ?
Dans un monde en plein bouleversement, et où le technosolutionnisme révèle ses limites face aux premiers effets du changement climatique, quelle place et quels soutiens apporter aux agriculteurs locaux, seuls capables de faire du Grand Lyon une Métropole nourricière ?
C’est à ces problématiques majeures que se confronte Jérémy Camus, vice-président chargé de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Prospective, en nous présentant la stratégie alimentaire de la Métropole de Lyon.
Pouvez-vous nous présenter les bases de la stratégie alimentaire que vous portez pour le Grand Lyon ?
L’alimentation est un sujet majeur pour la majorité : en termes de budget, c'est 12 millions d’euros, soit quatre fois plus que par rapport au précédent mandat. On met les moyens pour organiser des filières, avec plus de bio et plus de local. Tout d’abord, nous nous appuyons sur un Projet Alimentaire Territorial, labellisé par l'État juste avant l'été. Il nous permet d'avoir une stratégie alimentaire opérationnelle. On n’est donc plus dans le diagnostic : on rentre dans le faire.
Ce « Patly » repose sur deux grands piliers, dont le premier est l’amélioration de la lutte contre les précarités alimentaires. Le grand chiffre à retenir, c’est qu’un quart de la population métropolitaine interrogée déclare ne pas se nourrir à sa faim. Un tiers des ménages déclare ne pas avoir les moyens de se nourrir correctement. Il y a donc un vrai enjeu autour de la justice alimentaire et de la lutte contre la précarité.
Le deuxième pilier, c’est l’amélioration de la résilience alimentaire de notre territoire. Notre autonomie alimentaire, sur la Métropole de Lyon, s’élève à seulement 5%. 95 % de ce qui est consommé aujourd'hui par les habitantes et les habitants provient de plus de 50 kilomètres au-delà de notre agglomération.
Concrètement, il y a neuf repas qui séparent l'humanité du chaos. En cas de rupture d’approvisionnement, neuf repas, ce sont trois jours d'autonomie. Passés ces trois jours, on a une catastrophe qui pointe à l'horizon. Il y a donc un enjeu de résilience alimentaire. Dans ce but, on doit augmenter notre part de production locale destinée à nos habitants, pour que notre territoire devienne nourricier. Nous allons donc travailler « du champ à l'assiette », voire de la graine à l'assiette, en sanctuarisant le foncier agricole. Il faudra ensuite trouver des paysans pour les cultiver. Dans le Grand Lyon, 40 % de la population agricole a disparu en vingt ans, c’est incroyable !
Sur les exploitations actuelles, on a 62 % des agriculteurs métropolitains qui ont plus de 50 ans. Il faut donc aller chercher de nouveaux paysans. Aujourd'hui, quand ils viennent, ils n'ont pas accès au foncier, et souvent, ils n'ont pas les moyens d'investir dans le matériel nécessaire pour cultiver. Il faut donc les accompagner pour le foncier, le matériel, leur formation et le lancement de leur activité, d'où l'idée de créer au Grand Lyon un incubateur de paysans, qui accompagnera l’arrivée d’une nouvelle génération.
Quel est le risque concret que l'on prend en compte dans cette stratégie ?
Le risque de rupture d’approvisionnement, mis en lumière par la crise sanitaire. On se rend compte que le besoin primaire de se nourrir, le bas de la pyramide de Maslow, n’est pas assuré aujourd'hui de façon satisfaisante sur la Métropole.
Cela vient répondre aussi à un autre enjeu : dans un contexte mondial de plus en plus chaotique, l'attractivité d’un territoire passe par sa capacité à offrir à ses habitants de la résilience, c'est-à-dire de la sécurité, quel que soit le choc auquel il faut faire face. L'alimentation est l'une des fonctions de base comme respirer, boire de l'eau saine, etc.
Nous ne sommes pas du tout dans un esprit de repli, ou d’autarcie. En nous fixant pour objectif au début du mandat de passer de 5 % à 15 % d’autonomie alimentaire, on est très loin d'être à 100 %. Dans notre périmètre, il y a un certain nombre de produits, mais pas tout, donc évidemment qu’il y a des besoins d’importation. L'idée, c'est simplement d'augmenter notre autonomie, en particulier sur les produits de première nécessité.
On s'attend à ce que ce soit quasiment une stratégie régalienne, décidée au sommet de l’État. Comment expliquer ce phénomène de montée en puissance des collectivités territoriales sur ce type de problématique ?
Aujourd’hui, c’est une mission confiée à l’Europe. La Pac est faite pour soutenir l'agriculture, or elle soutient aujourd'hui un modèle qui n'est plus adapté aux enjeux actuels. Beaucoup de circuits longs sont développés à travers cette politique agricole, et pas forcément de circuits courts, de proximité. Il n’est pas non plus adapté aux enjeux liés à la santé environnementale, à l'alimentation et à la restauration collectives, ou encore à la promotion de l’agriculture biologique.
À l’échelle de l'État, la loi EGalim impose désormais un pourcentage de bio dans les cantines et de nourriture de qualité. Malheureusement, pour atteindre ces objectifs, il faut y mettre les moyens. Certaines associations environnementales, par exemple, ont chiffré à environ 330 millions d'euros annuels le budget pour atteindre les objectifs de qualité dans les assiettes de nos enfants dans les restaurants scolaires. Aujourd'hui, l'État a mis environ 50 millions d’euros sur deux ans. On est donc loin du compte. On peut se dire que c’est à la Pac, l'Europe et l'État de s’en occuper, mais comme les objectifs ne vont pas être atteints, il faut que la collectivité s'y mette.
On représente une très faible surface agricole, mais à notre niveau, on agit pour atteindre ces objectifs. Par exemple, on va mettre un million d'euros sur un plan bio, pour aller aider à la conversion en bio et aider à l'installation d'agriculteurs en bio sur la Métropole.
Ces soutiens qu'on apporte aux producteurs, notamment financiers, peuvent-ils constituer une marge de manœuvre pour influer sur la complémentarité des cultures ?
Oui. C'est du temps long l'agriculture, donc ce n'est pas en deux ou trois ans que l'on va modifier un modèle. En revanche, sur ce mandat, l’objectif est vraiment de cranter sur une filière qui semble être la plus tendue en termes d'approvisionnement : le maraîchage, les légumes. Il n’y a pas que la production, on devra développer d'autres formes de filières, en particulier sur de la céréale. Aujourd'hui, une grande partie de la production céréalière est destinée à l'exportation hors de notre bassin nourricier, donc il faut la recapter.
On doit aussi réfléchir aux entités de transformation, qui manquent sur ce territoire. Par exemple, on cultive des légumes à proximité, qui sont envoyés près de Grenoble pour être lavés et épluchés, avant de revenir pour être cuisinés dans nos restaurants scolaires. On parle là d’une légumerie, pas d’un outil industriel complexe, mais il manque ce type d'outils. Justement, on est en train de soutenir un projet avec un territoire voisin, à Brignais, d’une légumerie qui s'appelle Rhône-Saône Légumes. Nous soutenons un projet qui va être fait en dehors de la Métropole parce qu’il y a un manque. Pour sécuriser notre production, des appareils artisanaux, comme des casseries d’œufs ou des outils de conserverie, font encore cruellement défaut.
Pour parvenir à une telle transition, a-t-on besoin d’innovations techniques ?
Aujourd'hui, il y a encore un immense potentiel pour faire de l'agriculture paysanne. La Métropole compte pas moins que plus de 10 000 ha de terres agricoles. Ce n’est pas de l’agriculture tech, mais de l’agriculture paysanne.
La volonté de la Métropole, en tout cas sur ce mandat, est déjà d'optimiser l'agriculture pleine terre paysanne, le plus low tech possible. Low tech ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire des investissements. Mais être résilient, c’est être le moins dépendant possible des technologies les plus exigeantes. Des serres mécanisées, c’est très utile, on incline les panneaux solaires en fonction de l’orientation du soleil. Mais le mécanisé, ça tombe en panne, ça coûte cher, on n’a potentiellement pas les pièces de rechange, et on retombe dans un modèle agricole qui, à force de miser sur de la technologie, a enfermé des agriculteurs dans l’endettement. Il y a donc la nécessité d'aller aussi vers des solutions qui sont un peu plus low tech que de l'innovation à tout prix. La posture aujourd'hui est de dire : « Misons déjà sur l'agriculture et la paysannerie. Redonnons aussi du sens à ce métier qui n'est pas que d'être un technicien, c’est être aussi un nourricier ».
Est-ce qu'on peut espérer de réels bénéfices en matière d'emploi et de niveau de vie des agriculteurs qui sont visés ?
Clairement, c'est de l'emploi, et en plus non délocalisable. C’est très stratégique, en matière de développement économique. Ensuite, c'est de l'emploi qui, aujourd'hui, est sous-valorisé. Quand quelqu'un dit : « Je vais être agriculteur. », c'est un vrai engagement. C'est quand même une profession où l’on mesure l’un des taux de suicide le plus élevé. C’était un modèle qui a amené ça.
Nous avons pris acte de ces problématiques. L’idée n’est pas de continuer comme avant, mais de proposer un modèle plus vertueux. En particulier sur l’emploi, on va développer d’autres formes d’activités agricoles, qui ne sont pas uniquement le modèle de l'entrepreneuriat individuel, l'agriculteur seul sur son tracteur avec toutes les dettes sur le dos et la difficulté à s'en sortir.
Il s’agit de voir comment on peut organiser une agriculture plus coopérative, plus collective, sur laquelle on partage du risque, et dans laquelle la collectivité prend sa part. Aujourd’hui, financièrement, ce n'est pas choquant de voir une collectivité appuyer fortement des start-ups du numérique, donc ça ne me choque pas de dire que la collectivité doit aller accompagner aussi fortement les paysans.
Est-ce que vous percevez des attentes dans ce sens du côté des consommateurs ?
Oui ! Il y a un terreau fertile. Le besoin de consommer en bio est revendiqué. Il s’exprime même dans les supermarchés. Là où quelque chose doit encore mûrir, c'est la responsabilité autour de la consommation. À travers mon panier, je suis responsable du développement de cette agriculture paysanne et responsable. On doit amener cette notion-là dans la population, pour dire : « À travers votre alimentation, vous êtes aussi des citoyens. » Il y a aussi une reprise en compte de cette relation de proximité. Le bio, c’est bien, mais c’est encore mieux quand c’est local.
C'est de la responsabilité de la collectivité de s'emparer de ce sujet, et de faire de la pédagogie. On a un dispositif qui s'appelle Famille alimentation positive, et un autre destiné aux collèges, qui s’adressent à des personnes encore loin de ces préoccupations, soit parce qu'elles sont dans une précarité extrême et qu’elles ont d'autres urgences, soit parce qu'elles n'ont pas été acculturées à ces enjeux.
On agit à plusieurs niveaux. Il y a l'action à la source : arriver à faire qu’existe, sur la Métropole, une production saine, biologique et locale. Il y a une nécessité d'activer les filières. On a donc la chance d'avoir une belle commande publique. C’est tout l'objet du SPAR – Schéma de promotion des achats responsables. On a 80 collèges à nourrir, soit 25 000 assiettes tous les jours. On a 59 communes et chacune a son groupe scolaire. Ce sont des milliers de repas aussi qui sont à produire. On a là un vrai effet de levier pour proposer des débouchés à ces nouveaux paysans.
En envisageant une coopération, ou même un soutien direct à des producteurs extérieurs au territoire, on est vraiment dans une nouvelle approche du périmètre d’action que s’accorde une collectivité.
C’est vrai. La métropole fait 54 000 hectares. Comme je le disais plus tôt, il y a quand même 20 % de sa superficie qui est encore en espace agricole, mais il n'empêche qu'on ne va pas nourrir 1,4 million d’habitants avec les surfaces disponibles, même si on les optimisait à 100 %. Cela veut donc dire qu'il y a besoin d’une autre posture, sur cet enjeu agricole comme sur d’autres. La Métropole ne peut plus être dans ce côté « attractivité et aspiration » de tout son environnement extérieur. L’heure est plutôt à la coopération !
On a cette chance d'être entouré d'un bassin rural très riche. Pourtant, alors qu’on a 1,4 million de ventres à nourrir, la métropole représente finalement un tout petit débouché pour ces productions. Pour un producteur, une grande partie de sa valeur ajoutée part souvent dans la logistique et dans les intermédiaires. Il y a aussi à renouer un contact de réciprocité entre des consommateurs, ces 1,4 million habitants, et des territoires ruraux qui ont la capacité de les nourrir.
Il s’agit donc d’encourager les consommateurs à s’inscrire pleinement dans des circuits courts ?
Je ne pense pas qu’un client va faire cinquante kilomètres pour aller s’approvisionner, même si c’est arrivé pendant la crise sanitaire. On a eu ces mouvements un peu pendulaires. Si c’est un restaurateur, il pourra aller directement acheter ses produits. Il y a quelques restaurateurs particulièrement vertueux, sur la métropole, comme l’étoile verte du guide Michelin, Christian Têtedoie. Il s'approvisionne uniquement en produits locaux, en particulier à Collonges-au-Mont-d’Or.
Pour le client, le circuit court est bien, mais le circuit de proximité est encore mieux. Une relation directe producteur/consommateur a sa raison d'être, mais il y a encore beaucoup de gens qui n'ont ni l'envie ni les moyens de la développer. Il faut donc trouver des intermédiaires de proximité, et rendre accessibles ces produits. Un nombre impressionnant d'acteurs sont déjà dans ce mouvement-là, notamment à travers les épiceries sociales et solidaires, en particulier le réseau du Gesra. On a également d'autres épiceries qui n'ont pas un caractère solidaire, mais qui vont chercher de la production locale. Les grandes et moyennes surfaces contribuent aussi à ça en mettant dans les rayons de plus en plus de produits locaux. Elles en font largement la promotion dans leurs supermarchés, parce qu’elles ont bien compris qu’il y avait une attente des clients.
Ensuite, on doit approfondir des relations entre collectivités. Il y a un vrai défi de changer de paradigme, de ne plus être la Métropole ogre, et d'être beaucoup plus en lien avec les territoires voisins. On commence à initier le mouvement à travers l'Agence d'urbanisme. Il y a déjà une interconnaissance entre ces collectivités. Demain, l'enjeu est de créer des pactes de réciprocité entre territoires, qui permettront aussi d'aller garantir à nos partenaires une capacité à développer leur propre agriculture pour du local.
En enjambant le découpage administratif pour intervenir dans un périmètre plus large, plus fonctionnel et stratégique, qui s'appuie à la fois sur des ressources naturelles et des circuits de production, est-ce qu'on peut commencer à dire que par le bas, la Métropole initie les bases de ce que l’on peut appeler une « biorégion » ?
Ce sont plutôt des périmètres qui s'adaptent en fonction des enjeux. Sur l’enjeu mobilité, ça va être le Sytral qui va déjà se dimensionner à l'échelle du Rhône, par exemple, et qui pourrait demain couvrir des territoires qu’il serait stratégiquement intéressant d'intégrer dans une problématique de mobilité.
On peut imaginer des espaces de coopération très thématisés par le bas. On prend un sujet et on voit comment on le travaille, plutôt que de penser encore à ajouter une couche au millefeuille, en disant qu’on va essayer de mettre toutes les thématiques dans un même périmètre. C'est ça l'innovation, parce que ça vient aussi croiser des enjeux de pouvoirs, des enjeux politiques, de périmètres administratifs, de compétences étatiques, etc. C'est complexe. J'ai l'impression qu'en prenant le sujet par une thématique, on évite d'aller tout de suite dans l'usine à gaz qui freine l’opérationnel.
Il s’agit donc avant tout d’inventer un nouveau circuit logistique ?
Complètement, c’est une autre façon de penser les flux. On est vraiment dans quelque chose qui impacte l'ensemble des compétences de la Métropole. Au niveau de cette gestion des déplacements, on a jusqu'à présent été surtout axé sur la fluidité du travailleur avec une voiture individuelle. Là, on revient à des fondamentaux.
Dans le modèle alimentaire d'aujourd'hui, rien n’a été fait pour privilégier ces circuits courts. Le circuit long est très bien organisé. Il a sa logique, son économie et son modèle, mais sur l'alimentation de proximité, en lien direct avec les producteurs, il n'y a pas d'exemple gérant autant de volumes.
Arriver à avoir de la logistique qui vient chercher, ou qui propose un service aux producteurs pour amener l'alimentation en cœur de cité, là où ça mange, c’est un vrai enjeu. On peut heureusement compter sur des acteurs qui se sont mis en mouvement, en particulier de petites structures qui se débrouillent par leurs propres moyens. Elles se disent : « On fait la même chose, on va chercher les mêmes produits. Comment, en mutualisant notre projet, peut-on arriver à faire un truc plus efficace ? »
De plus, ce qui est intéressant pour une collectivité comme la nôtre, c’est de gérer une autre compétence transversale : le social. En l'occurrence, ce sont ces acteurs de la précarité alimentaire qui, en allant chercher de l'accessibilité à leurs produits, voient que là où il y a une grande marge de progression, c'est sur la logistique. Nous devons mutualiser les flux pour permettre à ces acteurs de l'accessibilité alimentaire de proposer un schéma. Ce sont peut-être eux qui vont inventer le système que l’on pourra tous utiliser demain.
Comment à la fois accompagner l’émergence de ces nouveaux réseaux, et poser la contrainte de limitation des émissions polluantes liées au transport ?
Comme on le disait tout à l'heure, 95 % de ce qui est consommé par les habitants vient de plus de 50 kilomètres. Il nous faut 1,2 million de tonnes d’équivalent CO2 pour se nourrir. Il faut déjà limiter cet équivalent CO2 en s'alimentant à travers moins de déplacements.
Cela vient croiser une autre notion, qui est la ZFE, zone à faibles émissions. On doit l'anticiper pour l'approvisionnement alimentaire. L'alimentation de proximité vient amener des solutions pour limiter le CO2 et l'arrivée en zone ZFE de véhicules qui ne sont pas appropriés. Comment développer une logistique qui s'articule sur de nouveaux points de départ et de nouveaux points d'arrivée, tout en faisant avec les modes de mobilité actuels ? On ne peut pas le faire. Le dernier kilomètre, son intérêt, ce n'est pas tant la distance, c'est le mode de véhicule et de logistique qu'on utilise. L'enjeu est surtout de décarboner ce dernier kilomètre. Par exemple, comment utiliser les aménagements qui sont faits aujourd'hui sur de la cyclabilité ? Ils sont aussi faits pour demain. Les vélos-cargo peuvent approvisionner les deux derniers kilomètres, tant qu’on est sur de petites quantités.
Par rapport à cette tendance relative d'exode des urbains vers la ruralité, est-ce qu'on aurait aussi une possibilité, peut-être liée à la question de l'agriculture urbaine, de ramener un peu de cette ruralité à l'intérieur de la ville ?
On l’a fait avec le 8ème Cèdre. Grand Lyon Habitat a donné 500 mètres de terres non exploitées à un maraîcher urbain qui a décidé de venir. Il cultive ses 500 mètres carrés avec une petite cabane de jardin et vend directement ses légumes à la résidence Grand Lyon Habitat en pied d'immeuble, dans le quartier États-Unis.
Il y a d'autres exemples d’optimisation de foncier existant. D'ailleurs, on va faire une modification dans le Plan local d'urbanisme. Pour le fameux maraîcher, on était bloqués administrativement pour avoir une mini-serre et un bâtiment en bois, une cabane de jardin pour pouvoir cultiver en pied d'immeuble. C'est une toute petite modification du PLU, ce n’est rien, mais en soi, on dépasse les fondements symboliques d’une ville perçue comme essentiellement minérale.
Sur cette idée de nature en ville, on n'est habituellement plus sur l'espace vert qui améliore le cadre de vie. Est-ce qu’on entre dans une approche nouvelle, avec un retour de la nature qui peut être aussi un élément productif ?
J’aime bien la notion de rentabilité immédiate en termes de proposition de valeur pour les habitants. Je n’ai pas fait d’enquête, mais si vous leur donnez le choix entre un espace vert tondu comme un gazon, et un espace végétalisé avec des arbres et des fruits ou des légumes, dans lesquels ils peuvent même aller se servir, il y a une proposition intéressante. On voit le nombre impressionnant de jardins partagés, de jardins de bas d'immeuble collectifs qui émergent. Le développement des jardins partagés, c’est 1,5 million d’euros de budget à la Métropole, et les bailleurs sociaux ou d’autres promoteurs immobiliers ont bien compris l’approche. Je pense qu’on a dépassé le côté ancien du simple parc. Il y a quelque chose qui naît autour du nourricier, et même du caractère peut-être plus brut de l'aspect naturel.
Dans le changement de pratiques liées à l’alimentation que vous décrivez, il y a forcément un changement d'emploi du temps. On consacre beaucoup plus de temps à préparer le repas. On change presque de mode de vie non ?
L’idée est de donner une valeur à l'alimentation, et pas uniquement parce que c'est quelque chose de très français, la culture gastronomique, la sociabilité, etc. C'est aussi parce que ça a un intérêt sanitaire. Et là, il n'y a pas de « sectarisme ». N'importe qui, aujourd'hui, s’intéresse à la cuisine. Ce serait intéressant de faire des enquêtes sur la typologie de personnes qui regarde les émissions culinaires par exemple. C’est grand public. Il y a une attention sur l'alimentation qui n'est pas que « gastronomique ». Il faut l'aspect gourmandise, sinon on n'y arrive pas, mais en tous cas, il y a aussi une attention à manger bon et sain. Les deux ne sont pas opposés.
Qu’est-ce que c’est alors, pour vous, un « bon produit » en 2021 ?
Première chose : un bon produit, c’est un produit qui a du goût. On ne mange pas que pour survivre, il faut que ce soit un plaisir. Par contre on peut avoir des choses délicieuses mais très industrielles, ultra-transformées, qui ne sont pas du tout de « bons produits ». L’aliment doit subir le minimum d’ajouts, chimiques et autres. Sa culture doit être la plus proche possible de notre cuisine. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un potager, donc c’est là tout le défi. Pourquoi proche de chez nous ? Parce que l’impact sur le climat est moindre quand on évite d’importer des marchandises de l’autre bout de la planète, mais aussi pour des questions de saisonnalité. Le local respecte le rythme de la nature, et ça nous encourage à avoir une alimentation diversifiée. Il faut aussi que ces produits soient issus de techniques qui n’entraînent pas la pollution des sols ou des nappes phréatiques. Et enfin, je dirais qu’un « bon produit » rémunère bien ceux qui les « produisent ». On doit arriver à ce que les paysans vivent dignement de leur activité, et pas simplement qu’ils en soient fiers.
Vous évoquez les produits « ultra-transformés ». Que répondre au parent isolé qui vous dit : « Moi, je reviens du travail à 21 heures, j'ai trois enfants, ils sont surexcités parce que je n'ai pas de quoi me payer un mode de garde. Quand j'arrive, je mets une moussaka congelée au four. C'est bien beau, ce que vous dites, mais ça ne me concernera jamais. »
Le dispositif Famille alimentation positive, que j’aimerais renforcer ces prochaines années, répond justement à ces problématiques, sans culpabiliser personne. Moi-même, je le fais pour mes enfants.
Il s’agit de montrer que justement, ce n'est pas impossible, y compris pour des populations qui sont les plus éloignées en termes financiers de ce type de pratiques, même si ce n’est pas tous les jours. Non seulement c'est accessible financièrement, mais si vous prenez le temps, vous allez prendre du plaisir et vous protéger votre santé, ainsi que celle de vos enfants.
On peut imaginer à long terme que ce soit un domaine pédagogique comme un autre, qui s’enseigne à l’école ?
C’est déjà un peu le cas à travers ce que l'on donne aux enfants à la cantine. On a un potentiel, là, déjà rien que par l’assiette, de dire sans grands discours : « Voilà ce qu'on vous donne. Qu’est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça change par rapport à la moussaka congelée ? »
Il y a déjà un effet de levier : l'enfant revient dans son foyer et potentiellement, il dit s'il a aimé ou non. Finalement, c’est un peu comme quand vous allez faire vos courses avec vos enfants dans un supermarché, c’est souvent l’enfant qui va orienter l'achat. C'est le premier point sur lequel on peut agir.
L'autre chose, c'est de continuer ce mode d'éducation au goût et au rôle de l'alimentation. C'est vraiment ce que je vais installer en premier à la Cité internationale de la gastronomie. Elle doit se mette à hauteur d'enfants et proposer aux groupes scolaires, et pas uniquement scolaires, des ateliers dans lesquels on va joindre le goût, la gourmandise, et une sensibilisation à l'alimentation durable.
Pour finir, pouvez-vous justement nous présenter ce projet de refonte de la Cité de la gastronomie ?
La nouvelle Cité internationale de la gastronomie est une belle opportunité d'incarner cette feuille de route que j'ai essayé de décrire. On veut faire un pas de côté par rapport à la dimension très muséale qui avait été imaginée par le passé, avec d'ailleurs un échec, même au niveau de la scénographie qui avait été proposée, ce n'est ni un tabou ni un secret. Il s’agit de remettre de la vie dans cette Cité, de la faire revivre et de la mettre au service de ses habitantes et habitants, en particulier des enfants.
La collectivité va y prendre sa part, en consacrant un budget à faire vivre cette Cité. D’ailleurs, au niveau de l’attractivité, je pense que l'offre sera tellement intéressante qu’elle aura, de toute façon, un impact touristique.
Elle sera également au service de ces acteurs de la filière, ce qui n’avait pas du tout imaginé au départ. Tout un espace de la Cité on va être réservé à cette dynamique. Pour la mettre en œuvre, on a créé un comité Rabelais, d’une trentaine de personnes dont cinq chefs, tels que Christian Têtedoie, Régis Marcon, Joseph Viola pour représenter les toques blanches, mais aussi de nouveaux talents, comme Nour Milan, qui est une jeune cheffe passée par le restaurant Saisons de l'Institut Paul Bocuse. D’autres membres viennent de la justice alimentaire, la présidente du Gesra, l'épicerie sociale et solidaire, le fondateur de Vrac. On a des gens qui viennent de la nutrition-santé avec Philippe Sans, du Biopôle, des chercheurs, des représentants du monde agricole avec des producteurs locaux, et l’Ardab, qui font de la production bio.
C’est une vraiment belle aventure qui démarre, avec des ambitions ne visent en fait qu’à nous hisser à la hauteur des attentes du public.

Interview de Frédéric Ségur
Responsable de l'Unité Arbres et Paysage
"La place et la fonction du végétal dans la stratégie de développement urbain me semblent encore à réévaluer"

Article
Cette infographie vous éclaire sur les micropolluants, leur diffusion et leurs impacts, ainsi que sur les moyens d’action déployés par la Métropole de Lyon pour limiter leur propagation.

Interview de Anne-Marie Laurent
De la Direction Environnement du Département du Rhône à celle de la Métropole de Lyon
Retour sur une carrière marquée par l’émergence des enjeux de développement durable.

Interview de Lucie Vacher
VP de la Métropole de Lyon Enfance, Famille et Jeunesse
En conclusion de notre cycle de veille prospective, entretien avec Lucie Vacher, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l’Enfance, la Famille et la Jeunesse.

Interview de Équipe Notus et ferme FUL
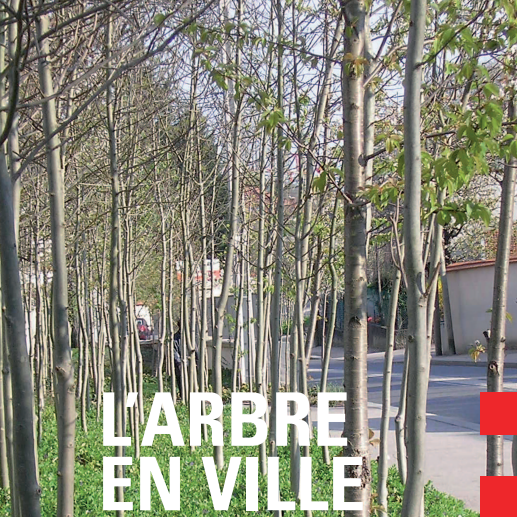
Interview de Claude Pillonel
Vice-président à l'écologie urbaine à la Communauté Urbaine de Lyon
"A l’époque où le réseau Eurocités s’est créé , j’ai été le premier président de la Commission Environnement".
Texte de Caroline RICHEMONT

Article
Pour saisir ce que la présence du moustique révèle de nos manières de vivre et de gouverner le vivant, il est utile de se tourner vers les sciences sociales.