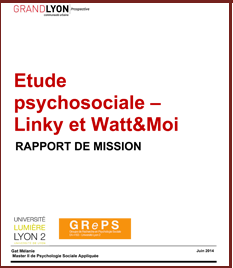Ces mesures se justifient, car c’est souvent l’un des objectifs d’une politique publique que de proposer une bonne qualité de service pour les bénéficiaires, et qu’à l’inverse une mauvaise qualité de service est une source d’inefficience. Dans les politiques sociales, c’est un facteur de non-recours aux droits par exemple.
En revanche elles n’aident pas vraiment à caler une politique. Nous n’apprenons pas grand-chose quand les allocataires du RSA qui sortent du dispositif se déclarent, en général, très satisfaits sur tous les aspects mesurés, alors que ceux qui tournent en rond se disent insatisfaits. La satisfaction des bénéficiaires n’est pas l’objectif premier d’une politique, dont le succès dépend de beaucoup d’autres paramètres. Dans les politiques sociales on recherche surtout à faire évoluer les parcours. De ce fait, la mesure de la satisfaction ne saurait être une composante essentielle du pilotage des politiques sociales. Et il ne faudrait pas réduire la participation des usagers à la mesure de leur satisfaction, ils peuvent aussi avoir un positionnement sur les politiques à mettre en place, pas seulement en fonction de leur intérêt individuel, mais de l’intérêt collectif, ou de ce qu’ils peuvent appréhender dans leur environnement. Je vois enfin un risque : comme on publie la qualité de service, avec une exigence de bons résultats ou d’amélioration des résultats, le risque est qu’une priorité soit donnée à la réalisation de ces indicateurs, au détriment d’autres objectifs de la politique qui sont à moyen ou long terme beaucoup plus importants.
Quitte à faire des enquêtes de satisfaction, autant en profiter pour les assortir d’autres mesures, sur les parcours, les motivations, afin d’obtenir de multiples enseignements qui ne seront pas forcément publiés, comme l’Insee qui adosse d’autres enquêtes à son recensement. Et d’aller bien plus loin dans l’analyse de la satisfaction, car des outils puissants sont à disposition. Avec la modélisation statistique on mesure l’impact de différents items sur la satisfaction globale. Les cartes de satisfaction indiquent ce sur quoi il faut travailler en priorité (items situés dans le cadran « fort impact sur la satisfaction globale / fort niveau d’insatisfaction » notamment).