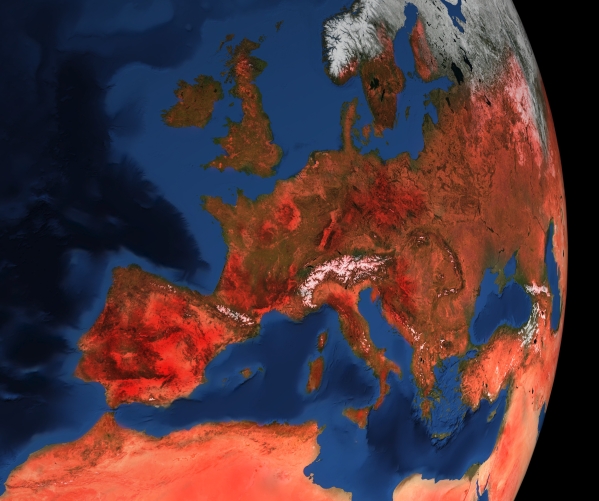Chronologie lyonnaise
Système de soins et politique publique
Antiquité : Parmi les nombreuses légendes sur les origines de la médecine à Lyon, l'une affirme qu'une Académie a été fondée dans une île au confluent de la Saône et du Rhône par des Grecs; une autre suggère que Saint Paul et Saint Luc sont venus exercer la médecine dans la région lyonnaise lors de leur évangélisation.
Il est avéré que Lugdunum comptait un certain nombre de praticiens de la santé (les "medicus").
177 : Martyre de Saint Alexandre, l'un des plus anciens médecins de Lyon.
542 : Fondation à Lyon par Childebert Ier du premier hôpital français, "Notre-Dame-de-Lyon" sur la rive droite de la Saône (l'hôpital disparaîtra au XVème siècle).
583 : Suite à des épidémies de peste (notamment en 571), institution de "léproseries" par le Concile de Lyon.
XIIe et XIIIème siècles (1129-1246) : En lien avec l'essor démographique lyonnais, création de nombreux hôpitaux qui sont des maisons particulières transformées en asiles pour les miséreux, pèlerins, voyageurs pauvres. Ces hôpitaux ont un personnel réduit (quelques religieux et domestiques). Ils sont placés sous la tutelle de l'Archevêque, puis des Consuls (ou Echevins) de la Ville au 15ème siècle, puis des Recteurs (notables de la ville) de 1533 jusqu'à la Révolution Française.
Ces hôpitaux sont : l'Aumonerie du Saint-Esprit (1129) située au Port du Rhône d'où partait le bac reliant la ville à la route du Dauphiné; les Frères Pontifes, membres de cette confrérie, conçurent le projet de relier les deux rives du Rhône par un pont (1184), d'où le nom d'Aumônerie du Saint-Esprit-du Pont-du Rhône qui deviendra plusieurs siècles plus tard l'Hôtel-Dieu; la léproserie de la Madeleine (1146); enfin, les hôpitaux du Temple (1176?), de Saint-André-de-la-Contracterie (1210), de Saint-Just (1225) et de Saint-Antoine (1246).
Lyon diffuse les maladies apportées par les déplacements des militaires, des marchands, le blanchissage du linge et la mise en nourrice des enfants. Inversement, elle accueille dans ses hôpitaux les malades des campagnes.
Première moitié du 16ème siècle : Pour secourir la misère, la vieillesse, limiter la mendicité, dans un contexte de fort accroissement démographique, création de nouvelles structures hospitalières : l'Hôtel-Dieu ou Grand Hôtel-Dieu du Pont du Rhône (1523), issu de deux asiles édifiés près du pont du Rhône. On lui adjoint des constructions nouvelles, on y organise un service de santé. L'institution des "soeurs hospitalières" donnent à l'Hôtel-Dieu une importance croissance à compter de la fin du 16ème siècle.1531 : Création de l'Aumône Générale.
1532-34 : François Rabelais est médecin à l'Hôtel-Dieu.
1545 : Michel Nostradamus est médecin à Lyon.
1636 : Ouverture de l'hôpital de la Charité (appelé aussi de l'Aumône Générale) grâce aux dons des notables lyonnais, du Consulat et des corporations (il sera détruit en 1934). La Charité recevait les mendiants de la ville, adoptait les orphelins et secourait les vieillards.
1744 : Découverte des eaux thermales de Charbonnières.
1796 : Création des Hospices Civils de Lyon (HCL) par la réunion de l'Hôpital de la Charité et de l'Hôtel-Dieu. Leur gestion est confiée à un Conseil Général d'Administration. Les HCL constituent jusqu'en 1974 une exception dans la législation hospitalière. Ils prennent un essor considérable grâce à leurs propres ressources, notamment leurs biens immobiliers dont la valeur est considérable et les afflux des libéralités.
Années 1830-1861 : Ouverture successive de l'hospice des vieillards de la Guillotière, de l'hospice du Perron pour les incurables (aujourd'hui Jules Courmont), de l'hôpital Desgenette, de Sainte-Eugénie, de l'hôpital de la Croix-Rousse en 1861. Ces structures dépendent des Hospices Civils de Lyon (HCL) ou seront rapidement placés sous son administration (hospice de la Guillotière). Cette période est aussi celle des agrandisements (Hôtel-Dieu).
A tous ces hôpitaux sont affectés des soeurs dont l'effectif global atteint 450 en 1850, 900 en 1900, et près de 1000 jusqu'en 1940. Leur nombre baissera ensuite à 600 en 1950 et 250 en 1980.
1875 : Ouverture de l'asile d'aliénés de Bron qui préfigure l'hôpital psychiatrique départemental du Vinatier.
1876 : Création d'importants services généraux aux Hospices Civils de Lyon (HCL) qui leur donnent une indépendance accrue (boucherie, abattoirs, buanderie, moulins à farine, boulangerie, pharmacie...). Ces services perdurent jusqu'en 1929. Les HCL forment une collectivité de plus de 1000 personnes. Les religieuses assurent directement les soins.
1909-1933 : Devant l'augmentation de la population lyonnaise (450 000 habitants environ en 1900) et l'insuffisance du nombre de lits, ouverture de nouveaux hôpitaux : inauguration de l'hôpital Debrousse (1909), puis de la maison de repos du Val d'Azergues, de hôpital des Charpennes, et enfin de Hôpital Edouard Herriot à Grange-Blanche (1933).
Professionnalisation du personnel religieux, et part grandissante du personnel non-religieux dans les établissements qui devient majoritaire à partir de 1950.
1933 : Ouverture de l'hôpital Hedouard Herriot à Grange Blanche (et démolition une année plus tard de celui de la la Charité). L'hôpital est une sorte de "cité jardin", avec ses 24 pavillons installés dans la verdure et reliés par des souterrains. L'hôpital est pavillonnaire, pour des raisons d'hygiène et de lutte contre la contagion, avec des édifices détachés les uns des autres. Il est au coeur du plus vaste quartier d'Europe consacré à la santé, avec les facultés de Médecine et de Pharmacie (partiellement financées par Rockfeller en 1930), l'école d'infirmière, puis les nouveaux établissements qui y prendront place dans les années 60 et 70 (hôpitaux neurologique et cardiologique, Centre International de Recherche contre le Cancer).
1957 : Ouverture du centre anticancéreux Léon Bérard.
1962 : Ouverture de l'hôpital neurologique Pierre Wertheimer à Bron.
1967 : Ouverture de l'hôpital cardiologique Louis Pradel.
1974 : Inauguration de la clinique du Tonkin à Villeurbanne.
1992 (février) : Le conseil d'administration des Hospices Civils de Lyon (HCL) arrête le principe du regroupement des activités cliniques de court séjour au sein de 3 pôles localisé à l'Est, au Nord et au Sud de l'agglomération lyonnaise, à partir des services actuellement disséminés sur 17 sites, afin d'accroître leur performance et leur rentabilité.
Leur implantation doit prendre en compte les densités de population, les axes géographiques, les filières de soin. C'est le début du processus de restructuration des HCL, dont on parle à Lyon depuis 1986, dans un contexte d'absence de projet hospitalier depuis les années 70.
1994 (janvier) : Le plan de restructuration des Hospices Civils de Lyon (HCL) est initié par Michel Noir, avec le vote de la première partie du plan stratégique des HCL (plan 1994-1999).
La restructuration des HCL, qui sera reprise sous le mandat de Raymond Barre, est à la fois un projet médical et d'aménagement du territoire.
Le regroupement des HCL en trois grands pôles hospitaliers, ou "pôles renforcés" est précisé :
A l'est avec les hôpitaux neurologique et cardiologique, l'hôpital Edouard Herriot qui va être restructuré, et un futur hôpital mère-enfant;
Au nord avec l'hôpital de la Croix-Rousse qui regroupera l'ensemble des disciplines médicales de l'Antiquaille et de l'Hôtel Dieu, un service d'accueil d'urgence et des centres spécialisés sur les maladies infectieuses;
Au sud avec les hôpitaux Jules-Courmont et Sainte-Eugénie.
Alors que la santé ne relève ni du champ strict de compétence de la Ville (bien que le maire de Lyon soit traditionnellement le président du Conseil d'Administration des HCL) ni de celui de la Communauté urbaine, ces deux entités sont associées au plan de restructuration des HCL en raison des implications d'un tel projet sur l'aménagement du territoire (armature urbaine, transports en commun, voix rapides, reconversion des sites). Elles apportent 500 millions de francs pour accompagner cette restructuration.
1994-99 : Mise en place en 1994 du premier Schéma Régional d'Organisation Sanitaire (SROS). Le SROS entend imposer aux hôpitaux une coopération pour constituer des pôles sanitaires hiérarchisés selon 4 niveaux d'organisation, depuis le niveau de proximité jusqu'au niveau universitaire de référence. La restructuration des Hospices Civils de Lyon (HCL) entre dans le cadre du SROS.
1997 (automne) : Publication d'une "liste noire des hôpitaux" par la revue Science et Avenir. L'enquête souligne le non respect des normes pour l'anesthésie dans certains établissements de la région Rhône-Alpes (19 sur 141 services), et dans dix maternités qui dépassent un taux de césarienne de 20% (au dessus de 20% d'accouchements par césarienne, certains experts considèrent que les hôpitaux recourent trop souvent à cette méthode).
Une enquête est commandée à l'institut Ipsos puis publiée par Lyon mag. Elle montre que les Lyonnais sont satisfaits de la compétence des médecins et de la qualité du matériel médical, mais mettent en cause le déficit de personnels des établissements hospitaliers, l'état dégradé des bâtiments, le manque d'accueil et d'information des malades.
1997-98 : Les services d'accueil des urgences de l'agglomération lyonnaise sont régulièrement débordés. Ce phénomène s'accentue en raison de la diminution des lits de médecine et du vieillissement de la population.
On compte en moyenne 200 000 passages annuels aux urgences des Hospices Civils de Lyon (HCL) dont 132 000 pour le seul hôpital Edouard Herriot. En 1998, un passage sur 5 donnait lieu à hospitalisation.
1999 (mai) : Signature d'une convention entre l'Agence Régionale d'Hospitalisation (ARH) et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) en juillet 2000, dans le cadre de la convention nationale signée entre le Ministère de la culture et de la communication et le Secrétariat d'Etat à la santé, visant à développer le lien entre le monde de l'hôpital et celui de la culture. Expériences dans ce domaine menés depuis 1997 à La Ferme du Vinatier (hôpital psychiatrique).
1999-2004 (septembre) : Le Schéma Régional d'Organisation Sanitaire (SROS) Rhône-Alpes (1999-2004) ou SROS 2, qui fixe la politique hospitalière régionale pour les 5 ans à venir, est adopté en septembre 1999 par le Conseil Régional après de multiples péripéties et un débat marqué par de fortes divergences, notamment liées à la suppression prévue de 1427 lits dans les hôpitaux lyonnais.
Dans le cadre de son élaboration, une consultation des usagers a été faite. Ces derniers énoncent deux grandes priorités vis-à-vis de l'hôpital : l'humanisation de la prise en charge des patients et le maintien d'hôpitaux à proximité des lieux de vie.
Le SROS 2 s'appuie sur le bilan du premier SROS Rhône-Alpes pour poursuivre les actions entreprises. Ce bilan est relativement insatisfaisant : il montre la difficulté de la mise en réseau, le manque de coopération entre secteur public et privé, la réticence des grands établissements (des trois Centres Hospitaliers Universitaires, CHU) vis-à-vis des plus petits, l'absence d'implantation de bornes d'urgences.
Trois dysfonctionnements structurels sont retenus à l'issue du premier SROS :
- Le potentiel de soins de suite et de réadaptation est insuffisamment médicalisé et très déséquilibré géographiquement;
- le potentiel de médecine est trop cloisonné en subspécialités, ce qui ne permet pas de bien prendre en charge le malades admis en urgences et présentant des polypathologies;
- le vieillissement de la population est mal pris en compte, alors que l'on comptera de plus en plus de personnes âgées de plus de 85 ans sujettes à des polypathologies liées au vieillissement et à une perte progressive d'autonomie.
Chaque SROS répond aux spécificités sanitaire d'une région. Les priorités définies pour la région Rhône-Alpes sont les urgences, la gynéco-obstétrique, la cancérologie, les soins de suite et de réadapatation, la prise en charge des personnes âgées, l'alcoolisme et la toxicomanie. Il vise à la multiplication des systèmes mobiles, de veille permanente, de points d'écoute et d'orientation, et au développement de l'hospitalisation à domicile.
Fin des années 90 : Développement spectaculaire de la chirurgie de l’obésité. En France, on est passé de quelques dizaines d’interventions en 1995 à près de 10 000 en 1999. Lyon est devenue la capitale française de ce type de chirurgie.
2000 (automne) : Début du chantier de la future clinique Jean-Mermoz, hôpital privé neuf de 210 lits situé dans le 8ème arrondissement. L'architecture conçue par Hélène Jourda cherche à marier exigences techniques et convivialité.
De la même façon, le centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc se restructure avec la construction d'un nouvel hôpital polyvalent de 350 lits autour des maîtres-mots architecturaux de transparence et capacité à évoluer (la réalisation des façades est confiée à une plasticienne, Cécile Bart).
Le modèle de l'hôpital monobloc, importé après-guerre des Etats-Unis, est abandonné. Tendance au regroupement des services (pôles mère-enfant, coeur-poumon à Strasbourg, "tête" à la Salpêtrière-Paris) dans des hôpitaux dont l'architecture doit pouvoir évoluer en fonction des besoins. Préoccupation pour l'accueil des patients (facilité d'orientation, accessibilité) et pour une meilleure insertion de l'hôpital dans la ville. Les constructions neuves et les restructurations engendrent en France un marché estimé à 10 milliards de francs par an.