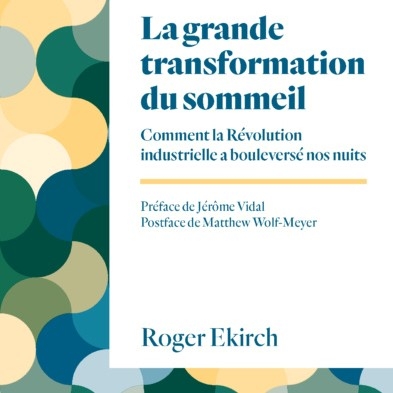Principes
Développée par Samuel Hahnemann (1755-1843), l’homéopathie fait appel à des préparations de substances aujourd’hui commercialisées en granules. C’est une méthode thérapeutique construite sur deux hypothèses. La première est la loi de similitude : « les semblables sont guéris par les semblables ». Ce principe affirme qu’une substance qui provoque un symptôme (par exemple, une migraine) chez des volontaires sains peut être utilisée à dose diluée et « dynamisée » pour traiter ce symptôme (la migraine) chez les individus qui en souffrent. Selon la seconde hypothèse, les remèdes homéopathiques deviennent actifs lorsqu’ils sont soumis à une « dynamisation », procédé décrivant une dilution fractionnée associée à une « succession », à savoir, une agitation vigoureuse du mélange. Une reconnaissance mitigée
L’évaluation de l’intérêt thérapeutique de l’homéopathie, souvent assimilée à un placebo, fait toujours débat. Reconnue comme une orientation médicale (et non une spécialité) par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, elle reste cependant qualifiée de « pratique médicale insuffisamment éprouvée » par l’Académie Nationale de Médecine. Elle n’en est pas moins inscrite à la pharmacopée française depuis 1965 et enseignée dans 8 facultés de médecine. Selon la DRESS , en 2005, il y avait 4526 médecins homéopathes et 1748 médecins à la fois acupuncteurs et homéopathes. En France, l’exercice de l’homéopathie est en principe réservé aux professions médicales. En pratique, de nombreux thérapeutes non-conventionnels y ont recours, et c’est l’un des médicaments les plus utilisés en automédication. Il existe peu de risques associés à ce type de traitements. Désengagement de l’Etat
Depuis 2004, le taux de remboursement des médicaments homéopathiques par la Sécurité Sociale est passé de 65 à 35%, la différence étant à la charge des mutuelles. Une décision gouvernementale qui interroge, au moins en termes économiques : le prix moyen des médicaments homéopathiques remboursables est 5 fois plus bas que celui des médicaments allopathiques . Les coûts annuels remboursés des médecins homéopathes (honoraires, prescriptions et arrêts de travail) sont 2 fois moindres que ceux des autres médecins généralistes . Enfin, 88% des patients traités par un médecin homéopathe ne consultent pas d’autres médecins pour la même maladie . L’enjeu économique d’une pleine intégration de l’homéopathie dans la nomenclature de la Sécurité Sociale ne vaudrait-il pas la peine d’une prise de position officielle de l’intérêt thérapeutique de cette médecine ? N’est-il pas dans l’intérêt collectif de mettre en place un système d’évaluation selon des critères satisfaisants pour tous ? A la clef, un pluralisme thérapeutique raisonné et une meilleure gestion des deniers affectés à la santé publique. Petite chronologie de l’homéopathie1 1790 : Le médecin allemand Samuel Hahnemann, fondateur de l’homéopathie, remarque que la prise de quinine chez un sujet sain peut lui déclencher un symptôme de fièvre. Il découvre ainsi les principes de l’homéopathie. 1796 : Il publie le résultat de ses travaux dans «Essai sur un nouveau principe » , Journal de pharmacologie pratique et de chirurgie. 1810 : Samuel Hahnemann publie « Orgagnon de l’art rationnel de guérir » . 1833 : La Société gallicane homéopathique, première société française d’homéopathie, est fondée à Lyon sous l’impulsion de Sébastien des Guidi. La fin du 19e siècle est marquée par les débuts de l’ère pastorienne et l’explosion des connaissances médicales. L’homéopathie perd du terrain et se trouve marginalisée. Il ne reste plus qu’une centaine d’homéopathes en France. 1905 : Le Dr Gallavardin, lyonnais, et le Dr Nebal, homéopathe suisse, lancent le Propagateur de l’Homéopathie, journal mensuel. 1910 : La revue connaît un grand succès. Elle devient un lieu de débat entre les différentes écoles de pratique homéopathique : l’école strictement Hahnemanienne et celle du Dr Jousset de Paris. Dans la foulée, les Dr Gallavardin, Nebel et Duprat fondent la Société régionale d’Homéopathie du Sud-Est de la France et de la Suisse romande. C’est à Lyon que se tient la première réunion. 1911 : René Baudry, pharmacien, ouvre la Pharmacie Générale Homéopathique Française à Paris. 1912 : le Dr Léon Vannier, ami d’enfance de René Baudry, crée la revue L’homéopathie française, devenue aujourd’hui L’homéopathie européenne. 1926 : le Dr Vannier lance les Laboratoires Homéopathiques de France, toujours à Paris. 1930 : René Baudry rejoint le groupe des médecins homéopathes lyonnais et crée le Laboratoire Central Homéopathique Rhodanien, 38 rue Thomassin, Lyon 2e. Il engage Henri et Jean Boiron, jumeaux diplômés en pharmacie et docteurs ès sciences. 1932 : Henri et Jean Boiron montent le Laboratoire Central Homéopathique de France à Paris. Un an après, René Baudry et Henri Boiron assurent le développement du laboratoire parisien qui devient Les Laboratoires Homéopathiques modernes. Jean Boiron prend en charge le développement de l’entité lyonnaise qui devient la Pharmacie Homéopathique Rhodanienne. 1933 : Les médecins homéopathes créent le Syndicat national des médecins homéopathes français ( SNMHF ) . 1945 : En France, les médicaments homéopathiques sont remboursables par l’Assurance Maladie. 1948 : Le Journal officiel publie un arrêté codifiant, pour la première fois, la préparation des médicaments homéopathiques. 1965 : Une monographie « Préparations homéopathiques » est introduite à la Pharmacopée Française. 1967 : Les Laboratoires Homéopathiques Jean Boiron, Les Laboratoires Homéopathiques Henri Boiron et les Laboratoires Homéopathiques Modernes fusionnent et deviennent les Laboratoires Boiron. Le premier établissement de fabrication et de distribution régionale est ouvert à Toulouse en 1968. Les années 70 verront le développement national et international du groupe. 1974 : Les médecins qui pratiquent l’homéopathie en informent le Conseil départemental de l’Ordre des médecins, en mentionnant
« orientation homéopathique ».
1974 : Le siège social et l’unité de production de Boiron s’installent à Ste Foy-lès-Lyon. 1982 : 16% des Français déclarent avoir recours au moins occasionnellement à l’homéopathie. 1983 : Christian Boiron succède à Jean Boiron à la Présidence du groupe. 1985 : L’Institut Boiron est fondé pour promouvoir l’homéopathie, notamment au sein de la communauté médicale et scientifique internationale. 1987 : Les actions de Boiron sont proposées à la cote du second marché de la bourse de Lyon. 1988 : Rapprochement des Laboratoires Homéopathiques de France avec Boiron. 1990 : Rachat du laboratoire marseillais Sibourg par Boiron. 1992 : Les médicaments homéopathiques sont soumis à l’AMM ( Autorisation de Mise sur le Marché) mais, à la différence des autres médicaments, « la preuve de l’effet thérapeutique n’est pas requise ». Cette exemption est applicable à l’ensemble du marché européen après la Directive Européenne du 22 septembre 1992. Les médicaments homéopathiques sont vendus sans ordonnance. 1997 : Le Conseil National de l’Ordre des Médecins reconnaît l’exercice médical de l’homéopathie ( rapport Lebatard-Sartre ). 2002 : La France se classe au 1er rang des pays utilisateurs de médicaments homéopathiques. Alors qu’ils ne représentent que 0.2 à 0.3% du marché des médicaments dans le monde, ils représentent 10% des ventes en pharmacie. 2005 : La controverse sur l'efficacité thérapeutique de l'homéopathie est relancée. Dans son édition datée du 27 août 2005, l'hebdomadaire britannique The Lancet publie une étude dont les conclusions laissent clairement entendre que cette pratique médicale n'aurait pas d'efficacité spécifique et serait, au total, comparable à un placebo.
2005 : Boiron fusionne avec Dolisos.
Aujourd’hui : L'industrie homéopathique est dominée au plan mondial par deux sociétés françaises, Boiron et Pierre Fabre. Boiron, numéro un mondial, affiche en 2005 un chiffre d'affaires de 361 millions d’euros dont 229 millions d’euros en France. Les laboratoires Pierre Fabre affichent en 2004 un chiffre d’affaires de 106 millions d’euros concernant la branche homéopathie-phytothérapie. Le troisième mondial est l'allemand Heel. Le marché mondial est estimé à 6 milliards de francs, dont 30% en France. 1 En bleu ce qui concerne Lyon