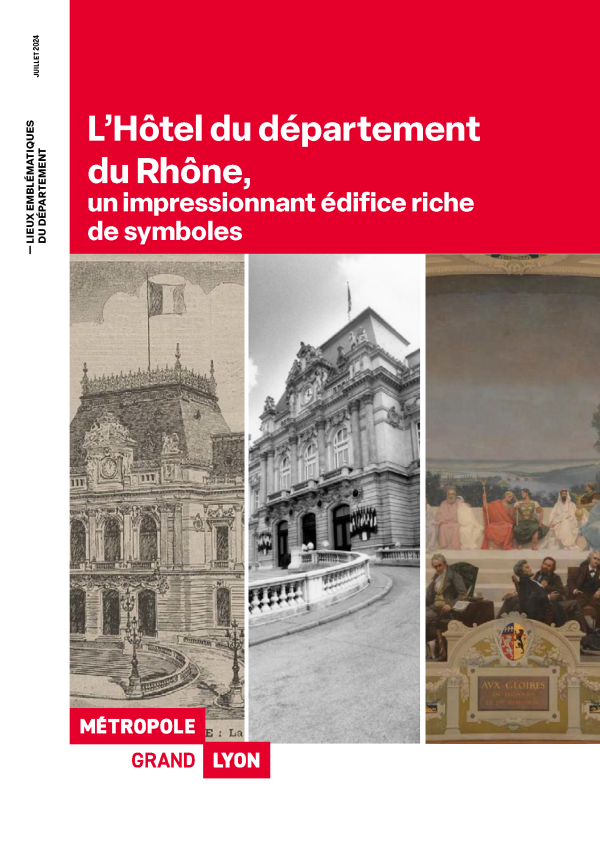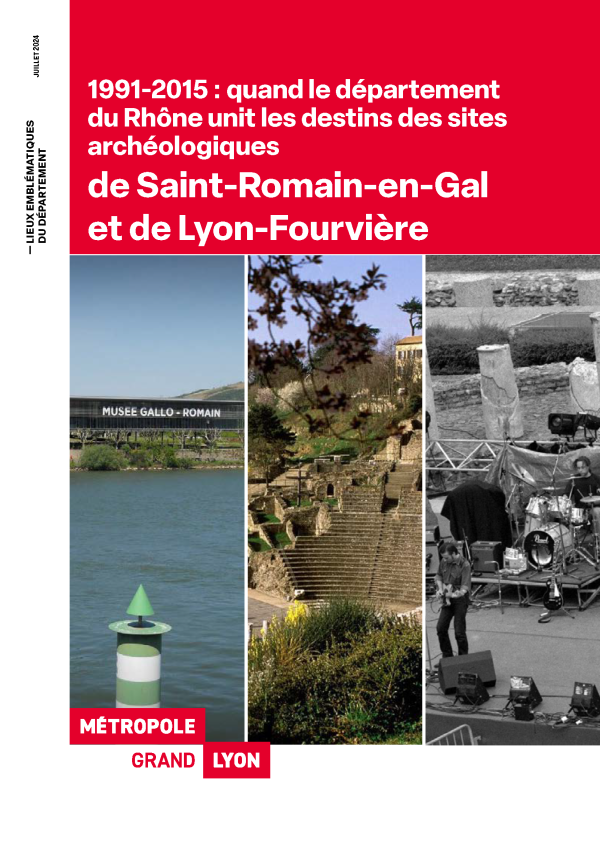Hier une ville ouvrière…
En effet, si l’existence de Givors est ancienne, son histoire commence véritablement avec la première industrialisation. Givors n’est pas une ville-usine sortie de la réflexion rationalisante et moralisatrice d’une grande compagnie. Elle n’est pas non plus une banlieue d’une grande cité d’Ancien Régime où se serait accumulée une population venue des campagnes. Givors est un rassemblement de populations d’origines géographiques diverses, aussi bien régionales qu’internationales, toutes porteuses de capacités technologiques. La ville de Givors n’est pas un déversoir, mais un lieu ouvert où chaque vague laisse une sédimentation porteuse de mémoire, tout en se revendiquant de Givors. C’est en 1749 que fut créée la Verrerie royale de Givors dirigée par Michel Robichon. Puis, son développement industriel est lié à la construction du canal de Givors, dont les premières études sont entreprises au milieu du XVIIIe siècle par François Zacharie. Le canal est mis en service en 1780 et permet l’évacuation du charbon de Rive-de-Gier. L’apogée du trafic est atteint en 1827. Prolongé jusqu’à Grand-Croix en 1831, il est vite abandonné par les compagnies minières au profit du chemin de fer, dont la ligne St-Etienne-Givors-Lyon est une des premières mises en circulation au début des années 1830. Il y alors deux gares, celles de Givors-ville et celle de Givors-canal. Le chemin de fer, apportant le charbon, donne naissance à une industrie sidérurgique, le premier haut fourneau fonctionne en 1839, et de construction mécanique qui connaît de beaux jours jusque dans les années 1970 grâce à des entreprises comme Fives-Lille ou Prenat la Fournaise. C’est à cette époque que la commune atteint son maximum de population, 21968 habitants en 1975. Givors, ville ouvrière par excellence, dirigée depuis 1953 par une municipalité communiste, hier par Camille Vallin et depuis 1993 par Martial Passi, a fait son entrée dans le Grand lyon le 1° janvier 2007.. De plus, elle est engagée dans la réalisation de son projet de ville 2000-2010 avec le soutien de l’Etat et des fonds
structurels européens.
… Aujourd’hui en reconversion
La crise givordine commence dans les années 1960, avec la fermeture des hautsfourneaux, s’accélère avec le retournement conjoncturel des années 1970 et la montée en puissance de la mondialisation durant la décennie suivante. Givors devient une ville sinistrée, avec une population de 18437 habitants au recensement de 1999, marquée par la nostalgie d’un temps où le travail ne manquait pas. Certes la reconversion est en marche, en particulier avec la zone de chalandise « Givors-Deux vallées », mais les sociabilités d’hier sont malmenées par le chômage, très supérieur à la moyenne nationale, par la paupérisation, le revenu moyen étant inférieur d’un quart au revenu moyen national, par le déchirement du tissu social. Cependant, du passé, il n’est pas fait table rase ! En 1989, une maison du Rhône est établie à Givors pour valoriser, par des expositions, des débats et autres manifestations, les relations entre le fleuve et ses habitants, par exemple, les joutes. Les Givordins, par tradition gens de rivière, excellent dans ce sport local, dont l’existence est maintenue grâce à la
Société de sauvetage. Le vieux dicton n’aime-t-il pas à dire :
Je son de vés Givor
Paï don s’hommo for,
Je fon craquo la lance
J’arréton le barqué
La mairie, toujours communiste, est en train de réhabiliter les Etoiles de l’architecte communiste Jean Renaudie. La première raison vient du fait qu’inaugurés en 1982, ces logements sociaux du vieux Givors, par leur conception originale, connaissent moins de problèmes sociaux que d’autres grands ensembles. En deuxième lieu, ces Etoiles, richesse patrimoniale de Givors, s’inscrivent dans la volonté de mutation de la ville qui cherche à modifier son image en s’appuyant sur une nouvelle notoriété, le fleuve, l’architecture contemporaine, le patrimoine industriel.
Bibliographie : Etienne Abeille, Histoire de Givors, 1910 ; Camille Vallin et Jean-
Michel Duhart, Givors, dictionnaire des rues et sites locaux, Messidor, 1990.