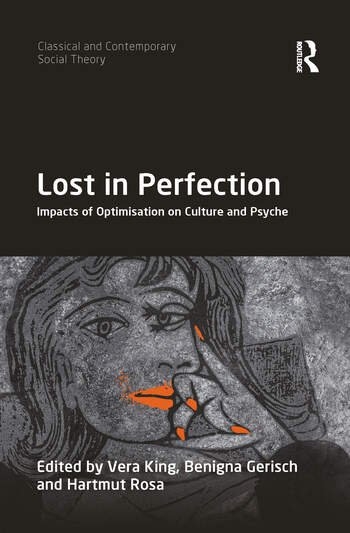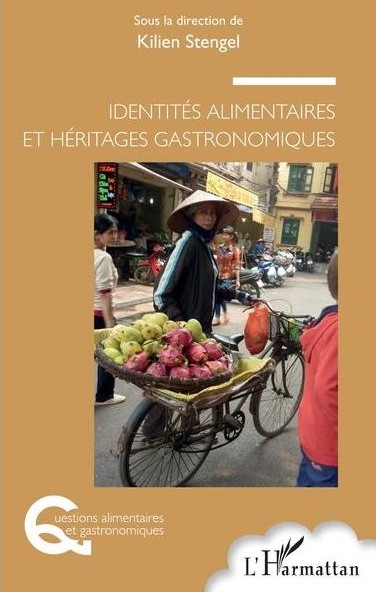C’est vraiment important. Il y a effectivement une notion qui se ressent dans la cuisine des chefs sur les ingrédients et la simplicité. Cela se ressent aussi au niveau du grand public sur le réemploi, le zéro déchet, etc. Notre festival est déjà né dedans parce qu’à l’époque, quand nous avons créé nos stands, nous sommes allés débarrasser des bambous qui poussaient chez le voisin et dont il ne savait pas quoi faire. Aujourd’hui, on prend des palettes, des planches de coffrage de chantier, etc. D’une nécessité, c’est devenu une signature, avec laquelle les gens sont à l’aise. Ils en ont envie, ils s’y retrouvent, puisqu’ils se l’appliquent à eux-mêmes sur le réemploi.
D’ailleurs, dans les cours de cuisine, on apprend à faire du réemploi. Par exemple, via la Métropole, on a pu flécher un certain nombre de structures qui travaillent sur le réemploi, la création de savons naturels, etc. On profite du monde incroyable qui vient sur le festival pour le sensibiliser. Grâce à la Métropole, il y a beaucoup d’ateliers pédagogiques mis en place autour de ces questions, et on sent bien qu’en retour il y a un intérêt fort sur ces sujets.
Un deuxième point important, c’est le digital, qui nous permet aussi d’éduquer les gens. L’une des plus belles actions qu’on a voulu soutenir, c’est une association qui s’appelle BelleBouffe et qui a fait une cartographie des producteurs de la région qui pouvaient vendre aux particuliers. Tous n’ont pas le temps d’aller identifier la bonne ferme pour ne pas se laisser tromper par le marketing. Aujourd’hui, malheureusement, sur nos marchés, dans les villes, la moitié des stands – ça me révolte ! – ce sont des gens qui mettent un béret, qui vont au marché de gros, prennent un peu un accent et ça y est, ils sont producteurs, et ça pénalise l’autre moitié qui a une démarche sincère.
Sur notre festival, on met donc en avant des initiatives qu’on estime authentiques. En cela, on travaille beaucoup avec la Métropole et le fait qu’il y ait une délégation à l’alimentation, créée à la fois au niveau de la Métropole et de la Ville de Lyon, cela nous aide beaucoup.