Thuasne : les enjeux de développement et son ancrage dans la métropole

Interview de Elisabeth Ducottet
« Je crois personnellement beaucoup au design, au maillage entre la beauté et la fonctionnalité du produit ».
< Retour au sommaire du dossier
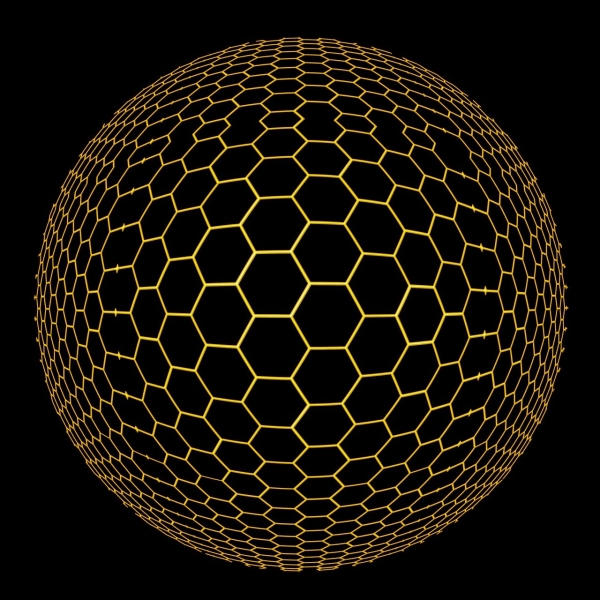
Interview de Yves Chauvin
<< La recherche appliquée est une école de la solidarité. Il y a forcément une équipe. >>.
Yves Chauvin reçoit le Prix Nobel de Chimie 2005.
Exemple du parcours d'un chercheur dans le domaine de l'industrie chimique, notamment dans le domaine de la catalyse et plus précisément le rôle de la créativité dans la recherche scientifique.
Pouvez-vous brièvement nous rappeler votre parcours universitaire et professionnel ? Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à vous intéresser à la catalyse ?
J’ai fait mes études à l’Ecole de chimie de Lyon – qui se nomme aujourd’hui Chimie Physique Electronique – et je suis sorti diplômé en 1954. A l’époque, j’avais en tête de poursuivre mes études et d’effectuer un doctorat. Mais, c’était la guerre d’Algérie ; il était très difficile d’avoir un sursis. J’ai donc intégré l’armée et fait mon service militaire.
Après les trente mois réglementaires, je suis revenu et j’ai décidé d’intégrer l’industrie car je n’avais pas de formation pour la recherche fondamentale. Je suis rentré chez Progil1 où j’ai fait de la recherche appliquée en synthèse organique. Mais, je manquais d’autonomie. Alors, j’ai cherché une autre place et j’ai fini par intégrer l’Institut Français du Pétrole (IFP).
Ce qui m’intéressait à l’IFP est que cet institut faisait de la recherche appliquée mais avait un regard bienveillant sur la recherche fondamentale. On pouvait conduire des thèses, en encadrer, etc. Mon travail était à la fois appliqué et fondamental et en plus, j’avais la possibilité d’avoir des élèves en thèse. A l’époque, il y avait une certaine tolérance. Aujourd’hui, il est impensable d’envisager que sans doctorat quelqu’un encadre des thèses !
A l’IFP, en général, on travaille sur le pétrole soit sur le craquage, le filtrage, l’hydrosulfuration, le reformage, etc. Quant à moi, ces thématiques ne m’intéressaient pas et je préférais travailler sur la chimie organométallique. Quand j’ai commencé à travailler sur ce thème, je n’ai pas eu beaucoup de soutien. Ma direction de l’époque estimait que cela ne servait à rien mais je trouvais que c’était un domaine où les choses bougeaient, où il y avait quelque chose de neuf à explorer. J’étais surpris qu’en France, cela ne bouge pas beaucoup alors qu’aux Etats-Unis, en Angleterre, etc. on était dans la situation inverse.
Est-ce que ce type de recherches a porté ses fruits ?
À force de travailler, j’ai fini par développer des procédés basés sur la chimie organométallique et plus exactement sur la catalyse homogène. Ces procédés ont été vendus en France et à l’étranger et ont connu une belle existence.
Comment fonctionnait la recherche au sein de votre laboratoire ?
Quand on fait de la recherche appliquée, on ne peut pas être seul. La recherche appliquée est une école de la solidarité. Il y a forcément une équipe. Vous dépendez beaucoup de vos collègues. Par exemple, vous trouvez une réaction, vous la développez au laboratoire. Ensuite, il vous faut convaincre un de vos collègues que c’est intéressant afin que ce dernier effectue le développement de votre réaction. Puis, il faut encore convaincre d’autres personnes de vendre le procédé ainsi développé.
Le premier procédé vendu que nous avions développé à l’IFP l’a été aux Etats-Unis. Après plusieurs aléas, nous avons pu le vendre ailleurs. En tout, nous avons pu vendre 45 unités. L’avantage de l’IFP est que même plus de 30 ans après, il reste seul sur ce marché. La concurrence n’existe pas.
Est-ce que recherche fondamentale et recherche appliquée doivent s’articuler intimement pour bien fonctionner ? Dans votre cas, cette articulation semble assez importante.
Il est vrai que j’ai passé ¾ de mon temps professionnel de chercheur à faire de la recherche appliquée et ¼ à faire de la recherche fondamentale. Au sein du laboratoire, nous avions des thésards, nous encadrions donc des travaux de doctorat.
Le choix d’un sujet de thèse est délicat. Il s’agit de proposer un sujet soit de recherche fondamentale dérivée de la recherche appliquée afin d’expliquer un procédé par exemple, soit d’étudier fondamentalement une nouvelle réaction pour ensuite essayer de la développer. Mais, parfois, il n’y a aucune justification. La recherche ne se base que sur l’intuition d’un chercheur qui pense qu’il y a là une voie à explorer, une voie nouvelle à défricher. C’est pour cette raison que l’autonomie et la liberté sont importantes.
Est-ce que cela vous est arrivé d’avoir une intuition et de vous engager dans un domaine non défriché ?
Oui, c’est ce que j’ai fait avec la métathèse. Lorsqu’en 1968, j’ai commencé à travailler dessus, c’était alors un peu risqué. Personne dans la communauté scientifique ne voulait entendre parler de ce que je faisais. Mais c’était une chance aussi car j’ai pu travailler tranquillement et explorer un champ vierge. J’ai toujours été curieux, ce qui m’a permis d’avancer en recherche.
Il m’a fallu trois ans pour convaincre les collègues scientifiques de la communauté internationale. Ce sont entre autres ces travaux qui m’ont valu le Prix Nobel des années plus tard, car personne avant moi n’avait travaillé dans ce domaine de la chimie organométallique. Aujourd’hui, la chimie organométallique est très développée en France et à l’étranger mais il a fallu plus de 30 ans.
Qu’est ce qui selon vous peut être caractéristique d’un bon chercheur ? Quel trait de caractère ? Quelle pratique ?
Tout d’abord, il faut savoir que chaque scientifique se construit sur ce que les autres ont fait… Pas de chimistes sans Lavoisier ! Mais, il faut aussi savoir se détacher de ses prédécesseurs à temps. Par exemple, je m’intéressais beaucoup à ce que faisaient les Allemands, les Américains… mais j’ai du aussi m’éloigner de leurs travaux pour trouver quelque chose de nouveau. Ce qui est difficile est de savoir quand quitter ses pairs, quand se démarquer pour faire ses propres expériences.
Vous souvenez-vous de l’idée qui vous a permis de sortir des sentiers battus et d’aller travailler sur la métathèse ?
A l’époque, le nombre de liaisons chimiques qu’on connaissait entre les métaux de transition (les organométalliques) et les hydrocarbures était limité. Il y avait les liaisons métal/carbone ou métal/hydrogène et les liaisons pi. On connaissait donc trois liaisons. Tout le monde voulait expliquer toutes les réactions avec ces trois liaisons. Je pensais qu’il fallait en sortir… C’est pour cette raison que les chimistes refusaient de voir ce que je faisais. Mais, il y avait l’Allemand Ernst Otto Fischer qui avait trouvé une double liaison métal/carbone – ce qui n’avait jamais été fait. Je me suis alors dit que cette double liaison devait jouer un rôle dans la catalyse. Cela a débouché sur mes travaux sur la métathèse.
Ensuite, il y a eu beaucoup de laboratoires et d’industriels qui ont travaillé sur cette réaction et qui ont trouvé des applications industrielles.
Lesquelles sont-elles ?
Cela sert beaucoup dans le pétrole mais aussi en pharmacie. En général, quand on produit une nouvelle molécule, il y a une stratégie de synthèse avec de nombreuses étapes pour passer du précurseur au produit final. La métathèse permet de raccourcir la synthèse, ce qui est un gain de temps et d’argent. Mais ce qui est également un gain pour l’environnement. Les coûts environnementaux et financiers sont donc diminués. Dans les produits pharmaceutiques près de 40% des synthèses font appel à la métathèse.
Il semblerait que ce mécanisme soit en concordance avec les principes de la « chimie verte ».
Oui, forcément. Mais, le principe de la chimie verte est assez universel. Si on utilise préférentiellement une nouvelle réaction c’est parce qu’elle apporte quelque chose de neuf par rapport à l’ancienne soit en nombre d’étapes, soit en terme de sélectivité. La « chimie verte » fait partie du métier du chimiste depuis toujours… Ce n’est pas une nouveauté. Prenons l’exemple de l’acide sulfurique. Avant, la sélectivité était de 98%, c’est-à-dire qu’une fois la chaîne de réaction terminée, il y avait 2% de produits polluants qui s’échappaient dans l’atmosphère. C’était assez dangereux et c’est pour cette raison que les cheminées des usines étaient très hautes. Mais, les chimistes ne pouvaient pas en rester là car aux alentours d’une usine d’acide sulfurique, tout l’environnement était détérioré. Aujourd’hui, on en est à une sélectivité de 99,99999…%. Les chimistes ont toujours œuvré pour améliorer les réactions tant en terme de coût financier que de coût environnemental. A mon sens, les principes de la « chimie verte » ont toujours été les principes des chimistes.
De toute façon, les sociétés humaines ont besoin de chimie et le métier de chimiste est de faire du nouveau propre. Cela paraît être une évidence. La chimie ne rentre pas en concurrence avec la nature ; c’est une aide. Par exemple, en 1938, les doryphores ont envahi l’Europe. C’était une catastrophe car ils dévoraient toutes les pommes de terre. On n’avait aucun moyen de lutter. On envoyait les enfants après l’école pour enlever les doryphores un à un à la main. Aujourd’hui, on n’accepterait sans doute pas cela ! Ensuite, on a trouvé l’arséniate de plomb. Il fallait en mettre 400 kg par hectare ! Mais aujourd’hui, nous avons des pesticides organiques : il suffit simplement de 100g/hectare pour être efficace. Imaginez le progrès !
Dans votre parcours professionnel, vous avez pu faire un lien très étroit entre une pratique de recherche fondamentale et une pratique de recherche appliquée. Le tout dans le milieu industriel. Croyez-vous que ce soit encore possible aujourd’hui pour un jeune chimiste qui se lancerait dans une carrière de chercheur ?
C’est une question délicate. Aujourd’hui, on donne de l’argent dans les domaines « utiles ». Il faut que la recherche serve à quelque chose. On ne peut pas donner des milliards d’Euros à la recherche fondamentale si on ne pressent pas son utilité. C’est un aspect très complexe de la recherche. De plus, certaines personnes sont très à l’aise dans la recherche appliquée tandis que d’autres trouvent davantage leur compte dans la recherche fondamentale. On ne peut pas forcer un bon chercheur en recherche fondamentale à faire de la recherche appliquée. Personnellement, j’aimais les deux aspects du travail.
La catalyse s’est fortement développée à Lyon dans les années 1950-1960, pensez-vous avoir bénéficié de ce mouvement pour mettre en place votre propre recherche ?
C’est vrai que j’ai effectué mes études à Lyon, à CPE et que j’ai eu Marcel Prettre comme professeur. Mais, il faut savoir que j’ai travaillé à l’IFP alors localisé à Rueil-Malmaison, même si je venais souvent voir mes collègues sur les unités pilotes installées à Lyon. Marcel Prettre a eu une influence considérable sur la catalyse hétérogène. C’est indéniable. Mais, ce n’était pas le domaine qui m’intéressait. J'étais plutôt un autodidacte. Mon domaine de prédilection était davantage la catalyse homogène. Comme je l’ai déjà expliqué, c’était assez complexe de travailler dans ce domaine car cela n’intéressait personne.
Aujourd’hui, avez-vous une vision de comment organiser la recherche scientifique et technique en France et en Europe ?
C’est très complexe. Il y a des domaines tels que les nanotechnologies et les biotechnologies où il faut absolument donner de l’argent pour que de nombreux chercheurs puissent travailler. Mais est-ce dans ces domaines que l’on trouvera quelque chose de très novateur ? Rien n’est moins sûr… Mais, il est impensable qu’en France, il n’y ait personne qui travaille sur les nanotechnologies. La complexité réside dans le repérage des domaines en rupture. Là où il peut y avoir potentiellement de la nouveauté, de l’innovation, de la créativité. Repérer cela est une tache complexe.
Vous disiez tout à l’heure que lorsque vous avez commencé à faire des recherches sur la catalyse homogène, vous aviez senti qu’il y avait quelque chose qui « travaillait » à cet endroit-là… sentez-vous aujourd’hui qu’il y a un domaine où peut émerger cette nouveauté ?
J’ai toujours des idées sur le domaine dans lequel j’ai travaillé. Lorsqu’on est chercheur, on a une idée qu’il faut tester en laboratoire. Mais souvent, on se trompe. On croit qu’il y a du nouveau mais en fait, il n’y a rien… Je ne peux absolument pas engager aujourd’hui des chercheurs sur des idées sans les avoir testées en laboratoire. C’est une démarche impossible.
Mais lorsque l’on regarde l’histoire des sciences en général et aussi plus particulièrement votre parcours de chercheur, on se rend compte que ce qui prime est l’émergence de la créativité, de l’inventivité… pensez-vous aujourd’hui que le système mis en place puisse permettre ce type d’émergences ?
Mon expérience peut, en effet, être intéressante. J’ai travaillé dans de mauvaises conditions : personne ne croyait en moi et en mes recherches… et pourtant, je suis parvenu à trouver quelque chose. Même si la recherche est mal organisée, il y aura toujours des gens qui trouveront ! Mais, organiser la recherche scientifique est une véritable gageure. Il faut savoir doser entre la liberté, le cadrage, l’anarchie, l’organisation, etc. Il faut instaurer un système pour que le chercheur puisse prendre des libertés tout en restant dans les cadres institutionnels mis en place. Il faut que le chercheur puisse se saisir des tendances pour obtenir de l’argent mais qu’il garde en tête sa créativité et qu’il puisse tester des idées nouvelles.
[1] La société Progil est la société créée au XIXe par Gillet, intégrée ensuite à Rhône-Poulenc.

Interview de Elisabeth Ducottet
« Je crois personnellement beaucoup au design, au maillage entre la beauté et la fonctionnalité du produit ».
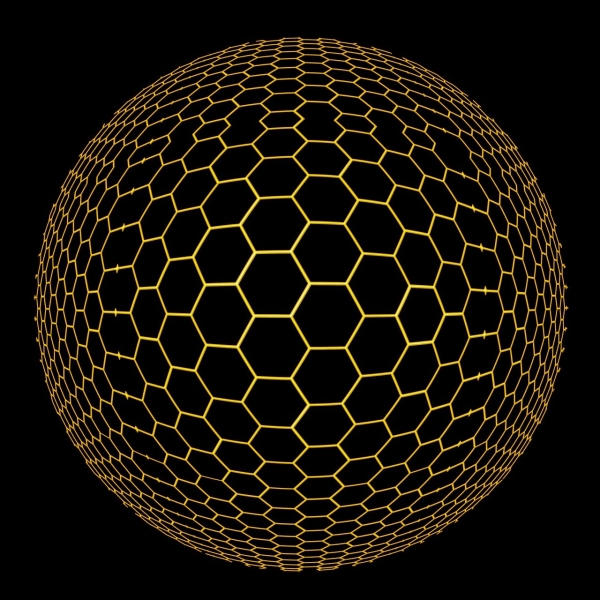
Interview de Yves Chauvin
« La recherche appliquée est une école de la solidarité. Il y a forcément une équipe ».

Interview de Bernadette Angleraud
« Lyon a été très marquée par l'activité de la soie et l'industrie a toujours été plus ou moins dévalorisée ».

Interview de Paul Berliet
« A travers la Fondation Berliet, nous voulons être un point de référence pour redonner à cette région sa fierté ! »
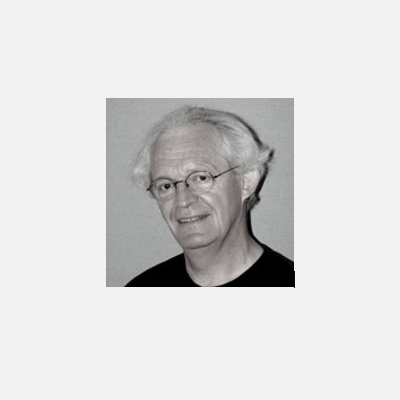
Interview de Philippe Dujardin
Politologue, chercheur au CNRS
"Tel est le « génie du lieu » qu’ici on doive penser avec les mains… avec la raison comptable et la compassion."
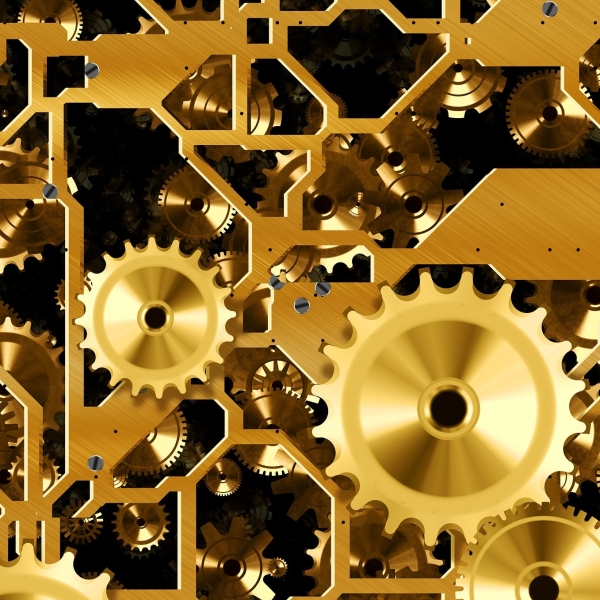
Étude
Dans un mouvement général de décollage industriel, le territoire lyonno-stéphanois se distingue par la collaboration qu’il initie entre les activités manufacturières et la création artistique depuis le XIXe.

Étude
Historiquement, l’activité de tissage est strictement définie par le pouvoir central.

Étude
Si la structure de la profession évolue peu, la soie lyonnaise parvient à conserver et même à élargir son leadership.

Étude
Présentation des principales étapes qui permettent de transformer une matière première naturelle.

Étude
Alors que les structures d’organisation des professions de la soie sont rigides, le secteur se développe et se renouvelle.

Étude
Une analyse concentrée sur les métiers en lien direct avec la soie : les métiers des textiles techniques et ceux en lien avec la mode.

Étude
Affiner sa compréhension permet aux décideurs, aux entrepreneurs, aux collectivités locales de se lancer dans une politique de l’innovation efficace et pérenne et d’agir sur les bons leviers.

Étude
Le génie technique en matière de textile s’est développé très tôt à Lyon.

Étude
Connue pour son Chasseur Français et son Tarif- Album, la « Manu » a incontestablement été, pendant une bonne moitié de sa vie, une entreprise pionnière.
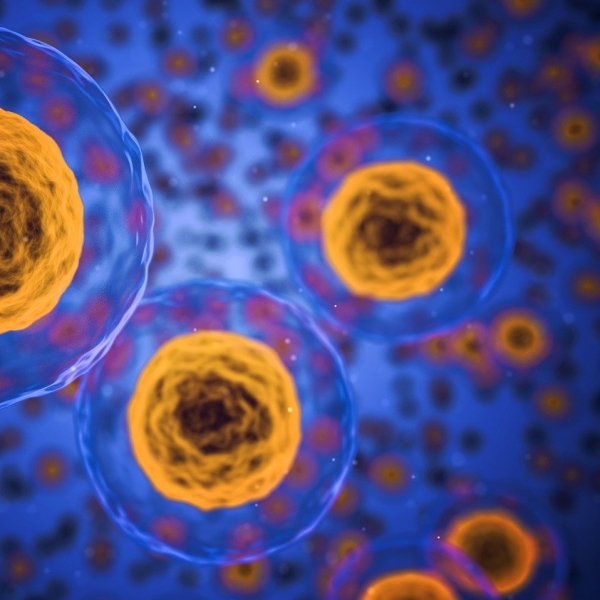
Étude
Retour sur les archives et les travaux de spécialistes du territoire et de la médecine, pour mieux cerner certaines composantes de la dynamique lyonnaise.

Étude
Celui qui a initié le travail de la soie vers des techniques plus mécaniques où l’homme laisse la machine faire le travail le plus rude.

Étude
Quelles évolutions pour l'édition sur le territoire lyonnais ?

Dossier
Comment l’activité de fabrication de la soie devint-elle un marqueur de révolutions techniques, industrielles et sociales ?

Étude
Quel est l’héritage technique des solutions proposées par la société Lumière ?

Étude
Les grands parcs apparaissent comme des espaces à part, qui proposent une nature organisée par l’homme et reflètent les préoccupations des époques qu’ils traversent.

Article
Issue de l’héritage du musée d’histoire naturelle de Lyon, le musée des Confluences n’a rien d’un long fleuve tranquille.
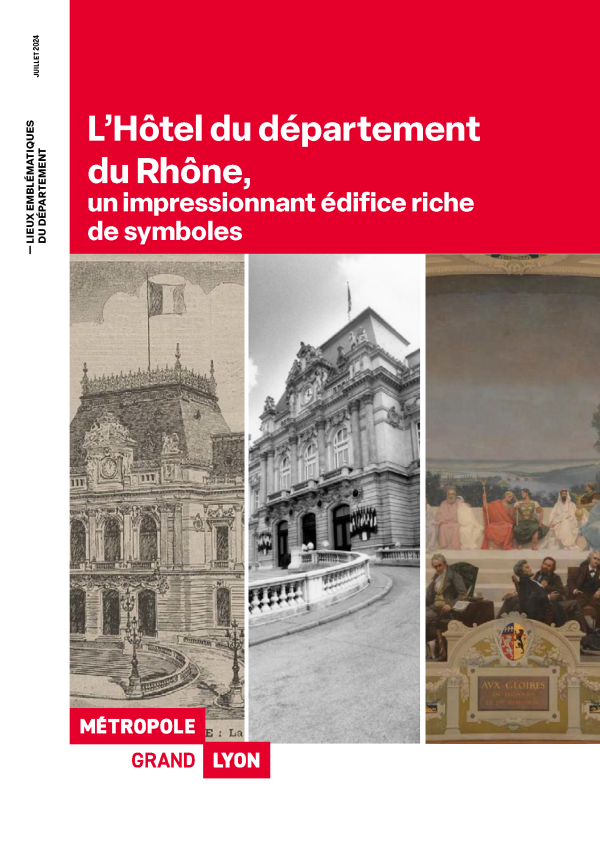
Étude
L’Hôtel du département du Rhône a la particularité d’abriter à la fois le Département du Rhône, collectivité territoriale, et la Préfecture du Rhône, service de l’État dans le département.
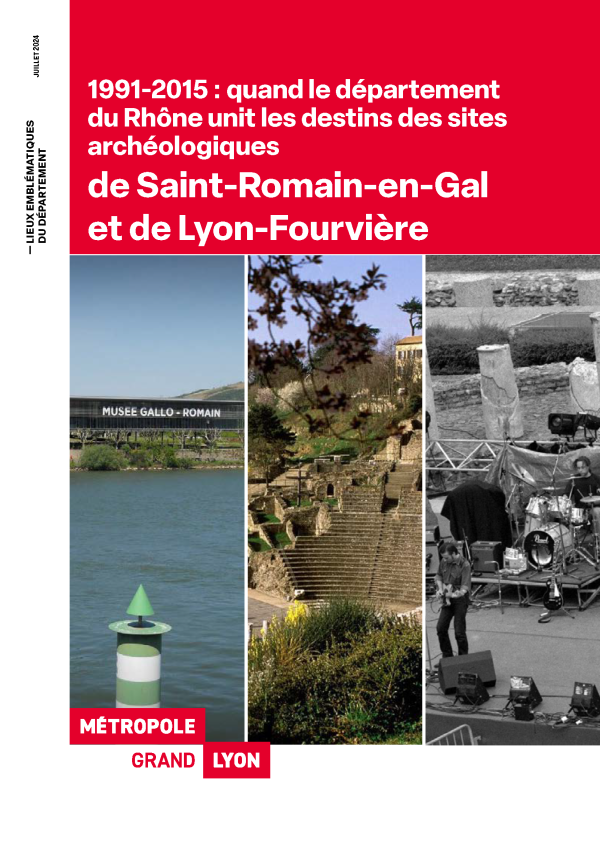
Étude
Dans le récit de la constitution des sites archéologiques de Saint-Romains-en-Gal et de Fourvière, prenons conscience de la valeur des traces civilisationnelles qui nous sont données à voir.
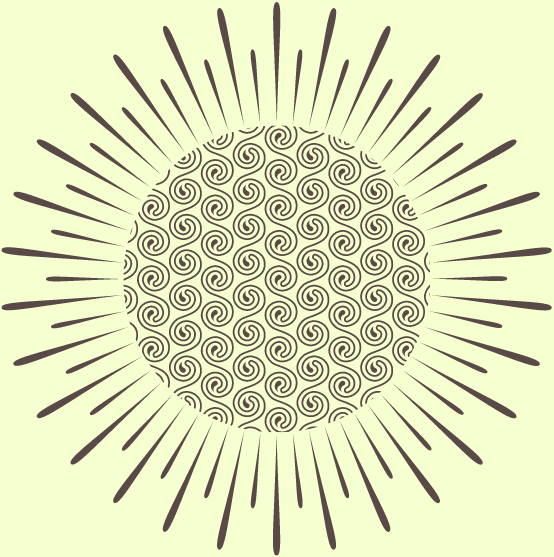
Étude
6 chronologies des emblèmes du territoire du territoire.
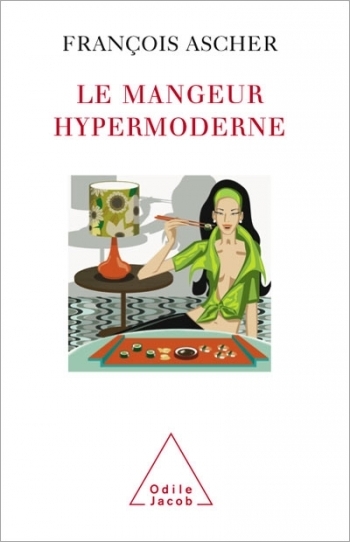
Article
En 2005, l’urbaniste et sociologue F. Ascher imaginait le mangeur d’aujourd’hui. Retour face à ce miroir déformant, qui en dit beaucoup sur le chemin parcouru depuis.

Étude
Dans ce numéro : un dossier consacré à la question de la place des morts aujourd'hui dans nos villes.