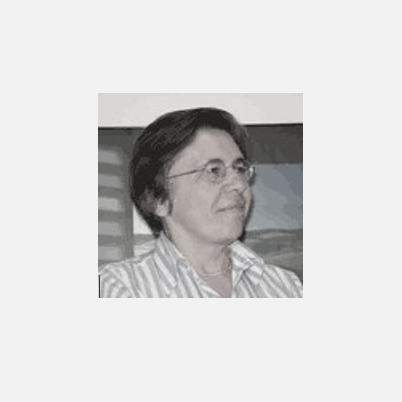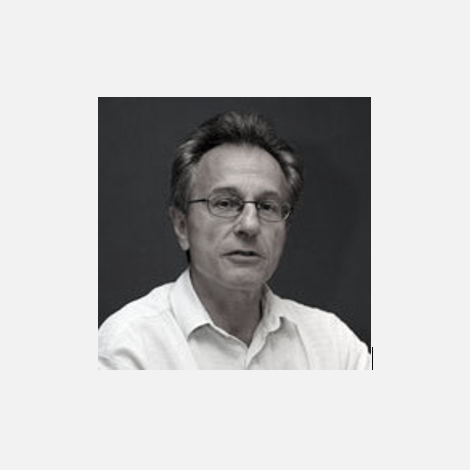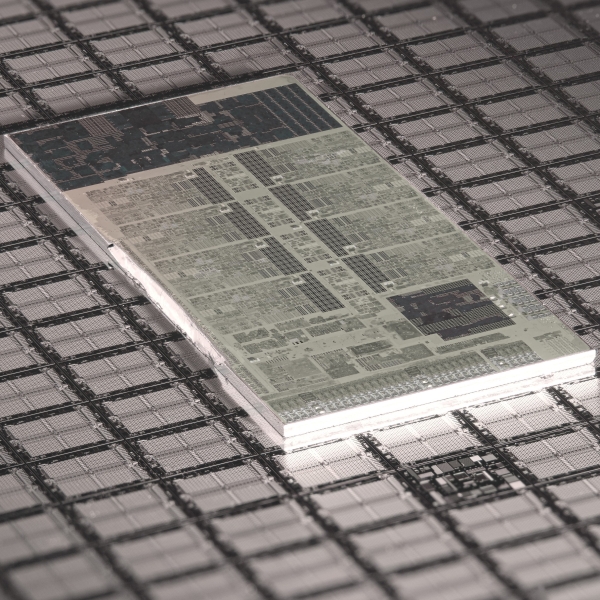Le monde de l’information et du savoir évolue sans cesse, à la faveur notamment des TIC, Technologies de l’Information et de la Communication ; comment formez-vous les futurs professionnels aux enjeux de demain ?
On est dans une phase très instable. Dans cette phase-là, il est bon d’essayer de prendre du recul et de ne pas baigner dans un pessimiste ambiant, conservateur ou réactionnaire ni de partir dans un enthousiasme aveugle. La vérité, de notre point de vue, est quelque part au milieu. On forme donc, chez nous, les étudiants à une analyse critique et problématique des sciences de l’information. Et on leur donne plus qu’une teinture technique : en sortant d’ici, ils sont supposés savoir créer un blog, un site web, faire de l’archivage numérique, de la production de documents.
Le numérique introduit-il une rupture radicale ?
Depuis une dizaine d’années, les choses changent de façon assez radicale en terme de production d’informations ou de savoir, de diffusion, de stockage, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les documents papier vont devenir obsolètes et qu’on va s’en séparer. C’est plutôt que l’on ajoute des strates. Je pense qu’à échelle humaine, on n’aura pas encore accès à l’ensemble de la production intellectuelle et scientifique sous forme numérique.
Dans les cinquante ans qui viennent on sera dans la coexistence de deux types de stock : un stock papier et un stock numérique. Les deux seront complémentaires. Ce n’est donc pas une rupture radicale. Tout ce qui existait avant ne tombe pas dans un puits sans fonds et dans l’oubli. On rajoute à ce stock d’informations, de savoir, de création, de production sur papier un autre type de production, de diffusion et d’archivage – sous forme numérique.
La dématérialisation de l’information menace t’elle l’existence des bibliothèques en tant que lieux physiques de la connaissance ?
Il y a 10 ou 15 ans, un certain nombre de décideurs disaient qu’il n’était plus la peine d’avoir des bâtiments de bibliothèques car tout serait sous forme numérique. Quand François Mitterrand annonçait la création d’une nouvelle grande bibliothèque nationale en 1988, pour Jacques Attali, c’était forcément une bibliothèque sans mur, uniquement sous forme numérique. De même, quand la construction des bâtiments de l’université de Marne la Vallée a démarré, il y a une quinzaine d’années, les responsables de l’université ont estimé que ce n’était pas la peine de faire une bibliothèque à l’ère du numérique. Et maintenant, ils sont en train de construire une bibliothèque !
La bibliothèque du futur sera donc toujours un lieu physique ?
C’est pour moi une évidence ! D’abord parce qu’il y a encore toutes ces collections papier qui vont demeurer l’accès unique à un certain nombre d’informations, de savoirs et de créations qui constituent notre patrimoine culturel. Cela ne sera pas remplacé de sitôt. De plus, nos générations – et cela va perdurer quelques décennies ! – ont appris à lire, à apprendre, à s’informer sous forme papier ; or, ce sont des habitudes qui ne changent pas si vite. La façon dont les e-books peinent à prendre place le démontre également. Lire un livre sous forme papier, ce n’est pas seulement une technique, c’est culturel, c’est un habitus, un rapport à une culture, une mémoire, une ère livresque qui cohabite aujourd’hui avec une ère numérique mais qui ne disparaît pas pour autant.
Le lieu physique demeurera aussi car le numérique, contrairement à ce qu’on dit souvent, ne facilite pas forcément la démocratisation et l’accès au savoir et à l’information. Le numérique nécessite aussi des technicités et des compétences, comme le fait de savoir évaluer l’information, distinguer une information valide, etc. Ce sont des choses qui s’apprennent, et les bibliothèques aujourd’hui, au moins dans le domaine universitaire, jouent ce rôle de formation. C’est important si on ne veut pas tomber dans la fracture numérique : les infos riches et les infos pauvres, ceux qui savent se servir de l’information numérique et ceux qui ne savent pas, ou moins bien.
Ce rôle de formation n’est-ce pas aussi celui de l’école ?
Bien sûr, mais pour l’instant, ce n’est pas tout à fait le cas ! Y compris pour ceux qu’on appelle les « digital natives ». Beaucoup d’étudiants qui arrivent aujourd’hui en premier cycle ne savent pas faire une recherche : à part Google et Wikipédia, ils ne connaissent rien !
Les bibliothécaires ont un rôle de formation à la recherche d’information. Il faut connaître les outils et les procédures, savoir où chercher, reconnaître une information valide, la stocker, la hiérarchiser, etc. C’est important car le numérique ouvre aussi la porte à toutes les manipulations. La question de la validation de l’information est donc essentielle. Est-ce le document original, a-t-il été modifié, qui valide le fait que le texte ait été modifié, qui est l’auteur ? Tout cela pose des questions très nouvelles.
On dit aussi que la dématérialisation accentue paradoxalement le besoin de rencontre physique…
C’est la 3e raison pour laquelle je reste persuadée que les bibliothèques restent nécessaires. Toutes les enquêtes sociologiques de public montrent que c’est très important que les bibliothèques soient aussi des lieux de vie, où les gens se rencontrent, se retrouvent, peuvent travailler ensemble, discuter, se donner rendez-vous. Les gens ont envie de se retrouver dans un lieu socialement assez neutre, gratuit, ouvert à tous, quels que soient l’âge, le diplôme et le statut social. Je crois que c’est important de préserver la possibilité d’accéder à des lieux socialement neutres et non marchands dans la ville ; les élus locaux semblent assez conscients de cela. De plus en plus, on considère aussi que les bibliothèques universitaires sont des lieux de vie. Dans les constructions, elles sont désormais conçues au milieu des campus, car c’est un lieu d’animation et de rencontre : tout simplement un lieu de vie.
La BmL a confié, sur appel d’offres, la numérisation d’une partie de ses fonds à Google. Qu’en pensez-vous ?
Je pense qu’il faut être assez attentif à la place que prend aujourd’hui Google dans la production du patrimoine numérique. Les deux grands dangers que je vois sont une privatisation de l’accès et une non pérennité des données. Qui nous dit que dans 2, 5 ou 10 ans, ils ne s’amuseront pas à tarifer tous les accès au patrimoine public, qui deviendrait de facto patrimoine privé ? Qui nous assure que dans 5 ou 10 ans ils n’auront pas changé de format, de norme, de modalité d’indexation, d’algorythme, etc. et que du coup, tout ce qui a été numérisé depuis 20 ans sera perdu ? Garantir un accès public et une pérennité d’accès, c’est un service public. Alors est-ce bien normal que l’on confie un service public à une entreprise privée ?
Que pensez-vous du fait qu’on adresse 87% de nos requêtes à un moteur de recherche unique : Google ?
C’est vrai que c’est très facile et que ça va vite ; moi aussi, je fais des recherches sur Google ! Mais le fait même que les occurrences par popularité arrivent en tête, signifie que les réponses ne sont pas forcément valides. C’est pourquoi il est important de former des gens à d’autres outils de recherche d’informations, et à l’idée que les réponses de Google ne sont pas l’alpha et l’oméga de toute recherche documentaire. On peut trouver mieux, plus pertinent, plus valide, plus à jour dans des bases de données, sur d’autres sites, etc. On peut rebondir d’un site à l’autre.
Un des atouts majeurs de Google, c’est la recherche en plein texte ; au lieu de chercher sur des index, d’essayer de trouver des mots clés, des descripteurs, on tape le mot ou la formule qu’on souhaite et on y va directement. C’est extrêmement efficace ; c’est d’ailleurs devenu la façon la plus courante pour faire des recherches. Sur ce point, les bibliothèques ont pris du retard puisque les catalogues des bibliothèques sont généralement basés sur des indexations par auteurs, sujets, titres, etc. En dehors des données qui alimentent explicitement le catalogue, on ne peut rien trouver. Or ce qui intéresse les usagers désormais n’est pas de savoir si la bibliothèque possède tel document ou tel article mais d’aller directement au document, à l’article. C’est un défi pour les bibliothèques ! Elles ont commencé à se mettre en ordre de marche pour répondre à cette demande, avec la constitution de bibliothèque numérique, la proposition de presse électronique. Les BU travaillent énormément dans ce registre-là.
Pensez-vous que le numérique puisse véritablement concurrencer le papier ?
Il y a des registres de concurrence évidents, par exemple pour les atlas ou les annuaires. On les consulte sur supports électroniques car on sait qu’ils sont remis à jour automatiquement et ne peuvent pas devenir obsolètes. Il y a donc un certain nombre de documents – ceux qui se périment assez vite -, dont la presse, qui de plus en plus vont être consultés sous forme numérique. Mais un tout un autre type de lecture va continuer pendant un grand moment à se faire sur forme papier, je pense aux livres pour enfants, aux romans, aux essais, etc. Il y a plutôt deux types de lecture, une lecture vraiment d’information, un peu zapping, en pointillés, pour laquelle le numérique apporte une plus-value évidente. Mais pour une lecture plus linéaire, plus continue, discursive, le papier reste incontournable.
La bibliothèque de demain – et plus généralement la constitution du savoir - sera-t-elle collaborative ?
Le côté collaboratif est évidemment une nouveauté importante dont il faut tenir compte. Car de plus en plus, la science et le savoir peuvent s’élaborer de cette façon, comme le montrent, dans le champ universitaire, les HAL. C’est une nouveauté tout à fait assise et acquise. Mais sur les wiki, je serais beaucoup plus réservée. Wikipédia pose le problème de la disparition du travail éditorial et des repères de validation de l’information. Nous qui sommes un établissement d’enseignement supérieur, nous prônons quelque part l’idée qu’il y a une expertise qui doit être mise au service de la communauté. Je ne pense pas que le rassemblement de 300 ignorants produise du savoir ! Un travail collaboratif oui, les outils le permettent et c’est un usage aujourd’hui très répandu parmi les scientifiques et au-delà. Mais je ne pense pas que n’importe qui puisse s’ériger comme producteur de savoir.
Vous militez donc toujours pour un modèle vertical de validation des savoirs ?
Pas forcément, car les gens qui savent peuvent être partout. Ce ne sont pas forcément que des universitaires. Les expertises sont partout ; elles sont diffuses. Je crois à une régulation au sein de communautés assez réduites d’historiens, de physiciens, de cuisiniers, qui eux-mêmes créent de la compétence, mais un grand bazar comme Wikipédia me laisse franchement très sceptique !
Que pensez-vous de ceux qui préconisent d’établir des drapeaux, des labels, des repères sur Internet ?
Je ne crois pas forcément à une politique de labels, mais à une nouvelle politique de médiation. Des bibliothèques ou d’autres entités peuvent créer des dossiers, des fiches techniques, des répertoires, des sources qui aident les gens à se débrouiller dans cet océan d’informations – on parle d’ « infobésité » –, à trouver quelques balises, quelques repères. Les bibliothèques peuvent aider à recréer une certaine organisation de l’information. Cela ne viendra pas concurrencer Google qui restera sans doute dans les années qui viennent la source d’information la plus spontanée et la plus courante. Mais complémentairement à ça, on peut proposer une information organisée, validée, hiérarchisée. Dans quelle organisation, avec quels outils ? Ça évolue tellement vite qu’il est difficile de se prononcer.
Internet facilite également les mises en réseau…
Encore une fois les bibliothèques universitaires ont démarré vraiment tôt ; elles ont constitué une base bibliographique commune, mais aussi une base pour les thèses, et une autre pour les manuscrits conservés. Ces mises en réseaux se font. La BnF a d’ailleurs joué un rôle fédérateur tout à fait important dans ce domaine. Et puis il y a d’autres réseaux transversaux, thématiques : la bibliothèque inter-universitaire de médecine a évidemment un portail numérique sur les sciences médicales ; Cujas est en train de faire la même chose pour les sciences juridiques ; oui, ça se fait !
Des mises en réseau à un niveau territorial vous semblent-elles pertinentes ?
Pour le coup, je suis plus réservée car l’un des intérêts d’Internet est de franchir les territoires ; donc est-ce bien intéressant de s’y renfermer ? Je ne suis pas sûre…
Je sais que le ministère de Culture pousse un peu à la roue, pour la constitution de bibliothèques numériques régionales. Et Patrick Bazin comme moi-même sommes plutôt réservés. Je ne vois pas quel est l’intérêt de faire une bibliothèque numérique régionale à partir du moment où les informations sont disponibles nationalement voire internationalement. Qu’est-ce que ça apporterait de plus que ce soit fédéré dans une instance régionale ? Je ne vois pas.
Alors quelle peut être l’action de la puissance publique dans ce domaine ?
Je pense qu’il faut que l’Etat et les collectivités publiques puissent être les garants de l’accessibilité des données et de leur pérennité. Les collectivités publiques peuvent également faciliter la mise en synergie des énergies et des compétences et contribuer à mettre en place une nouvelle offre de médiations.