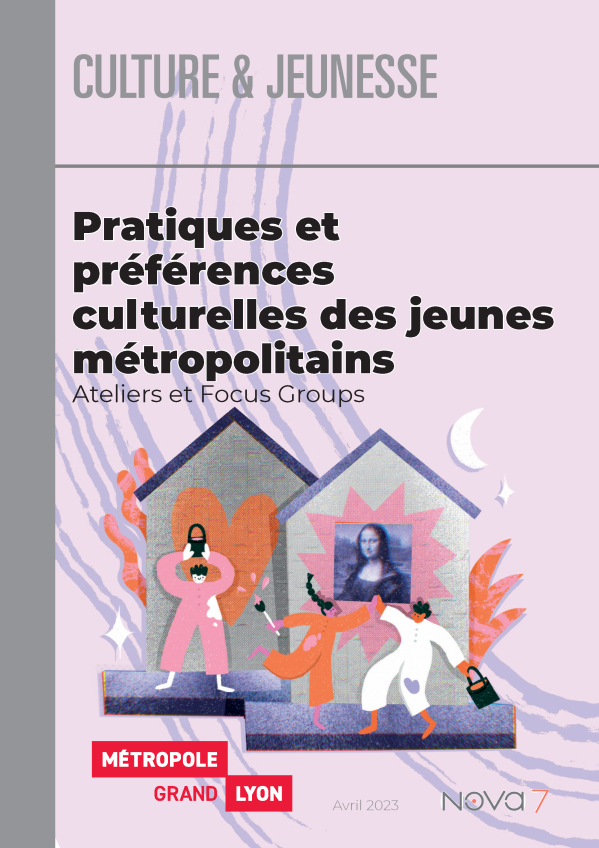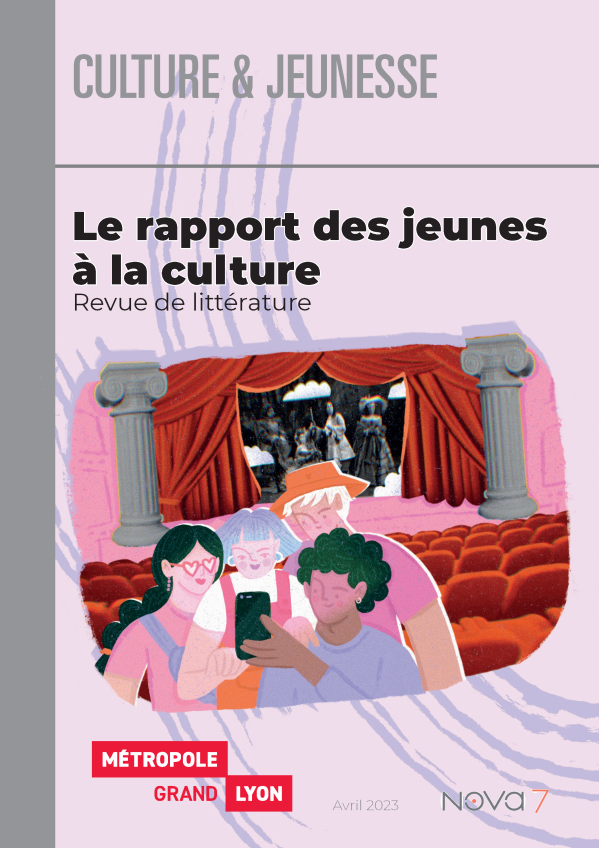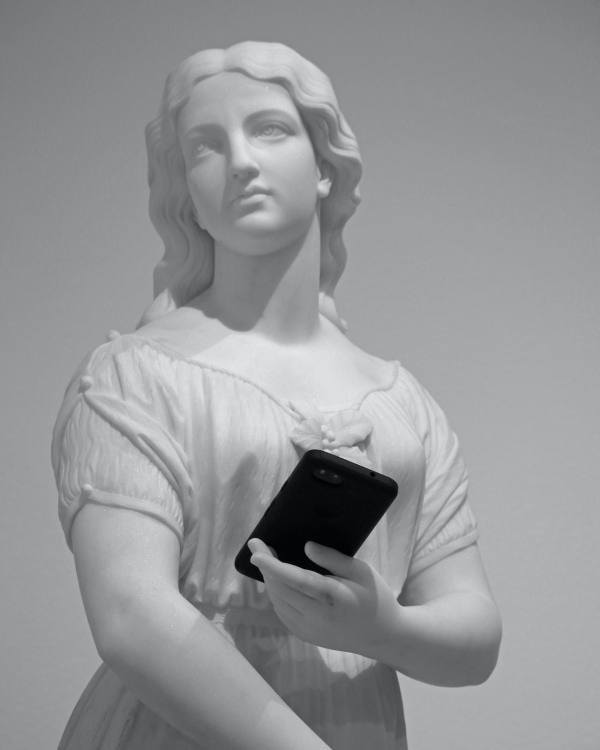On a connu plusieurs révolutions techniques dans l’histoire du concept art de jeu vidéo. Jusque dans les années 1990, le travail des concept artists - alors nommés illustrateurs - se faisait essentiellement de manière traditionnelle, avec des dessins techniques sur papier, mis en couleurs au crayon et parfois terminés à l’aérographe pour la gestion de la lumière… C’était un travail très artisanal, malgré le fait qu’on soit dans une industrie numérique. Il y avait une cohabitation entre cet univers très technique et des artistes issus du milieu de la bande dessinée, de l’animation ou de l’illustration, qui travaillaient de manière traditionnelle.
Il y a une première révolution, fin 1990 - début 2000, avec la démocratisation d’Internet. C’est en effet une période symbolique durant laquelle naissent les premières communautés artistiques en ligne, à la fois françaises et anglophones. Je pense à des salons comme « Café Salé » [créé en 2002, le site www.cfsl.net s'est imposé comme le premier portail francophone dédié à la création graphique ; plusieurs ouvrages compilant des créations de la communauté ont été publiés, NDLR] ou bien à conceptart.org. Ces communautés vont avoir une importance capitale dans le développement et la médiatisation de la discipline du concept art. C’est parallèlement à cette période que les artistes commencent à utiliser en nombre les outils numériques, notamment Photoshop qui est l’outil par excellence du concept artist à partir du début des années 2000. Les artistes s’interrogent d’ailleurs : faut-il passer au tout-numérique ou mélanger les deux approches ? Si oui, dans quelles proportions ? Ces débats animent pleinement les communautés émergentes de l’époque.
La deuxième révolution technique pour les concept artists, un peu plus récente, est celle liée à la démocratisation des outils 3D (Blender, Maya, 3DS Max, etc.). Pour beaucoup, ces outils sont l’opportunité de gagner du temps sur la production de leurs images, un temps alors réinvesti dans la phase d’exploration graphique et conceptuelle. Aujourd’hui, si beaucoup de concept artists choisissent de se spécialiser dans la 2D ou la 3D, la tendance générale est à l’hybridation. C'est-à-dire qu’ils travaillent dans leur outil 3D (ou directement dans le moteur de jeu) pour créer une structure intéressante, puis ils importent leur composition dans Photoshop pour procéder à un paint over.
Enfin, on peut voir une dernière révolution technique avec l’utilisation progressive des outils de réalité virtuelle, même s’il convient ici de mesurer le propos. Il y a certes un intérêt évident pour les artistes : plutôt que de produire dix concept arts pour imaginer une scène, on en produit un à 360° dans lequel on va pouvoir se déplacer librement. Pour un réalisateur ou un développeur, c’est un outil de projection inespéré ! Néanmoins, ces outils restent encore chers et très contraignants pour les artistes qui ne peuvent raisonnablement passer 10h chaque jour avec un casque VR sur la tête.
Le jeu vidéo est un médium numérique, il est donc conditionné par les évolutions technologiques et techniques. Néanmoins, ce n’est pas l’outil qui fait l’artiste. Ce que l’on doit retenir avant tout, c’est l’intention créative portée par l’image et non seulement la performance technique. À la suite de nombreux entretiens réalisés pour mon ouvrage Imaginaires du jeu vidéo, je constate une envie assez forte de la part des studios de jeux vidéo français à se détacher de la technique pour garantir l'intemporalité de leurs productions. Le mythe du dessinateur remplacé par la machine n’a jamais été aussi erroné !