Transition vers une économie circulaire : quels indicateurs territoriaux ?
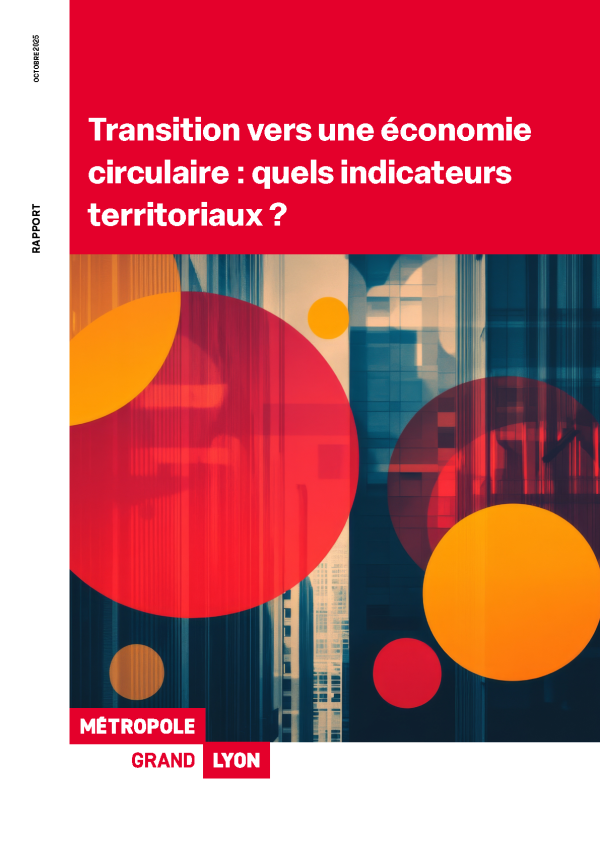
Étude
Comment évaluer son degré de déploiement ? Quels indicateurs privilégier avec quels objectifs ?
Interview de Jean-Louis Rastoin

<< Les critiques à l'égard du modèle conventionnel se font de plus e plus aigües >>.
Cette interview a été menée en 2018, alors que la Métropole de Lyon souhaitait se doter d’une stratégie alimentaire métropolitaine à l’occasion de l’ouverture de la Cité de la gastronomie à l’horizon 2019. L’identification des enjeux alimentaires du territoire s’appuyait notamment sur une série d’entretiens auprès d’experts du système alimentaire.
Dans cet entretien, Jean-Louis Rastoin souligne les impasses du système agroindustriel et évoque les voies possibles d’une alimentation plus durable. La territorialisation des filières alimentaires apparaît comme un levier de première importance.
Jean-Louis Rastoin est ingénieur agronome, docteur ès sciences économiques et agrégé de sciences de gestion, professeur honoraire à Montpellier SupAgro, fondateur et conseiller scientifique de la chaire Unesco en « Alimentations du monde ». Il anime le comité de rédaction de la revue « Systèmes alimentaires/ Food Systems » publiée par les Éditions Garnier à Paris. Expert associé du think tank Ipemed, il est membre de l’Académie d’Agriculture de France.
Vos travaux ont largement contribué à la compréhension du système alimentaire, et notamment des limites du modèle agroindustriel. Quelles sont-elles ?
Rappelons tout d’abord la définition donnée par Louis Malassis, fondateur de l’école francophone d’économie agroalimentaire : un système alimentaire est « la façon dont les hommes s’organisent dans l’espace et dans le temps, pour obtenir et consommer leur nourriture ». On peut également le définir comme un ensemble d’acteurs en interrelations orientés vers la satisfaction des besoins alimentaires d’une population. Les systèmes alimentaires sont le résultat d’une très longue histoire remontant au néolithique, avec aujourd’hui une grande diversité de formes dans le monde. On observe cependant depuis quelques décennies le développement hégémonique d’un système agroindustriel de production et de consommation de masse, spécialisé, concentré, globalisé et financiarisé, structuré par de très grandes firmes industrielles et commerciales. Ce modèle issu des pays occidentaux se diffuse désormais aux économies émergentes.
Avant d’évoquer les limites du système agroindustriel, j’ai coutume de rappeler les services qu’il a rendus au cours des dernières décennies. Il a permis à un pays comme la France, longtemps déficitaire en produits agricoles par rapport aux besoins de la consommation intérieure, d’entrer dans une ère d’abondance où les besoins alimentaires sont globalement largement satisfaits. La France dispose aujourd’hui d’une capacité de production de premier plan en Europe qui lui permet de figurer parmi les premiers pays exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires. Enfin, si l’on se place du point de vue du consommateur, le modèle agroindustriel a contribué efficacement à la réduction du coût des aliments et à l’amélioration de leur qualité sanitaire.
Mais l’expansion du système agroindustriel se heurte désormais à un certain nombre d’impasses aujourd’hui largement documentées. Du point de vue de la consommation alimentaire, plus de la moitié des habitants de la planète est en situation de malnutrition par carence (environ 1,5 milliard) ou excès (également 1,5 milliard), soit au total 40 % de la population mondiale actuelle, ce qui constitue un échec des plus alarmants et une lourde responsabilité pour les gouvernements et institutions internationales. Outre la sous-alimentation principalement présente dans les pays pauvres, il faut souligner le fardeau des maladies chroniques d’origine alimentaire (obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers…) qui se répandent de façon très rapide dans la plupart des pays du monde. On est donc face à un enjeu de santé publique de grande ampleur. Une étude remarquable récemment publiée au Royaume-Uni montre que les coûts cachés de l’alimentation (non incorporés dans le prix et en partie couverts par les transferts fiscaux) sont équivalents à la dépense alimentaire des Britanniques ! La moitié de ces coûts cachés concernent les dépenses de santé qui découlent d’une mauvaise alimentation.
Quelles sont les autres dérives du système agroindustriel ?
Le système agroindustriel se révèle également vulnérable au plan environnemental. Ses performances productives reposent sur une consommation importante d’énergies fossiles et de leurs dérivés (mécanisation, intrants chimiques, transport, transformation, réfrigération…). Cette dépendance aux énergies fossiles se traduit par une forte contribution aux émissions de gaz à effet de serre, dont les conséquences en termes de changement climatique impactent fortement en retour le système alimentaire. Le modèle « conventionnel » participe également de la dégradation des sols, de la qualité des eaux et de l’air, ainsi qu’au recul de la biodiversité. Concernant la biodiversité, une étude du CNRS qui vient de sortir indique que les populations d’oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse catastrophique — un recul d’un tiers en moyenne en quinze ans — en raison principalement des pratiques agricoles. Les fondateurs de l’agriculture biologique, dans la première moitié du XXe siècle (Rudolf Steiner, Albert Howard, Masanobu Fukuoka, Hans-Peter Rusch) au moment du démarrage de l’intensification chimique, ont été des lanceurs d’alerte insuffisamment écoutés, en particulier de la communauté scientifique. Enfin, on peut mentionner les limites socio-économiques. En effet, comment se satisfaire d’un système où la concentration des acteurs induit de forts déséquilibres de la répartition de la valeur au sein des filières, où la course à la productivité se traduit par un effondrement du nombre d’agriculteurs et menace le tissu des TPE et PME agroalimentaires, où une large partie des denrées alimentaires est gaspillée entre le champ et l’assiette.
Que serait un système alimentaire plus durable ?
C’est un système alimentaire permettant, selon la définition de la FAO, à chacun d’accéder à une alimentation suffisante, saine et privilégiant la qualité nutritionnelle, organoleptique et culturelle des produits. C’est aussi un système reposant sur des modes de production soutenables, c’est-à-dire favorables à la préservation des ressources naturelles sur lesquelles repose notre alimentation : les sols, l’eau, la biodiversité, l’énergie, etc. C’est enfin un système organisant les filières alimentaires sur des principes de répartition équitable de la valeur entre les différents maillons — producteurs, transformateurs, distributeurs — et de gouvernance ouverte à l’ensemble des parties prenantes.
La transition du système alimentaire vers un modèle plus durable questionne en particulier les modes de production agricole. Quelles sont les alternatives au modèle conventionnel ?
Les critiques à l’égard du modèle conventionnel se font effectivement de plus en plus aigües. Aujourd’hui, deux notions alternatives se dégagent : l’agriculture biologique, qui est adossée à un label officiel, et l’agroécologie. Le bio se caractérise avant tout par l’exclusion de l’usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et une limitation de l’emploi d’intrants. L’agroécologie constitue une approche plus large qui consiste à concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle implique le recours à un ensemble de techniques en synergie permettant d’utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement.
Par exemple, au lieu de recourir aux traitements phytosanitaires afin de lutter contre les maladies et les ravageurs, l’agroécologie utilisera les prédateurs et les parasites naturels de ces bio-agresseurs pour les maîtriser. En matière de fertilisation, plutôt que d’apporter des engrais chimiques de plus en plus coûteux et très polluants, l’agroécologie met en synergie cultures, élevages et forêts. En réunissant les termes agriculture (au sens large) et écologie, l’agroécologie fait aujourd’hui consensus pour désigner la transition vers des modèles agricoles plus durables. Quoi qu’il en soit, les avantages environnementaux et sanitaires du bio et de l’agroécologie par rapport au modèle conventionnel paraissent incontestables. Il ne faut toutefois pas oublier que l’agriculture ne constitue que l’un des maillons de la chaîne alimentaire et que tous les autres (industries et services) doivent évoluer en profondeur pour que l’on parvienne à une alimentation durable.
Quelles différences entre ces alternatives et le modèle conventionnel en matière de productivité, de travail et de rémunération de l’agriculteur ?
Il y a encore peu d’études comparatives concernant la productivité, sauf pour l’agriculture bio versus agriculture conventionnelle. Selon le degré de maitrise technico-économique, le conventionnel présente une productivité du travail et de la terre (rendements par unité de travail ou par ha) supérieure de 5 à 30 % par rapport au bio. La maitrise technique peut donc permettre d’atteindre des performances proches. Ce qui veut dire une compétence, une expertise, un accompagnement et une organisation accrus du producteur en mode bio ou agroécologique. Ces modèles se révèlent ainsi plus riches en emplois, ce qui n’est pas anodin au regard de la tendance historique au recul de l’emploi agricole.
Notre consommation alimentaire reposant en très large majorité sur des produits transformés commercialisés via les circuits de la grande distribution, quel rôle revient aux industries de transformation et aux grandes enseignes dans la transition vers un système plus durable ?
C’est peu dire que ces acteurs ont un rôle important à jouer. Ce que l’on reproche aujourd’hui à l’agriculture est indissociable de la demande qui lui est adressée par l’aval. Les exigences des Industries agroalimentaires (IAA) et les grandes enseignes en termes de prix, de volumes, de spécifications techniques jouent un rôle incontestable dans la poursuite de la logique productiviste et ses dérives. En raison de son poids dans les dépenses alimentaires des ménages et de sa forte concentration, la grande distribution bénéficie d’un pouvoir de marché considérable à l’égard de ses fournisseurs. En phase avec un modèle économique fondé sur la vente en grands volumes de produits à prix bas, elle se caractérise par des logiques d’approvisionnement mettant l’accent sur la compétition par les coûts, incarnée par le regroupement des centrales d’achat.
Ceci a bien évidemment un impact sur les pratiques d’approvisionnement des industries de transformation puisque les matières premières représentent une part significative (variable selon les filières) de leurs couts de production. In fine, les exploitations agricoles se trouvent réduites à un rôle de producteurs de denrées standardisées échangeables sur des marchés globalisés. Les problématiques de qualité des produits alimentaires ne se jouent donc pas seulement au niveau des matières premières, mais également au stade de la transformation : excès de sels, gras, sucre, adjonction d’ingrédients artificiels, faible teneur en nutriments, peu de prise en compte de toutes les composantes organoleptiques et culturelles…
Par ailleurs, le pilotage par les prix exercé par la grande distribution et les industriels de l’agroalimentaire se traduit également par une répartition déséquilibrée de la valeur au sein des filières. Comme le montrent les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, sur 100 € de dépenses alimentaires des ménages : seulement 6,5 € reviennent à la production agricole nationale, 25 € rémunèrent des importations finales ou intermédiaires, 59 € reviennent à l’aval dont 15,4 € pour le commerce, 13,7 € pour la restauration et 11,9 € pour les industries agroalimentaires. Cette situation est assez frappante, car du point de vue de son contenu économique, l’alimentation renvoie de moins en moins à la production de denrées agricoles.
Les États Généraux de l’Alimentation (EGA) laissent-ils entrevoir une évolution de la situation de ce point de vue ?
Les EGA ont soulevé beaucoup d’espoirs, hélas le résultat est pour le moins décevant. Comme l’ont montré les débats, l’idée que le développement d’une offre alimentaire plus saine et plus respectueuse de l’environnement implique une évolution des pratiques des IAA et de la distribution a progressé. Mais au-delà d’une belle « charte d’engagement » sur la base du volontariat, on ne voit aucune action et régulation concrètes pour orienter les pratiques en matière nutritionnelle, environnementale et sociale.
Comment voyez-vous évoluer le modèle agroindustriel à l’avenir ?
Je pense qu’il est loin d’avoir dit son dernier mot. La globalisation, la concentration et la financiarisation des firmes de la distribution, de la transformation, des agrofournitures et, de plus en plus, de la production agricole, constituent un mouvement puissant. Les tenants du modèle agroindustriel anticipent la poursuite de la course à la taille, tout en s’efforçant de réduire les externalités négatives à grand renfort de technologies (biotechnologies, génomique, big data…). C’est l’exemple de la ferme des 1 000 vaches qui fait couler beaucoup d’encre. De ce point de vue, il me parait important de souligner deux points. Le premier concerne le secteur des agrofournitures — semences, intrants chimiques, machines, etc. Celui-ci constitue le maillon du système alimentaire dont les acteurs sont les plus concentrés, comme l’illustre la fusion géante entre Bayer et Monsanto. Ce sont ces méga-firmes qui ont le plus intérêt au maintien du modèle agroindustriel qu’elles ont contribué à forger. Si demain une loi imposant les critères d’une alimentation durable était adoptée (on peut rêver), ils se trouveraient en grande difficulté !
Par ailleurs, il convient d’être attentif aux risques inhérents à la financiarisation de l’ensemble des acteurs du système agroindustriel qu’implique ce modèle. Il appelle en effet des capitaux de plus en plus importants pour produire, capitaux qui ne sont plus à la portée d’un exploitant. Ceci soulève notamment la question de la vente de terres agricoles à des investisseurs étrangers. On a eu le cas récemment en Picardie où des investisseurs chinois ont pu, du fait d’un vide juridique, acquérir 5 000 hectares. À une autre échelle, on voit émerger des exploitations de 100 000 hectares dans un pays comme le Brésil. Parce qu’il place l’agriculture dans une situation de dépendance à l’égard des marchés financiers, ce modèle apparaît dangereux. Une bulle spéculative explose, les actionnaires se retirent de l’agriculture et tout s’effondre comme un château de cartes… Favoriser le développement de modèles alternatifs apparaît indispensable.
Le changement peut-il venir du consommateur ?
Les consommateurs et les citoyens ont, j’en suis convaincu, un rôle essentiel à jouer. La transition vers une alimentation plus durable appelle en effet une évolution des choix des consommateurs. On prend conscience de la nécessité de favoriser des régimes alimentaires plus sains et moins impactant sur l’environnement. Selon les nutritionnistes, une bonne alimentation est avant tout pauvre en protéines animales, riche en fruits, légumes et fibres (céréales et légumineuses), proportionnée à l’activité. Par ailleurs, l’évolution de la demande reste un levier majeur pour stimuler une évolution de l’offre ! Or, on observe une inflexion des attentes des consommateurs à l’égard de leur alimentation. Les priorités qui étaient données jusqu’ici aux facteurs de prix, apparence, rapidité, sureté, laissent peu à peu la place à la santé, la naturalité, le goût, la transparence. Aujourd’hui, on peut estimer à 20 % les consommateurs français s’inscrivant dans une volonté de reconquérir leur alimentation. Ils ont compris que ce qu’ils mangent pouvait impacter lourdement leur santé et la nature, ils s’inquiètent de la santé de leurs enfants et sont en recherche de produits de qualité nutritionnelle élevée, de produits bio… dont ils interrogent de plus en plus la provenance (« d’où ça vient ? ») et les modes de fabrication (« comment, par qui ? »). Ce segment de marché se développe de façon accélérée et cela n’échappe pas à la grande distribution et à l’industrie agroalimentaire.
Les consommateurs sont-ils prêts cependant à payer le prix d’une alimentation plus durable ?
Le modèle agroindustriel centré sur le « culte du prix bas » a habitué le consommateur à consacrer une part réduite de son budget à l’alimentation. Le cout des produits de meilleure qualité peut effectivement se heurter à l’idée que les consommateurs se font du « juste prix » des denrées alimentaires. Comme je l’indiquais précédemment, environ 20 % des consommateurs français ont d’ores et déjà franchi le pas et donnent une importance nouvelle à leur alimentation. Pour le reste, le changement de perception et de pratiques passe avant tout par l’éducation de la maternelle à l’université du 3e âge, par la communication générique à travers notamment le Programme national nutrition santé, et l’encadrement de la publicité commerciale dont l’influence au sein du modèle agroindustriel n’est plus à démontrer. L’éducation à l’alimentation ne doit pas porter seulement sur les liens avec la santé, mais doit intégrer les questions concrètes touchant à la pratique culinaire — réinvestir dans la fonction alimentaire — et la gestion du budget. L’adhésion est notamment conditionnée par une construction d’image positive et valorisante de l’alimentation durable. En outre, la fiscalité doit contribuer à corriger les distorsions de concurrence entre produits alimentaires « durables » et « non durables ». Enfin, le cas des 10 % de la population française sous le seuil de pauvreté doit faire l’objet d’un accompagnement spécifique pour parvenir à une véritable « démocratie alimentaire » à travers une offre alimentaire accessible à tous.
Vous dites que la grande distribution et les industriels sont attentifs aux évolutions des attentes des consommateurs, c’est-à-dire ?
On voit effectivement se mettre en place de nouvelles stratégies pour répondre à ces attentes. Le plus évident ce sont les linéaires consacrés au bio dans les magasins qui ne cessent de s’étendre, ainsi que la remise en question des hypermarchés aux profits des surfaces de vente de proximité de taille plus réduite. Plus délicate est la question des centrales d’achat : faire plus qualitatif, plus bio, plus local est-il compatible avec leur fonctionnement actuel ? Sur ce point, le mode organisationnel des grandes enseignes constitue un facteur important à prendre en compte. D’un côté, nous avons le modèle dit « intégré » de Auchan, Carrefour ou Casino, où les magasins appartiennent ou dépendent de grandes enseignes nationales. L’autre modèle, « succursaliste », est décentralisé et donne une large autonomie aux magasins dont les propriétaires gestionnaires sont indépendants : Leclerc, Intermarché, Système U. Ce second modèle me parait plus favorable à une substitution d’achats centralisés de « produits globaux » pilotés par les prix par des achats de « produits locaux » avec une attention accrue aux critères de qualité. L’enseigne Système U me parait être un bon exemple. Elle a engagé une démarche de développement des approvisionnements en filières courtes et durables et entend bien en faire un axe de différenciation fort. Dans les rayons, les produits locaux sont beaucoup plus présents. Autre exemple, Biocoop : au départ cette enseigne communiquait avant tout sur le fait de proposer exclusivement des produits bio, aujourd’hui elle met l’accent sur le « bio local ».
Mais encore faut-il avoir ces produits à disposition ?
Effectivement, dès lors que les 20 % de consommateurs pionniers que j’évoquais passeront à 30 ou 40 % du marché, vous imaginez les enjeux en termes d’approvisionnement. Il faut pouvoir disposer de fournisseurs en capacité de proposer des produits dont on peut garantir la proximité, la qualité, la transparence. Or cela n’a rien d’évident pour les industriels agroalimentaires dont l’organisation repose généralement sur de grosses usines calibrées pour permettre de fortes économies d’échelle et des volumes importants. Par définition, les aires d’approvisionnement et de marché de ces unités de production dépassent largement leur territoire d’implantation. À contrario, les nouvelles exigences en matière d’approvisionnement poussent à des formes de « downsizing » de l’outil de transformation et des filières d’approvisionnement agricole. Certains industriels freinent des quatre fers face à ces évolutions. Le scandale récent autour du lait contaminé de Lactalis reflète ainsi la faible volonté de transparence de certains acteurs. D’autres entreprises en revanche cherchent à s’adapter et voient un intérêt stratégique à changer de modèle.
Quel intérêt peuvent-elles trouver à sortir du modèle agroindustriel ?
Ce qu’il faut comprendre c’est que la logique déflationniste du modèle agroindustriel ne permet plus aux producteurs et aux transformateurs de créer de la valeur. Se maintenir dans une compétition par les couts pour des produits standardisés apparait de plus en plus difficile. À mon sens, les acteurs ont tout intérêt à opter pour une différentiation qualitative totale : organoleptique, nutritionnelle, culturelle et durable. C’est en valorisant les patrimoines alimentaires nationaux, et donc des territoires, que les entreprises seront en mesure de reconquérir le consommateur et de se redonner des perspectives de développement sur le marché intérieur et au-delà.
Face aux limites du modèle agroindustriel, on voit émerger la notion de « système alimentaire territorial ». De quoi s’agit-il ?
La communauté scientifique, les ONG et les organisations internationales ont fait émerger le concept de « système alimentaire territorialisé » (SAT) en croisant les concepts de territoire et de filière agroalimentaire. Un SAT peut être défini comme un ensemble cohérent de filières alimentaires intégrées localement, c’est-à-dire produisant et valorisant des denrées alimentaires dans une logique de proximité, par opposition aux filières longues de la mondialisation agroalimentaire.
En quoi la territorialisation du système alimentaire est-elle favorable à une transition vers une alimentation plus durable ?
L’alimentation « reterritorialisée », car elle l’était encore il y a un demi-siècle en Europe, est source de durabilité, car elle est fondée sur une triple proximité. Proximité au stade de la production agricole en « reconnectant » les filières végétales, animales et forestière, selon les préceptes de l’agroécologie. Proximité entre les différents maillons des filières par le rapprochement entre agriculture, artisanat et industries alimentaires. Ceci implique que l’approvisionnement des unités de transformation s’appuie en priorité sur des matières premières agricoles de la région où elles sont implantées. Cette mise en réseau local des acteurs des filières permet de privilégier une agriculture familiale et des réseaux de PME et TPE agroalimentaires, des circuits de commercialisation positionnés sur le local et de mieux partager la valeur. Troisièmement, la proximité culturelle. Le développement d’une offre locale plus abondante et variée est favorable à une réorientation de la demande alimentaire. Des études ont montré en effet que plus les filières sont longues et moins la qualité nutritionnelle est au rendez-vous. Les produits s’inscrivant dans une logique de terroir — et bénéficiant des labels européens d’indication géographique — constituent également un facteur de différenciation de la production locale sur les marchés extérieurs et un facteur d’attractivité touristique.
D’une manière générale, la proximité entre l’ensemble des acteurs du système est favorable à la définition de nouveaux modèles de production respectueux de la santé des consommateurs, intégrant une bonne gestion des ressources naturelles, facilitant la lutte contre les gaspillages tout au long de la chaine alimentaire. Selon le principe de souveraineté alimentaire, les SAT permettent d’augmenter l’auto-approvisionnement des territoires et ainsi leur résilience face aux vulnérabilités des filières longues du modèle agroindustriel.
Comment accompagner la transition des modes de production ?
Elle appelle en premier lieu un effort intense de formation et d’innovation. La mise en place de nouveaux itinéraires de production agroécologiques implique en effet des compétences renouvelées. Elle suppose de bien observer la nature, de mieux en comprendre le fonctionnement et de savoir en tirer parti. L’approche agroécologique n’est donc pas un retour au passé, elle appelle quantité d’innovations, mais qui ne reposent plus sur les mêmes leviers (agrochimie, mécanisation, etc.). Les travaux scientifiques autour de l’agroécologie connaissent un développement important en France et dans le monde, mais c’est encore insuffisant. Il y a un enjeu fort concernant la réorientation de la recherche agronomique vers l’agroécologie. L’INRA a été créée autour d’un objectif d’accroissement de la productivité de l’agriculture française qui a été largement atteint. Désormais la recherche doit intégrer pleinement performance économique et performances environnementale et sociale. Or force est de constater qu’un organisme comme l’INRA peine à changer de cap, c’est-à-dire concrètement à redéployer les postes de la recherche agrochimique vers la recherche agroécologique et plus généralement dans le champ de l’alimentation durable. Il manque encore une volonté politique pour mettre véritablement la recherche publique au service de la transition vers des modèles de production plus durables. D’un point de vue territorial, cela questionne bien évidemment les capacités d’enseignement et de recherche présentes localement. À Montpellier, par exemple, avec Agropolis, il existe une collaboration ancienne entre la communauté académique et les acteurs territoriaux sur les questions agricoles et alimentaires. À Lyon, il faudrait s’efforcer de mobiliser les chercheurs et les enseignants au service du système alimentaire local.
L’installation et la transmission des exploitations sont-elles également des moments charnières pour favoriser la mise en place de nouveaux modèles de production ?
Absolument. Tout porte à croire que la transition agroécologique sera portée par une nouvelle génération d’agriculteurs. La majorité des exploitants actuels parait trop formatée par le modèle conventionnel pour devenir la cheville ouvrière du changement. On assiste en particulier à l’arrivée croissante de néo-ruraux, souvent diplômés (ingénieurs, diplômés bac+5…), qui s’installent sur la base des principes agroécologiques, développent une transformation à la ferme ou en lien avec des PME-TPE agroalimentaires, commercialisent en circuits courts, etc. Ils mettent en place des modèles économiques qui tiennent la route, gagnent relativement bien leur vie. La question de la transmission entre les anciens et les nouveaux constitue un enjeu majeur dans la mesure où une large partie des exploitants actuels s’approchent de la retraite et bien souvent ne trouvent pas de repreneur au sein du cadre familial. Je pense que les pouvoirs publics ont un rôle considérable à jouer pour développer la formation sur les nouveaux modèles agricoles et accompagner la transmission des exploitations et l’installation des nouveaux exploitants
Ce qui nous amène à la question clé de l’accès au foncier agricole…
En effet, le principal frein à l’installation de nouveaux producteurs est l’accès au capital foncier. Cela coûte très cher. Or s’il y a un levier stratégique pour l’avenir de l’alimentation que détiennent les collectivités locales c’est bien le foncier ! De ce point de vue, on voit des initiatives territoriales très intéressantes visant à privilégier l’agriculture dans l’usage des sols. Par exemple, l’agglomération de Montpellier a mis en place un projet alimentaire territorial qui a permis de geler le développement urbain sur certaines parties du territoire au profit de l’installation de maraîchers. Toujours en Hérault, des coopératives viticoles se sont lancées dans l’achat de terres pour installer des viticulteurs et maintenir leur volume d’activité. Le crowdfunding est également un bon moyen de mobiliser l’épargne des citoyens pour financer l’acquisition de terres agricoles. Toutefois ces initiatives n’annulent pas le besoin d’une loi protégeant les terres agricoles des investissements financiers de nature spéculative.
Vous évoquez également les possibilités de diversification du modèle économique des exploitations agricoles ?
En termes de développement territorial, il est important de souligner les nouvelles opportunités qui s’offrent aux exploitations. La production de denrées alimentaires peut être l’occasion de mettre en place de nouveaux process valorisant les résidus et coproduits. Par exemple, la méthanisation des déchets végétaux et animaux peut permettre de générer du biogaz, de l’électricité, mais aussi une source de fertilisant alternative aux engrais chimiques. On parle aussi de multifonctionnalité lorsque l’agriculture est rémunérée pour préserver la biodiversité ou la qualité de la ressource en eau, pour accueillir des touristes, etc. Je suis convaincu qu’il n’y aura pas de solution à la question de la rémunération des agriculteurs sans favoriser une diversification de leurs activités.
En matière de gouvernance des systèmes alimentaires territoriaux, comment appréhendez-vous la mobilisation des différents acteurs des filières ?
Outre la question des relations urbain-rural, je pense que la gouvernance alimentaire se joue à deux niveaux. Il y a besoin d’une part d’une gouvernance horizontale réunissant des représentants « éclairés » des différentes composantes du système alimentaire territorial : agrofourniture, agriculture, artisanat et IAA, canaux de commercialisation, restauration, associations de consommateurs, chambres consulaires, animateurs des mouvements associatifs-citoyens, État et collectivités territoriales. Il est indispensable d’avoir la totalité des acteurs et de viser le pluralisme de points de vue. Par ailleurs, la construction de filières alimentaires locales implique également une gouvernance « verticale » par filière en s’inspirant des interprofessions. En effet, les logiques technico-économiques de chaque filière sont très spécifiques. Mais il serait bon d’élargir le tour de table de chacune de ces filières aux associations de consommateurs et citoyennes et aux pouvoirs publics. Enfin une gouvernance inter-filières parait également souhaitable afin d’appréhender les enjeux transversaux. La construction d’une telle gouvernance ferait vraiment sens à Lyon qui se targue d’être la capitale de la gastronomie.
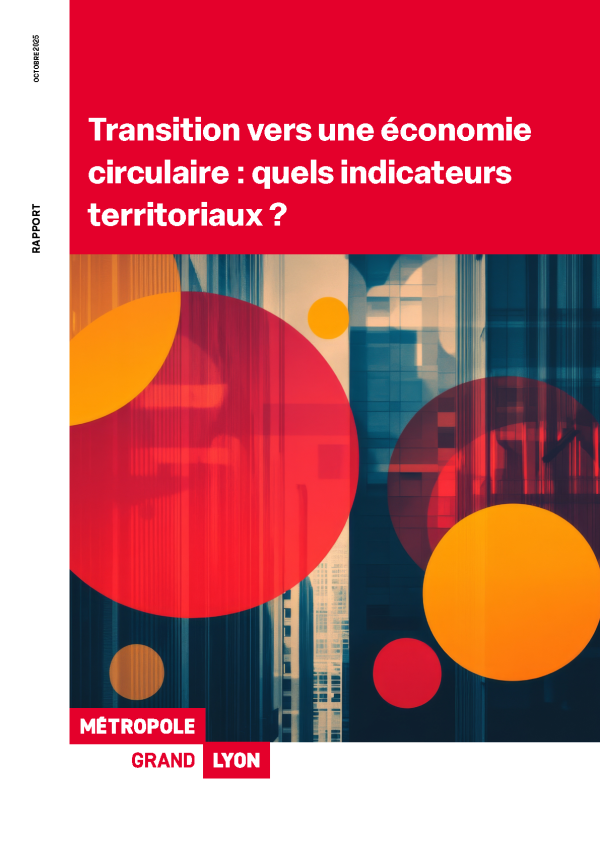
Étude
Comment évaluer son degré de déploiement ? Quels indicateurs privilégier avec quels objectifs ?

Article
Quels secteurs sont amenés à décroître, et quels autres vont au contraire devoir recruter ?

Article
Découvrez nos sept leviers à actionner pour consolider l’économie de votre territoire et améliorer sa soutenabilité !

Article
Ces renoncements ont un coût.

Article
Le défi de la transition économique est immense, complexe, car il implique des transformations des activités et des modèles.
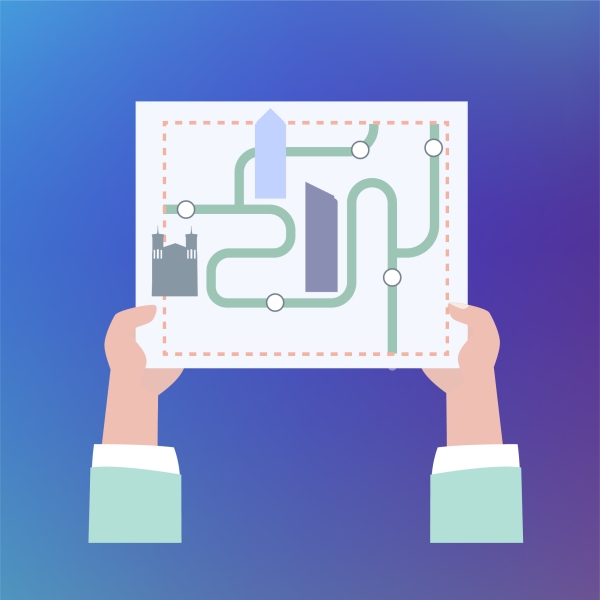
Article
Entre soutenabilité et exploitation des ressources, chaque décision ouvre la porte à un dilemme !

Interview de David Le Bras
Délégué général de l’Association des directeurs généraux des communautés de France
Et si… la transformation écologique devenait la matrice des politiques intercommunales ? Retour sur cette réflexion collective.
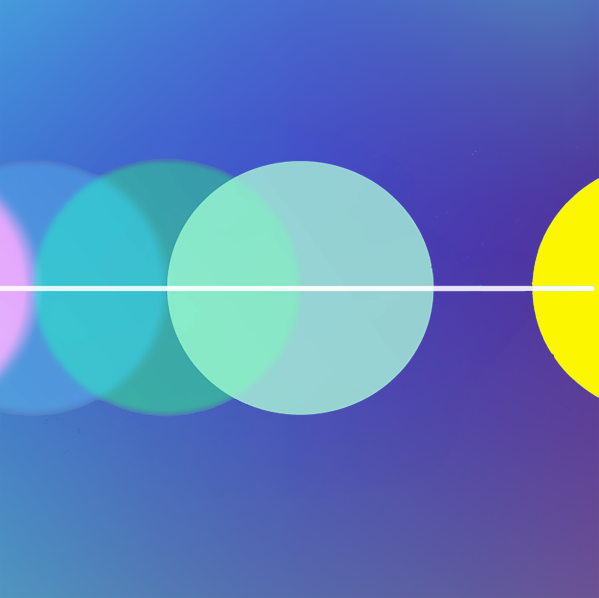
Dossier
Ce dossier donne de premières clefs pour interroger de manière lucide les leviers de transformation de nos entreprises et de leurs modèles.

Article
En quoi la transition vers le véhicule électrique est-elle réellement bénéfique pour le climat ?