Veille M3 / Des villes intelligentes aux habitants éclairés

Article
Dans une perspective démocratique, la politique est-elle une « technique » réservée aux sachants ou un « art » ouvert à toutes et tous ?
Interview de Jérôme GOFFETTE

<< Les histoires de robots sont un laboratoire extraordinaire parce que tout y est transformable et possible. Elles facilitent la réflexion en la radicalisant >>.
Vous êtes philosophe, impliqué dans la Faculté de médecine de Lyon-Est de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et, au sein de votre laboratoire, S2HEP, vous travaillez avec des anthropologues. Sur quoi portent vos recherches ?
Effectivement, nous sommes fortement impliqués dans le domaine médical. Avec Evelyne Lasserre (S2HEP, Univ. Lyon 1) et Axel Guïoux (CREA, Univ. Lyon 2), tous deux anthropologues, nous travaillons sur le corps et ses dynamiques face aux pathologies, aux traitements, aux handicaps, et aux améliorations sans but médical (modifications corporelles, dopages, modulation de l’humeur...). Nos préoccupations de recherche portent donc sur les transformations corporelles et surtout sur leurs retentissements, à la fois pour la personne et pour les représentations sociales. Dans tous les cas, nous cherchons à clarifier la manière dont se construit le schéma corporel ou l’image du corps, expressions qui viennent des sciences cognitives et de la psychologie.
Ces termes, qui sont un peu anciens mais qui ont encore cours, sont retravaillés car ce champ de réflexion reste encore en chantier et de nombreuses conceptions théoriques ne sont pas claires. En ce sens, nous poursuivons des travaux entamés il y a plus d’un siècle et toujours en élaboration. Par exemple, au début du 19ème siècle, le philosophe Pierre Maine de Biran a développé la notion de « corps propre », qui désigne non pas le corps biologique mais le corps tel qu’on se l’approprie par l’action, le corps vécu, les gestes, le style corporel. Un tel concept change et complète assez profondément la vision de ce qu’est le corps. Par exemple, lorsqu’on écrit, on ne pense pas au mouvement de sa main, mais à ce qu’on écrit. Le geste traverse le corps organique et suppose une maîtrise née de l’apprentissage corporel. Le corps propre se prolonge au-delà du corps organique car, pour reprendre l’exemple de l’écriture, on sent la pointe du stylo sur le papier, on l’intègre pour en faire un élément du corps propre. Ce qui vaut pour le stylo vaut pour n’importe quel outil qui permet de prolonger son corps dans une action. A l’inverse, il existe des parties de notre corps biologique que l’on ne sent pas et qui ne font pas partie du corps propre. A-t-on un corps propre des zones du poignet ou de nos organes comme le foie, la rate, etc. ? Habituellement non. En revanche, certains malades voient une transformation de leur corps propre lorsque leur pathologie procure des sensations inhabituelles, par exemple une douleur à l’estomac. On expérimente et on construit alors un corps propre renouvelé. Lorsque les malades sont atteints de pathologies lourdes, comme des cancers, par exemple, avec de la chirurgie, cela peut devenir un travail long et compliqué puisque cela induit une dynamique corporelle qui retentit sur les sensations, les émotions, l’identité corporelle, l’estime de soi, etc.
Pour résumer, on voit que l’expérience du corps change selon nos états et nos outils et que ces expériences nous conduisent à un apprentissage particulier qui vise une nouvelle maîtrise du corps propre. Tout cela met en jeu la capacité plastique de notre psychisme à intégrer de nouveaux éléments (outils ou dispositifs artificiels) et soulève des interrogations sur l’identité personnelle et la manière de s’inscrire socialement.
En quoi cette notion de corps propre peut-elle nous aider à penser le robot et éclairer soit nos ressemblances soit nos dissemblances avec eux ?
Qu’est-ce qui se passe à l’origine d’un être humain ? In utero le psychisme essaie d’intégrer un corps qui est d’abord assez étranger faute de développement et d’apprentissage. Une fois né, l’homme s’approprie progressivement son propre corps, puis des éléments extérieurs, des outils, etc. Il élabore une dynamique de constante réappropriation du corps selon les âges de la vie (enfance, puberté, vieillesse, etc.), selon ses états de santés ou les outils qui sont disponibles. C’est un apprentissage gestuel, fonctionnel, affectif, identitaire vis-à-vis de soi et des autres. Si la plupart des robots existants n’ont pas de corps propre, on peut néanmoins se demander si certains types très particuliers de prototypes de robots récents pourraient faire un apprentissage similaire (bien qu’encore embryonnaire) de leur « corps » ou en tout cas de quelque chose du même type. A quel point est-ce semblable ou différent ? C’est une vraie question.
Mais des travaux ont été conduits sur des petits robots-chiens dans lesquels on implante un programme de motivation intrinsèque qui leur donne une sorte de capacité d’apprentissage corporel, tâtonnant. En quelques heures, le robot-chien qui ne savait pas marcher parvient à le faire. Dans d’autres cas, le robot-chien apprend d’abord à courir puis ensuite à marcher…
La conscience de soi pourrait passer par l’apprentissage de notre « corporéité » ?
Cela est difficile à dire dans la mesure où la notion même de conscience reste obscure. Mais en tout cas, il y a là quelque chose d’intrigant. Une expérience de robotique similaire a été faite, non plus sur l’apprentissage de la marche, mais sur l’apprentissage du langage. On se rend compte que des groupes de robots parviennent à créer une communication structurée et ainsi à échanger des informations. Mieux encore, à partir d’un même programme d’apprentissage, ils peuvent produire des structurations différentes, avec des syllabes différentes, une syntaxe, etc. Il est toutefois difficile de statuer sur la question de savoir si c’est une métaphore véritable des situations humaines ou s’il ne s’agit que d’une analogie.
On ignore aussi si nous devons tous passer vraiment par les mêmes phases de développement pour parvenir à développer une fonction identique. Il est probable qu’il y a à la fois une certaine souplesse et des limites structurelles. Il se peut donc que les machines futures passent par d’autres voies pour atteindre des fonctions similaires aux nôtres, comme l’appropriation corporelle, la communication, la reconnaissance d’autrui, l’attribution d’un soi, voire quelque chose comme une conscience. Ce sont des interrogations dont les prémisses se trouvent chez Descartes, Berkeley, etc. Comment construit-on notre vision du réel, de nous-mêmes, de notre corps ? Voilà des questions radicales dont on ignore beaucoup de choses concernant l’homme et concernant les robots à venir, peut-être. En tout cas, les questions que nous posent les robots nous renvoient à des questions sur nous-mêmes et sur des sujets qui avaient été délaissés par les scientifiques pendant des années, comme la conscience.
Ou place-t-on la frontière entre l’homme et le robot ? Si on reprend les expériences de pensée qui consistent à progressivement remplacer du biologique par du mécanique, quand cesse-t-on d’être humain pour devenir d’abord cyborg, puis entièrement robot ?
J’aurais tendance à penser qu’à partir du moment ou on utilise un concept comme celui de « corps propre » cette question perd une bonne partie de son sens, mais ouvre un autre horizon de réflexion. L’utilisation d’un outil fait déjà de nous, peu ou prou, des cyborgs. Lorsqu’il s’agit d’un outil banal, cela ne pose pas de problème d’adaptation ni d’acceptabilité. Si on saisit une pelle, immédiatement notre schéma corporel se modifie pour intégrer la pelle, en tenant compte de son poids, de sa forme, tout en maintenant notre équilibre et en ajustant nos tensions musculaires, par exemple. Les prothèses externes, en démultipliant les possibilités, ouvrent des perspectives passionnantes. Mais on peut aller plus loin, vers des moyens de se prolonger qui s’intègrent cette fois-ci à l’intérieur du corps.
Exoprothèses et endoprothèses sont des outils et des éléments corporels ouvrant de très nombreuses perspectives, avec une variété infinie de formes, de fonctions, et d’interface de sensations ou d’actions entre le psychisme et ces prothèses. Derrière votre question, se trouve en fait une autre question : qu’est-ce qu’un être humain ? Un esprit ? Une forme de psychisme ? Une forme psychique et corporelle ? Selon la réponse à cette question on répondra différemment à la vôtre.
La question centrale est toujours la relation au corps. Est-ce que, derrière cette question, on ne cherche pas à savoir si l’homme n’est pas autre chose que son corps. Est-ce qu’on ne cherche pas à savoir si l’homme ou l’humanité de l’homme ne relève ni du biologique ni du mécanique, mais est encore ailleurs ? Et dans ce cas, quelle est la limite à la transformation ?
Je crois que la limite pratique à la capacité de transformation, c’est l’apprentissage, c'est-à-dire notre capacité à intégrer de nouveaux outils. Mais, surtout, la limite éthique souhaitable, c’est de parvenir à déterminer si ces nouvelles possibilités sont d’un usage épanouissant ou, au contraire, aliénant. C’est la grande problématique des Temps modernes de Charlie Chaplin, qui décrit la soumission de l’homme à la cadence, à la machine, ou encore du mouvement luddiste, si on se souvient des protestations de Ned Ludd devant la pullulation des machines lors de l’industrialisation et la soumission des hommes aux machines. Mais la possibilité inverse, épanouissante, humanisante, est aussi présente, quand il s’agit d’ouvrir des possibilités d’action souhaitées par les êtres humains. Le projet de recherche que nous menons, avec Evelyne Lasserre et Axel Guïoux, sur l’utilisation de l’informatique et des jeux en ligne par des personnes handicapées physiques montrent qu’elles y trouvent une façon de s’affranchir en partie de leur handicap, de la stigmatisation sociale et de l’incapacité physique, et qu’elles peuvent vivre des sensations corporelles ainsi qu’une socialisation humainement enrichissante. Pour répondre à votre question, je dirais que la limite concrète à cette expansion de l’association bio-mécanique, cyborgique, est la capacité et le temps de l’apprentissage que nécessitera chaque nouvel élément prothétique à intégrer. Je dirais aussi que la limite éthique, tout aussi importante, est celle qu’il convient de placer entre des cyborgisations humanisantes et d’autres déshumanisantes, entre des cyborgisations qui accroissent l’autonomie et répondent à la dignité humaine, et d’autres qui leur portent atteinte ou comportent des risques importants. Ce sont alors des choix métaphysiques et politiques qui se dessinent. Le rapport préparatoire à la révision des lois de bioéthique (publié en janvier 2010) montre d’ailleurs dans sa partie 4 que le législateur français commence à se soucier de ces questions. De même, au niveau européen, une étude dirigée par Christopher Coenen (Human Enhancement – A Study) pour le Parlement Européen, montre une prise de conscience et un travail en cours. Mais nous sommes au début d’un grand chantier. La phase de réflexion, de prospective, d’apprentissage et de bricolage est déterminante pour savoir où placer le curseur entre ce qu’on veut et ce qu’on ne veut pas.
Mais qui place le curseur ? Est-ce chaque individu comme le prônent les transhumanistes ? Et dans ce cas, cela pose des questions d’acceptabilité sociale. Est-on capable et souhaite-t-on construire une société non pas sur un consensus commun mais sur une collection de volontés individuelles ?
Le transhumanisme affiche une idéologie politique très claire (cf. www.humanityplus.org) selon laquelle il appartient à l’humanité de progresser et de dépasser ses limites corporelles. De plus, il est prophétique en affirmant que cela arrivera un jour, qu’on le veuille ou non. En même temps. Les transhumanistes ne se posent guère la question des difficultés d’apprentissage ni celle de l’épanouissement ou de l’asservissement. Pour avoir travaillé sur la question du dopage sportif, il est assez clair qu’il s’agit d’un usage aliénant qui provoque des cassures du corps et des cassures psychologiques. La problématique du cyborg est similaire à celle du dopage dès lors qu’elle cherche à transformer l’humain en un dispositif de performances. Or cela peut être extrêmement aliénant. Tel type de performance, pour être améliorée, devra peut être se payer de la réduction de telle capacité humaine. Ceci se voit déjà dans le dopage. Les transhumanistes évacuent totalement cet aspect-là, de la transformation de l’être humain en un produit performant. De même, dans La domestication de l'Etre, Peter Sloterdijk considère que le progrès technique contribue plus à l’humanisation qu’à la déshumanisation. Mais c’est une affirmation qui demanderait à être étayée ! Beaucoup de choses dépendent de l’infrastructure sociale, de la manière dont les humains agissent pour vivre et survivre en société. Si, pour survivre, il faut se retrancher telle ou telle partie du corps organique, prendre des psychotropes ou porter telles ou telles prothèses, c’est clairement une aliénation. Les enquêtes sur le dopage montrent qu’il est moins pratiqué dans le domaine sportif que dans les autres champs de la société. On vit donc déjà dans une société à ce point exigeante en termes de performances que ses membres ont besoin de prothèses chimiques et ont des conduites dopantes variées. Dès lors, la vision des transhumanistes est simpliste ; si pour survivre dans un champ social donné on ne dispose que d’une palette de choix restreints, ce n’est pas ce que j’appelle un choix libre. Sur ce sujet, les Européens, contrairement aux Américains, ont une conscience assez forte des effets de quasi-obligation sociale qui peuvent exister et refusent plus ouvertement l’aspect asservissant de la concurrence, alors que les Nord-Américains sont plus focalisés sur la liberté individuelle au sens étroit, au sens opposé à la règlementation commune, y compris lorsqu’elle est protectrice des individus. En même temps, ce ne sont là que des généralisations culturelles, alors que nos sociétés sont bien plus complexes et bigarrées que mes propos ne le disent.
Ces questions sur la transformation des corps, sur l’opposition homme/robot et les effets de frontières, sont liées à l’opposition classique entre biologique et mécanique. Est-ce une opposition qui tient toujours ?
Je crois qu’en réalité il s’agit moins d’opposition que de modélisation. La tendance à l’opposition entre l’artificiel et le naturel est commode et traditionnelle. Mais d’autres voies ont été proposées. La Mettrie ou Descartes, par exemple, cherchent du côté de la mécanique une modélisation de l’humain parce qu’ils voit entre eux une identité de nature, avec une relation de modèle à copie. Si on prend le mécanique pour modèle de l’humain, tout en pensant que l’automate est une copie dégradée, on se trouve face à un effet de miroir. Au fur et à mesure que les mécaniques deviennent sophistiquées, la séparation technique/biologique se brouille. Dans des petits robots jouets ou dans les automates, souvent le mécanisme est donné à voir, et en tout cas, il est démontable. Mais aujourd’hui, on est parfois face à des modèles beaucoup plus complexes. Difficile, par exemple, de démonter un ordinateur. On finit par se demander si un certain type d’intériorité corporelle ne va pas devoir s’appliquer à l’ordinateur ou au robot. Je pense qu’un moment viendra où il sera compliqué de faire la différence. Modèle, copie… cela circule dans tous les sens. Les robots à motivation intrinsèque sont développés par les roboticiens à partir de modèles venant de la psychologie du développement. Or celle-ci va probablement s’appuyer sur l’apport des roboticiens pour ses propres recherches en sciences cognitives. Un champ éclaire l’autre : les robots éclairent les humains, les humains éclairent les robots.
Au japon, les robots sont enracinés dans un imaginaire très fort, avec une acceptabilité plus importante qu’en Occident parce que les Japonais se pensent peut-être moins en termes d’opposition biologique/mécanique. La grande question qui se pose à nous, et que traite notamment Asimov, c’est : Comment faire pour que les robots ne soient pas menaçants mais neutralisés ? Ce n’est pas vraiment la problématique japonaise. Cette différence se voit également dans la manière dont sont représentés les robots. D’un côté, au Japon, on voit des robots ronds, en plastique, etc., de l’autre, aux Etats-Unis, des robots plus anguleux, plus froids. C’est notre manière d’opposer humains et robots humanoïdes. L’organique est tiède, mou, doux, animé, possède une intériorité, peut tomber malade, réagit de manière imprévisible, etc. Le mécanique est froid, dur, démontable donc sans intériorité, tombe en panne, est prévisible, etc. Mais, dans cette catégorisation, où est vraiment le robot ? Les frontières se brouillent. Ainsi un film d’animation japonais comme Ghost in the shell de Mamoru Oshii (2001) brouille volontairement ces séparations. L’humain peut être métallisé, avec des implants, de la dureté, du piratage de cerveaux, etc. De l’autre côté, le robot peut acquérir une peau, avoir une certaine souplesse, une intériorité parce que le système devient trop complexe pour être démontable, etc. Les questions de pannes ou de maintenance deviennent des questions plus médicales. Mais ce n’est pas seulement limité à l’Orient. On a le même type de phénomène et de réflexion dans une œuvre comme L’Homme bicentenaire de Chris Colombus (1999). Ce film tiré d’une nouvelle d’Asimov met en scène un robot qui devient progressivement biologique et finit par mourir. C’est d’ailleurs cette possibilité de la mort qui le fait accéder légalement au statut d’humain, par la Cour Suprême. Il y a là toute une série de transitions qui conduit du robot à l’humain. Mais on pourrait imaginer un film proposant une transition inverse où l’homme verrait progressivement ses organes biologiques remplacés par du mécanique.
La fascination des robots anthropomorphes tient-elle à la ressemblance des corps ?
D’une certaine façon, le robot anthropomorphe est un laboratoire et fonctionne comme une expérience de pensée incarnée. Les simulations qui nous sont proposées sous forme de fictions les mettant en situation nous permettent de jouer avec cette idée. On se questionne sur la question de savoir si on doit leur attribuer la même dignité que l’homme. On cherche à comprendre la manière dont on doit les considérer. Finalement, on se projette dans le robot pour se voir différemment. Si le rêve de l’humanité est d’avoir des individus polis, qui ne posent pas de problème, qui s’autodétruisent sur ordre, etc., alors son idéal c’est le robot, l’homme devenu robot. Mais ce que proposent les fictions est tout autre. La plupart du temps, ont voit des robots qui réinventent la liberté, la capacité à réfléchir, à décider, etc. C’est le cas par exemple dans cet autre très beau film qu’est Blade Runner (1982) de Ridley Scott.
Est-ce une altérité technologique qu’on met en scène pour se penser ?
Oui. Mais ce n’est pas un phénomène nouveau. Metropolis (1927) de Fritz Lang traite de cela. Dans l’Eve future (1886), Villiers de L'Isle-Adam met en scène une femme artificielle pour racheter l’Eve déchue. Que le robot puisse incarner la femme parfaite en dit long sur la société de l’époque, sur l’aliénation des femmes. D’une certaine façon, on voudrait que tout se passe bien, que tout soit lisse, mais finalement on trouve toujours de l’inattendu et de la complexité. Pourquoi ? Parce que les relations humaines sont compliquées. Comment contourner les difficultés qu’il peut y avoir entre les gens, les sexes, etc. ? Le robot est une alternative. Si c’est par lui que passe le lien, la question des relations interpersonnelles humaines est évacuée. C’est tout le sens de Face aux feux du Soleil (1957) d’Asimov. Et, si l’on y réfléchit bien, c’est ce qui se passe avec les poupées-robot sexuelles japonaises, si j’en crois ce qu’en indiquent quelques documentaires récents .
Ce qui se joue aujourd’hui c’est l’acceptabilité sociale des robots, la place que l’on peut leur donner. Il y a quelques années, au Japon, des robots d’assistance ont été placés auprès de personnes âgées, pour qu’ils puissent donner l’alerte en cas de chute ou faire de l’animation afin que les gens se sentent moins seuls. Cette expérience n’a pas très bien marché, parce qu’elle était, semble-t-il, un peu artificielle et déconnectée des attentes de ces personnes. Mais c’était les personnes âgées d’il y a 10 ans. Rien ne dit que cela sera encore le cas dans 10 ans, pour des personnes qui auront été familiarisées avec l’ordinateur, Internet, etc. Ce sont des procédés complexes qui dépendent à la fois des technologies mais aussi de la codification des rapports sociaux. Si on est tétraplégique, on peut être très gêné d’être alimenté à la petite cuiller par une infirmière ou un proche, parce qu’on est en situation d’obliger un autre être humain. En revanche, on serait peut-être bien plus à l’aise avec un robot.
Pourtant, il y a un lien affectif entre l’homme et ses robots.
Oui mais c’est un lien paradoxal, tout à fait différent du lien avec l’autre humain. Il y a bien une dimension affective qui se créé entre robots et utilisateurs, comme d’ailleurs avec d’autres objets techniques. Mais si on part du principe que le robot est un dispositif qui obéit, alors cela pose une relation en termes de servitude entre humain et robot. En termes de passion, de relation amoureuse ou même dans le monde professionnel, cela soulève toute une série d’interrogations. Cela pose aussi la question de la place du robot. Est-ce nécessairement une place de dominé ? Pourquoi, dans la fiction, les robots en viennent-ils à se poser des questions, à se révolter ? Finalement, ils nous disent que ce que nous leur faisons n’est pas correct, n’est pas respectueux, et ils demandent l’accès à la dignité. Les œuvres de fiction nous aident à envisager et préparer un type de comportement et à amadouer des situations problématiques. Elles sont des expériences par procuration, présentées avec une grande finesse, notamment par le cinéma parce qu’il joue aussi sur le non-verbal. Ces œuvres de fictions nous aident à cheminer en nous faisant voir et vivre en partie des situations, même si nous savons qu’elles sont fictives (cf. www.cerli.org). Ce n’est pas tout à fait de la rêverie au sens de Bachelard où l’esprit rêve aux contrées qu’il veut habiter, mais cela nous place en phase avec des scénarios, des possibles, des mythologies, des mises en récit exploratoires. Les histoires de robots sont un laboratoire extraordinaire parce que tout y est transformable et possible. Elles facilitent la réflexion en la radicalisant.

Article
Dans une perspective démocratique, la politique est-elle une « technique » réservée aux sachants ou un « art » ouvert à toutes et tous ?

Dossier
L'impact de l’IA dépasse largement le périmètre de l’innovation technologique et prend désormais part à des choix politiques, sans que les citoyens aient leur mot à dire...

Article
Comme dans les pires dystopies, ce « golem » moderne, et bien réel, pourrait-il devenir assez autonome pour s’émanciper de ses maîtres ?

Article
Si toute notre vie sociale tient dans un smartphone, à quoi bon profiter de sorties nocturnes ?
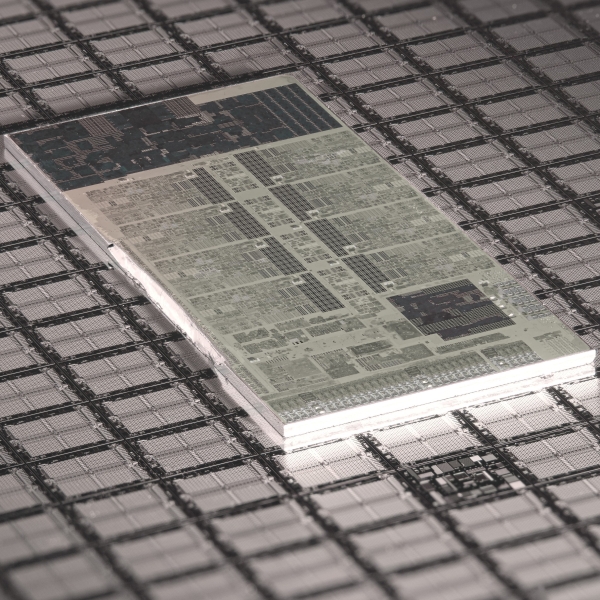
Article
Comment déterminer la balance bénéfices-risques de technologies aux progrès à la fois fulgurants et exponentiels ?

Article
Longtemps confinée aux pages de la science-fiction dans l’esprit du plus grand nombre, cette classe de technologies est désormais omniprésente dans notre quotidien numérique.

Interview de Michel Desmurget
directeur de recherches en neurosciences à l'INSERM, à l'Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod

Étude
Pourquoi acheter en ligne ? Quelles préférences entre se faire livrer à domicile, en point-relai ou en drive ? Une douzaine d’habitants témoignent.

Étude
Comment les commerces de proximité s’adaptent à la vente en ligne ? Cette étude donne la parole à une dizaine de commerçants indépendants du territoire.