LES RÉVOLUTIONS DE LA MÉMOIRE À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

Dossier
Comment les acteurs de la mémoire appréhendent-ils le passage d’une mémoire culturelle classique à une mémoire numérique ?
Interview de Patrick Bazin
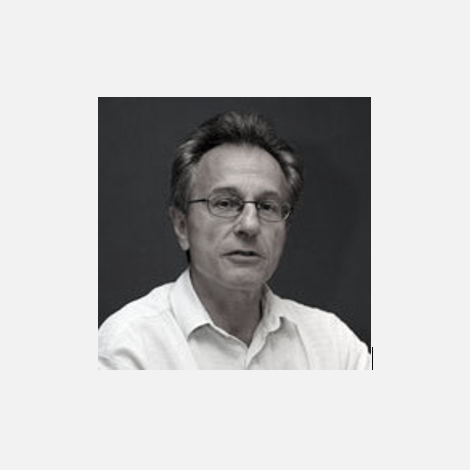
<< Le numérique exige un nouveau mode de gestion de la mémoire >>.
Pour Patrick Bazin, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon, les technologies de l’information et de la communication (numérisation, réseaux sociaux, etc.) nécessitent la recherche d’un nouveau mode de gestion de la mémoire qui prenne en compte la complexité de cette mémoire culturelle vivante et dynamique et impose de nouvelles médiations.
Les sociétés privées – et pas seulement Google qui vient de démarrer la campagne de numérisation de 500 000 ouvrages des fonds de la Bibliothèque de Lyon que vous dirigez - sont de plus en plus présentes sur le terrain de la connaissance et de la mémoire ; faut-il s’en inquiéter ?
Il est très intéressant de constater qu’effectivement la connaissance est devenue un enjeu économique majeur, plus fortement qu’elle ne l’était lorsqu’elle n’intéressait que l’édition traditionnelle. Deux interprétations sont possibles. L’une négative : le savoir tombe dans la sphère marchande ; on passe de l’être à l’avoir, du sens à l’information. L’autre positive : la connaissance est devenue un enjeu tellement vital et partagé par tous que seule l’implication de la sphère économique peut dégager les capacités d’investissement nécessaires et développer l’innovation dans ce domaine. Il n’est pas interdit de penser que, jusqu’à présent, la connaissance était perçue comme un luxe aristocratique et, du coup, restait une affaire artisanale, dépendant du bon vouloir de structures sociales plus ou moins démocratiques. Je ne dis pas qu’il n’y a pas des risques. Il y en a, évidemment, car il y a de l’argent en jeu. Mais, cela est vrai de tous les domaines d’activité, y compris les plus vitaux. Regardez la nourriture : personne n’est choqué de devoir acheter un litre de lait ou une baguette de pain. Il ne faut pas opposer l’économie à ce qui est vital pour l’homme. Je trouve extrêmement positif que la sphère économique se soit emparée de la problématique de la connaissance. Cela montre que celle-ci est véritablement devenue une affaire centrale pour tous.
Face à l’inflation mémorielle, qui stocke et diffuse de plus en plus d’informations, y compris d’ordre privé, certains préconisent un « droit à l’oubli ». Qu’en pensez-vous ?
Je suis très réservé par rapport à cette traçabilité généralisée, qui mord sur le terrain privé. C’est une question majeure. Si demain il y a un totalitarisme, ce sera un totalitarisme de la trace évidemment. Mais, je ne sais pas si on peut instituer une règle en la matière, décréter qu’on va oublier ça et pas ça. Vous est-il déjà arrivé de vous dire « ça je l’oublie » et que ça marche ? En fait, on oublie ce que la vie met de côté. C’est l’usage, c'est-à-dire l’effectuation de son parcours personnel, qui fait que certaines choses sont renforcées et d’autres disparaissent. C’est pour ça que l’analogie avec la mémoire biologique me semble pertinente. Celle-ci est métastable, c’est une activité permanente qui se reconfigure sans arrêt à travers son usage tout en gardant une certaine cohérence. De ce point de vue-là j’ai toujours gardé la leçon de Bachelard : « ce qui compte, c’est la relation ». Dans le réseau de nos pensées et de nos affects, certaines relations, parce qu’elles se « renforcent » au fil du temps – pour utiliser le vocabulaire des neurosciences –, font mémoire. La question de la mémoire culturelle à l’époque d’Internet se pose un peu comme cela. Il faut se garder d’une approche exclusivement essentialiste ou en termes de stock de la mémoire. Les musées et les bibliothèques auront été des stocks pendant quelques siècles, des stocks souvent mal gérés et parfois générateurs d’oublis. Nous entrons, à présent, véritablement, dans l’âge de la mémoire, une mémoire culturelle vivante car, en permanence, à l’épreuve du présent.
Oui mais comment se repérer dans ce flux de mémoire et d’informations numériques où le pire côtoie le meilleur ?
Fondamentalement, on doit, d’abord, faire confiance en la capacité de chacun à trouver ce qui lui convient plutôt que d’imposer d’emblée des cadres prescripteurs. Ce qui est vrai de la vie quotidienne, de la capacité des individus à vivre, à s’en sortir dans la vie, c’est vrai de la connaissance aussi. D’autant plus que sur Internet, à côté des contenus, il y a aussi toute une ingénierie de la connaissance qui se développe et facilite l’usage de ces contenus. Ce sont des outils de structuration de l’information, des outils linguistiques, des environnements collaboratifs qui permettent de bénéficier de l’apport des experts. Demain, même si vous n’êtes pas spécialistes des incunables du 16e siècle, vous allez disposer via Internet d’outils qui vous permettront d’aborder des documents que jamais avant vous n’auriez pu aborder. En fait, une bonne part de ce qui semblait relever de la connaissance savante, mais qui n’était finalement que des outils, va s’automatiser, tandis que la sociologie de la connaissance elle-même, longtemps limitée à des milieux restreints va s’élargir. Face à cette extension du domaine de la connaissance, le rôle des médiateurs, des passeurs sera, sans doute, très important. Il ne s’agira pas pour eux de prescrire, mais d’accompagner, d’acquérir un savoir faire dans la recherche d’information tout en faisant un bout de chemin avec l’usager. C’est, sans doute, dans cette direction que les bibliothèques doivent repenser leur avenir.
Internet a donc besoin de « coachs » du savoir ?
Je pense effectivement qu’il faudra pouvoir disposer, à travers Internet, de « coachs », c’est-à-dire des gens qui passeront plus de temps que les autres à sourcer les informations, à les contextualiser tout en accompagnant les usagers dans leur recherche. La question est de savoir si ces « coachs » vont constituer une seule et même classe d’individus, comme aujourd’hui avec le corps enseignant, ou s’il y aura autant de coaches que de domaines ou de communautés … La solution sera sans doute intermédiaire. La remise en question d’une certaine sociologie de la connaissance basée sur les corporations de bibliothécaires, de profs, de journalistes ne signifiera pas leur disparition, mais leur évolution vers un rôle relevant davantage de la médiation que de la prescription.
C’est ce que vous avez mis en place avec le Guichet du Savoir (GdS), service de renseignement à distance par lequel les bibliothécaires s’engagent à répondre en moins de 72h à toute question posée sur Internet…
Demander à chaque individu de refaire tout le parcours, de refaire le monde à chaque fois, c’est ridicule. On n’a pas le temps ; on a d’autres chats à fouetter ! Il y a tellement d’enjeux aujourd’hui. l faut donc s’en remettre pour une bonne part à des intermédiaires. Le rôle des bibliothécaires, des médiateurs en général, est de simplifier la vie des gens, d’aller chercher l’information. Le problème est qu’ils ne peuvent pas le faire indépendamment de la question posée, de l’attente réelle de la personne. A chaque personne autant de questions et autant de réponses. Alors, bien sûr qu’il y a de la redondance : à travers le GdS, on nous pose souvent les mêmes questions, n’empêche qu’à chaque fois, il faut adapter la réponse. Et, en faisant cela, on apprend soi-même et l’on devient de plus en plus performant dans la recherche d’informations. C’est en cela que le GdS est original, d’autant que les réponses sont capitalisées et viennent constituer une base de connaissances, une sorte d’encyclopédie dynamique, qui complète progressivement l’offre documentaire de la bibliothèque.
Autrement dit, la bibliothèque devient un process, un « work in progress », né de l’interaction des bibliothécaires et du public, et non plus seulement une accumulation de documents figés. De cette dynamique naissent des connaissances et des règles de gestion et de partage de ces connaissances. Quand je parlais d’émergence de procédures, c’est cela : si on veut que le service public continue à jouer un rôle et que l’espace public existe encore, il faut qu’il se confronte au monde alentour, à la réalité, qu’il s’inscrive dans une activité. Mais, dire qu’il faut édicter des règles de façon surplombante et autoritaire, comme par le passé, ne me semble pas correspondre aux nécessités du moment.
Certains s’inquiètent que les digital natives, baignent dans une sorte d’éternel présent, dénué de toute conscience historique, et aient du mal à distinguer le vrai du faux, le réel du virtuel. Partagez-vous ces inquiétudes ?
Je pense que l’être humain est capable de distinguer d’une façon naturelle, car il est fait comme ça, le réel du virtuel, le présent du passé. Je ne pense pas que les jeunes ne soient plus capables de se situer dans le temps. Au contraire, avec Internet, on a une capacité à rappeler le passé qui est bien supérieure à celle que l’on pouvait avoir dans le temps. Je ne suis pas sûr, par exemple, que la vision cyclique du monde qui prévalait à l’Antiquité ait favorisé une prise en compte de l’histoire. Il en va de même de la vision eschatologique du monde propre au Moyen-Age. Je crois, au contraire, que nous entrons dans l’âge de la mémoire, d’une mémoire de plus en plus riche, complexe et en relation active avec le présent. Les difficultés redoutées aujourd’hui tiennent davantage à la recherche d’un nouveau mode de gestion de la mémoire, intégrant cette complexité, plutôt qu’à un risque de perte. Mais l’être humain est ainsi fait qu’il aime se faire peur …
Si des modérations doivent se développer sur Internet, faut-il que ces modes de régulation viennent du terrain, d’en bas plutôt que cela ne soit imposé d’en haut – ce qui correspondrait mieux au modèle horizontal d’Internet ?
La vie des contenus (leur création, leur transformation, etc.) doit s’exprimer, à mon avis, pour l’essentiel, horizontalement. Par contre, il est très important que les procédures d’accès et de partage soient largement et équitablement diffusées. Là réside le rôle des pouvoirs publics, en particulier par le biais d’institutions comme les bibliothèques.
La puissance publique a donc un rôle important à jouer ?
Je pense que la sphère politique a une raison d’être évidente dans le domaine de la connaissance. Comme je l’ai déjà dit, elle ne doit pas intervenir sur les contenus intellectuels et culturels, mais faire en sorte, par des dispositifs de régulation, que l’accès aux contenus et à l’expression des contenus soit équitablement diffusé. Ensuite, il faut faire confiance aux individus, à la liberté, à la capacité d’initiatives, etc. Tout part du potentiel que chaque individu représente. Mais il faut que l’individu soit amené, s’il veut avoir un commerce utile avec ses congénères, à respecter des règles. Et le rôle de la sphère publique c’est de dégager – je ne dis pas définir – des règles communes qui fassent que quelque soient nos obsessions personnelles, nos qualités et défauts, notre diversité, nos différences, il y ait des échanges possibles, une vie commune tout simplement.
Pour l’élaboration d’une politique publique de la mémoire et de la connaissance, quelle entrée vous paraît la plus judicieuse : l’éducation, l’économie, la culture ?
C’est l’entrée éducative, même si ce terme est à mon avis trop à sens unique, car l’éducation sera de plus en plus interactive. Le rôle des pouvoirs publics dans une ville comme Lyon est à mon sens de favoriser la possibilité pour chaque individu de mobiliser les informations, les connaissances nécessaires à son activité, à tout moment de sa vie. Ce n’est pas le Grand Lyon ou la Ville de Lyon qui va se transformer en université. En revanche, le Grand Lyon peut – c’est vrai aussi de l’Etat – définir un sorte de cahier des charges pour chaque acteur du système : les universités, les écoles, les associations, voire les entreprises qui disposent de connaissances, d’informations. Ce cahier des charges encouragerait chaque acteur du système à partager ses connaissances, à se mettre en réseau.
Vous savez, les entreprises privées, qui ont bien compris que, souvent, les compétences étaient à l’extérieur, le font de plus en plus – même si elles gardent secret ce qui est vraiment important – y compris dans des domaines aussi sensibles que l’industrie pharmaceutique. Cette idée suivant laquelle il faut s’ouvrir pour continuer à être créatif est aujourd’hui monnaie courante. Encore une fois, cela ne veut pas dire que les rapports de pouvoir vont disparaître – je n’y crois pas du tout – mais le modèle gagnant-gagnant propre à la sphère de la connaissance, qui est, par définition, partage, ne peut que s’imposer aujourd’hui – d’où, d’ailleurs, tous les tâtonnements actuels sur la question des droits.
Les collectivités publiques peuvent donc favoriser un climat propice au partage…
Elles le doivent. Elles doivent favoriser la mise en relation des acteurs, par-delà les communautarismes culturels, générationnels, socio-économiques, institutionnel. Elles doivent susciter la diversité, favoriser la recomposition et l’ouverture des réseaux. Elles doivent penser et mettre en œuvre une politique de la connaissance. Non pas, bien sûr, régenter la pensée, mais réunir les conditions pour un plein exercice d’une pensée libre, c'est-à-dire favoriser l’existence d’un espace public de la connaissance. Il s’agit, au fond, de continuer l’œuvre amorcée avec la création de l’éducation nationale. Mais cette dernière était conçue sur un mode séparé et surplombant. Il s’agit, à présent, de la repenser en fonction d’un contexte plus ouvert et plus mobile où le rôle des médiateurs de toutes sortes, des « passeurs », sera déterminant.
Quelle sera la mémoire du futur, une mémoire sans papier, une mémoire globalisante ?
Je crois que le papier et le livre ont encore de l’avenir. Mais il est évident que l’électronique et, bientôt, d’autres véhicules de l’information, bien plus rapides, comme les photons, vont prendre de plus en plus d’importance.
Autre aspect : il y aura un lien direct entre le corps tout entier, chacune de ses cellules, et l’environnement. On va « connaître » avec son corps.
On voit bien que les limites de l’Intelligence Artificielle (IA), c’est le corps. Croire qu’on puisse rendre un ordinateur intelligent alors qu’il n’a pas de corps, c’est absurde. L’IA, ce sera le corps biologique. La bonne direction c’est la pensée collective. L’Intelligence Artificielle de demain ce sera une pensée collective augmentée, c’est-à-dire un mixte de pensée biologique de dispositifs technologiques (numérique pour l’instant) et de réseaux sociaux. Autrement dit, nous allons devenir hypersocialisés, tout en renforçant notre capacité d’individuation. Espérons que l’individu sera suffisamment résistant pour renforcer son individualité à travers sa socialisation. C’est en tout cas ce qui s’est produit jusqu’à présent.
Vous prenez la modernité, née au 13e, 14e siècle. C’est un phénomène de socialisation avec la mondialisation, les voyages, la banque, etc. On était de plus en plus avec les autres, on sortait de sa tribu, son fief, son village… On voyageait à travers l’espace, mais aussi à travers le temps puisqu’on retrouvait les textes anciens et inventait l’imprimerie. La modernité fut, donc, l’extension géographique et temporelle de la socialisation humaine. Mais comme par hasard, elle fut, aussi, l’émergence de l’individu. On ne va pas opposer socialisation et individu : ça va de pair. La vie est faite de paradoxes et l’on ne peut pas comprendre la révolution numérique si on ne la pense pas à travers la continuation de ces paradoxes immémoriaux, qui sont le moteur de l’humanité.
C’est l’époque des commémorations…
La commémoration fait perdurer un usage ancien de la mémoire dans un monde qui n’est plus adapté à ça. Avant, on oubliait plus facilement. On ne prenait pas grand risque à être encombré par la mémoire et l’on pouvait se focaliser sur certains souvenirs que l’on décrétait majeurs. Mais si on fait cohabiter l’esprit de commémoration avec les nouveaux usages de la mémoire, qui permettent de tout réactiver, on risque de rencontrer de sérieux problèmes… Cela ne veut pas dire que les fameux lieux ou monuments de mémoire chers à Pierre Nora n’ont plus à jouer la fonction politico-symbolique qui est la leur. Mais trop de symboles tuent le symbolique. Et, pour ce qui est de la mémoire culturelle en général, mieux vaut faire confiance à une décantation moins forcée.
Oui mais avant de décanter, elle doit « gérer » une quantité d’informations inouïe !
C’est vrai. Nous sommes, dans la société culturelle et intellectuelle d’aujourd’hui, face à une nouvelle frontière, quantitative. Les quantités d’information que nous devons gérer n’ont rien à voir avec celles que devaient traiter, naguère, les instances les plus savantes. Entre l’époque d’Einstein et celle du LHC de Genève, le gap est évident. Il en est de même, d’ailleurs, du nombre des acteurs concernés, à savoir, potentiellement, chacun d’entre nous. Ce saut quantitatif, allié à la complexité des réseaux d’acteurs, ne peut pas ne pas avoir d’impact non seulement sur les concepts mais sur la nature même des concepts, sur la nature même de la connaissance. Par exemple, la dimension interactive et communicationnelle de celle-ci va, sans doute, l’emporter sur sa dimension de thésaurisation. Et il serait vain d’opposer au flux une connaissance profonde parce que lente. Cette nouvelle frontière d’un champ de la connaissance incommensurable à celui que nous avons connu jusqu’à présent oblige les professionnels du domaine – y compris les bibliothécaires - à repenser leur métier. Quoi de plus exaltant ?

Dossier
Comment les acteurs de la mémoire appréhendent-ils le passage d’une mémoire culturelle classique à une mémoire numérique ?

Interview de Ghislaine Chartron
Ghislaine Chartron est à l'origine de la création de @rchivSIC et professeur titulaire de la chaire d'ingénierie documentaire au Centre National des Arts et métiers (CNAM-Paris)
"Il nous faut rapidement mettre en place une vraie politique nationale en matière d’édition numérique sans détruire les systèmes éditoriaux existants, du moins ceux qui ont prouvé leur efficience."

Interview de Daniel Charnay
L’idée première de ces archives ouvertes est de construire un espace où les chercheurs peuvent échanger leurs productions, établir des collaborations et être visibles

Interview de Emmanuel Hoog
« L'apparition d'Internet a bouleversé le débat public, qui est sans cesse percuté par la mémoire ».

Interview de Anne-Catherine Marin
Directrice des Archives municipales de Lyon en 2010
"C’est le moment de s’interroger sur les relations entre conservation de la mémoire et territoire"
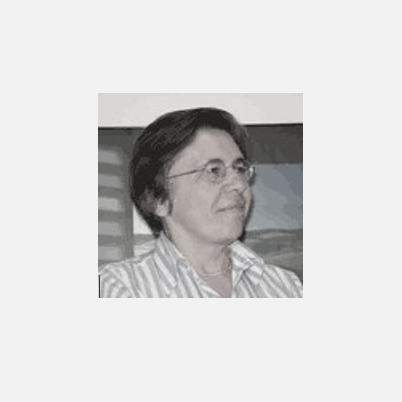
Interview de Anne-Marie Bertrand
Directrice de l’ENSSIB
" Il ne faut pas tomber dans la fracture numérique : les infos riches et les infos pauvres, ceux qui savent se servir de l’information numérique et ceux qui ne savent pas, ou moins bien."

Interview de Patrick BAZIN
directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon en 2010
"Diaboliser Google comme on le fait en ce moment, est plus une preuve de faiblesse et d’hypocrisie que de lucidité"

Dossier
Comment résister au grignotage et à l’envahissement de ce temps par les écrans ?

Interview de Florian Fomperie
Directeur d’antenne de Radio Anthropocène
Une multitude de médias associatifs, locaux et citoyens pourrait-elle un jour constituer un rempart contre la désinformation et le manque d’indépendance des médias mainstream ?