Moyens techniques de lutte contre les micropolluants : quelles limites pour l’approche curative ?

Article
Quelles techniques et quels coûts pour traiter les micropolluants ?
Interview de Gérard POSA
<< Les fondations sont nouvelles en France. Il ne faut pas vouloir cloner le modèle anglosaxon mais expérimenter d’autres voies >>.
"La fondation est un organisme de droit privé auquel, par dons, donation ou legs, une ou plusieurs personnes physiques ou morales, consacrent des biens ou des droits mobiliers ou immobiliers en vue de les affecter à une action sans but lucratif de type culturel, pédagogique, scientifique ou de bienfaisance." (dictionnaire du droit privé).
Dans cette interview, Gérard Posa, directeur d'Ezus, revient sur l'histoire de la création de la Fondation Lyon1.
Initiée bien avant le projet de réforme des universités, la Fondation Lyon 1 est la première du genre en France. Comment a germé l’idée ?
Lorsque Lionel Collet a été élu président de Lyon 1, il y a deux ans, il m’a demandé de réfléchir à un moyen de développer les relations de l’université Claude Bernard avec le tissu socio-économique. Ce qu’il souhaitait, c’était promouvoir l’offre de compétence de l’ensemble des domaines de l’université, qu’il s’agisse de la recherche, de la formation ou de toutes autres actions transversales, et pas seulement des actions de valorisation ou de sous-traitance qui sont prises en charge par Ezus Lyon, la filiale de valorisation de l’université. Mon premier travail a donc été de définir précisément les actions que nous menons en lien avec le monde socio-économique car, si toutes sont concurrentielles, certaines sont marchandes et d’autres ne le sont pas. En effet, nous conduisons via Ezus des actions de business – R&D, prestations technologiques ou actions de formations. Mais l’université propose également des actions non-lucratives comme le placement de stagiaires, l’insertion professionnelle d’étudiants, l’adaptation de ses filières d’enseignement à ce qu’attendent ceux qui embauchent nos étudiants, le cofinancement des programmes de recherche, l’aide aux étudiants en difficultés financières, etc. Lucratives ou non lucratives, toutes ces actions ressortissent d’une démarche commerciale au sens où il s’agit d’une démarche de séduction. Vous êtes un tiers, je veux vous convaincre de prendre des étudiants, je vais vous séduire pour vous convaincre de le faire, etc. Pour moi, cette démarche de séduction doit être prise en charge par une structure autre que l’université car, à mon avis, celle-ci ne possède pas (encore) cette culture commerciale.
Mais vous auriez pu confier cette démarche à Ezus qui est une structure commerciale…
C’est ce à quoi on a d’abord pensé. Mais, précisément, Ezus est une structure commerciale, or cela lui interdit de percevoir des subventions et la contraint à équilibrer ses comptes avec ses propres prestations. Placer des actions non-lucratives par le biais de chargés d’affaires salariés n’était pas raisonnable… Ezus est une structure de business et il fallait donc une structure elle-même non lucrative.
Et c’est le statut de fondation qui est le plus adapté pour cette mission ?
Oui et non. Tout dépend de quel type de fondations. Et c’est là que nous avons eu un rôle pionnier, en expérimentant les possibles. Nous avions le choix entre deux formes de fondations : fondation reconnue d’utilité publique ou fondation d’entreprise.
Les premières sont très lourdes à constituer. La reconnaissance d’utilité publique d’une fondation revient au ministère de l’Intérieur qui ne rend avis qu’après consultation du Conseil d’État. Il faut compter deux ans et demi d’instruction. Autre inconvénient, une fondation d’utilité publique ne peut pas être dirigée par ses membres fondateurs. L’université aurait pu la créer, mais pas la diriger. Il n’y avait donc pas de sens à vouloir créer un levier de promotion de l’université sur lequel celle-ci n’aurait pu peser.
Nous nous sommes donc dirigés vers une fondation d’entreprise pour laquelle il suffit d’un un avis du préfet, lequel avis est rendu sous 4 mois. Mais ce type de fondations a aussi ses inconvénients. Le premier est qu’une université ne peut pas la créer ! C’est donc Ezus, associé à Sanofi pasteur et à la Banque populaire, qui en a été à l’initiative. Autre inconvénient, une fondation d’entreprise ne peut pas faire appel à la générosité publique et faire bénéficier au donateur de la déduction fiscale. En revanche, l’université si. Nous avions donc envisagé un système dans lequel la Fondation avait pour objectif de faire la promotion de l’université et de mettre en relation les donateurs éventuels avec l’université.
Vous avez donc expérimenté un mode juridique pas complètement satisfaisant ?
Oui. Mais cela nous a permis d’avancer et plus loin qu’on ne le pensait au départ. Nous déposons le dossier en décembre 2006. En avril 2007, le préfet prend l’arrêté de création de la Fondation Lyon1. Arrive alors le projet de loi de réforme des universités. Dans sa version initiale, il prévoyait que les universités pourraient créer des fondations universitaires, sous forme de structures internes, non dotées de la personnalité morale, mais fonctionnant comme des fondations d’utilité publique. Ce qui à mon avis était une aberration. De plus la formule était ambiguë et nécessitait un décret en Conseil d’État car la loi prévoyait que l’université pouvait créer une fondation, non pas privée, mais publique, fonctionnant comme une fondation d’utilité publique, c’est-à-dire selon le mode du privé mais dans le cadre d’une comptabilité publique… Autant dire que tout cela était compliqué, plus, même, que ce que nous expérimentions, nous.
Comment avez-vous pu peser sur l’évolution de la loi ?
Nous avons décidé de communiquer sur notre expérience, pionnière en France, d’une université adossée à une fondation d’entreprise. Nous avons organisé une conférence de presse à Lyon puis à Paris avec les médias nationaux, tant et si bien que le sénateur Philippe Adnot, rapporteur pour l’examen de la loi au Sénat, a pris connaissance de notre expérience. Il nous a contacté et dans la note que je lui ai transmise, je préconise que les universités puissent créer des fondations dites partenariales, dotées de la personnalité morale, fonctionnant comme des fondations d’entreprises, c’est-à-dire de manière très souple, mais pouvant faire appel à la générosité publique et pratiquer la déduction fiscale. C’est un amendement qui a été retenu et qui figure aujourd’hui dans la loi. Sans cela, on aurait eu des fondations non dotées de la personnalité morale et je ne suis pas sûr que les universités s’engouffreraient dans cette voie comme elles le font pour les fondations partenariales. Lyon 1 a d’ailleurs transformé sa fondation initiale en une fondation partenariale. Voilà la genèse de ces fondations qui devraient bientôt se constituer dans les universités. D’ailleurs, la dizaine de demandes que j’ai reçues portent sur les fondations partenariales.
Vous pensez que c’est une possibilité qui attirera d’autres universités que les universités de sciences ? Vous savez qu’une des critiques faites aux fondations porte justement sur le fait que les filières socio-économiquement moins bien intégrées se paupérisent.
Je maintiens que toutes les universités pourront trouver avantage à créer des fondations, même si c’est selon des modèles économiques différents. Mais aujourd’hui, toutes les universités ont un environnement socio-économique, toutes. Il n’y a pas d’université qui ne fasse que de la philosophie ou du grec ancien. Il y a des départements de géographie, de sciences humaines et sociales, de sciences économiques, etc. Ezus a travaillé avec Lyon 2 qui avait de nombreuses relations avec le secteur industriel ! J’ai travaillé avec l’université de Limoge dont le département géographie intéressait les pétroliers, etc. Le modèle économique doit être adapté à l’université et son environnement, mais toutes sont potentiellement concernées.
Aux USA, la plupart des dons sont affectés à des projets spécifiques. Vers quel modèle se tourner pour que tout le monde bénéficie des fonds levés ?
D’un point de vue du concept, il faut bien comprendre que les fondations sont nouvelles en France. Il ne faut pas vouloir cloner le modèle anglo-saxon mais expérimenter d’autres voies. Que notre fondation œuvre, par exemple, sur la collecte de fonds et sur la promotion des actions non lucratives de l’université le montre. C’est assez atypique.
Je pense que la société française n’est pas prête à s’attendrir sur le sort de l’université et qu’on ne va pas toucher si facilement les industriels ou le grand public. Vouloir dupliquer ce qui se passe aux USA, qui fonctionnent de cette manière depuis des années et où existe cette culture, est voué à l’échec. Dans 10 ans, 20 ans, peut-être… mais aujourd’hui, non.
Cela signifie que notre manière de collecter des fonds auprès des industriels, dans un premier temps, et du grand public, dans un second temps, doit être différente de celle qui se pratique outre Atlantique. Quand je reçois des entreprises dans le cadre d’Ezus, je vois quels discours peuvent les toucher et ce n’est pas, en tout cas, un laïus sur la pauvreté de l’université. Je pense que lorsqu’on aura noué des partenariats très forts avec les industriels, par des stages, de l’insertion, etc., ils se rendront compte de la valeur de l’université, de son sérieux, de ce qu’elle peut leur apporter et notamment parce qu’elle est dans une démarche de citoyenneté, alors, et alors seulement, ils seront d’accord pour soutenir financièrement l’université sur du financement global, non fléché. Aujourd’hui, je le dis franchement, je veux bien aller frapper à la porte des entreprises, mais peu sont prêtes à donner. Il faut préparer la société française à cette démarche de fond.
Cela veut-il dire que les relations de l’université à la société civile, tout comme la construction des liens que vous avez avec vos partenaires industriels, vous les inventez maintenant ?
Oui, on est dans la construction. Sachant tout de même que la Fondation n’avance pas en tâtonnant complètement mais en s’appuyant sur le travail d’Ezus qui était déjà une entreprise pionnière. La Fondation est une prolongation des missions d’Ezus.
L’université de Compiègne, une université technologique, avait créé une association de valorisation, et l’Insa, école d’ingénieur, avait mis en place Insavalor, mais Ezus a constitué la première société de valorisation créée par une université. Tout ce que je vous dis, je ne peux le faire que parce que depuis 18 ans Ezus vérifie un principe méthodologique de base, c’est que l’industriel n’exprime jamais aucun besoin. Il faut aller le chercher, le convaincre !
L’université doit être tournée vers la société civile, vers le citoyen. Expliquer à Untel que ses enfants peuvent entrer à l’université parce qu’ils trouveront ensuite du travail. Dire à tout le monde que les médicaments que nous prenons sont faits dans les universités, que les téléviseurs, les radios, etc., fonctionnent peut être avec des process mis au point ici. Nous souhaitons insister sur deux choses : l’université doit renvoyer au citoyen ce que le citoyen lui donne et, pour cela, elle ne forme plus et ne fait plus de recherche seulement pour son propre plaisir mais en direction de la société.
L’autre critique faite aux fondations, et plus largement aux efforts de financements propres des universités, est qu’ils pourraient être un prétexte au désengagement de l’État.
Non, je ne le pense pas. D’abord, ce n’est pas, en tout cas aujourd’hui, la position de l’État. Il est clair que ce sont des fonds qui doivent venir en complément des fonds publics. Pour nous, il est hors de question que ces fonds servent la formation initiale ou des programmes de recherche fondamentale qui doivent être financés par l’État. Les fonds que nous levons doivent aller à des actions complémentaires. Quand Microsoft signe une charte avec nous et nous donne 60 000 Euros pendant 3 ans, c’est pour développer des outils pédagogiques, de l’enseignement par i-learning, compléter des bourses, c’est-à-dire au profit direct des étudiants. On sera vigilant. Bien sûr, je ne peux pas vous dire ce qui se passera dans 10 ans, mais le but c’est de bien veiller à ce que l’utilisation ne viennent pas en lieu et place du financement public. Et puis nos perspectives sont de lever 10 millions d’Euros sur les 4 ans à venir (hors contrat de recherche ou valorisation), l’université c’est environ 300 millions d’Euros de budget annuel…
Certains craignent également que l’université soit captive de ses financements privés et que naissent des conflits d’intérêt, lors de demande d’expertises par exemple.
Si Lyon 1 a pu créer la Fondation à l’unanimité moins deux absentions (deux étudiants UNEF), en pleine période de crise, c’est parce que depuis 18 ans, Ezus a pu expérimenter et développer des partenariats avec le tissu socio-économique et montrer qu’il n’y avait pas de dérive. Ezus fait déjà des expertises sans rencontrer de pressions. Par ailleurs, nous avons des gardes-fous comme le Conseil d’éthique de l’université que nous avons saisi à plusieurs reprise lors de contrats pour de la balistique lésionnelle, par exemple, ou pour les OGM.
La fondation aura-t-elle pour vocation de développer des activités marchandes type édition, par exemple ?
La Fondation est un levier ; elle n’a pas vocation à croître en masse salariale et ne devrait pas compter plus de 5 à 6 personnes. Son rôle est d’être un guichet unique. Si un industriel ou un enseignant la contacte pour éditer un ouvrage, il sera dirigé vers Ezus. Elle a pour mission de faire le lien entre l’université et le tissu socio-économique, d’être un levier appuyé sur les chargés d’affaires d’Ezus, le service des stages, etc.
Derrière votre question, j’entends aussi la compatibilité de deux structures : Fondation et Ezus. Le jour où la Fondation reçoit une demande marchande, elle la répercute vers Ezus. Il n’y a pas de conflit d’intérêt. La Fondation n’est pas là pour faire du commerce, elle ne va pas prendre du volume d’affaire à Ezus, mais au contraire l’alimenter. Aujourd’hui Ezus fait 13 millions d’Euros de CA. Si dans 3 ans, il fait 20 millions, ce n’est pas que les laboratoires auront travaillé plus, mais parce que le dispositif mis en place par la Fondation aura nourri Ezus. Même chose pour la taxe d’apprentissage. La fondation n’a pas vocation à la lever. En revanche, elle rencontre des industriels et peut les inciter à la verser, tout ou partie, à l’université. Quant à la fondation, elle est alimentée par les fonds des fondateurs et par les dons qu’elle va lever et qui produisent des produits financiers. C’est pour ça qu’elle ne doit pas avoir une masse salariale importante. Il faut donc bien distinguer deux choses différentes : ce que la fondation va collecter et ce qu’elle va amener indirectement en volume d’affaire.
La fondation Lyon 1 est-elle un levier pour que les offres de formation collent plus au tissu socio-économique ? Peut-on imaginer, dans l’avenir, que l’université soit davantage tournée vers les lignes de forces des compétences locales (pôle de compétitivité, RTRA, RTRS, etc.) et que, finalement, on puisse venir à Lyon pour s’y former avec l’idée qu’on va ensuite y trouver un travail et y rester ?
Oui. Il est essentiel d’ancrer l’université dans son milieu. Aujourd’hui, l’université doit, non pas donner un droit de regard aux industriels, mais un droit de collaboration. Elle ne peut pas former des jeunes sans se préoccuper de ce qu’attendent ceux qui les emploieront demain non pas en terme de diplômes mais de métiers. On ne peut pas dire qu’on fait de la professionnalisation ou de l’insertion professionnelle si on ne tient pas compte de l’évolution des métiers. La société française est ainsi faite que les PME/PMI sont les plus gros employeurs en France, il faut les écouter. Par exemple, quand Minalogic nous dit que leurs entreprises réclament des techniciens de salle blanche et que la formation n’existe pas, est-ce que l’université peut ne pas mettre en place cette formation via une licence pro ? 150 emplois par an, est-ce qu’on peut passer à côté ?
Depuis quelques années, une structure commune de valorisation répond aux besoins des établissements regroupés dans ce qui est aujourd’hui le PRES. Celui-ci a d’ailleurs pour mission de faire la promotion de l’université de Lyon à laquelle appartient Lyon 1. N’y a-t-il pas doublon entre le PRES et la Fondation et, si non, n’est-ce pas une fondation au service du PRES qu’il faudrait mettre en place ?
En premier lieu, il n’est pas tout à fait aussi explicite que le PRES doive faire la promotion de chaque établissement. Et puis, la Fondation est positionnée sur la promotion de « l’offre de compétence » de l’université dans sa relation avec le tissu industriel, et non envers les étudiants… C’est très différent.
Mais sur le fond. Je suis d’accord. On peut rêver que le PRES dispose d’une fondation et que les universités n’aillent pas, chacune, créer leur propre fondation. Mais il est encore trop tôt pour cela. Et pour au moins deux raisons. Aujourd’hui, les PRES n’ont pas la possibilité juridique de créer des fondations partenariales. Le PRES est un établissement public de coopération scientifique (EPCS). La loi ne s’applique qu’aux universités qui sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP). Je ne dis pas qu’il n’y aura pas des amendements pour que tel ou tel élément de la loi puisse être appliqué aux PRES, mais aujourd’hui, ce n’est pas le cas.
Ensuite, le PRES est actuellement dans une phase de consolidation et de structuration. Lionel Collet n’assure qu’une présidence transitoire ; Philippe Gillet, directeur de cabinet de Madame Pécresse, ne pouvant plus assumer cette charge, doit nommer un président dans les mois qui viennent. Il faut aussi que le PRES finisse d’intégrer par exemple l’INSA de Lyon qui, juridiquement, n’y est toujours pas. Et puis, aujourd’hui, il y a un projet de PRES qui va jusqu’à Saint-Étienne.
Enfin, le PRES assure bien une mission de valorisation pour tout ce qui touche aux brevets, aux licences, etc., via Lyon Science Transfert (LST). Mais cela ne règle que question de la valorisation stricto sensu. Aujourd’hui, l’INSA, Lyon 3, Lyon 1 et L’école centrale disposent chacun d’une structure de valorisation car pour la valorisation élargie, la réponse à appel d’offre, les contrats européens, etc., chaque structure se débrouille dans son coin et ne relève pas du PRES. Demain, il faudra peut-être qu’une même structure réponde aux appels d’offre ANR, etc., d’autant plus que la plupart des UMR qui répondent sont inter-étabilssements ! Mais je pense que ces questions devront attendre la consolidation du PRES.

Article
Quelles techniques et quels coûts pour traiter les micropolluants ?
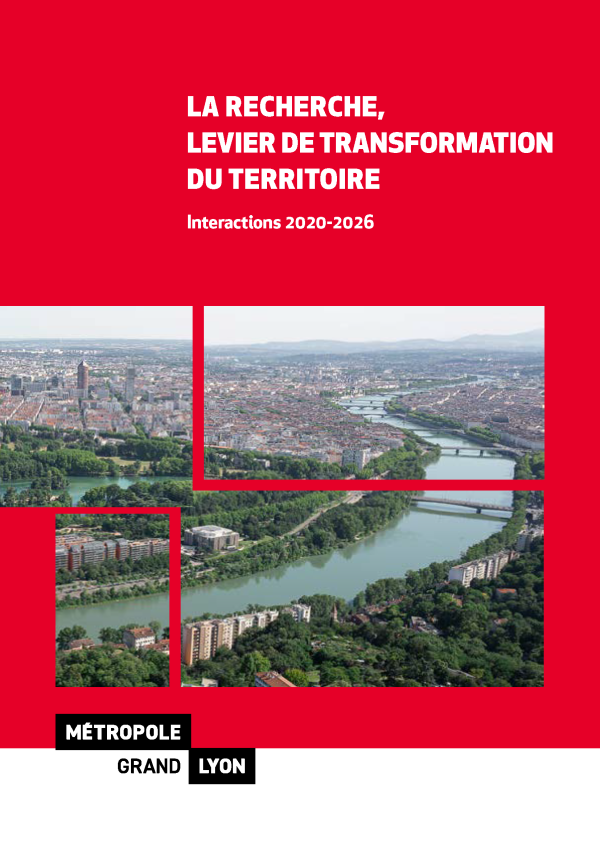
Étude
Aménagement du territoire, solidarités et santé, éducation, culture et sport : autant de champs d’action métropolitains qui ont fait l’objet de partenariats approfondis, détaillés dans ce document.

Article
Après la poussée de complotisme constatée pendant la pandémie, quels enseignements tirer pour réconcilier sciences et engagement citoyen ?

Texte de Marianne CHOUTEAU
Comment proposer un cadre normatif à l’exercice de la recherche tout en permettant une indispensable liberté scientifique ?

Dossier
Des bulletins pour approfondir vos connaissances au sujet de la vie des sciences humaines et sociales de la Métropole Lyon-St Étienne
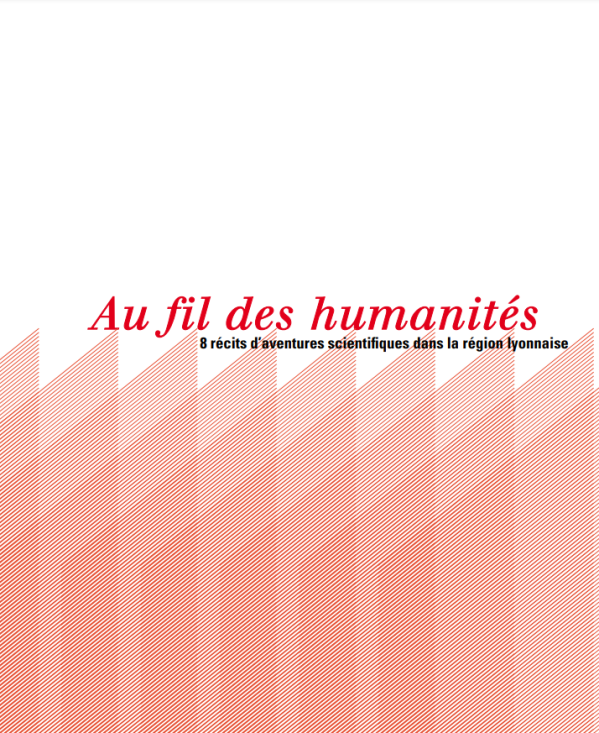
Étude
Huit récits d'aventures scientifiques dans la région lyonnaise.
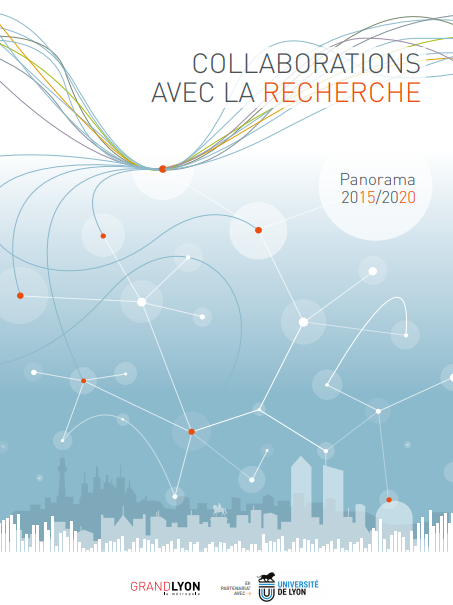
Étude
Ce document retrace les collaborations entreprises ou réalisées au cours des 5 premières années d’existence du Grand Lyon en tant que Métropole.
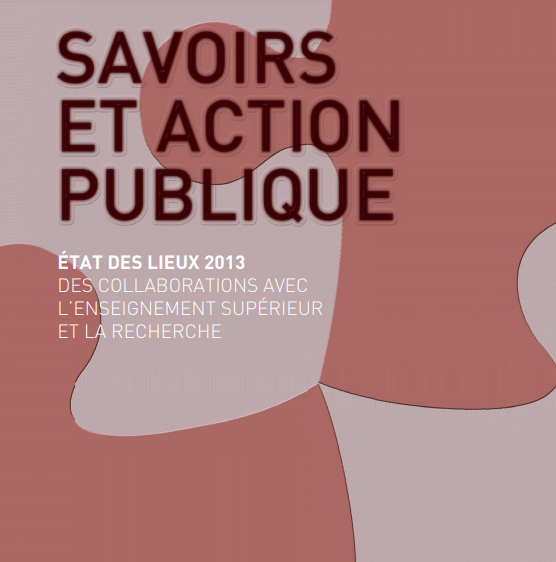
Étude
Cette nouvelle édition traduit un renouvellement significatif des projets engagés avec les sphères académiques. Parmi la cinquantaine de collaborations recensées, la recherche de connaissances au service de l’action apparaît comme un fil conducteur.
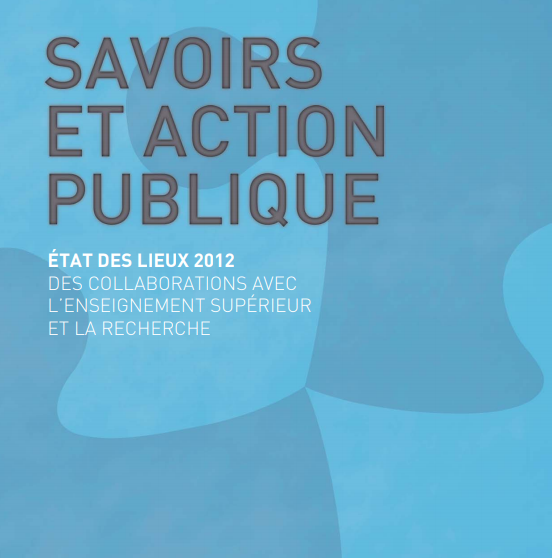
Étude
Cette nouvelle édition du livret des partenariats de recherche entre le Grand Lyon, l’Agence d'urbanisme de Lyon et les milieux académiques s’étoffe en présentant 52 collaborations engagées.