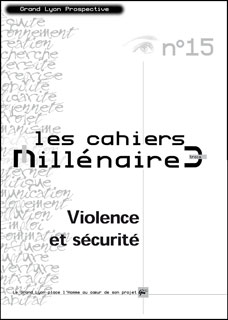Octobre 2012
Article réalisé pour la revue M3 n°3
Tripler le nombre de caméras installées sur la voie publique en deux ans, afin de passer de 20 000 à 60 000 caméras, était l’objectif affiché par le gouvernement en 2007. Afin d’assurer la promotion des équipements, il a aidé les communes à financer les installations en s’appuyant sur les ressources du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Les subventions accordées aux collectivités ont mobilisé une part croissante des crédits disponibles : 30 % en 2007 et 2008, 46 % en 2009, 60 % en 2010 et 2011. Au total, fin 2009, plus de 30 000 caméras seraient installées sur la voie publique en France (un chiffre contesté par la Cour des comptes qui en décompte deux fois moins). Pour quels résultats ?
Déficit d’évaluation pour la prévention
À ce jour, aucune évaluation scientifique n’a été menée en France pour mesurer l’impact préventif de la vidéosurveillance. Comme le remarquent justement A.-C. Douillet et S. Germain, contrairement à la Grande-Bretagne, notre pays est peu enclin à développer une véritable politique d’évaluation (cf. Vidéosurveillance ou vidéoprotection ?, éd. Le Muscadier, 2012). Les seules études officielles émanent des services de l’État, ce qui a conduit la communauté scientifique à mettre en doute leur impartialité et surtout à critiquer la méthodologie retenue pour les conduire. Celle-ci ne tient pas compte de la nature des délits considérés, des caractéristiques des lieux surveillés, des performances techniques du matériel utilisé et de la qualité des personnels en charge de la gestion des équipements (formation des opérateurs, conditions de travail, etc.). C’est donc vers l’étranger qu’il faut se tourner pour y voir plus clair. En effet, depuis le début des années 1990, près d’une centaine de recherches ont été réalisées hors de nos frontières sur ce sujet. Parmi les leçons à tirer de ces travaux, deux méritent de retenir l’attention ici. La première se résume en quelques mots : la vidéosurveillance a des effets distincts selon la nature des délits. Elle n’a pas d’effets dissuasifs s’agissant des violences physiques contre les personnes (homicides, viols, agressions) et les infractions les plus graves commises contre des biens (attaques à main armée notamment). Les criminologues rappellent à ce propos des choses simples. Dans la mesure où les comportements de nature impulsive (liés à la consommation d’alcool ou de drogues par exemple) sont imprévisibles, la présence de caméras est inopérante pour dissuader des jeunes gens ivres de se battre à la sortie d’un bar. De même pour un terroriste habité par une foi indéfectible qui aurait décidé de poser une bombe dans un métro. Quant aux délinquants professionnels, ils ont pris en compte depuis fort longtemps l’existence de dispositifs d’alarme ou de détection. S’agissant des atteintes à la propriété (cambriolage, vol à l’arraché, etc.), les résultats sont beaucoup plus contrastés. Certains comportements (comme l’action rapide et discrète d’un pickpocket) étant difficilement détectables sur un écran de contrôle, le vol à la tire par exemple est un délit qui évolue rarement à la baisse. En fait, la catégorie de délits pour laquelle la vidéosurveillance a apporté les résultats les plus significatifs est celle des vols visant les véhicules dans les parkings. Dans ces lieux clos, la crédibilité des moyens dissuasifs déployés semble amener un délinquant à appréhender le risque de se faire prendre comme étant réel. C’est là le deuxième enseignement majeur à retenir de ces études scientifiques : la vidéosurveillance a un impact limité dans les espaces complexes et étendus car le risque d’être arrêté n’est pas assez grand pour dissuader un délinquant potentiel de passer à l’acte. Toutes les études scientifiques étrangères aboutissent à la même conclusion. L’opération qui consiste à saupoudrer des caméras dans une ville pour prévenir la délinquance est vouée à l’échec si des objectifs précis et une doctrine d’emploi des systèmes ne sont pas définis au préalable.
Des élucidations très rares
Qu’en est-il en matière d’élucidation ? Un constat s’impose. Les réussites, très médiatisées, sont rares car la tâche est immense et fastidieuse. En effet, une caméra saisit tout ce qui entre dans son champ de vision, sans égard à une cause précise, et la collecte est prolifique : un appareil traitant 25 images par seconde, c’est-à-dire plus de 2 millions d’images en 24 heures, dans un espace qui compte une vingtaine de caméras, un système capture plusieurs dizaines de millions d’images au cours d’une journée ! Il en résulte que la visualisation apporte toujours des informations excédentaires au regard de la finalité du dispositif. Ce qui, dans la pratique, soulève de sérieux problèmes pour les enquêteurs. Un rapport récent du ministère de l’Intérieur montre bien les limites de cette opération. En s’appuyant sur un échantillon de 156 villes équipées de caméras sur la voie publique par rapport à 256 villes non équipées, les auteurs notent que « les taux d’élucidation progressent sensiblement de la même manière dans les villes avec ou sans vidéoprotection » (2009, p. 21). De fait, de 2000 à 2008, ce taux est en hausse quel que soit le type de délits, mais sa progression est toujours plus forte dans les villes non équipées que dans les villes équipées. Un rapport de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes qui a analysé la politique de sécurité publique menée par la ville de Lyon permet d’en savoir un peu plus sur la nature des affaires traitées par les agents de l’ordre grâce aux caméras. En s’appuyant sur les statistiques disponibles pour l’année 2008, elle a établi que les faits constatés sur les images, signalés ou enregistrés par le centre de supervision, relèvent principalement de troubles à l’ordre public (1 096 faits). Ce sont à la fois les faits les plus constatés par les opérateurs devant leurs écrans et les faits pour lesquels le centre est le plus sollicité. Dans une moindre mesure, ils relèvent des atteintes aux biens (212 faits) et aux personnes (118 faits). Quant à l’utilisation judiciaire de ces images, les auteurs du rapport observent « [qu’] elle reste marginale (322 réquisitions d’images ou PV de renseignements judiciaires) au regard de l’ensemble des faits enregistrés sur la ville de Lyon (45 000 faits totaux dont 20 640 faits de voie publique) » (p. 48). 322 réquisitions pour 20 640 faits de voie publique enregistrés au cours d’une seule année, soit 1,5 % des affaires traitées, c’est effectivement un pourcentage extrêmement faible au regard des efforts financiers considérables consentis par la collectivité. Et la ville de Lyon ne constitue pas un cas à part. La chambre régionale a établi un constat identique à Saint-Étienne (2 % des affaires traitées en 2008). C’est dire que l’apport de la vidéosurveillance à l’élucidation d’affaires judiciaires demeure marginal.
Les limites des systèmes intelligents
Face à ces résultats, la tentation des autorités publiques pourrait être de multiplier le nombre de caméras ou encore de recourir à la vidéosurveillance dite intelligente. Est-ce bien raisonnable ? On peut sérieusement en douter. J’avancerai ici deux arguments pour m’en expliquer. Le premier concerne l’économie de la visibilité qui tend à se développer dans les espaces urbains. Jusque-là, le gouvernement a cru pouvoir répondre au sentiment d’insécurité de la population en appelant à la greffe de caméras un peu partout sur le territoire. Un sentiment qui est moins nourri par l’existence d’une menace que par celui d’être abandonné par les autorités publiques dans son espace de vie. Face à ce sentiment d’abandon, les caméras, aussi sophistiquées soient-elles, n’ont aucune utilité car elles rendent les agents de l’ordre encore plus invisibles aux yeux de la population. À moins qu’ils décident d’abandonner toute idée d’une police de proximité, les élus locaux devraient se tenir à l’écart de cette course à l’armement technique, alimentée par des industriels en quête de nouveaux marchés, à laquelle ils n’ont strictement rien à gagner.
Le deuxième concerne les effets imprévisibles de ce qui est présenté comme un progrès. La vidéosurveillance dite intelligente qui repose sur la reconnaissance faciale des individus en fournit un bel exemple. Les dispositifs les plus performants permettent d’identifier en quelques secondes un visage parmi plusieurs milliers (plusieurs millions selon la déclaration récente d’une firme japonaise) puis de filer en temps réel l’individu visé ou d’extraire des données conservées par le système toutes les séquences vidéos passées où il est apparu. Nombre d’observateurs saluent les prouesses de ces systèmes tout en soulignant les difficultés techniques à surmonter pour les rendre véritablement opérationnels (angle de la prise de vue, luminosité, mouvement trop rapide, etc.). Mais la plupart négligent l’essentiel : ces captations biométriques doivent être confrontées à des données déjà stockées pour servir au repérage ou à l’identification. Qui donc sera habilité à alimenter ces bases de données ? À les gérer ? Sous quelle autorité les opérateurs seront-ils habilités à agir ? Quelles sont les personnes dont les données biométriques seront conservées ? Les criminels (lesquels) ? Des individus suspectés (par qui, de quoi) ? Tous les habitants d’une ville (vers un fichage généralisé) ? Autant de questions auxquelles il serait bon de répondre avant de céder une part de l’intelligence humaine à des machines…