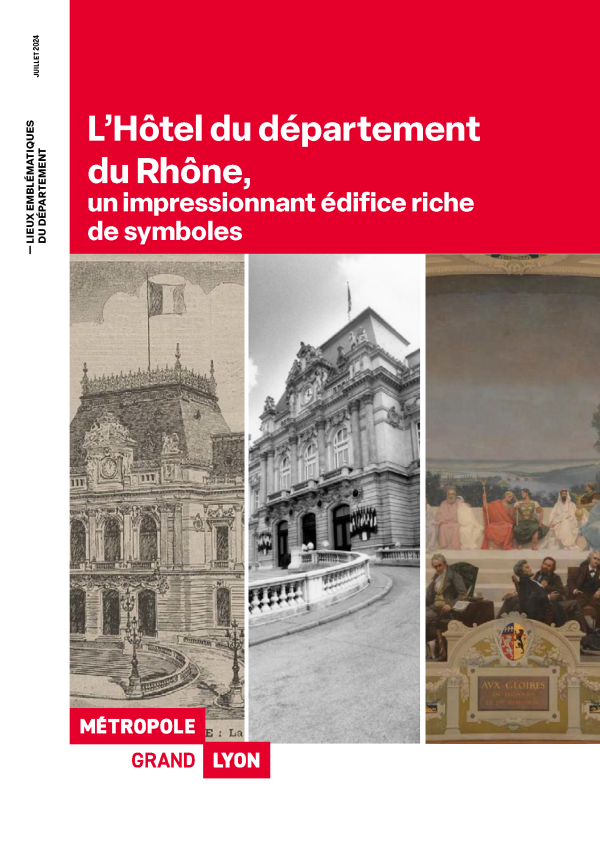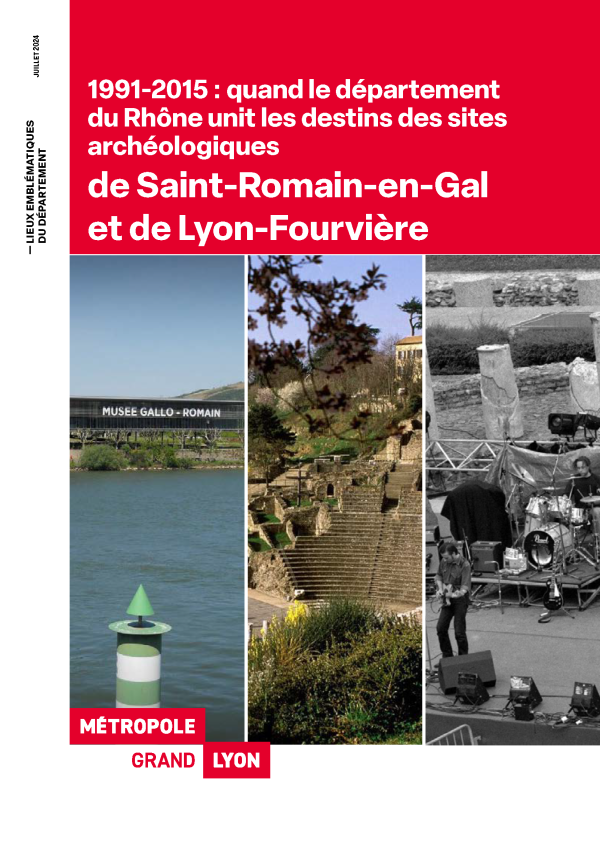Il est né le 1er janvier 1837 à Lyon dans une famille bourgeoise qui a bâti sa fortune, à l’époque napoléonienne, dans le commerce des draps et qui s’est tournée par la suite vers le négoce de la soie avec un magasin de soieries au 14 rue du Griffon à Lyon.
Un représentant typique de la bourgeoisie d’affaires lyonnaise
Cet héritier familial se forme en Angleterre et aux Etats-Unis, mais aussi, soie oblige, chez un canut de la Croix-Rousse. Il associe donc une approche à la fois théorique, celle de la libre entreprise et du libre échangisme, et pratique, le travail de la soie qui est à la base de la réussite économique de la ville de Lyon et de la fortune familiale. Sa carrière commence dans la banque familiale, Aynard et Rüffer fondée en 1857, qu’il dirige à partir de 1861. Par la suite, il fonde avec ses héritiers, la banque Aynard et fils.
Pour lui, le bourgeois doit s’investir au service de sa ville aussi bien dans les domaines économique, social que politique. Il entre en 1868 comme administrateur de la succursale de la banque de France à Lyon. Il est de 1881 à 1887 président de la Société lyonnaise de dépôts, comptes courants et crédit industriel (l’actuelle Lyonnaise de banque, groupe CIC) et après sa présidence, il garde toujours un oeil sur cette banque. Il est élu en 1882, à la Chambre de commerce dont il occupe ensuite la vice-présidence puis la présidence de 1890 à 1898. Il intervient dans de nombreuses caritatives au sein des Hospices civils de Lyon. Pour élever l’esprit de l’ouvrier par le travail, l’éducation, la moralité et l’instruction, il participe à de nombreuses associations, telles la Société d’instruction primaire, la Société d’enseignement professionnel, la Société de logements économiques.
Entré en politique en 1871 comme conseiller municipal de Lyon, sa carrière lyonnaise est modeste, puisqu’il quitte le conseil municipal en 1881 sans avoir été adjoint, car dans l’opposition. Son envol politique date de 1889 lorsqu’il devient député de la 8e circonscription du Rhône, mandat qu’il occupe jusqu’à sa mort le 25 juin 1913. Il échoue aux sénatoriales en 1909. Père de douze enfants, ce catholique social qui admet que la religion relève de la sphère privée, mais qui défend la liberté religieuse et de l’enseignement, s’inscrit à la Chambre des députés comme un conservateur rallié à la République à condition que celle-ci ne se mêle pas des affaires économiques et n’affirme pas un jacobinisme trop marqué. Ce républicain du Centre revendique dans l’héritage de la Révolution, celui des Droits de l’homme. Son modérantisme n’est pas de la mollesse, puisque « la modération est un état violent de l’esprit ». Sans avoir occupé de hautes fonctions nationales, Aynard est un homme de forte influence nationale.
Il s’érige donc, soit à la Chambre des députés, soit à la Chambre de commerce, en défenseur du libéralisme économique et est hostile à tout protectionnisme et réglementation douanière. Son modèle est Arlès-Dufour* qu’il a rencontré, qui l’a précédé dans beaucoup d’associations lyonnaises, avec qui il a déjeuné dans le cercle familial et amical, mais aussi dans celui des affaires. Il appartient à ce cercle de capitalistes qui, dans le dernier quart du XIXe siècle, ont fait de Lyon une métropole économique de premier plan grâce à l’interpénétration entre banques, négoce ancien et industries nouvelles.
Aynard, un homme de réseaux
On peut parler à son propos de la bande à Aynard. Gravitent autour de lui des artistes, des négociants, des architectes, des industriels qu’il côtoie dans les conseils d’administration des différentes banques, en particulier à la Société lyonnaise de dépôts, à la Société de géographie, à l’école de commerce, au sein de la rédaction du journal qu’il lance sans grand succès, Le Journal de Lyon, dans les différentes sociétés en charge d’instruction, aux Hospices civils de Lyon., à la Chambre de commerce et à la Société d’économie politique de Lyon, créée en 1866. C’est au sein de cette Société que des débats ont lieu sur les grands sujets économiques et sociaux qui accompagnent ou précèdent le vote de lois. Il en est le président de 1886 à 1889. Parmi les hommes clés de son réseau, il faut citer Clair Tisseur (alias Nizier du Puitspelu) écrivain lyonnais, l’architecte Gaspard André, le président de la Compagnie nationale de navigation Jean Bonnardel, les soyeux Léon Permezel, Sigismond Lilienthal et Auguste Sévène, les banquiers Saint-Olive, Cambefort, Cottet, Jacquier, Morin- Pons et Morel, l’abbé Camille Rambaud. Parmi le cercle rapproché de connaissances, il faut citer les industriels Gillet et Mangini avec qui il a des relations familiales étroites, et surtout Auguste Isaac et Ulysse Pila, compagnons d’investissements coloniaux en Asie et ailleurs.
Ce réseau permet à Aynard d’être présent même quand il n’est plus physiquement présent à Lyon, de placer des hommes à lui à la tête de tous ces lieux d’influence et de pouvoir entre Saône et Rhône, d’avoir des relais parisiens, de pouvoir intervenir dans les domaines qui lui sont chers, tels le libre-échange, le libéralisme, l’action sociale en faveur du peuple par le biais des sociétés de secours mutuels ou des oeuvres laïques, dont les plus connues sont les Habitations à bon marché (HBM) ou l’oeuvre lyonnaise des tuberculeux indigents. Un des domaines où Aynard s’est beaucoup investi est l’aventure coloniale par le biais des missions commerciales, comme la mission Brunat pour une meilleure connaissance du Tonkin en 1884. A ce propos, il est un des organisateurs essentiels de l’exposition coloniale de Lyon en 1894 qui se tient au parc de la Tête d’Or. Lors de son inauguration, en présence de Sadi Carnot, président de la République, il prononce ces mots : « Partout où vous trouvez un commerçant solide et honorable, un colon appliqué et tenace…, c’est un Lyonnais ».
Edouard Aynard appartient à cette catégorie de Lyonnais aujourd’hui inconnus, mais qui a agi en faveur de la ville, pour définir politiquement, économiquement, culturellement ce que peut être la ville de Lyon. Des institutions lui survivent, tel le musée des tissus. En effet, cette soif d’identité lyonnaise peut s’expliquer par l’histoire familiale, puisque son arrière grand-père Claude-Joseph est mort guillotiné en 1793 pour avoir défendu Lyon contre la Convention.
Bibliographie :
- Sylvie Geneste, Edouard Aynard banquier, député, mécène et homme d’oeuvres (1837- 1913), thèse de doctorat d’histoire, Lyon III, 1998.