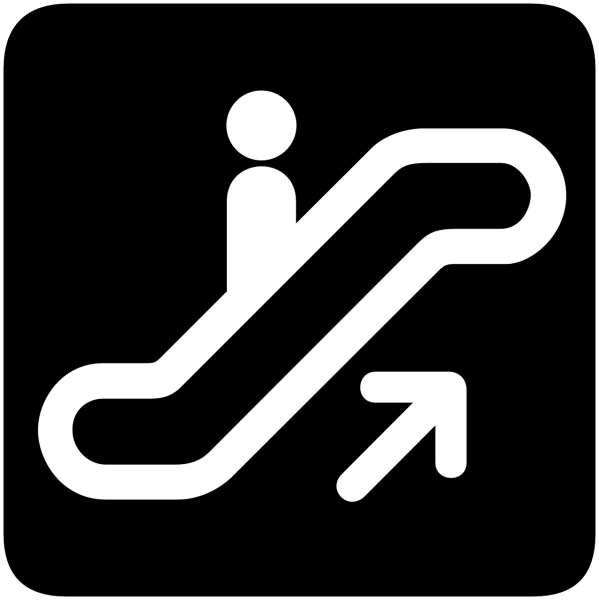La mobilité entretient des rapports complexes avec la ségrégation résidentielle que les politiques de mixité entendent combattre. Son influence sur la composition sociale et ethnique des territoires est équivoque. Par le jeu du profil différencié des entrants et des sortants, la mobilité représente tantôt un facteur de ségrégation, tantôt un facteur de déségrégation résidentielle, même si les phénomènes sont cumulatifs puisque les choix de localisation des ménages (du moins ceux qui disposent d’une capacité de choix) sont eux-mêmes influencés par les caractéristiques différenciées des territoires. Dans tous les cas, les dynamiques résidentielles ne sont pas réductibles à la simple rencontre (ou non-rencontre) entre des individus et des lieux : la mobilité des premiers et le niveau de ségrégation des seconds ne sont jamais indépendants des contextes institutionnels et des conditions de fonctionnement des marchés résidentiels. Dans ce jeu entre individus, territoires, institutions et marché, aucune relation causale évidente ne se dégage, qui permettrait à l’action publique d’utiliser un levier en vue d’atteindre mécaniquement un certain résultat, par exemple celui d’accroître la mixité des populations dans un espace donné. Reflétant l’impossibilité d’une modélisation unique, plusieurs figures – ou idéaux-types – sont identifiables autour du couple plus ou moins antagonique que forment mixité (ou ségrégation) et mobilité (ou immobilité) résidentielles. La première et principale figure investie par les politiques en faveur de la « mixité sociale » est celle des grands ensembles HLM.
D’emblée, les enjeux de la mixité et de la mobilité résidentielle ont eu partie liée car la formation historique des « cités » correspond au grand chassé-croisé s’étant produit à partir des années 1970 entre ménages sortants blancs et ménages entrants immigrés – une mobilité à double sens largement façonnée par les choix institutionnels de l’époque (encouragement à l’accession dans le périurbain et attribution ségrégative des logements sociaux). Dès l’origine, la mobilité résidentielle a ainsi joué contre la mixité des populations majoritaires et minoritaires. Aujourd'hui encore, son rôle reste décisif si l’on veut comprendre la spécialisation durable de ces quartiers au plan social et ethnique. Cette spécialisation résulte d’un double processus : d’une part les comportements de fuite ou de contournement des ménages en capacité d’arbitrer entre plusieurs localisations résidentielles ; d’autre part l’attractivité toujours réelle de ces quartiers pour d’autres ménages qui y trouvent les voies d’une promotion résidentielle , grâce aux logements spacieux et bon marché que l’on y trouve encore malgré les efforts des pouvoirs publics pour diminuer ce parc.
L’autre extrémité du spectre socio-urbain a fini par attirer l’attention des chercheurs et des pouvoirs publics, avec l’émergence du thème à succès de l’« entre-soi » des riches, voire des classes moyennes, à partir de la fin des années 1990. Il y aurait lieu ici d’affiner l’analyse, pour mieux distinguer entre les espaces historiques de la bourgeoisie où semble prévaloir une certaine immobilité sociale et résidentielle, et les territoires de prédilection des « classes moyennes », même si cette catégorie sociologique est bien trop grossière pour rendre compte de la diversité des dynamiques résidentielles de ce groupe central. La façon dont leurs pratiques font interagir ségrégation et mobilité reste d’ailleurs mal établie. Un courant de travaux d’inspiration économique insiste sur la rationalité qui préside aux choix résidentiels des classes moyennes, soucieuses de maximiser leurs chances dans la compétition sociale et économique en privilégiant la proximité de certains biens, services et aménités, et en évitant le voisinage d’autres groupes sociaux perçus comme porteurs de « risques » .
Cette lecture est contestée par d’autres auteurs soulignant au contraire la prédominance d’espaces « moyens mélangés » , même si les situations de relative hétérogénéité sociale n’excluent pas des formes d’évitement autre que résidentiel, notamment à l’école .
La troisième figure de relations entre ségrégation et mobilité n’est pas celle du refoulement ou de l’évitement des « pauvres », mais celle de leur délogement comme effet paradoxal de la mixité. On pense ici aux quartiers en voie d’embourgeoisement où les progrès de la mixité induisent souvent, à terme, l’éviction des habitants les plus vulnérables. Dans le schéma qui voit se succéder déségrégation puis re-ségrégation, la mobilité choisie des uns a pour corollaire la mobilité forcée des autres. Ce phénomène de mobilité à deux vitesses peut se vérifier aussi dans les quartiers en rénovation urbaine où une population peut en chasser une autre sous l’effet d’une gentrificationqui n’a ici rien de spontané puisqu’elle est activement recherchée par les pouvoirs publics.
Une dernière combinaison entre ségrégation et mobilité renvoie aussi à des phénomènes de relégation, même si les mécanismes et les groupes socio-ethniques en jeu ne sont pas forcément les mêmes que dans les cas de figure précédents. On fait ici référence à ces territoires périphériques très médiatisés dans la période récente , où la densité est faible et la ségrégation diffuse. Ces territoires seraient les réceptacles de populations qui choisissent et subissent tout à la fois leur mobilité résidentielle : refusant la proximité avec les minorités dans le logement social, ces populations cherchent en même temps à satisfaire leur rêve d’accession à la propriété, mais la réalisation de ce rêve est conditionnée à un exil toujours plus lointain, parce que la ville est devenue inabordable, et débouche sur de nouveaux phénomènes de captivité et d’immobilité résidentielles.
Augmenter la capacité de choix des citadins qui en ont le moins
À négliger la pluralité des configurations de la ségrégation résidentielle tout comme les stratégies et capacités différenciées des citadins, on s’expose à de sévères désillusions. C’est particulièrement vrai d’un pays comme la France où une loi sur la ville promettait rien moins qu’« éviter ou faire disparaître les phénomènes de ségrégation ». La leçon d’un siècle de sociologie et d’histoire urbaines est pourtant claire : les groupes sociaux et ethniques ne se répartissent jamais de façon uniforme dans l’espace. Les territoires composant les agglomérations remplissent des fonctions spécifiques pour différentes populations – des fonctions qu’il serait vain de nier sauf à faire de la puissance publique un inquiétant démiurge de la fabrique des rapports sociaux dans la ville.
Les bienfaits de la mixité résidentielle sont quasi indémontrables du point de vue de l’intérêt général et de celui des individus . L’action publique n’a-t-elle donc aucun rôle à jouer ? Si l’on juge politiquement souhaitable que l’horizon résidentiel et les possibilités d’usage de la ville de chacun ne soient pas implacablement dictés par son statut social ou son appartenance ethnique, alors des considérations d’équité devraient selon nous guider les politiques motivées par une double préoccupation de mixité et de mobilité. Approche équitable car la possibilité de choisir son quartier étant très inégalement partagée, promouvoir la mixité et la mobilité en général revient en pratique à favoriser ceux qui disposent déjà des ressources permettant d’arbitrer entre mixité et entre-soi, entre mobilité et immobilité. Si l’on veut éviter que les politiques urbaines ajoutent de l’inégalité aux inégalités existantes, il faut apprécier la valeur des politiques de mixité et de mobilité à l’aune de ce critère simple qu’est l’augmentation de la capacité de choix des citadins qui en ont le moins.
Dans cette perspective de justice spatiale, l’enjeu de la mixité peut croiser celui de la mobilité, mais selon des combinaisons distinctes liées à la nature des processus ségrégatifs. Sans que la liste soit exhaustive, on peut identifier au moins trois modes d’articulation équitable entre mixité et mobilité correspondant à trois configurations territoriales.
En théorie du moins, mixité et mobilité se conjuguent quand l’enjeu est d’ouvrir des territoires organisés sur un principe d’entre-soi social ou ethnique à des populations – notamment les minorités ethniques – qui en sont refoulées parce qu’elles se heurtent aux barrières discrètes de la discrimination ou du droit des sols. Parmi les leviers envisageables pour surmonter ces barrières figurent le développement d’une offre de logements sociaux correspondant au profil effectif de populations volontaires pour la mobilité, la transparence des attributions et des mutations au sein du patrimoine social, ou encore le travail sur les représentations et préjugés des élus, bailleurs et habitants des territoires d’« accueil » envers le logement social et les populations qui font figure d’« épouvantails ».
La convergence entre mixité et mobilité est déjà moins évidente dans les quartiers de type « cités ». Le respect du principe d’équité voudrait que l’on crée les conditions d’un choix entre une mobilité résidentielle circonscrite à l’échelle du quartier et une mobilité vers d’autres quartiers. On retrouve ici l’ancienne et toujours pertinente formule avancée par Daniel Béhar : donner aux habitants les moyens de partir, mais aussi l’envie de rester . Outre le fait qu’elle ne rejoint pas l’aspiration majoritaire des habitants, telle qu’on peut l’apprécier au travers des opérations de rénovation urbaine, une politique qui n’encouragerait la mobilité que vers d’autres quartiers viendrait conforter l’idée discutable d’une division fonctionnelle de la ville entre quartiers de non-choix (ceux de la politique de la ville) et quartiers de choix (les autres). Cela reviendrait aussi à nier le fait que tous les habitants ne peuvent mobiliser les ressources nécessaires à leur « émancipation » vis-à-vis du quartier et que le quartier lui-même n’est pas forcément synonyme d’aliénation.
Si l’enjeu d’une politique urbaine équitable est d’élargir la palette des choix, il faut alors considérer l’attractivité des quartiers pour les habitants en place et qui le resteront à horizon prévisible. Tel est en principe l’objet des stratégies « intégrées » qui s’efforcent d’agir conjointement sur différents leviers (logements, école, emploi, commerce, transport, sécurité, gestion urbaine, etc.) pouvant être autant de facteurs de stabilisation des populations en place. Cependant, au moins dans le cas français, un tel effort ne semble guère pouvoir être assumé politiquement si ses bénéficiaires potentiels restent essentiellement des minorités ethniques.
Un troisième cas de figure est celui de quartiers en voie de valorisation, que celle-ci procède d’une dynamique spontanée de gentrification ou qu’elle soit délibérément recherchée au travers des politiques de rénovation urbaine. Esquissé dans le cas précédent, le droit à l’immobilité résidentielle devient ici impératif, dans un souci d’équité, s’agissant des groupes les plus vulnérables aux effets d’éviction liés à la valorisation de leur quartier. Parmi les leviers d’action devraient figurer la préservation d’une offre de logements (très) abordables et l’ensemble des mécanismes permettant aux populations désavantagées de tirer parti du développement induit par l’arrivée de ménages plus fortunés.
Droit au logement, droit à la ville et rénovation urbaine : un réductionnisme facteur d’iniquité
Faute de prêter attention à la diversité des dynamiques résidentielles et aux ressources inégales des habitants, force est de constater que les politiques urbaines françaises sont bien éloignées d’une conception équitable de la mixité et de la mobilité. Depuis que la mixité a été érigée en impératif des politiques de l’habitat et de la ville, les pouvoirs publics ont privilégié une approche substantielle plutôt que procédurale : la mixité est comprise non pas comme un processus posant la question des choix dont bénéficient les moins favorisés, mais comme un état à construire au nom de l’intérêt général, c'est-à-dire au nom de l’idée que les décideurs publics – et les intérêts particuliers qu’ils représentent – se font de la « ville bonne ». À prétendre énoncer la substance même d’une politique de mixité, sans égard pour les processus conduisant à la réalisation de cet objectif, on le réduit à une simple question de seuils quantitatifs de logements et de populations à atteindre sur un territoire donné. Se trouve ainsi évacuée peu ou prou toute réflexion stratégique sur les manières d’articuler mixité et mobilité dans des situations territoriales spécifiques, de même que toute réflexion relative à leurs effets sur la situation des moins favorisés. Les politiques les plus emblématiques de la gauche (droit au logement, droit à la ville) et de la droite (rénovation urbaine) portent la marque de ce réductionnisme non dépourvus d’effets inéquitables .
La problématique des « seuils » parcourt toute l’histoire des politiques conduites au nom de la mixité depuis une quarantaine d’années. Tout a commencé avec l’institution de « seuils de tolérance » des populations immigrées dans les premiers quartiers HLM. Différents textes officiels cherchaient alors à limiter leur présence à 15% environ des locataires de chaque ensemble d’habitat social. Ces seuils se sont avérés inefficaces pour endiguer l’entrée massive des immigrés dans certains segments du parc HLM, mais l’idée de seuil a perduré, d'abord à travers les « politiques de peuplement » des bailleurs sociaux, puis à la faveur des deux lois fondatrices de l’approche « de gauche » de la lutte contre la ségrégation résidentielle, soit la loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement (dite loi Besson) et la loi d'orientation pour la Ville du 31 juillet 1991 (dite Lov, prolongée dix ans plus tard par la loi SRU). Tout en instituant de nouveaux droits (au logement, à la ville), le point d’entrée de ces deux textes était négatif, puisqu’il s’agissait de lois « anti », en l’occurrence de lois « anti-ghettos ». Les débats parlementaires étaient en effet polarisés sur cette « mobilité » qui avait abouti à la concentration de ménages d’origine immigrée dans les mêmes quartiers d’habitat social. Mais le remède proposé n’était pas tant une « mobilité positive » qu’une solution quantitative formulée en forme de seuils : seuils de populations qualifiées par euphémisme comme « défavorisées » dans les quartiers d’habitat social, seuils de logements sociaux dans les communes qui n’en offraient pas assez. On ne peut pas dire que l’équité envers les populations ciblées, pour ne pas dire stigmatisées par le législateur, ait été au rendez-vous.
Les Protocoles d'occupation du patrimoine social (Pops) créés par la loi Besson, qui devaient concrétiser le droit au logement en fixant des objectifs quantitatifs d’accueil des populations « défavorisées » dans le parc social, ont été conçus dans bien des territoires non comme des « quotas planchers » mais comme des « quotas plafonds ». Au point qu’une circulaire ministérielle est venue rappeler aux acteurs locaux qu’ils devaient raisonner « en termes de fluidité de marchés du logement, de mobilité résidentielle et de parcours résidentiels des familles et des personnes » afin que les objectifs quantitatifs ne soient pas « générateurs d’exclusions, comme c’est le cas dès lors que le protocole contient un ou plusieurs objectifs exprimés en termes de seuils maxima d’accueil ». Quant au seuil de 20% de logements sociaux dans toutes les communes d’une certaine taille, toutes les évaluations montrent qu’il ne bénéficie pas à la population que l’on cherche à « déconcentrer », mais pour l’essentiel aux populations indigènes (jeunes, retraités) des communes concernées, voire à des ménages relativement fortunés lorsque ces mêmes communes optent pour des logements sociaux haut de gamme (de type PLS) dans le but à peine voilé d’éviter l’accueil de ménages pauvres et de familles nombreuses.
Depuis les années 2000, la rénovation urbaine a reproduit les mêmes travers. Devant l’échec des politiques antérieures de «rééquilibrage» des quartiers d’habitat social attendue d’une meilleure répartition spatiale des logements sociaux et des ménages éligibles à ces logements, la rénovation urbaine introduit une méthode radicale de rééquilibrage entre logements sociaux et privés à l’échelle même des quartiers où les minorités sont jugées en surnombre. Le pari est là aussi mécaniste, le rééquilibrage quantitatif du parc devant suffire à attirer «des catégories de population différentes» dans ces quartiers. Cette équivalence s’est avérée trompeuse : sauf conditions particulières, introduire du logement privé dans les quartiers d’habitat social ne provoque pas l’arrivée des populations désirées, celles qui devaient alléger le poids des minorités ethniques dans les sites rénovés. Ces produits intéressent d’autant moins les ménages du groupe majoritaire qu’ils disposent de marges de manœuvre résidentielles : quand ces ménages ont le choix, pourquoi iraient-ils s’installer dans des zones qui restent mal réputées, notamment parce que les minorités y sont majoritaires ? Si elles restent majoritaires, c’est aussi parce que cette politique a par trop négligé la réflexion et la dimension opérationnelle de son volet «dispersion». Focalisée sur le « vidage » des immeubles à démolir, elle a fort mal anticipé les nombreux obstacles à la mobilité résidentielle « hors site », qu’il s’agisse de la coopération intercommunale, des effets conjugués de centaines d’opérations de démolition et de la loi Dalo qui absorbent la vacance du parc social mobilisable à une large échelle, ou encore des barrières de la discrimination auxquelles se heurtent les habitants à reloger. Sans oublier le point le plus aveugle de cette politique : le désir très majoritaire des habitants originels de rester dans leur quartier, que les décideurs ont paru découvrir en menant ces opérations .
Lutter contre la ségrégation contre le désir d’une partie très substantielle des habitants qui aspirent à la non-mobilité résidentielle, n’est pas l’aspect le moins problématique de cette politique . Là non plus l’équité n’a pas été au rendez-vous, une partie non négligeable de ces habitants ayant subi une mobilité forcée au nom de la mixité. Ce sont en fait les ménages les moins défavorisés qui ont tiré le profit maximum de cette injonction à être mobiles, tandis que les plus défavorisés ont pâti plus que les autres de ses effets. Tous les travaux sur le relogement identifient une fraction minoritaire d’habitants optimisant leur déménagement, qu’ils n’aient pas besoin de recourir aux dispositifs de relogement ou qu’ils soient dotés d’une bonne capacité de négociation avec les bailleurs et les municipalités . Pour la majorité des locataires, le relogement n’apporte aucune plus-value, quand il ne s’accompagne pas d’un coût financier ou psychologique élevé pour les plus réticents à la mobilité, ceux que la rénovation urbaine entendait précisément disperser. Or, l’appétence pour la mobilité est inversement proportionnelle aux difficultés socio-économiques éprouvées par ces ménages qui ont un intérêt objectif à ce que leur situation résidentielle n’évolue pas, pour ne pas déstabiliser davantage des conditions d’existence précaires.
Au-delà des ménages à reloger, la rénovation urbaine produit des effets systémiques pesant sur les opportunités résidentielles (accès et mutations) de l’ensemble des ménages dépendants du logement social bon marché, en bouleversant les files d’attente par la création d’une nouvelle catégorie de ménages plus prioritaires que les autres, et en rétrécissant partout l’offre de logements bon marché et de grande taille.Face à ces nombreux impensés, l’enjeu est rien moins que de reconceptualiser une doctrine urbaine qui reconnaisse la pluralité des modes d’intégration à la ville, qui tienne compte des ressources inégales des populations, qui envisage la lutte contre la ségrégation en termes de flux plutôt qu’en termes de stocks de logements et de populations à déplacer pour atteindre des quotas. Si l’on veut mener à bien cet effort de reconceptualisation, il paraît primordial de mieux distinguer les concepts de ségrégation et de discrimination, car faire de la lutte contre la ségrégation résidentielle (et donc de la mixité) une arme contre la discrimination ne vaut que dans une configuration bien précise : l’accès des minorités aux territoires qui leur sont de facto interdits. Il convient aussi de dissocier résolument les objectifs de mixité sociale et de mixité ethnique, car en se polarisant sur un objectif d’attraction de populations extérieures, c'est-à-dire blanches, dans les quartiers de minorités, les pouvoirs publics s’interdisent de penser des politiques cohérentes de promotion socio-résidentielle des populations déjà en place dans ces quartiers.
Il est non moins essentiel de repenser la relation entre mixité et mobilité en travaillant sur l’accessibilité aux divers espaces non-résidentiels de la ville (école, entreprises, lieux de culture, de loisirs …), là où les bénéfices du brassage social et ethnique sont bien mieux étayés que dans l’espace confiné des relations de voisinage. Alors que les raisons sont nombreuses de douter des vertus de la diversité résidentielle, dont les effets pervers ne sont pas rares en termes de conflits de cohabitation, la France a opté pour un modèle de diversité qui combine un volontarisme manifeste, focalisé sur la seule question du logement et sur les seuls quartiers de minorités, avec des efforts superficiels pour accroître l’hétérogénéité sociale et ethnique dans le monde du travail et de l’éducation. Voici un demi-siècle, Gordon W. Allport avait forgé une « théorie des contacts » suggérant que les préjugés diminuent lorsque les membres du groupe majoritaire multiplient les occasions de contact avec ceux des minorités. L’entreprise ou l’université sont les lieux par excellence où se forgent ces liens quotidiens et au long cours, alors que l’expérience de l’altérité est bien plus superficielle dans l’espace résidentiel, par ailleurs plus facile à fuir ou à éviter. C’est aussi une manière de réconcilier mobilité et mixité que de faciliter l’accès aux diverses ressources de la ville sans faire du déménagement une condition de la promotion personnelle.