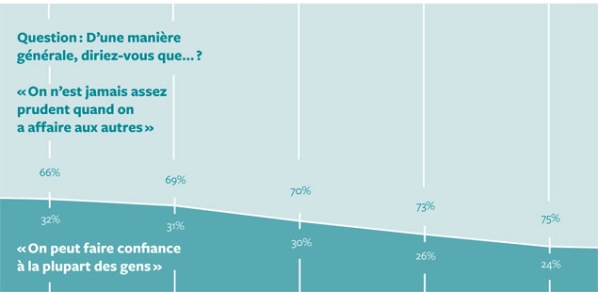L’actuelle crise de la démocratie se caractérise par une profonde fracture entre les citoyens et leurs représentants. Cette défiance se traduit dans les urnes par une évolution des comportements de vote des électeurs. Si le taux d’inscription sur les listes électorales a baissé, celui de l’abstention et le vote protestataire ont en revanche régulièrement augmenté entre le début des années 1960 et le début des années 2000. Par ailleurs, durant cette même période, le vote a confirmé sa tendance à être plus volatile et intermittent et, une succession d’alternances et de cohabitations politiques semble s’être installée.
Le niveau d’intérêt pour la politique Au printemps 2006, un an avant les présidentielles de 2007, à la question « Est-ce que vous vous intéressez à la politique ? » seulement 44% des Français ont répondu beaucoup (12%) et assez (32%).
Ce sont surtout les hommes qui manifestent un intérêt politique, 53% contre 35% de femmes.
Ce sont surtout les chefs d’entreprises, les enseignants (41%), les diplômés du supérieur (34%) et moins les ouvriers (11%) ou les employés (6%).
Parmi les 18-24 ans ayant un niveau d’études inférieur au baccalauréat, 37% sont politiquement « non impliqués » contre 3% parmi les plus de 50 ans diplômés de l’enseignement supérieur. Enquête par sondage réalisée par l’IFOP. Baromètre Politique Français 2006-2007 CEVIPOF - Ministère de l’Intérieur – 1ère vague Printemps 2006 |
Inscription sur les listes électorales
On observe, notamment depuis la fin des années 80, une diminution du taux d’inscription sur les listes électorales essentiellement dans les grandes villes où cette diminution serait de l’ordre de 4,4% entre l’élection présidentielle de 1998 et celle de 2002. (F.Subileau, L’absention : participation, représentativité, légitimité. Regards sur l’Actualité, n°287, janvier 2003) Depuis les années 70, l’abstention progresse très régulièrement
Les personnes qui n’ont pas de diplôme et d’emploi stable s’abstiennent plus : 20% des électeurs sans diplôme n’ont jamais utilisé leur droit de vote lors de la double élection de 2002, contre seulement 5% des plus diplômés (au-delà du premier cycle universitaire).
Taux d’abstention aux élections sous la Vème République – en pourcentage
| 1958 | 1962 | 1965 | 1967 | 1968 | 1969 | 1973 | 1974 | 1978 | 1981 | 1988 | 1993 | 1995 | 1997 | 2002 |
Elections présidentielles
2eme tour | | | 15,7 | | | 31,1 | | 12,7 | | 14,1 | 15,9 | | 20,3 | | 20,3 |
Elections législatives
2ème tour | 25,2 | 27,9 | | 20,3 | 22,2 | | 18,2 | | 15,1 | 24,9 | 30,1 | 32,4 | | 28,9 | 39,7 |
Source : ministère de l’intérieur La participation des jeunes connaît une chute brutale
Les générations nées en 1970-1976, âgées de 18 à 24 ans en 1995, avaient voté cette année-là dans une proportion de 71% (en taux de participation moyen). Un septennat plus tard, alors qu’elles sont âgées de 25 à 31 ans, les mêmes générations ne votent plus qu’à 58%.
Le vote des jeunes
Journal La-Croix.com du 18/03/2007, (Extrait) Qui peut voter ?
Depuis la loi du 10 novembre 1997, les jeunes atteignant leur majorité sont inscrits automatiquement sur la liste électorale de la commune de leur domicile. Les 18-24 ans et la politique
Selon une enquête Ipsos-Graines de citoyens réalisée auprès des 18-24 ans en décembre 2006, 75 % de ceux qui étaient inscrits sur les listes électorales étaient tout à fait certains d’aller voter à l’élection présidentielle de 2007. Mais, le même sondage indiquait qu’ils n’étaient que 57 % à s’intéresser à la politique et que 79 % d’entre eux déclaraient avoir une mauvaise image des hommes et femmes politiques. Les intentions de vote des jeunes pour la présidentielle de 2007
Selon un sondage de l’institut CSA réalisé pour Le Parisien et i-Télé le 14 mars, les 18-24 ans donnent un net avantage à Ségolène Royal, qui arrive en tête au premier tour avec 34 %, devant Nicolas Sarkozy (22 %), François Bayrou (20 %), Jean-Marie Le Pen (9 %) et José Bové (5 %). Le vote des 18-24 ans au premier tour des dernières élections présidentielles
– 1988 : Mitterrand 36 % (ensemble des Français : 34 %) ; Barre 18 % (17 %) ; Le Pen 17 % (14 %) ; Chirac 12 % (20 %)
– 1995 : Chirac 25 % (21 %) ; Jospin 24 % (23 %) ; Le Pen 17 % (15 %) ; Balladur 12 % (19 %)
– 2002 : Le Pen 20 % (17 %) ; Jospin 12 % (16 %) ; Mamère 11 % (5 %) ; Chirac 10 % (20 %) ; Besancenot 10 % (4 %) ; Bayrou 8 % (7 %).
Le 21 avril 2002, 63 % des 18-24 ans se sont rendus aux urnes. |
Le vote des 75 ans et plus
Journal La Croix.com du 10/04/2007, (Extrait) Les 75 ans et plus représentent 8,4% de la population française (3,8 % en 1950)
Le 1er janvier 2007, selon les données de l’Insee, les 75-84 ans étaient en France au nombre de 3 865 773 et les 85 ans et plus au nombre de 1 314 789. Les 75 ans et plus représentent donc 5 180 562 personnes et 11,5 % du corps électoral. Le vote des 18-24 ans au premier tour des dernières élections présidentielles
En 2002, lors du premier tour de l’élection présidentielle, les personnes âgées avaient voté en majorité pour le candidat de la droite républicaine, Jacques Chirac. Ce dernier avait recueilli 36,9 % des suffrages des plus de 75 ans et 31,8 % de ceux des 65-75 ans.
Les plus de 75 ans étaient par ailleurs 24,3 % à choisir le socialiste Lionel Jospin (les 65-75 ans un peu moins, 17,5 %). Signe d’une méfiance vis-à-vis de tous les extrêmes, les plus de 75 ans n’étaient que 9,3 % à choisir le président du Front national Jean-Marie Le Pen (qui avait obtenu 16,86 % des suffrages au total) et 0,5 % Arlette Laguiller, la candidate de Lutte ouvrière (5,72 % au niveau national). Les intentions de vote pour la présidentielle de 2007
Selon la vague 4 du baromètre « Cevipof-ministère de l’intérieur » sur les intentions de vote au premier tour, les 75 ans et plus déclarent vouloir voter à 47 % pour le candidat UMP Nicolas Sarkozy, 25 % pour la socialiste Ségolène Royal, 16 % pour le centriste François Bayrou et 3 % pour Jean-Marie Le Pen.
http://www.cevipof.msh-paris.fr
|
Le vote des zones urbaines sensibles et le vote de l'immigration
Journal La Croix.com du 16/04/2007, (Extrait) Les électeurs des ZUS sont significativement plus abstentionnistes que la moyenne nationale. « Au 1er tour de l’élection présidentielle de 2002, plus d’un électeur sur trois inscrits en ZUS n’a pas pris part au scrutin, contre moins de 3 sur 10 au niveau national. » Au 2e tour, l’écart s’est réduit mais est resté « supérieur à 5,5 points ». (1) Les habitants des ZUS ont significativement moins voté pour la droite traditionnelle que l’ensemble des électeurs nationaux. « en 2002, moins d’un vote sur quatre dans les ZUS est allé à la droite, contre un peu plus de trois sur huit au niveau national. » Ces suffrages perdus ont été, pour plus des trois quarts, gagnés par la gauche traditionnelle, qui a recueilli plus de 40 % des voix dans les ZUS. Les votes aux extrêmes, eux, ont été proches de ceux du reste du territoire. L’ordre de classement des principaux candidats a été l’exact inverse de celui qui a prévalu au plan national, avec Jospin en tête, suivi de Le Pen puis de Chirac en 3e position. (1) Le vote de l’immigration
23 % des habitants de la France métropolitaine sont immigrés ou d’origine immigrée. D’après Vincent Tiberj (2), « cette France du melting-pot se porte globalement vers la gauche ». Le baromètre politique français de septembre 2006 montre notamment que 60 % des descendants immigrés, toutes origines confondues, se sentent proches d’un parti de gauche, contre 47 % des Français sans origine immigrée. (1) La spécificité du vote ZUS, par Christine Fauvelle-Aymar, Abel François et Patricia Vornetti, septembre 2004, Etude du Laboratoire d’économie publique (Laep, Paris I) fondées l’analyse des comportements électoraux dans 210 ZUS à la présidentielle de 2002 (1).
(2) Dans Atlas électoral 2007, qui vote quoi, où, comment, sous la direction de Pascal Perrineau, Les Presses de Science-Po, 140 p., 19 €. |
Les votes blanc et nul ont également connu une progression
Ils ont pratiquement triplé entre 1965 et 2002.Votes blancs et nuls au premier tour des élections présidentielles en pourcentage des inscrits
1965 | 1969 | 1974 | 1981 | 1988 | 1995 | 2002 |
0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.4 |
Le vote contestataire
Le « front de refus » à l’élection présidentielle au 1er tour en pourcentage des inscrits
Source : F.Subileau, L’absention : participation, représentativité, légitimité. Regards sur l’Actualité, n°287, janvier 2003
| | Abstention | Vote blanc et nul | Vote protestataire | Total |
1965 | 15 | 1 | 7 | 23 |
1969 | 22 | 1 | 2 | 25 |
1974 | 17 | 1 | 9 | 27 |
1981 | 19 | 1 | 10 | 30 |
1988 | 19 | 2 | 18 | 39 |
1995 | 22 | 2 | 22 | 46 |
2002 | 28 | 2 | 28 | 58 |
Le vote protestataire est surtout celui des milieux populaires
Françoise Subileau précise que l’élection présidentielle de 2002 a révélé que les retraités et les cadres, et eux seuls dans l’électorat, donnent une majorité de leurs voix aux candidats des partis de gauche et de droite, cette majorité étant plus nette pour les retraités (62%) que pour les cadres (50%). Il n’y a qu’un retraité et un cadre sur sept qui donne sa voix à un candidat « protestataire ». À l’inverse, les voix des milieux populaires se divisent en trois tiers presque égaux : un tiers pour les partis de gouvernement, un tiers pour les candidats « hors système » et un tiers d’abstention. Ce phénomène est encore plus accentué chez les ouvriers.
Des comportements significatifs et en augmentation
Selon Bruno Denis, chargé d’études à la Documentation française, une fois cumulées, ces expressions d’hostilité peuvent aller jusqu’à représenter plus de la moitié des suffrages exprimés, et être à l’origine de « surprises électorales » interprétées comme autant de « séismes politiques ».
Le référendum du 29 mai 2005 est l’un de ceux-là : alors même que les trois plus importants partis français (UMP, UDF, PS) avaient officiellement fait campagne pour le « oui » au projet de constitution européenne et étaient soutenus par la quasi totalité des médias nationaux, les Français ont répondu « non » à 54,87%.
Et les études réalisées en 2006 par le Cevipof démontrent que cette fracture civique semble persister, voire s’aggraver.
Le 29 mai 2005 : un vote révélateur d’un basculement des classes moyennes
Les votes protestataires des dernières élections, lors des présidentielles de 2002 ou du référendum sur le traité constitutionnel de 2005, montrent combien les citoyens ont voulu exprimer leur sentiment. Les résultats du référendum de 2005 sont particulièrement éloquents et confirment que si le sentiment d’insécurité sociale touche d’abord les personnes les plus exposées, les ouvriers (81% se sont exprimé en faveur du « non »), les employés et les chômeurs, il tend également à se généraliser et à devenir le « mal être » de l’ensemble des classes actives. Le « non » a été majoritaire dans toutes les tranches d’âge : 56% chez les 18-24 ans, 55% chez les 25-34 ans et plus de 60% chez les 35-60 ans.
C’est la grande révélation du référendum : les classes moyennes ont basculé.
Alors que les retraités et les cadres ont eu un vote presque similaire respectivement de 60% et 62% en faveur du « oui », on note une très forte progression du « non » chez les professions dites intermédiaires (infirmiers, professeurs, comptables, commerciaux). Selon l’enquête réalisée à la sortie des urnes par Ipsos pour le Figaro, le non gagne dans cette catégorie professionnelle, 17 points entre 1992 (Maastricht) et 2005 pour se fixer à 53%. Ce phénomène protestataire avait déjà été constaté lors de l’élection présidentielle de 2002 où une partie non négligeable des classes moyennes, notamment des catégories intermédiaires, avait choisi des candidats « protestataires ». « Ce qui bascule, c’est la France périurbaine, celle des zones pavillonnaires bas de gamme. C’est la remise en cause d’une classe moyenne intégrée, héritage des Trente Glorieuses » analyse le géographe Christophe Guilluy. C’est l’essence même de cette « France du milieu » qui est en train de disparaître. Ce qui la caractérisait, c’est-à-dire la foi en une vie meilleure pour eux et pour leurs enfants, l’aspiration à rejoindre les classes supérieures, n’est plus. Ce rêve s’est brisé. La crainte du déclassement et le sentiment de précarisation ont contaminé la classe moyenne. Ni perspective d’enrichissement, ni accès aux programmes sociaux, ni bénéfice tiré des mesures fiscales sur les donations, ce triple sentiment irrigue la classe moyenne qui se considère exclue.
Résultat du référendum sur le traité constitutionnel dans l’agglomération lyonnaise La France a voté NON à 54,18%, la région Rhône-Alpes à 51,62%, le département de la Loire à 55,85%, Saint Etienne à 53,69%, Roanne à 56,74% et Saint Just Saint Rambert à 51,39%.
Le département du Rhône a voté OUI à 54,18% et l’agglomération lyonnaise à 55,76%.
On constate que derrière les pourcentages de l’agglomération lyonnaise, de grands écarts sont à souligner : Charbonnières a voté OUI à 76,4%, Lyon à 61,35%, Bron à 50,99 et Vénissieux, a voté NON à 54,21%.
D’une manière générale, le vote négatif en Rhône-Alpes s’est concentré dans les zones rurales et dans les zones urbaines les plus défavorisées. |
Ce phénomène n’est pas propre à la France
Ces comportements de vote témoignent du désenchantement des citoyens à l’égard du politique. Et dans la plupart des pays d’Europe on constate une évolution comparable ainsi qu’une montée inquiétante des votes populistes. C’est d’ailleurs la quasi-totalité des pays développés (Etats-Unis, Japon) qui se trouvent confrontés à une crise des représentations collectives plus ou moins comparable compte tenu des disparités des systèmes politiques.
Le vote devient intermittent
Comme le souligne le journaliste Michel Noblecourt dans un dossier du Monde de mai 2006 « Partis politiques : 12 mois pour convaincre », la France semblait avoir trouvé l’antidote à sa déliquescence partisane grâce à un système électoral à dominante majoritaire uninominale faisant émerger une bipolarisation politique qui était un gage de stabilité et d’efficacité. Cette époque semble révolue. Et l’on assiste à des changements notables dans les comportements électoraux. Les intentions de vote sont aujourd’hui plus volatiles. Le vote n’obéit plus autant aux clivages idéologiques classiques et dépend davantage des enjeux perçus. (D.Boy et N.Mayer L’électeur a ses raisons. Paris, Presses de sciences PO, 1997)
Une des conséquences : une succession d’alternances et de cohabitations
Depuis le début des années 80 la France est marquée par une succession d’alternances et de cohabitations politiques.
1981
Présidentielles
Législatives | Législatives Victoire de la gauche
François Mitterrand est élu Président.
Victoire de la gauche
L’alternance politique est complète. |
1986
Législatives | Victoire de la droite
Jacques Chirac est nommé Premier ministre.
Début de la première cohabitation. |
1988
Présidentielles | Victoire de la gauche
François Mitterrand est réélu Président.
Fin de la première cohabitation. |
1993
Législatives | Victoire de la droite
Edouard Balladur est nommé Premier ministre.
Début de la deuxième cohabitation. |
1995
Présidentielles | Victoire de la droite
Jacques Chirac est élu Président.
Fin de la deuxième cohabitation. |
1997
Législatives | Victoire de la gauche
Lionel Jospin est nommé Premier ministre.
Début de la troisième cohabitation. |
2001
Municipales | Progression de la droite et recul de la gauche plurielle malgré son succès à Paris et à Lyon. |
2002
Présidentielles Législatives | Victoire de la droite
Jacques Chirac est réélu Président.
Jean-Pierre Raffarin est nommé Premier ministre.
Victoire de la droite
Fin de la troisième cohabitation. |
2004
Régionales | Victoire de la gauche qui remporte toutes les régions sauf une. |