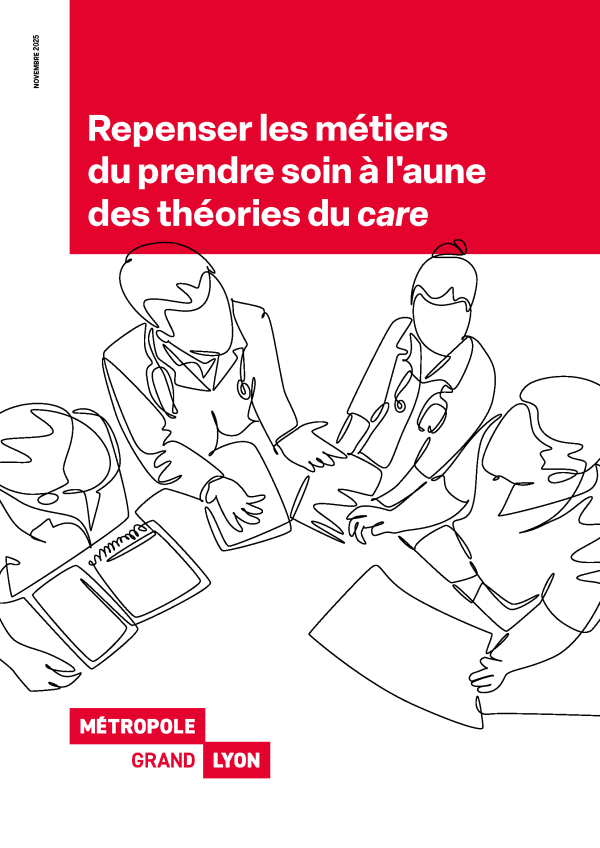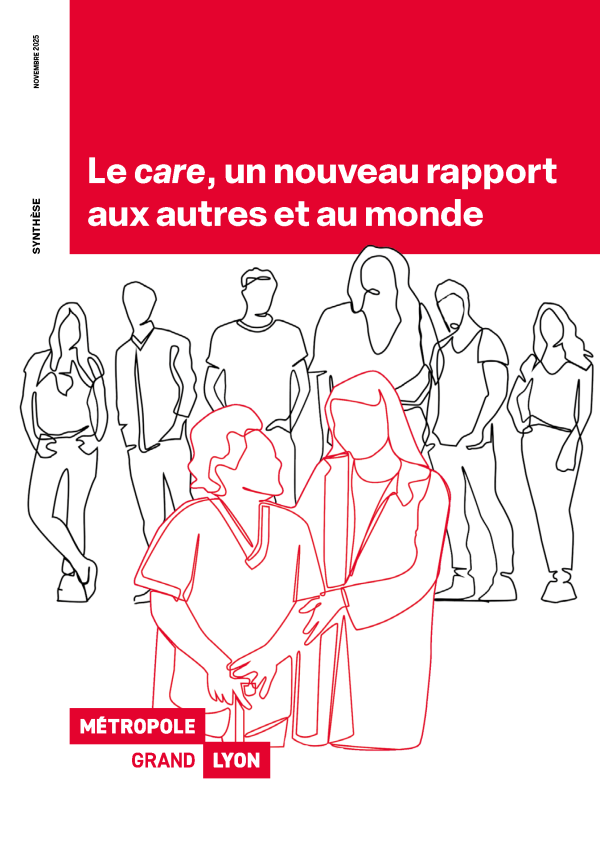La « géographie prioritaire » (on désigne ainsi les quartiers populaires qui font l’objet, avec la politique « de la ville » d’une intervention publique spécifique) est née au début des années 1980 dans un registre local et expérimental.
Non seulement, au cours des années 1990 et 2000, cette géographie s’est maintenue, mais encore elle a fait l’objet de deux phénomènes coextensifs : un élargissement quantitatif et une rationalisation statistique. Ces deux processus permettent de décrire un phénomène nouveau en France, la naissance et l’inscription durable dans le paysage politico-administratif d’une catégorie territoriale et de poser une question : que désigne cette catégorie, et à quoi sert-elle en pratique.
Ces deux dimensions de l’interrogation débouchent sur une troisième : peut-on parler de « discrimination positive à la française » ?
Au sommaire :
- Naissance et développement d’une catégorie territoriale
- Une catégorie territoriale, mais pour quoi faire ?
- Une « discrimination positive territoriale » ?
Ce texte sert notamment de référence dans la fiche n°10 du document Millénaire3 : Discriminations "raciales" et politiques antidiscriminatoires, édité à l'occasion de la journée prospective du 3 juin 2003 au Grand Lyon.