L’ESPRIT DES LIEUX : Pour sortir de l’alternative : patrimoine contre projet urbain

Étude
Présentation de l'expérience « esprit des lieux » à Vaulx-en-Velin.
< Retour au sommaire du dossier

Interview de Philippe DUJARDIN
« Il n’y a pas de collectif humain qui soit autre chose qu’une "symbolisation" »
Nos sociétés contemporaines apparaissent de plus en plus distendues ; leur modernité même repose sur l’autonomie croissante des individus et sur la fiction d’une dé-hiérarchisation toujours plus poussée du corps social.
Dans ce contexte, comment le pouvoir politique peut-il exercer sa mission première, qui est de faire tenir ensemble ce qui semble avoir vocation à se séparer continuellement ?
Dans cet entretien, le politologue Philippe Dujardin partage avec nous ses réflexions sur l’importance du symbolique en démocratie, à partir de l’histoire lyonnaise.
Vous travaillez sur l’histoire des pratiques politiques et sur leur dimension symbolique. En quoi une telle approche permet-elle d’éclairer les enjeux actuels de gouvernement des sociétés locales ?
Lorsque, après avoir enseigné à l’Institut d’Études politiques de Grenoble, je suis revenu à Lyon en qualité de chercheur du CNRS, c’était avec l’intention déclarée de travailler sur une histoire politique lyonnaise qui me paraissait extrêmement négligée. En 1983, j’ai créé avec quelques collègues une équipe de « politologie historique » : il s’agissait pour nous de comprendre l’actualité des pratiques politiques locales en la replaçant dans le temps long de l’histoire.
Nous avons donc travaillé sur le XIXe siècle et le début du XXe siècle, en enquêtant notamment sur les réseaux qui se constituaient à l’époque : réseaux cléricaux et anticléricaux, républicains et monarchistes, libéraux et radicaux, blanquistes et socialistes, qui ont informé un espace public très polémique, très clivé.
Nous nous sommes vite aperçus que l’on ne pouvait pas comprendre la vigueur du face-à-face entre ces réseaux sans nous pencher, entre autres, sur le dispositif maçonnique, qui est très fortement ancré dans la région lyonnaise depuis le XVIIIe siècle ; et que l’on ne pouvait pas penser le prosélytisme maçonnique sans analyser en même temps, face à celui-ci, l’extrême importance du dispositif clérical inspiré par les Jésuites — notamment celui dit, à Lyon, de la « Congrégation des Messieurs ».
Il nous a fallu interroger le surprenant parallélisme des formes — formes de recrutement, formes de hiérarchisation des groupes, formes de cloisonnement horizontal ou vertical — qui est bien l’un des effets et l’une des conditions d’un espace de véhémente adversité. Il nous a fallu interroger également les filiations qui mènent des dispositifs compagnonniques médiévaux, des dispositifs maçonniques caractéristiques de l’âge des Lumières aux dispositifs des sociétés conspiratives de la première moitié du XIXe siècle.
C’est à ce titre que nous nous sommes intéressés à l’histoire du compagnonnage des Bons cousins charbonniers et de sa réappropriation politique par les carbonari italiens et la Charbonnerie française. Il nous a fallu, encore, interroger les hybridations étonnantes de dispositifs de type religieux, militaire, civil qui ont pu conduire à l’idéologie de « l’armée industrielle » que les saint-simoniens ont répandue, avec le succès que l’on sait, à Lyon.
Comme politologues, nous avons été très rapidement convaincus que le temps présent était inintelligible sans un minimum de connaissances de ce qu’avaient été les conditions de formation de cet espace public constitutif de notre contemporanéité. Mieux encore, nous réalisions qu’il fallait plonger bien plus loin dans le temps, en nous intéressant à des formules d’assemblage venues, comme je viens de le suggérer, de l’époque dite moderne, de la Renaissance, voire de l’Antiquité.
Une société secrète conspirative du XIXe siècle se distingue, certes, d’une société secrète de type initiatique, telle celle des pythagoriciens grecs, mais la problématique du secret est là, qui oblige à penser le même et le distinct. Il ne suffisait donc pas d’adopter la méthode historique, il nous fallait adopter, également, un regard anthropologique.
Pourquoi fallait-il ce regard anthropologique ?
Parce que la problématique de l’agrégation, que celle-ci soit religieuse, civique, professionnelle, déborde les périodisations historiennes. Elle n’a pas d’âge, ou plus exactement, elle est transhistorique. Parce que la problématique du secret, du pouvoir de liaison d’un collectif qui fonctionne au secret ou à la discrétion, échappe aux catégories historiques convenues. Pourquoi un agrégat politique fonctionne-t-il au secret, à la hiérarchie, à la gradation ? Évidemment, parce que les conditions légales de l’expression de l’opinion, par la voie du suffrage notamment, ne sont pas réunies.
Parce que la liberté de constitution d’une formation partisane n’existe pas. Mais aussi, parce que les formules d’assemblage « au secret » sont jugées efficaces… et sont séduisantes : elles agrègent une élite, puis l’élite de l’élite, sur un mode initiatique ou para-initiatique, qui génère la fierté de ceux qui ont surmonté les épreuves, l’inconditionnalité des engagements et, au total, une remarquable emprise du collectif sur ses membres. En d’autres termes encore, elles restaurent paradoxalement, dans le moment même de la lutte pour la démocratie, le principe de l’aristocratie… La désignation politiquement correcte de l’aristocratie, durant des décennies, n’aura-t-elle pas été « avant-garde » ?
Nous avons donc mené une réflexion pluridisciplinaire sur ce que nous avons nommé « les processus et les procédures d’agrégation », réflexion qui a donné lieu à l’édition d’ouvrages, tels que Le Secret (1987), Du Groupe au réseau (1988), Sociologie du découpage et de ses usages politiques (1993), Politique de la mémoire (1993). Nous nous sommes aussi intéressés au rapport entre pouvoir et image, à l’efficacité, dite symbolique, de l’image. J’ai travaillé et travaille encore de conserve avec un historien, Gérard Sabatier, spécialiste de Versailles.
Versailles, c’est l’illustration d’un fonctionnement monarchique pleinement structuré par la monumentalité, la théâtralité, par des effets d’image inédits. La Galerie des Glaces, c’est un programme iconographique exceptionnel ! Est-ce par hasard si, le 18 janvier 1871, Bismarck y fait proclamer l’unité de l’Empire allemand ? Épisode bien humiliant de l’histoire de France, à coup sûr, mais qui témoigne, aussi, du type d’efficacité symbolique induite par les mises-en scène de la monarchie absolutiste.
La dimension symbolique est-elle indispensable à l’exercice du pouvoir ?
Il n’y a pas de pouvoir qui ne requière ce que nous nommons, faute de mieux peut-être, une dimension symbolique. Mais la difficulté dont nous pâtissons tous est de ne pas entendre l’étymologie grecque de l’adjectif symbolique. En grec, symboliser signifie assembler. Tel est le sens de la forme verbale du grec sumballeïn. Non pas « mettre en signes », mais « assembler », « mettre ensemble ».
L’antonyme est diaballeïn, d’où nous vient diabolisation, mais qui signifie primitivement « passer entre », « diviser », « séparer ». Quand je dis « agréger », forme verbale dérivée du latin, et quand je dis « symboliser », j’emploie des synonymes. Quand je dis « désagréger » et « diaboliser », j’emploie des synonymes. Or, il n’y a pas de collectif humain, de société, qui soit autre chose qu’un assemblage, autrement dit qui soit autre chose qu’une « symbolisation », advenue et advenant. Et il n’y a pas d’assemblage, pas d’agrégation, sans qu’il y ait une « mise en ordre ».
Toute symbolisation appelle un cosmos, c’est-à-dire, littéralement, un « ordre ». À ce titre, et toujours en me fiant à l’étymologie grecque, je puis assurer que toute symbolisation est « cosmétique » : elle produit l’ordre qui lui est conforme. Et la symbolisation s’actualise — ceci est un point cardinal pour moi — dans une compétence qui est la compétence rituelle : soit une combinaison de gestes, de paroles, de manipulations diverses.
J’assemble des humains, en manipulant des objets et en manipulant du langage, en travaillant non pas seulement dans l’espace et dans le temps, mais en travaillant sur l’espace et sur le temps. Et le génie des humains c’est qu’ils s’assemblent « au nom de », qu’ils « évoquent » quelque chose qui n’est pas là : une divinité, un animal totémique, la liberté… Mais, « avant tout », les humains s’assemblent au nom du défunt dont on fait mémoire, de l’ancêtre que l’on honore. La première définition possible de l’humain, à mes yeux, tient à la compétence rituelle, dont on relève les indices dans les premiers rites funéraires observables, 100 000 ans avant l’ère chrétienne…
On voit bien comment les sociétés monarchiques ont réinventé ces ritualités pour faire tenir ensemble leurs sujets, mais on voit moins ce qu’il en est dans nos sociétés démocratiques…
Toute société, en quelque lieu et quelque temps qu’elle soit, produit les formes adéquates à l’ordre qui est le sien. Ces formes relèvent d’un ordre « juridique » : il en va des us, coutumes, codes, protocoles, règles, lois et règlements. Ces formes relèvent, aussi, d’un ordre « esthésique » et il en va alors des opérations ayant pour effet d’affecter les sens.
Quand on sature d’encens une basilique byzantine, l’effet est enivrant, et tel est le but de l’opération. Quand, à Lyon, on projette des « mégawatts » de lumière le soir de la venue d’un pape ou lors d’une fête des Lumières du 8 décembre, les pouvoirs publics et les entreprises concernées en jettent littéralement « plein la vue », et tel est le but de l’opération.
Ceci dit, il est vrai que les sociétés démocratiques ont du mal à signifier l’ordre qui leur est propre, parce que cet ordre se veut a-hiérarchique. Avant la grande coupure des révolutions du XVIIe siècle anglais et du XVIIIe siècle français, les sociétés étaient « naturellement » hiérarchisées : l’ordre divin avait son reflet sur terre en la personne des monarques, des princes, clercs ou laïcs, lieutenants de Dieu. Et la hiérarchie était celle des ordres composant la société selon la triade des fonctionnalités indo-européennes : le prêtre, le guerrier, le laboureur. Quand le principe républicain et démocratique est mis en œuvre, un grand embarras naît : comment figurer un ordre quand on dénie le principe même d’ordre ?
Nous sommes dans des sociétés de plus en plus déhiérarchisées ?
Oui, les sociétés démocratiques technologiquement avancées, les unes républicaines, les autres monarchiques (la société britannique, la société hollandaise, la société belge ou espagnole…) fonctionnent à la dé-hiérarchisation permanente, puisqu’elles doivent satisfaire constamment à l’exigence qui est culturellement la leur, à savoir la promotion du principe d’autonomie. C’est un principe de plus en plus avéré : nous choisirons bientôt la couleur des yeux de nos enfants…
La science et la technologie alimentent sans cesse cette propension en ouvrant le jeu des possibles et en autorisant le zapping. En ce sens, nos sociétés sont fondamentalement « hérétiques », pour autant que je redonne à « hérésie » son sens premier, dérivé du verbe grec aïrein qui signifie « choisir », « élire ». Elles ouvrent la possibilité illimitée de l’hérésie, c’est-à-dire du choix, procédure dans laquelle s’actualise le principe d’autonomie.
Comment donc faire « tenir ensemble », comment gérer de telles sociétés ?
C’est une gageure, un paradoxe. Comment agréger, c’est-à-dire comment « symboliser » au sens grec, là où je n’ai plus affaire, dit-on, qu’à des individus autonomes ? La réponse doctrinale de Rousseau est connue. Pour lui, l’association se substitue à l’agrégation. Le « contrat social » remplace l’ordonnancement venu d’en haut : on est en société parce qu’on le veut bien. Mais c’est un « faire comme si » !
Il faut être vraiment naïf pour penser qu’on fonde une société volontairement. Je n’ai pas inventé ma langue, ni le nom de mon père, ni les coutumes ni les mœurs dont j’ai hérité : avant de naître, je suis pris dans un jeu de formes, de relations, de possibles et de contraintes, qui m’est alloué, dont je ne suis que l’usufruitier. Les premiers de ces « formatages » culturels sont sans aucun doute celui de la nomination — le nom du père et/ou de la mère — et celui de la bien nommée langue maternelle.
Mais la notion de contrat a pourtant eu et a toujours un succès fou ?
Oui, elle est d’une efficacité redoutable, ce qui explique que nous en sommes plus que jamais tributaires. Aujourd’hui, tout le monde contracte avec tout le monde. L’État français lui-même contracte avec les régions, les villes ; les régions, les départements, les villes contractent avec la « société civile »… L’omnicontractualisation contemporaine signale la difficulté sans cesse plus avérée de hiérarchiser l’espace politique démocratique.
Le « contrat » est la figure juridique qui permet de répondre à la très problématique combinaison de l’idée d’un ordre démocratique et du principe d’autonomie. C’est une « fiction » qui met en œuvre le principe d’autonomie, mais aussi voile et active des rapports de force et de domination. Il en va, à ce titre, du « contrat de ville » comme du « contrat de travail »…
L’illusion est celle d’une autonomie qui ne composerait jamais avec son contraire, l’hétéronomie. Je ne dispose pas de ma nationalité, de ma citoyenneté, je ne peux pas vendre mon fils ou ma fille, mon rein ou mes yeux ni acheter à l’état neuf ou d’occasion une constitution. Pourquoi ? Parce qu’il y a des conditions posées, que je reçois d’un souverain (qui est le souverain national), voire même qui s’imposent au souverain national ; conditions qui lui viennent d’un ordre « supérieur », celui des règles internationales ou celui, ultimement non codifiable, des « valeurs ». C’est dire que, là où j’ai déhiérarchisé, je rétablis nécessairement quelque chose qui est de l’ordre d’une hiérarchie, d’une « transcendance ».
Nos sociétés démocratiques industrielles ont ainsi retravaillé l’ordre rituel des sociétés anciennes dont elles ont hérité. Les démocraties hollandaise, britannique, belge, espagnole entretiennent à plus ou moins grands frais l’apparat des monarchies… À quoi sert donc cela qui « ne sert plus à rien » ?
Et en France ? On a inventé des rituels laïcs adaptés à l’ordre démocratique républicain ?
Le coup de génie des républicains français, de l’élite politique française au XIXe siècle, a été d’abandonner le principe monarchique de la célébration, pour le remplacer par celui de la commémoration. Auparavant, on « célébrait » le prince, ses victoires, la naissance d’un(e) héritier(e), son entrée dans la cité de ses loyaux sujets, sa mort et sa succession… La personne du prince était entourée de l’aura du sacré et l’on honorait le prince, dans le moment dont la conjoncture fournissait le motif.
Après la Déclaration d’indépendance américaine, puis la Révolution française, qui pouvait-on encore célébrer ? On ne peut pas plus célébrer le président d’une république, pour sa personne, que ses hauts faits. On va alors reprendre à la tradition juive et à la tradition chrétienne ce qu’elles avaient mis en place sur plusieurs millénaires, à savoir le rituel de la commémoration : je mets en mémoire un passé en honorant non pas tant un personnage qu’un événement.
Événement salvateur : la sortie d’Égypte, la résurrection de Jésus-Christ… Je fais mémoire d’un passé à la fois néfaste et faste, puisque la libération de l’esclavage figure une libération à venir, puisque la mort est un simple passage vers la vie à venir. Dans la célébration, on est dans le pur présent, alors que, dans l’action rituelle commémorative, le passé, le présent et le futur percolent. Le rapport au temps n’est plus grammatical, on construit un régime de temporalité inédit, en même temps que l’on active un régime spatial extraordinaire, le régime de l’ubiquité.
La commémoration juive peut avoir lieu pour les Juifs du monde entier au même moment, en tout point du monde : ce qui se passe ici, se passe également ailleurs. La concordance dans le temps et la multilocalisation de l’opération rituelle satisfont à l’exigence de et induisent la « concordance » des esprits et des cœurs. Cela est vrai de la Pâque juive ou chrétienne, mais cela est vrai, tout autant, par conséquent, d’un 14 juillet !
Il n’y a pas à se plaindre, comme le font certains, du « trop-plein commémoratif » : il n’y a ni trop-plein ni insuffisance de commémorations. Il y a d’abord à constater que le régime cérémoniel qu’institue la commémoration fournit à nos sociétés, aussi sécularisées et laïcisées soient-elles, l’accès à la sacralité qui leur est indispensable ; que l’espace-temps que déploie la commémoration est conforme aux attendus du monde actuel.
Comment le politique se débrouille-t-il aujourd’hui avec cet héritage ?
Nos élus, maires de petites et de grandes villes, présidents de communautés urbaines ou de régions, consacrent une bonne part de leur temps à participer à des opérations rituelles, voire à construire l’ordonnancement protocolaire de rituels.
Dès que l’on est maire, en effet, on sait que l’on aura un 14 juillet à honorer, mais aussi un 11 novembre, un 8 mai, la Journée des Justes ou la date anniversaire de la Libération des camps, sans oublier les vœux au personnel ou aux concitoyens, l’arbre de Noël de la mairie, le départ en retraite des employés… Et l’on est élu maire sous l’effet d’une pratique démocratique qu’on appelle une élection, qui repose sur le respect scrupuleux de règles, d’usages, que l’on ne peut pas ne pas apparenter à un rituel séculier.
Tout ceci témoigne de cette contrainte de « mise en ordre » à laquelle nos sociétés contemporaines — sociétés éminemment hérétiques, schismatiques, d’autonomie exacerbée… — ne peuvent se soustraire. Car il y a une sacralité séculière-démocratique, comme il y avait une sacralité théologique-monarchique.
Le coup de force des républicains français est d’avoir mis la technologie rituelle de la tradition juive et de la tradition chrétienne au service d’une société qui se construit comme séculière et qui va même inventer, seule en Europe, le principe de laïcité, tel que fixé en 1905 dans la Loi de séparation des Églises et de l’État.
Le XIXe siècle est aussi celui des débuts de l’industrialisation. En quoi les grandes inventions technologiques de cette époque ont-elles participé à la démocratisation du pouvoir ?
Si l’on prend l’exemple du cinématographe, inventé à Lyon par les Frères Lumière, on a l’illustration de ce que la technologie des instruments de représentation a modifié dans le rapport entre pouvoir et image. La photographie, le cinéma et toutes les techniques qui ont permis leur invention ont simplifié les modes de reproduction du réel et abaissé considérablement le coût de la reproduction du motif.
Quand on passe du marbre et de l’huile au daguerréotype (soit la reproduction sur plaque de cuivre), puis au celluloïd des Frères Lumière, on rend possible ce que j’appelle l’abaissement, puis l’extinction du caractère « censitaire » de la représentation.
Dans les sociétés prédémocratiques, ceux qui avaient droit à la représentation ne relevaient pas de l’ordre mondain : il en allait de la divinité elle-même, des hiérarchies célestes, des saints et des martyrs. Dans l’ordre mondain, étaient représentables ceux qui étaient au faîte de l’ordre féodal ou monarchique : les princes, clercs ou laïcs, et leur entourage.
Quand la bourgeoisie parvient à la représentation d’elle-même — voyez Rembrandt, au XVIIe siècle, et sa très célèbre Ronde de nuit —, c’est que ses membres sont assez fortunés, et disposent aussi d’assez de loisirs pour poser dans l’atelier du peintre. Mais l’artisan, le laboureur, l’ouvrier n’ont ni le loisir ni les moyens d’accéder à la représentation.
À partir du moment où la société se démocratise, où la souveraineté n’est plus celle d’un monarque, mais celle d’une nation, la question se complique singulièrement. Comment en effet représenter le nouveau pouvoir ? Il faudrait, idéalement, figurer la Nation. Or, celle-ci n’est « visible » qu’à travers l’ensemble du corps de ses représentants — soit plusieurs centaines de personnes ! Telle est la gageure…
C’est là qu’intervient la magie de la photographie et du cinéma. Les Frères Lumière vont donner à la société démocratique en formation les moyens de sa représentation : ils vont filmer leur temps, la société industrielle de leur époque, en leur prêtant la figure inaugurale de leur propre usine. Et ils vont le faire de la manière la plus ordinaire qui soit. En captant ce qui, dans le champ de la caméra, n’a rien que de banal, de commun : le flot des ouvrières et ouvriers, le chien du gardien, la bicyclette vacillante que tient à la main tel ouvrier…
Qui se trouve dans le champ de la caméra ? C’est le quidam, l’individu anonyme, l’homme quelconque, quelconque et cependant représentable. L’homme quelconque, en effet, pourra non seulement accéder à l’être-vu, passif, du tournage de la séquence, mais il pourra se voir, et être vu le soir même dans la projection que proposera au public l’opérateur Lumière. Il en va de ce que, pour ma part, je ne crains pas d’appeler une « démophanie » : la manifestation ou la révélation du peuple au monde.
À l’époque, d’ailleurs, l’idée se fait jour que la mort est quasi annulée, puisqu’à jamais on pourra revoir des personnes décédées. Certains contemporains ont une conscience très claire de la bascule culturelle qui s’opère alors, grâce à la photographie et au cinéma. De fait, il en va d’une révolution culturelle d’une portée incalculable.
Pourquoi cette invention révolutionnaire n’a-t-elle pas été davantage valorisée localement ?
Auguste et Louis Lumière, malheureusement pour nous, ont placé l’invention cinématographique dans le registre du divertissement forain ! Et s’ils négligent leur invention, qu’ils vont abandonner aux Américains, c’est que leur obsession — celle de Louis Lumière plus particulièrement — les porte vers la reproduction photographique de la couleur, reproduction qui leur permettrait de rejoindre le faîte de la hiérarchie des beaux-arts : soit la peinture, dans son moment impressionniste.
À l’inverse, les Américains vont très vite comprendre en quoi la photographie et le cinéma peuvent servir la représentation de leur monde, de leur culture : celle du migrant américain, privé de la tradition picturale accumulée en Europe depuis des siècles dans les cours princières et la haute bourgeoisie.
Pour comprendre cet état d’esprit, il faut également rappeler que Lyon n’est pas une ville où l’on s’adonne à la représentation de soi : il n’y a personne pour se mettre en représentation. On peut même dire que Lyon travaille à l’interdiction de la représentation de soi. Cette ville est en effet le siège d’une bourgeoisie fortunée, mais qui ne peut pas afficher sa richesse parce qu’elle est en permanence menacée par l’insurrection populaire.
C’est ce que laissera entendre, au XIXe siècle, le chant des canuts, composé par Bruant : on ne peut pas « tisser des chasubles d’or et aller tout nus », sans que la rébellion ne menace… Si l’on est fortuné, on ne doit pas et on ne peut pas faire ostension de sa fortune. Cela, par précaution politique, sans doute, mais aussi pour d’autres raisons que l’on ne peut saisir qu’en revenant, à nouveau, à l’histoire de la ville.
Il n’y a jamais eu de noblesse de sang ou d’épée à Lyon. Il n’y a pas eu de corps princier, de haute magistrature, de corps militaire, qui aient pu entretenir une sociabilité de cour. Il n’y a, à Lyon, que deux noblesses possibles : la noblesse cléricale, celle des chanoines-comtes de la Primatiale Saint-Jean et une noblesse de robe, dite parfois avec ironie « de cloche », d’extraction échevinale. À partir du XVIe siècle, on peut en effet être anobli après avoir assuré les fonctions d’échevin.
Mais il faut noter, en sus, que le cursus honorum d’un futur échevin commence le plus souvent par la fonction d’administrateur des hôpitaux, pour se conclure par la fonction échevinale… La seule noblesse réellement lyonnaise est donc attachée à une capacité, celle de la bonne gestion du bien hospitalier, puis du bien commun de la ville elle-même. Cela dit beaucoup de cette ville… Il y a ici, depuis des siècles, une intelligence politique — celle de l’espace conflictuel de la Cité —, une intelligence de l’urgence sociale, qui obligent à réparer ou pallier les dégâts et les risques qu’induisent l’indigence, la maladie, la disette, voire la famine.
D’où l’Hôtel-Dieu (le plus munificent de France disait-on), l’Hospice de la Charité, le Grenier d’abondance. D’où, bien sûr, la puissance ultérieure des Hospices civils, qui constituent aujourd’hui le deuxième plateau hospitalier de France après Paris. Pourquoi Lyon et pas Montpellier — alors que cette dernière ville a plusieurs siècles d’avance sur Lyon en matière d’histoire universitaire et de collation du grade de docteur en médecine ? Parce que cette « ingénierie sociale » de haut niveau a perduré dans le temps, formatant successivement les congrégations et confréries, les multiples sociétés de bienfaisance, la philanthropie maçonnique, les œuvres du catholicisme social…
Il faut faire l’histoire hospitalière de cette ville — hospitalité devant s’entendre historiquement comme accueil, réparation de l’indigence et administration des soins — pour comprendre ce qu’est le génie du lieu, le génie lyonnais. Et pour comprendre aussi pourquoi, à Lyon, on ne pouvait ni ne voulait, « s’afficher ».
La noblesse, aussi bien au sens du titre qu’elle confère qu’au sens moral du beau geste, se tire ici du fait de limiter et réparer la souffrance ou l’indigence d’autrui : non seulement la richesse ne doit pas être exhibée, mais il convient qu’elle serve le bien commun de la cité. Où il apparaît que la fameuse « discrétion » lyonnaise ne relève pas tant d’une psychologie, d’un tempérament, d’un humanisme atemporel, que des conditions d’ordonnancement de l’espace public.
Mais comment cet esprit de ville, ce génie du lieu peut-il se transmettre de génération en génération, alors que tout le monde circule aujourd’hui, que la population se renouvelle sans arrêt ?
Comment des valeurs se transmettent-elles ? Elles se transmettent par les institutions qui en répondent ! Dans le fil de ce qui a été évoqué, je puis assurer que la valeur « d’hospitalité » a de multiples répondants : il en va de l’ensemble des institutions hospitalières lyonnaises — parmi lesquelles je n’aurai garde d’oublier celles qui, apparues au XIXe siècle, ont vocation à réparer la souffrance psychique ; il en va du réseau associatif, du dispositif des ONG, qui actualisent cette valeur en se portant, thématiquement ou géographiquement, vers les « délaissés » des politiques publiques.
Comment une mémoire collective se transmet-elle ? Par le récit des témoins et de leurs descendants, par le discours savant des historiens, certes. Mais elle se transmet aussi par ce que l’on peut nommer des « liturgies », religieuses ou profanes. Comment la mémoire de la prise de la Bastille se transmet-elle ? Par l’œuvre de Jules Michelet à coup sûr, mais plus sûrement encore, par le cérémonial du 14 juillet. Et dès lors qu’un motif est confié à la « technologie » du rituel, le rituel lui imprime sa propre temporalité qui se moque des décennies, se moque même des siècles.
Toute opération rituelle bénéficie, a priori, d’un coefficient d’inertie sans rapport aucun avec l’ordinaire de nos pratiques et de nos agendas. Car le rituel est la condition pratique d’accès à l’ordre de la sacralité — ce à quoi nos sociétés (les « corps urbains » en étant évidemment parties prenantes) ne sauraient renoncer, sauf à se défaire : une origine, un monument, une couleur, un hymne, une devise, une institution… Et la sacralité échappe à la mesure ordinaire du temps. Elle est même la condition du temps, de la scansion du temps calendaire, en tout état de cause.
Ce qui a trait à ce type d’opérations, ici dites liturgiques, passe assez souvent pour le « supplément d’âme » — ce complément dont on pourrait presque se dispenser, pour des raisons d’économie notamment. Ce quasi-superflu, je le pense pourtant, à l’inverse, comme « la barre d’uranium au cœur du réacteur nucléaire ». Car c’est bien une économie du sacré qui, ultimement, autorise et garantit la coaction ou l’assemblage de nos sociétés.
Pour revenir au terrain lyonnais, en termes de puissance de « symbolisation », peu d’opérations sont comparables à ce que Guy Darmet et son équipe ont promu, en 1996, en inventant la formule du Défilé de la Biennale de la Danse : une fête appropriable qui, parce qu’elle sollicite l’investissement personnel et collectif, génère l’enthousiasme individuel et collectif, emblématise désormais une agglomération.

Étude
Présentation de l'expérience « esprit des lieux » à Vaulx-en-Velin.

Interview de Gilbert COUDENE
"Il est important et urgent de décréter la culture « cause nationale », tout autant que le défi écologique, c’est une question de survie de l’espèce humaine"

Interview de Régis NEYRET
Journaliste
"C’est pour des raisons de développement touristique — donc rien à voir au départ avec un intérêt pour le patrimoine — que nous avons décidé de nous intéresser au Vieux Lyon, quartier à l’époque complètement déshérité"

Interview de Bernadette Angleraud
« Lyon a été très marquée par l'activité de la soie et l'industrie a toujours été plus ou moins dévalorisée ».

Interview de Michel KNEUBUHLER
Direction Régionale des Affaires Culturelles
"Les associations anticipent très souvent les politiques publiques"

Interview de Philippe DUJARDIN
Politologue, chercheur au CNRS
Comment le pouvoir politique peut-il faire tenir ensemble ce qui semble avoir vocation à se séparer continuellement ?

Étude
Analyse de a place du patrimoine depuis le XIXè siècle : de l'émergence de la conscience de l'intérêt des monuments historiques aux dernières attributions accordées par les ministères de la Culture.

Texte de Philippe DUJARDIN
« C’est d’une tragédie sans précédent qu’est né le projet de constitution d’un espace public européen ».

Étude
En 20 ans notions de biens publics et de biens communs ont vu leur sens renouvelé par des chercheurs qui y ont vu des outils performants pour la gestion des ressources communes.

Étude
Les grands parcs apparaissent comme des espaces à part, qui proposent une nature organisée par l’homme et reflètent les préoccupations des époques qu’ils traversent.

Article
Issue de l’héritage du musée d’histoire naturelle de Lyon, le musée des Confluences n’a rien d’un long fleuve tranquille.
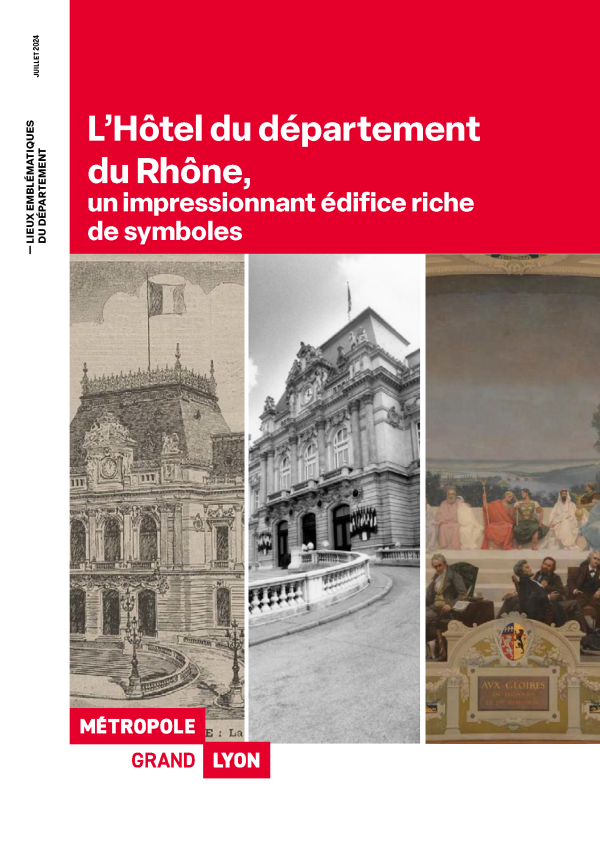
Étude
L’Hôtel du département du Rhône a la particularité d’abriter à la fois le Département du Rhône, collectivité territoriale, et la Préfecture du Rhône, service de l’État dans le département.
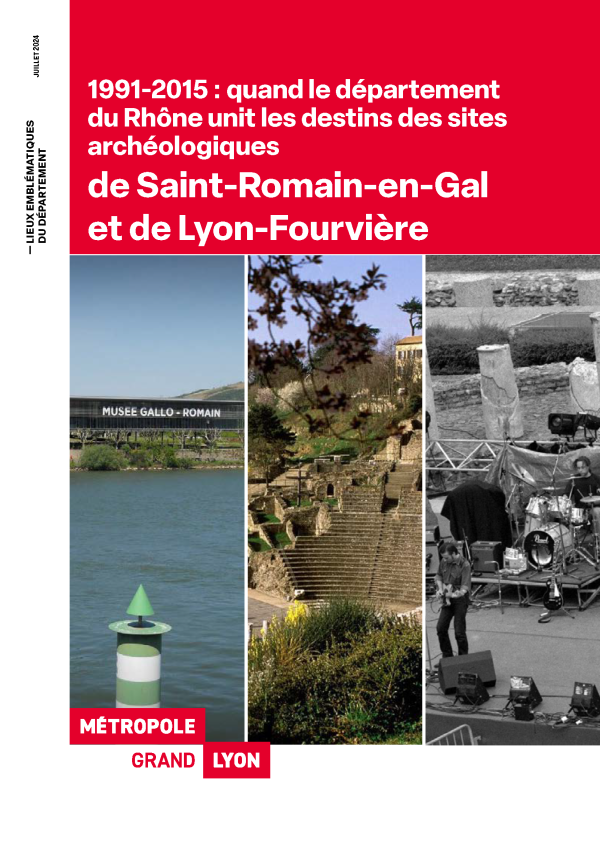
Étude
Dans le récit de la constitution des sites archéologiques de Saint-Romains-en-Gal et de Fourvière, prenons conscience de la valeur des traces civilisationnelles qui nous sont données à voir.
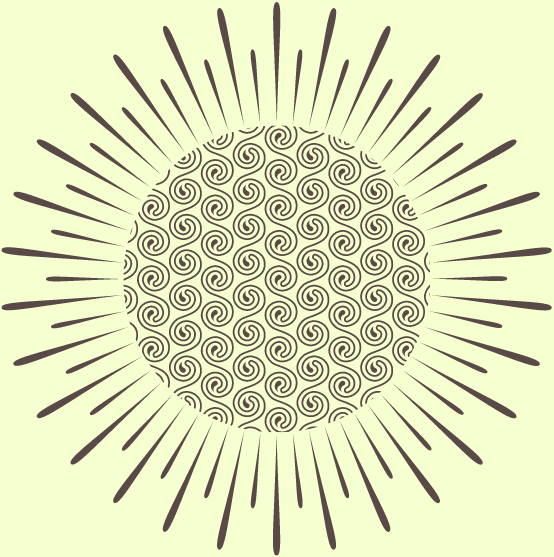
Étude
6 chronologies des emblèmes du territoire du territoire.

Dossier
Comment l’activité de fabrication de la soie devint-elle un marqueur de révolutions techniques, industrielles et sociales ?
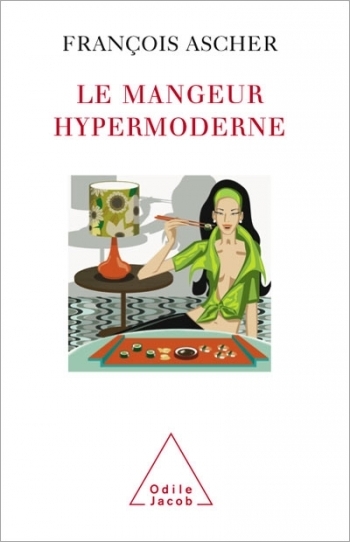
Article
En 2005, l’urbaniste et sociologue F. Ascher imaginait le mangeur d’aujourd’hui. Retour face à ce miroir déformant, qui en dit beaucoup sur le chemin parcouru depuis.

Étude
Le Grand Lyon bouillonne d’initiatives, de projets, d’envies de faire et d’inventer : puisse ce guide aider, encourager et multiplier ces enthousiasmes !

Dossier
Etat des lieux : le cinéma un secteur en pleine mutation. Et demain? L'avenir du cinéma en salle. L'impact des révolutions technologiques. Interactivité et transmedia : les principales pistes du futur