M3 Société urbaine et action publique - N°2

Étude
Dans ce numéro : un dossier consacré aux rapports entre l’espace, la vie, la ville.
Interview de Yves Raibaud

<< Moins on est conforme à la norme hétérosexuelle virile dominante et moins on a d’emprise spatiale dans la ville >>.
Spécialiste de la géographie du genre, Yves Raibaud est enseignant-chercheur à l’Université Bordeaux-Montaigne. Auteur de La ville faite par et pour les hommes (Belin, 2015), il démontre à quel point la ville se construit sur des normes hétéro-sexuelles et viriles. Il ne cesse de dénoncer la banalisation du harcèlement des femmes dans l’espace public et redoute que la ville dite « durable et intelligente » aggrave encore les inégalités de genre.
Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur l’usage de la ville par le genre ?
Je travaille sur les études masculines et les masculinités depuis les années 2000. Je les ai abordées par la culture puisque j’avais fait ma thèse sur les musiques actuelles : rock, rap, techno, etc. La variable sociologique majeure qui ressortait de mon étude c’est que les musiciens étaient à plus de 90 % des garçons. Ces chiffres ont été corroborés depuis par les études statistiques de la SACEM et de la SACD qui montrent que les musiques actuelles sont un secteur sinistré pour les femmes. Pire encore que tous les autres arts.
J’ai travaillé sur des lieux de répétition des musiques actuelles qui fonctionnent comme des maisons des hommes : les garçons se livrent à une compétition entre eux pour la désignation d’un leader dominant, autour desquels s’organiseront la solidarité et la loyauté du groupe, modèle de la société patriarcale. Ce fonctionnement de groupe passe par des phases d’exclusion fondée sur la hiérarchie des sexes et la norme hétérosexuelle dominante : les rares filles ne sont que tolérées, le garçon qui est exclu est celui qui est considéré comme déloyal, traître, mais aussi celui qui est une fillette, un pédé... quelqu’un qui ne correspond pas aux standards du groupe. Par la suite, j’ai observé longuement sur d’autres lieux de construction de l’identité masculine tels les skateparks et citystades les mêmes principes de fonctionnement.
La ville reflète les normes sociales dominantes dont elle hérite, mais elle crée également des pratiques nouvelles, spontanées. Ces pratiques nouvelles ne peuvent-elles changer, progressivement, ces normes et aller vers un rééquilibrage entre les sexes ?
À chaque fois qu’il y a de nouvelles cultures urbaines, il y a presque de façon fatale, un renouvellement des cultures masculines. Les pratiques sportives urbaines comme le skate, le roller ou le BMX, comme pour le rock, ont d’abord poussé de façon anarchique dans la ville avant d’avoir leurs lieux dédiés dans la ville. Désormais, d’autres cultures émergent comme le parkour (escalade urbaine), ou le street workout, autrement dit la musculation dans des aires de fitness avec des garçons torse-nu qui montrent leurs muscles. Dans l’espace public on voit bien que ces espaces masculins se multiplient et se renouvellent, et ce qu’on salue souvent comme une innovation, n’est qu’une nouvelle culture masculine. Le skate park remplace le terrain de boules. En l’absence de conscience de cette homogénéité de sexe, on continue de créer des espaces qui forment un continuum d’espaces masculins, du grand stade au terrain de boules. Ils se prolongent avec les terrasses de café et les rues où les hommes stationnent, et trouvent un écho dans les manifestations culturelles affichées dans la ville qui sont constamment reliées aux standards des cultures masculines hégémoniques, viriles et hétérosexuelles.
Quels sont les principaux obstacles à la pratique de la ville par les femmes ?
Outre cette présence permanente des cultures masculines dans la ville, les femmes sont empêchées par les tâches domestiques puisque ce sont elles qui continuent à faire 75% des accompagnements d’enfants et 60 % des tâches ménagères. Elles ont donc beaucoup moins de temps de loisirs. Deuxième élément : dès qu’elles sortent dans la rue, elles sont des « proies sexuelles potentielles ». Il apparaît normal au « male gaze », le regard masculin, de les jauger, de les dévisager, avant qu’elles ne soient suivies, draguées lourdement ou même agressées sexuellement.
Plus encore que sur la norme masculine, la ville fonctionne, selon vous, sur la norme hétérosexuelle…
Oui, la ville fonctionne sur l’hétéro norme. Il faut sortir de la dichotomie f / h et voir que cette norme n’est pas simplement masculine, elle est hétéro-sexuelle et virile. Quand vous êtes sur un skate park ou un terrain de foots, maigrichons et maladroits s’abstenir ! C’est vraiment le lieu des musclés. On retrouve cette norme virile qui exclut le fait d’être efféminé ou fragile dans la ville, dans le travail que nous avons réalisé avec le sociologue Arnaud Alessandrin sur la géographie des homophobies. On a interrogé les lesbiennes, gays, bis, trans pour leur demander comment elles et ils vivaient la ville. En terme de géographie, moins on est conforme à la norme hétérosexuelle virile dominante et moins on a d’emprise spatiale dans la ville. Si vous êtes un peu efféminé, si vous avez un peu de khôl sous les yeux ou à l’inverse trop musclée ou poilue, un rien peut alerter les gardiens de la ville, cette « police du genre » que représentent les garçons virils et dominants, qui repèrent de la terrasse d’un café ou d’un coin de rue les gradiants de virilité des hommes comme les gradiants de féminité des femmes. Le « male gaze » juge les femmes selon qu’elles sont grosses, moches, baisables ou canons, mais aussi les hommes selon qu’ils sont efféminés, sportifs, virils, etc. La police du genre, dès la cour de récréation, ce sont des leaders - plus souvent des garçons, quelquefois des filles -, qui observent si chacun est bien conforme, si les garçons jouent avec un pneu et pas une corde à sauter. Lorsqu’un garçon joue trop avec les filles ou avec des jeux de filles, il peut être violemment rappelé à l’ordre par les autres garçons.
Ces schémas ne sont-ils pas en train de changer ?
Non, je pourrais vous montrer des films tournés en maternelle, c’est pareil. La sociologue Sylvie Ayral montre que le fondement du harcèlement scolaire est presque toujours un harcèlement sexuel, et les garçons en sont, d’après une étude récente, presqu’autant victimes que les filles. Selon qu’on est gros, moche, roux, ou trop belle, ou trop intelligente : il ou elle est pris.e en grippe par une communauté qui le ou la persécute, pour des raisons qui sont essentiellement des raisons de genre, de jalousie, de rivalité. Le genre est une variable centrale de la violence sociale. Il n’y a pas de djihadisme féminin, ou très peu, pas de violence urbaine féminine, ou très peu. La violence des femmes peut avoir augmenté de 3 à 5% mais il y a toujours 95% d’hommes en prison. Tout le budget du ministère de la Justice est essentiellement consacré aux hommes ! Plusieurs autres budgets de l’État d’ailleurs : la guerre c’est les hommes, la justice c’est les hommes, les sports c’est les hommes… La collectivité publique leur consacre des budgets gigantesques ; le coût du masculin est très important.
Les spatialités et les mobilités sont-elles si différentes entre les hommes et femmes ?
Oui, il y a un type de mobilité très spécifique des femmes qui marchent la nuit : ni trop vite pour ne pas montrer qu’elles ont peur, ni trop lentement de crainte de se faire aborder. On relève également que les hommes apprennent dès leur enfance à percuter, à aller sur une ligne droite, et les femmes à éviter. Une femme qui croise un homme sur le trottoir aura tendance à faire un pas de côté pour le laisser passer. L’homme considérera qu’il a le droit d’aller tout droit. On le voit aussi dans les couloirs de piscine ! Ça fait partie des apprentissages de l’école avec le terrain de foot au milieu de la cour de récréation, qui institue la centralité masculine et la périphérie féminine. La géographe Edith Maruéjouls montre de façon très fine comment les enfants apprennent la spatialité conforme à leur genre, dès la cour de récréation. Les filles font un usage des périphéries, ce qui impose de choisir des jeux qui prennent peu de place, des jeux statiques ou qui ne débordent pas, alors que les garçons, dès le départ, s’emparent du terrain de foot central, dont le ballon ne cesse de déborder sur les espaces périphériques. On voit bien dans ces travaux comment les filles apprennent à tourner autour, à esquiver, à prendre moins de place, et comment les garçons ont cette légitimité de la cour qui fait qu’ils sortent de la classe en criant pour aller coloniser le terrain dont ils occupent les 4/5e.
Ces structures du genre dans l’espace que l’on observe dès la cour de récréation, sont-elles vouées à se retrouver dans la conception des villes ?
L’usage des villes ne se transmet pas simplement de génération en génération, il est sans cesse reconstruit. C’est pour cela que ça m’intéresse de travailler sur les skate parks et les citystades. De même qu’à chaque reconstruction d’école, si on n’y pense pas, on créera un terrain de foot au milieu de la cour de récréation, dès qu’on reconstruit un quartier, on met un skate park ou un city stade au milieu de la place. Il y a une continuité de la construction de la ville avec cette idée qu’il est absolument nécessaire qu’il y ait des espaces pour les jeunes, dont on ne dit jamais que ce sont les jeunes garçons. Lorsqu’on le fait remarquer on nous dit : oui mais c’est précisément eux qui posent problème, ils ont besoin de se défouler ou de canaliser leur violence, etc. C’est vrai pour tout : on pense qu’ils ont plus besoin de jouer, plus besoin de manger, donc on les nourrit davantage. Il y a toute une anthropologie du masculin qui montre comment les garçons sont toujours l’objet d’attentions soutenues, beaucoup plus que les femmes.
Que révèle la cartographie des déplacements des femmes en ville ?
Les cartes de mobilité des femmes montrent des circulations différentes des femmes, empêchées par des « murs invisibles » comme le montre le géographe Guy Di Méo. On voit dans ces cartes des discontinuités, des endroits infranchissables, des passages impossibles des zones de non droit, des évitements. Quand on fait des entretiens, on se rend compte que ces évitements viennent toujours d’un renseignement qui a été donné, ou d’une expérience qui a été vécue. Si vous avez été suivie par un homme, si vous avez eu peur dans une rue, le lendemain vous allez choisir un itinéraire de contournement plutôt que de repasser dans cette rue. On voit bien ce côté discontinu de la ville pour les femmes. Principalement pour des raisons de sécurité quand elles sont seules. Mais aussi parce que ce sont elles, majoritairement, qui accompagnent les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Là il y a des itinéraires compliqués quand on a une poussette ou des affaires à récupérer… Il y a aussi des endroits de bousculade où les femmes, notamment quand elles sont enceintes ou avec des jeunes enfants, hésitent à aller. Et puis il y a aussi ces femmes âgées de 80 ans ou plus qui sont majoritaires dans leur classe d’âge : leurs conditions d’accès à la ville deviennent difficiles.
Vous estimez que la ville durable, qui privilégie les déplacements à vélo notamment, creuse les inégalités. Cela paraît paradoxal…
On peut penser que la ville durable est favorable à l’égalité femmes / hommes, mais il faut travailler cette question. L’étude menée à Bordeaux, ville cycliste, montre qu’il n’y a que 38% de femmes à vélo, ça descend à 30% dans certains endroits et 25% à certaines heures. Les raisons sont multiples, mais je vous donne un exemple : les femmes cyclistes arrêtent massivement le vélo à leur 2e enfant tandis que les hommes cyclistes continuent tous le vélo après leur 2e enfant. De même, contrairement à ce que l’on pense, le vélo ne rend pas la ville plus sûre la nuit : Les femmes sont harcelées aux arrêts des Vélib, aux feux rouges, elles sont aussi victimes de la misogynie des chauffeurs ou des autres cyclistes, insultes, sifflements, etc. Elles nous disent dans les entretiens que les incivilités ne cessent pas parce qu’on fait du vélo. Il y a même un sexisme propre au vélo.
Dans la même étude sur la marche à pied, nous avons filmé des bouts de rue, le matin, le soir, la nuit ; on constate une baisse régulière des femmes qui circulent la nuit, qui sont 20 à 30% moins nombreuse que de jour, jusqu’à 50 % pour les femmes qui circulent seules. Il y a une crainte de la ville la nuit, qui rejaillit sur la marche à pied, même dans les rues piétonnes. Les femmes qui marchent la nuit sont le plus souvent accompagnées, soit en groupe si elles sont entre femmes, soit par un homme. On voit bien que dans la ville moderne, cool, agréable, comme le centre de Lyon ou de Bordeaux, la crainte de la nuit n’est pas résolue.
Vous soulignez aussi que la ville sans voiture est plus difficile à envisager pour une femme parce que la voiture est perçue comme un cocon où l’on est en sécurité, surtout la nuit, et parce que les femmes ont des trajets plus discontinus ou plus complexes…
À chaque fois on retrouve les deux contraintes majeures – la 3e étant l’âge – que sont le sentiment d’insécurité et la peur de l’agression sexuelle d’une part, les contraintes familiales de l’autre. Une étude a été faite à Montréal, sur un quartier résidentiel, avant et après la mise en place de la piétonisation. Il ressort que les mères de familles consacrent entre une demi heure et trois quarts d’heure de plus de temps de vie par jour en accompagnements.
Dans les enquêtes mobilité liée au ménage réalisées sur la métropole bordelaise on observe que les femmes accompagnent non seulement leurs enfants et leurs parents, mais aussi leurs voisins, leurs amies. Elles sont fréquemment dans leur voiture à accompagner du monde alors que les hommes circulent seuls. Quand il y a une personne en situation de handicap dans la famille, c’est très majoritairement la mère qui s’en occupe. Les femmes s’arrêtent de travailler plus tôt pour s’occuper de leur mère ou de leur beau père âgé. Dans ce cas, les accompagnements se font très souvent en voiture. Du coup, la piétonisation des villes pose des problèmes supplémentaires aux femmes.
Le mouvement #MeToo révèle une prise de conscience importante et une moindre acceptabilité sociale des inégalités de genres. Cette prise de conscience est-elle également à l’œuvre dans les politiques urbaines ?
En France, les villes s’en sont plus ou moins emparées. C’est un des axes forts de la politique de la ville de Paris, avec, notamment, l’aménagement des 7 places parisiennes avec la clause genre, auquel a participé l’agence Genre et Ville.
J’ai participé à mettre en place le budget genré du sport des villes de Bordeaux et Genève qui a amené à reconsidérer ces espaces que sont les skate parks et city stades, et à faire qu’au moins dans les nouveaux espaces comme les quais, il y ait des équipements ou des espaces pour les filles, permettant une réappropriation de l’espace. Il y a eu aussi tout un travail pionnier et très actif sur le harcèlement dans les transports. À Bordeaux on en est à la 2e campagne de sensibilisation, un essai va commencer sur les arrêts de bus entre deux stations. Ce qui a convaincu à mon avis le maire, Alain Juppé, c’est la question des ambiances urbaines : si on veut une ville résidentielle, touristique, agréable, attractive, il faut gérer, entre autres, ce problème de harcèlement de rue et le sentiment d’insécurité. Les nouveaux arrivants préfèrent une ambiance apaisée, une régulation des rapports entre les femmes et les hommes, des gestions municipales où ces problèmes sont envisagés, où on cherche des solutions pour les résoudre.
Que pensez-vous du mouvement #balancetonporc ?
Dans #balancetonporc ou Me too, tous les hommes sont concernés, représentés par les plus visibles, les blancs, les forts, les riches qui sont balancés. Du coup, il n’y a pas d’équivoque là-dessus : ce sont des dominants. Quand on est porte de la Chapelle ou la nuit du premier de l’An à Cologne, c’est trouble parce qu’on mêle sexisme et racisme, en accusant pêle-mêle les arabes, les Noirs, les migrants. L’affaire de la porte de la Chapelle (harcèlement de rue dans un quartier d’immigration) est contrebalancée par l’affaire Weinstein et #balancetonporc et montre que la domination et la violence masculine sont des phénomènes universels
Comment analysez-vous le phénomène de harcèlement de rue dont on a beaucoup parlé lors des incidents de Cologne ou de la porte de la Chapelle ?
Les sociologues américaines ont montré dès les années 1980 que le harcèlement de rue (street harassment) est une activité systémique qui a pour but de réguler les rapports des femmes et des hommes dans une ville patriarcale. Ce n’est donc pas le fait de quelques individus mal élevés mais bien une activité ancienne, culturelle, massive. Ce regard des hommes sur les femmes dans la ville, on le retrouve dans la littérature – avec les flâneurs du 19e siècle, les poètes maudits, les peintres, clients de prostituées de rue. Le harceleur qu’on désigne aujourd’hui a de nombreux ancêtres et ses lettres de noblesse dans la chanson et la littérature. Des guides touristiques américains et anglais, dans les années 1920, conseillaient d’aborder les midinettes, ces employées du textile parisien, pendant leur pause déjeuner au jardin des tuileries. Ces figures qui faisaient partie de la fierté de la ville sont des femmes à qui on ne demandait pas leur avis, qui subissaient le harcèlement des hommes et protestaient déjà, à travers leurs petits journaux syndicaux. Aujourd’hui encore, la promotion du tourisme international continue à se faire à travers des figures de femmes : vahinés, femmes africaine aux seins nus, beautés créoles ou asiatiques.
Sur cette question du harcèlement de rue, y a-t-il un risque de stigmatisation d’une population paupérisée et racialisée qui doit nous retenir d’avancer ?
Non, il faut avancer, il ne faut pas protéger les harceleurs. Je considère que la verbalisation du harcèlement de rue est une bonne idée. Au moment de l’affaire de Cologne, nous avions écrit avec Sylvie Ayral un article dans Libération intitulé : « Cologne une variation ethnique de la domination masculine », pour montrer que Cologne c’était avant tout une affaire de sexisme, de harcèlement de rue. À la fête de la bière de Munich, aux fêtes de Bayonne, dans les festivals d’Europe, c’est pareil. Mais à Cologne, tout à coup, il y a une violence collective qui polarise une opinion publique tentée par le racisme sur un événement, alors que les mêmes événements se passent exactement de la même façon lors d’un concert rock ou d’une semaine de Carnaval fréquentés majoritairement par des Blancs autochtones. Après #Metoo et #Balancetonporc, dont la caractéristique est qu’ils sont l’expression massive des femmes elles-mêmes (contrairement aux commentaires sur Cologne ou la rue de La Chapelle, servis par des journalistes, hommes politiques ou philosophes majoritairement de sexe masculin), il me semble qu’on devrait être moins enclins à stigmatiser les étrangers et les jeunes des quartiers populaires, en constatant que c’est pareil partout, y compris dans le milieu du cinéma, à la tête des entreprises, à la télévision ou à l’Assemblée nationale. #Me too et #balance ton porc (après Paye ta blouse pour l’hôpital, Paye ta fac pour l’université etc.) montrent la continuité des violences machistes et les nomment en tant que telles. La violence machiste apparaît ainsi comme une variable sociologique majeure pour expliquer les faits de sociétés.
On a vu lors de la dénonciation du harcèlement de rue à la porte de la Chapelle qu’il y avait un vrai risque d’instrumentalisation politique, que cela pouvait faire le jeu de l’extrême droite…
Les associations féministes ne se sont pas trompées : ni racistes, ni sexistes, elles demandent la même loi pour tous. Un harceleur, c’est un harceleur, un violeur, c’est un violeur. Strauss-Kahn ou Weinstein doivent payer comme les autres, et même davantage car ils sont en situation de responsabilité. Il faut éviter les dérives sécuritaires, lorsque des responsables politiques se découvrent tout à coup féministes en prétendant protéger les femmes contre les agresseurs d’origine ou de culture étrangères. C’est un risque que l’on retrouve dans l’histoire des guerres : on accuse l’étranger d’être un violeur, mais combien de fois dans l’histoire les soldats ont eu carte blanche pour faire régner la terreur avec cette arme de destruction massive des individus qu’est le viol de guerre ? La terreur sexuelle prend les femmes en otage et ne fait que conforter le pouvoir qui protège. Quand Nicolas Sarkozy légitime la guerre en Afghanistan par la défense des femmes afghanes (reprenant les mêmes slogans tenus au moment de la guerre d’Algérie), certains de mes collègues parlent de femo nationalisme, une position symétrique à l’homo nationalisme de Marine Le Pen lorsqu’elle déclare : « Dans ces quartiers-là il ne fait pas bon être gay », en parlant des quartiers d’habitants dont les parents ou les grands parents sont originaires des anciennes colonies du Maghreb musulman. Ce sont des stratagèmes connus qui font malheureusement toujours recette faute de connaître ce que peut être vraiment le féminisme politique et une analyse des rapports sociaux de sexe, interagissant avec d’autres rapports de domination tels que « race » ou classe sociale.
Comment démonter ces stratagèmes ?
Nous montrons dans nos enquêtes (dont la dernière menée avec Marion Paoletti sur le harcèlement des étudiantes sur le campus de Bordeaux) qu’il n’y a pas d’origine type du harceleur, juste des variations culturelles et géographiques du harcèlement. Les exhibitionnistes nombreux qui sévissent sur les campus de Bordeaux sont signalés comme étant plutôt des hommes blancs de 40 / 60 ans. Les frotteurs frôleurs du bus ou du métro aussi. Les harceleurs de trottoirs, les suiveurs de jour qui harcèlent « eh t’es bonne, tu me donnes ton 06 » seraient plutôt des jeunes de milieu populaire. Cependant, Mélanie Gourarier nous décrit dans Alpha mâle l’existence des « communautés de la séduction », fréquentées sur Internet par des jeunes hommes appartenant aux classes moyennes et supérieures, et ainsi de suite. À chacun son style, sa technique de prédation, son milieu social, mais invariablement ce sont des hommes.
Il faut donc réfléchir à la question du genre, et pas seulement des hommes et des femmes, comme variable centrale de la violence sociale. Si l’on veut que l’espace public soit plus mixte et agréable, on pourrait commencer par arrêter de construire des équipements urbains spécifiquement masculins comme les skate parks, des grands stades, des urinoirs. Si on veut que la ville soit mixte, quel est l’intérêt pour les villes d’accueillir des compétitions de football où pendant 4 jours des Irlandais ou des Allemands ivres morts abordent toutes les femmes dans la rue ? Des événements 100 % masculins qu’on relate comme si c’étaient des jours de fête alors qu’ils sont constamment émaillés d’incidents graves, de bagarres entre supporters, avec la police ? Pourquoi personne ne note-t-il qu’il n’y a aucun équivalent d’événement à 100% féminin ? Avec une telle violence ? On a vraiment un problème avec la violence de ces cultures masculines qu’on prétend universelles alors qu’elles ne sont le fait que d’un sexe. Qu’est-ce qu’on fait de Bertrand Cantat : la une des Inrocks ou pas ? Le Zénith ou pas ? Comment pourrait-on réfléchir d’une façon moderne à la mise en scène du meurtre de Carmen, du viol sur mineure de 15 ans et du suicide de Suzuki dans Madame Butterfly, du chantage sexuel et de la mort de La Tosca, mis en scène de façon de plus en plus crue et violente ? Ne sont-elles pas des répétitions incessantes et pornographiques de meurtres de femmes ? Les cultures masculines violentes sont dominantes dans la culture bourgeoise comme dans la culture populaire. Comme on viole ou on assassine les femmes sur la scène des théâtres bourgeois, on programme Cantat, le rapeur Jules, Orelsan ou Sexion d’assaut sur des scènes de la périphérie. Dans le cinéma, c’est pareil, ce que la spécialiste du cinéma Geneviève Sellier appelle « la femme dans le frigo » : ce sont les films policiers qui commencent tous par une scène où l’on va voir le corps d’une femme à la morgue. La violence, le viol et le meurtre des femmes restent un standard du cinéma d’auteur comme du cinéma populaire, ainsi que des séries les plus vues au monde. On ne peut pas d’un côté policer la ville et en même temps avoir des caricatures masculines hégémoniques qui continuent à envahir tout. La question de la culture est importante, il ne suffit pas de dire « c’est de la création artistique » et de crier à la censure lorsqu’il s’agit de financements publics donnés à des scènes subventionnées. La ville éducative n’a pas les mêmes missions que le marché, et les lois contre les violences faites aux femmes doivent s’appliquer à tous les secteurs.
Dispose-t-on désormais d’instruments de mesure ou d’évaluation que permettent de mieux objectiver, et donc corriger les inégalités hommes / femmes dans l’espace public ?
Oui, on progresse dans ce domaine. Le premier élément d’appréciation, c’est le gender budgeting, le budget genré. Il s’agit de mesurer combien de femmes et d’hommes bénéficient de l’argent public dans tous les domaines de l’action publique. Les résultats sont frappants. Dans les études que nous avons réalisées sur le sport et les loisirs des jeunes 75 % des budgets publics sont consacrés aux garçons et aux hommes. Le chiffre est encore plus important si l’on y intègre les équipements sportifs : citystades, skateparks, grands stades, terrains de boules d’accès libre sont fréquentés par plus de 90 % d’hommes et l’on ne cesse d’en construire, alors qu’on ferme les colonies de vacances, qu’on réduit les moyens aux écoles d’art, aux piscines, aux salles de danse et de gym. Dans tous les cas, c’est la non mixité masculine qui bénéficie de la part du lion. Sur les nouvelles mobilités urbaines dans la ville, nous avons expérimenté des instruments de mesure pour objectiver les inégalités : compter les femmes et les hommes à vélo, mais aussi les vélos avec porte-bagage enfant, les tenues, les chaussures, les jupes, pantalons ou shorts, les façons d’utiliser le vélo, prudentes ou acrobatiques… Pour la marche à pied, nous avons filmé des tronçons de rue échantillonnés à 10h, 12h, 14h… 24h, le lundi, le samedi, l’hiver, l’été. Cela peut être complété par un travail de monographie sur un parc public : un.e observateur.trice note le passage des hommes, des femmes, selon l’éclairage, la zone, etc. Ces informations peuvent être complétées par des enquêtes. À partir d’une première enquête en ligne, on identifie les grandes questions avant de réunir des groupes focus de 3 à 6 personnes avec un.e sociologue spécialisé.e qui enregistre tout et qui les fait discuter librement entre elles pour obtenir des explications qualitatives aux phénomènes observés dans la rue ou lors des enquêtes en ligne. Les résultats sont intéressants et très probants. Malheureusement, les études de genre sur la ville sont peu financées pour l’instant, même si elles rencontrent toujours un écho favorable, auprès des élu.e.s comme auprès des médias.
Parmi les mouvements féministes, lesquels trouvez-vous particulièrement pertinent ?
Il faut distinguer les mouvements féministes et les théories ou concepts qui les inspirent, ce qu’on pourrait appeler l’épistémologie féministe, à, condition qu’elle soit à un niveau suffisamment élaboré pour fonder des recherches. Dans ces concepts, l’écoféminisme représente une avancée alliant écologie et féminisme même s’il faut s’extraire d’abord de son aspect « new age », un peu mystique. J’en retiens pour ma part un féminisme politique, qui considère que le patriarcat n’a pas seulement créé un système d’exploitation des femmes mais aussi des « races » et des ressources naturelles, notamment à travers le colonialisme. L’historienne Silvia Federici décrit comment l’esclavagisation des femmes et des populations colonisées s’est durcie à partir du XVIème siècle. D’autres intellectuelles féministes montrent que cette domination va de pair avec une façon de faire violente avec la nature, les animaux, les végétaux, toutes choses qui apparaissent aujourd’hui comme un désastre, prélude à une catastrophe écologique sans précédent. L’écoféminisme c’est penser globalement la domination, le rapport aux autres, à la nature, à l’environnement, au climat, mais aussi les questions de soin et d’éducation comme enjeux éthiques et politiques, ce qu’on trouve chez les théoriciennes du care Carol Gilligan et Joan Tronto.
Une ville pour et par les femmes, ce serait quoi ?
Ce serait, sans hésiter, une ville agréable pour toutes et tous. Nous avons travaillé avec le Conseil de Développement de Bordeaux Métropole sur un diagnostic de quartier à Mérignac, près de Bordeaux. Il était question de déplacer un terrain de boules occupé par des hommes décrits comme envahissants et vulgaires. À la place, l’urbaniste envisageait un skatepark. Ce qu’ont proposé les femmes après une marche exploratoire c’est de ne rien mettre du tout, de façon à ce que le terrain soit libre, qu’on puisse garder la possibilité de mettre des tables avec des tréteaux ou une scène, pour faire des bals, une brocante, des repas de quartiers. Les propositions des femmes sont le plus souvent inclusives : d’une part parce qu’elles sont majoritaires lorsqu’il s’agit de s’occuper des enfants, des personnes âgées ou en situation de handicap, ensuite car elles ont des engagements généralement plus altruistes du fait de leur éducation. Les sociologues Sandrine Rui et Eric Macé analysent l’éducation différenciée des filles et des garçons comme allant vers un altruisme obligatoire pour les filles et un égoïsme légitime pour les garçons. Je trouve que cette formulation recoupe bien les entretiens que nous avions réalisés à l’époque auprès des deux groupes non mixtes masculin et féminin, concernant l’aménagement de cette place.
Dans tout ce que vous avez pu observer, qu’est-ce qui vous a paru le plus inspirant ?
Le programme vertueux des villes du nord, où l’égalité fait partie du système politique, l’assemblée est paritaire, de même que la gouvernance des grandes entreprises. En Suède et en Norvège, la réflexion sur l’égalité femmes/hommes est systématique. Nos travaux sur les skateparks et les citystades sont connus en Suède. Certaines villes suédoises ont réalisé qu’il n’y avait que des garçons sur ces équipements. A Malmö, par exemple, la ville a instauré une journée réservée aux filles. Au bout de quelques mois, on a observé une augmentation de la mixité filles / garçons les autres jours de la semaine. Peut-être supprimera-t-on la journée non mixte des filles lorsque la mixité sera rétablie les autres jours de la semaine ? Au regard de l’égalité face à l’impôt, les Suédois ont considéré qu’on ne pouvait pas créer des équipements qui ne soient pas également fréquentés par les femmes et les hommes. On en est loin en France, même si des villes comme Lyon, Paris, Rennes ou Bordeaux ont mis en place progressivement les dispositifs et bonnes pratiques pour aller vers des villes égalitaires, condition essentielle pour améliorer les ambiances urbaines.

Étude
Dans ce numéro : un dossier consacré aux rapports entre l’espace, la vie, la ville.

Étude
Compte-rendu du premier débat rétro-prospectifs du cycle de conférences qui a donné l’occasion à la communauté des agents, élus et partenaires de se mobiliser ensemble sur les enjeux d’avenir de l’agglomération.

Étude
À partir d’une enquête documentaire et d’entretiens, cette étude propose une compilation de scénarios prospectifs sous la forme d’images commentées qui mettent en scène des trajectoires potentielles pour les rues de la métropole lyonnaise.

Étude
En déployant les tendances issues de la littérature et de benchmark nationaux et étrangers, cette étude interroge la cohabitation des mobilités dans une rue qui demeure un espace contraint.

Article
Quand le temps devient un outil d’aménagement de l’espace

Dossier
De l’occupation de bâtiments à l’aménagement d’espaces ouverts, ces projets qui donnent du sens à l’éphémère
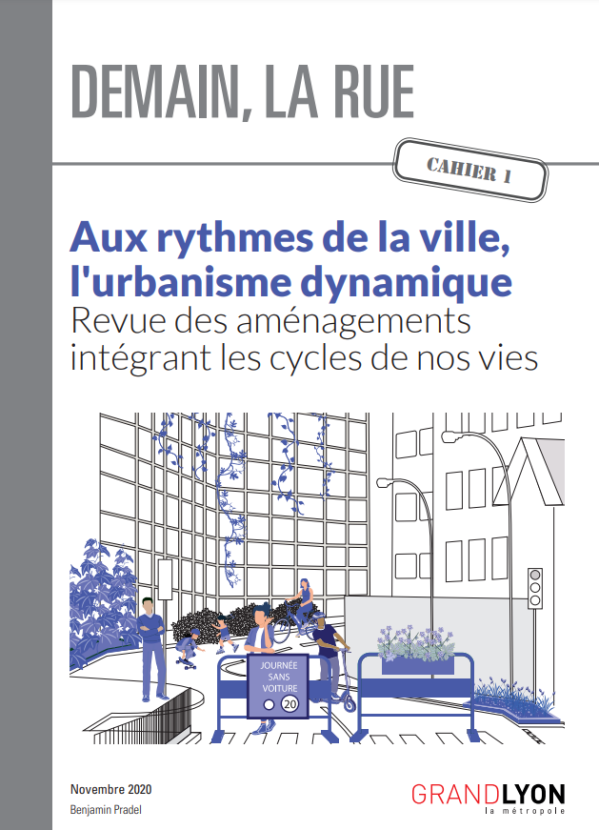
Étude
Cette étude revient sur sept modèles de rue où s’applique une prise en compte des rythmes. Mises bout à bout, ces logiques de régulation temporelle révèlent un mouvement global qui consiste à penser autrement l’organisation de la voirie par un arbitrage, selon les besoins et les lieux.

Étude
Tendances prospectives.

Interview de Pascale Lapalud
Urbaniste et designeuse
"Nous militons pour que l’égalité de genres devienne une compétence de l’urbanisme".