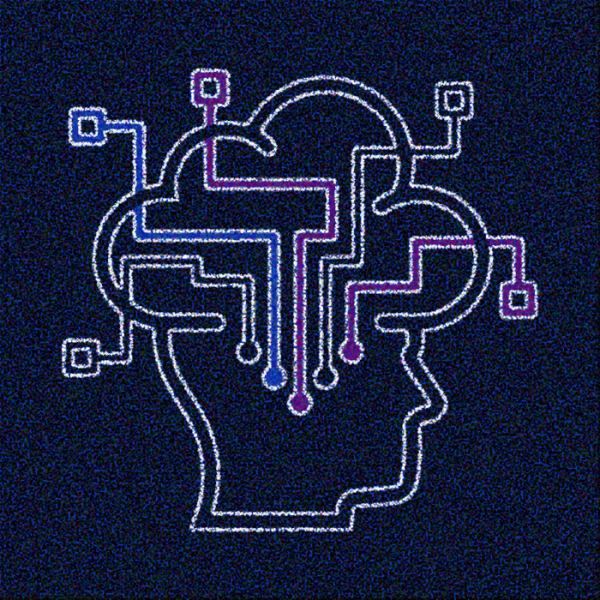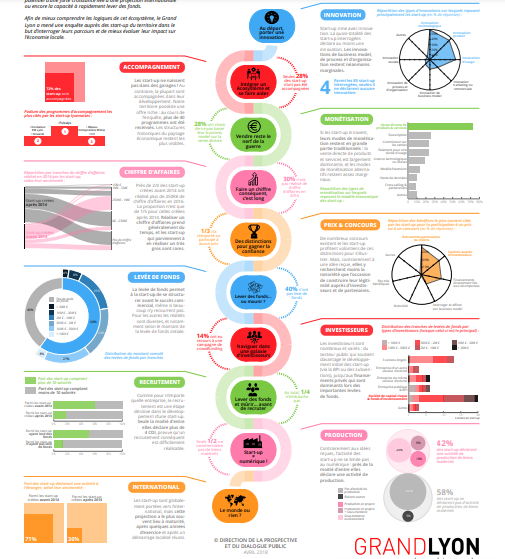Je me suis passionné pour les énergies renouvelables (EnR) pendant mes études d’ingénieur et j’ai travaillé 5 ans, jusqu’en 2016, dans le développement de projets EnR dans un groupe industriel, filiale d’un grand groupe. J’ai choisi ce métier par conviction : être un acteur de la transition énergétique, mais j’ai fini par ne plus croire au modèle dominant de développement des EnR qui bénéficie en premier lieu aux investisseurs et non aux territoires directement. Le schéma classique est le suivant : un développeur réunit autour de lui les compétences juridiques, techniques et financières, et monte une société de projet clé en main. Les retombées économiques locales sont alors très limitées, réduites essentiellement à la fiscalité locale, alors que le montant des investissements pour un parc éolien par exemple peut représenter des dizaines de millions d’euros. Ce modèle résiste également à intégrer plus d’horizontalité et d’implication des citoyens, perçues comme des sources de ralentissement et de complexification des procédures. Dans mon parcours j’ai butté sur ce mode de fonctionnement et me suis aperçu qu’il était difficile de faire évoluer les pratiques depuis l’intérieur...
Au début des années 2010 le mouvement de la transition énergétique citoyenne a pris de l’ampleur en France avec la multiplication des projets coopératifs et participatifs d’EnR, autour de l’association « Energie Partagée » et des centrales villageoises notamment. La Région Auvergne Rhône-Alpes est d’ailleurs une des régions où ce type de projets se développe le mieux. Ces initiatives promeuvent des projets d’EnR « citoyens », avec un ancrage local, une gouvernance partagée, et qui s’inscrivent dans une logique d’intérêt général pour les territoires et leurs habitants. Enercoop, coopérative de distribution d’électricité renouvelable, s’est également développée à cette même époque, illustrant l’évolution de notre rapport aux ressources énergétiques.
Ailleurs qu’en France, on constate également que d’autres modèles énergétiques existent, avec la coexistence de petites structures locales de production et de grands énergéticiens. En Allemagne par exemple plus de 50% des EnR sont produites par des coopératives dont les actionnaires sont des acteurs du territoire, alors qu’en France c’est moins de 1%.
Mon parcours professionnel et mes convictions personnelles, portées par ce contexte, m’ont amené à réfléchir à d’autres façons d’adresser la transition énergétique ; en ancrant sur les territoires la valeur ajoutée liée au développement de projets d’EnR.