Repenser les métiers du prendre soin à l’aune des théories du care

Étude
Et si le turn-over et l’attractivité en berne des métiers du prendre soin était lié à des transformations organisationnelles et managériales ?
Interview de Jacques ION

<< La démocratie, c’est mettre ensemble des gens qui n’ont pas d’intérêt commun. Donc forcément, c’est de la bagarre, c’est du conflit, du dissensus. Si on étouffe ça, on tue aussi la démocratie >>.
Propos recueillis par Catherine Foret, avril 2012.
Observateur de longue date du monde associatif et auteur de l’ouvrage « Citoyens dans une société d’individus » (à paraître chez Armand Colin), Jacques Ion affirmait en 2011 dans un article de la revue Sciences Humaines que « nous ne sommes pas plus individualistes, ni altruistes que nos prédécesseurs », mais seulement « plus autonomes », en recherche de « singularité ». Le sociologue explique ici en quoi les nouvelles modalités d’inscriptions collectives qui émergent dans nos sociétés occidentales obligent à repenser les formes de la solidarité et de l’action politique.
Comment caractériser les nouveaux types de liens qui se construisent entre les individus, dans nos sociétés marquées par la "désaffiliation" ?
Je me méfie du terme nouveau. Mais pour reprendre une idée de François de Singly qui me va très bien : « Narcisse ne peut pas être Narcisse dans l’île de Robinson ». Il faut un Autre. Aujourd’hui, on est de moins en moins défini par ses statuts et ses appartenances…, et l’injonction est partout d’« être soi-même ». Or la seule façon de se définir, ce sont les liens, les attachements que l’on a avec les autres. Donc, on n’y échappe pas. Mais la nature des liens n’est plus la même. Pour dire les choses rapidement, on est de moins en moins dans des liens hérités, de moins en moins dans le vertical, et de plus en plus dans l’horizontal. Les travaux de la sociologue Dominique Pasquier, qui a enquêté auprès de lycéens, le montrent bien. Elle explique, en gros, que la culture des adolescents est de moins en moins la culture des pères, et de plus en plus la culture des "pairs". Y compris chez les enfants des couches sociales supérieures. Je pense aussi à une autre enquête, de Michel Pialoux et Stéphane Beaud : après avoir travaillé longtemps sur les ouvriers des usines Peugeot, à Montbéliard et au Creusot, ils sont allés interroger les enfants de ces derniers. Et ils font un constat très difficile : ces enfants ne se reconnaissent pas dans la culture de leurs pères. Il y a un divorce total. Aussi bien — et c’est ce qui est intéressant d’un point de vue sociologique — chez les enfants de travailleurs français de longue date que chez les enfants d’immigrés. C’est très dur à vivre, pour les parents, mais aussi pour les enfants. On n’est pas dans le ressentiment, on est dans l’écart : « Leurs valeurs ne sont pas les nôtres. La culture ouvrière, on s’en fout. Nos parents se sont fait avoir…, pourquoi le fait de suivre leur modèle culturel nous permettrait de nous en sortir ? ».
Si l’on est moins dans ces solidarités "verticales", où et comment se manifestent les liens de type "horizontal" ?
J’ai beaucoup travaillé pour ma part sur l’engagement associatif et politique : c’est de ce point de vue-là que je peux en parler. J’ai notamment regardé du côté des jeunes — parce qu’on n’arrêtait pas de me dire : les jeunes ne sont plus dans les associations. En fait, on trouve plein d’exemples qui témoignent du contraire. J’ai trouvé des choses extraordinaires — comme le cas de cette association d’une petite ville de la Loire, qui regroupe près de 400 jeunes depuis une quinzaine d’années, et qui a obtenu depuis peu un statut de MJC. Je l’ai vu dans une ville moyenne de Rhône-Alpes, où les élus se plaignaient de ne pas trouver d’associations partenaires dans la ZUP. En fait, en allant sur le terrain, on a découvert plein de groupements de jeunes ; pas forcément déclarés en association, et pas forcément sur place : ils étaient plutôt au centre ville, pour échapper à la stigmatisation, par refus d’assignation identitaire, territoriale. Ils ne se revendiquaient pas comme « une association de la ZUP », mais comme des jeunes de la ville, tout simplement. Je pourrais évoquer beaucoup d’exemples comme ça. La forme associative n’est pas toujours respectée juridiquement ou dans son fonctionnement, mais les gens se regroupent et agissent ensemble. Ils sont de plus en plus mobiles, et de plus en plus incertains sur leurs identités…, et pour autant ils ne se replient pas. Le nombre de personnes qui se réunissent dans des groupements associatifs n’arrête pas de croître. Les actions en faveur des plus démunis (Resto du cœur), des oubliés de la planète (aide internationale) et de l’environnement mobilisent de plus en plus de monde. Les grandes manifestations de rue n’ont pas disparu ; et ceux qui défilent ne sont pas exclusivement mobilisés pour défendre leurs propres intérêts, mais le font aussi pour ceux qui ne peuvent le faire sans risques. Cela veut dire quelque chose : ce n’est pas parce qu’on est plus autonomes qu’on est plus égoïstes.
Qu’est-ce qui change par rapport à autrefois, dans ces manières d’être ensemble ?
Ce qui est sûr, c’est qu’avant, on voyait peu de groupements qui se faisaient indépendamment des héritages familiaux, ou des appartenances de quartiers, ou des affiliations idéologiques. J’ai observé en détail dans trois départements de la Région Rhône-Alpes le fonctionnement de deux associations "historiques" : le Secours Catholique et le Secours Populaire. Toutes deux ont le même objectif : s’occuper de la misère du monde, l’une s’inscrivant dans la tradition catholique, l’autre, dans de tradition laïque. Or j’ai découvert des croisements inédits dans la composition des conseils d’administration. Alors qu’avant, c’était surtout les femmes des militants communistes ou socialistes qui étaient présentes au Secours Populaire, on trouve presque autant de gens d’origine chrétienne dans cette association que dans le Secours Catholique ! C’était inimaginable il y a encore une trentaine d’années ! Cela veut dire que les clivages politiques qui ont structuré pendant si longtemps la vie associative ne fonctionnent plus comme ils le faisaient autrefois
Les associations d’aujourd’hui sont socialement plus hétérogènes qu’avant ?
Oui. L’espace associatif est de moins en moins un groupement d’interconnaissance. Bien sûr il y a de grands déterminants sociaux qui se maintiennent : plus tu es cultivé, plus tu as de diplômes, plus tu as de chances d’être dans une association. Mais le fait qu’on ne soit plus dans des liens d’appartenance commune (de quartier, familiale, idéologique, ethnique, religieuse…) modifie beaucoup les choses. Il n’y a pas si longtemps, les gens se "pré-connaissaient" avant d’être dans une association. On allait au cinéma ensemble, on partait en week-end ou en vacances ensemble, voire on se mariait ensemble… ! On était entre soi, en gros. Aujourd’hui, les gens qui se réunissent dans les associations viennent d’horizons différents, souvent d’autres villes, du fait de la mobilité résidentielle ou professionnelle. Et ils se connaissent de moins en moins indépendamment des objectifs associatifs. Ce qui a des conséquences sur les règles de fonctionnement, et notamment sur les horaires. Nous nous sommes aperçu par exemple, en étudiant le fonctionnement concret d’une trentaine d’associations, syndicats, partis politiques, amicales laïques, cercles paroissiaux, que les réunions de conseils d’administration et de bureaux ne se tenaient plus le week-end comme il y a 30 ans, mais les soirs de semaine, et qu’elles duraient de moins en moins longtemps. Elles commencent de plus en plus à l’heure, et ne se prolongent pas au bistrot d’à côté, comme avant. Autrement dit, on n’est plus dans le temps de la convivialité, mais dans un temps de la fonctionnalité. Cela correspond aussi à autre chose : Il y a 30 ans, les femmes représentaient 20 % des adhérents associatifs, aujourd’hui, elles sont environ 50 % (tout en se heurtant toujours au "plafond de verre" : elles sont rarement en position de dirigeantes). Tout cela fait que, bien plus qu’auparavant, dans le monde associatif, on est obligé de se confronter à des gens que l’on ne connaît pas.
N’y a-t-il pas aussi des changements d’échelle dans la façon dont se nouent les liens entre individus et toutes ces expériences altruistes ?
Oui, il est certain que les solidarités "naturelles", celles inscrites dans la famille ou l’espace de voisinage, ont aujourd’hui moins de poids, même si la crise peut parfois revivifier les liens intergénérationnels. Simultanément se développent des solidarités à distance, du type Amnesty International et autres : tous ces groupements dans lesquels on intervient ensemble sans se connaître. Internet facilite d’ailleurs ce type de connexions. Je suis allé voir ce qui se passait en Espagne, avec les Indignados, et j’ai été frappé par deux choses : la référence à Mai 68 (dont on a peu parlé…), et surtout le fait que les participants ne voulaient en aucun cas être représentants de quelque chose ou de quelqu’un. Ils étaient là tout seul. Avec plein de copains, c’était très festif…, mais on sentait une mise en cause, une peur de tout système de représentation : « On est les oubliés du monde, on se débrouille tout seul, on n’a pas besoin d’organisation ». Du coup c’est très compliqué : la moindre décision doit être prise à l’unanimité, la parole de chacun doit être pris en compte, il n’y a pas de médiation. Les gens veulent parler en leur nom propre. C’est assez logique : on n’est pas dans l’interconnaissance dans un mouvement comme celui-ci. Les gens viennent d’horizons variés, ils se rencontrent pour peu de temps : la confiance ne va pas de soi, et il devient difficile de déléguer sa voix. Les systèmes de représentativité traditionnels sont remis en cause ; et on est obligé d’inventer d’autres modes de fonctionnement. D’où, plus généralement, toutes ces instances de démocratie participative ou "délibérative", que l’on voit fleurir aujourd’hui, notamment en France. Le problème qui est ainsi soulevé, c’est « comment être ensemble tout en étant autonomes » ? Mais ce que ce mouvement des Indignés manifeste très fortement aussi, à mon sens, c’est l’évolution générale de l’idée de citoyenneté : autrefois considérée comme un droit et un devoir lié à une inscription dans la Nation, la citoyenneté est de plus en plus vécue comme une exigence par rapport au fait que l’on est citoyen du monde — tous embarqués dans les mêmes affaires, dans la globalisation. Le fondement de ces mobilisations collectives n’est plus l’Etat Nation, plus du tout, c’est clair. Et l’action publique n’a pas bien pris la mesure de ces phénomènes, parce que ces derniers ne sont pas territorialisables aisément. On ne peut pas les circonscrire dans des échelles claires, précises. Alors qu’une politique publique fonctionne de manière territorialisée, elle a du mal à accepter que les individus jouent tous aujourd’hui sur des échelles différentes.
Sur quels types d’affinités se fondent ces inscriptions collectives contemporaines ? Sur des proximités générationnelles ?
Non. Ce qu’on veut, c’est agir. Pour dire les choses très vite : auparavant, on avait l’espérance de jours meilleurs dans les siècles futurs. Il y avait des idéologies, au sens fort du terme, qui mobilisaient les gens : « Demain sera meilleur qu’aujourd’hui ». Aujourd’hui, on pense tous que demain sera pire qu’aujourd’hui. Cela manifeste un changement du rapport au temps : on ne peut plus attendre les transformations sociales à venir des changements politiques, au sens large du terme. Donc, on est obligé d’agir dans le présent. J’appelle ça l’idéalisme pragmatique. Ça ne veut pas dire que les gens n’ont pas d’idées, agissent sans repères : ils veulent pouvoir transformer un tout petit peu les choses. Même si c’est réformiste, même si c’est de petite ampleur, il faut qu’il y ait un résultat. Et il ne faut pas que les moyens qu’on emploie soient contradictoires avec les fins pour lesquelles on se bat. Là, il y a un vrai basculement. Hier, au nom de la révolution, tu pouvais faire un peu n’importe quoi, aujourd’hui ce n’est plus le cas. Si l’objectif c’est « agir ici et maintenant », le double critère, c’est l’efficacité et la cohérence des objectifs et des moyens. Cela explique d’ailleurs que des gens de traditions différentes puissent travailler ensemble.
Donc les choses bougent du côté du corps social, de manière intéressante. Les gens inventent d’autres types de liens, dans toutes les générations. En quoi ces évolutions interpellent-elles les politiques nationales de solidarité ?
Si l’on revient à la naissance de l’Etat providence, ou de l’Etat social, on s’aperçoit que c’est lorsque la question de l’égalité est entrée en contradiction avec la question de la liberté (ou plutôt l’inverse…) que sont apparus les systèmes de protection sociale sur lesquels nous vivons encore. Les socialistes, les solidaristes… ont voulu précisément réconcilier égalité et liberté. Aussi bien dans les pays anglo-saxons qu’en France, les deux piliers sur lesquels s’est construit l’Etat social sont le statut de salarié d’une part, et le statut dans la famille d’autre part : quand on est marié on a droit à ceci ou cela, quand on est mère, on a droit à des allocations… Ces droits-créances sont liés à une position, à un statut. Ceci s’est d’ailleurs fait contre les syndicats : il ne faut pas oublier que pendant toute la fin du XIXème siècle et au début du XXème, la CGT, la SFIO y étaient opposées, parce que leurs responsables raisonnaient sur les bases du mutualisme. Ils ne voulaient pas que l’Etat vienne mettre le nez dans la solidarité… Toujours est-il que depuis, l’ensemble des politiques sociales (l’assurance maladie, la retraite, les congés payés, les allocations familiales…) est fondé sur ces deux entités que sont le statut de salarié et le statut dans la famille. Or ce qui est en cause aujourd’hui, et ce que prouvent les différentes enquêtes que je viens d’évoquer, c’est que l’on ne peut plus définir l’individu simplement par son statut — autrement dit comme un individu anonyme. Les individus se définissent davantage par leurs singularités : leur parcours, leurs expériences, les épreuves qu’ils traversent… Même dans les quartiers populaires, où les choix relationnels se font encore beaucoup de manière territoriale, voire communautaire — du fait de l’assignation, et parce que ce qui est en cause là, c’est la survie — je suis surpris par le fait que ce à quoi les gens, majoritairement, font état pour se définir, ce sont moins des systèmes d’appartenance que des épreuves, des expériences ; qui sont d’ailleurs souvent des expériences d’humiliation, de discrimination dans le logement, à l’école, dans le boulot, de contrôle au faciès… D’où il ressort d’ailleurs que l’urgence politique, en matière de solidarité, c’est bien de toujours et constamment essayer de s’en tenir au principe d’égalité. C’est le déni d’égalité qui doit être prioritairement combattu, tout spécialement dans les quartiers populaires.
Quelles conséquences a, pour la puissance publique, ce passage de l’individu "anonyme" à l’individu "singulier" ?
Il me semble que cela doit conduire à redéfinir, dans le cadre national, la solidarité sur la base des parcours éducatifs et professionnels individuels. C’est d’ailleurs ce que réclament les organisations syndicales, qui ont bien conscience qu’elles représentent surtout les salariés non précarisés, et qu’il faut trouver des garanties collectives pour l’ensemble des travailleurs. Cette évolution vers des protections individualisées est d’ailleurs en partie amorcée, hors du monde du travail. On voit bien que ça coince en effet, aujourd’hui, dans nombre d’institutions : l’école, l’hôpital…. C’est la raison pour laquelle on met en place toutes sortes de dispositifs "adaptés" (les ZEP, les ZUS, les PAIO…). On crée des béquilles, pour essayer de réintroduire un peu d’individu concret dans le fonctionnement d’institutions qui se sont constituées sur la base de l’individu anonyme. Le meilleur exemple, ce sont les conseils de classe. Le sociologue Danilo Martucelli montre bien comment les élèves ne peuvent intervenir dans ces conseils qu’en tant qu’élèves, de par leur statut d’élève. Quand ils disent : « Mohamed, son père l’a quitté, etc. »…, ils ne sont pas entendus, parce qu’ils ne doivent pas aborder de cas singuliers. Ils ne doivent pas s’exprimer en tant qu’individus. Alors que la réalité, le concret déborde toujours le statut d’élève, bien évidemment. Il convient donc que nos institutions fonctionnent davantage sur la base de ces individus concrets. Cela ne veut absolument pas dire de singulariser les politiques en fonction de tel ou tel public. Le droit commun doit au contraire être la règle si l’on veut marier égalité et diversité. Ne pas opposer, comme le dit Nancy Frazer, politique de reconnaissance et redistribution.
Tout cela remet profondément en cause les métiers de l’action publique…
Oui. J’ai pu l’observer dans le travail social, une institution qui a fonctionné très longtemps sur le modèle éducatif, pédagogique — Erving Goffman dirait le modèle de la réparation : on fait un diagnostic, on évalue, on répare ; autrement dit, on met aux normes. Or on voit qu’aujourd’hui, le travail social ne fonctionne plus comme ça, y compris dans les textes officiels. Ce que disent les textes, c’est : « aller vers », « accompagner », « favoriser l’autonomie de la personne », etc. Le travailleur social doit aider l’autre à devenir ce qu’il pourrait devenir, et la personne à aider est de moins en moins pensée comme handicapée. En quelque sorte, la relation dans le travail social devient pratiquement une relation d’égal à égal. C’est tout un modèle de pratique qui est remis en cause, là. Et ce n’est pas par hasard si cela se passe dans ces métiers, qui récupèrent tous les individus avec lesquels les autres institutions, qui fonctionnent sur la base de l’individu anonyme (la famille, l’école, la religion…), ont échoué. Le travail social est la première institution obligée de se transformer. Devant l’injonction sociale à l’autonomie, qui pénalise les plus faibles, ceux qui ne disposent pas de ressources pour être reconnus socialement, il est contraint d’adapter ses pratiques, tout en évitant de particulariser à l’extrême. Toujours la même double obligation à tenir simultanément : travailler sur le singulier, mais dans un cadre égalitaire.
Du côté des institutions qui ont en charge la vie dans la Cité, quelles compétences faudrait-il mettre en œuvre pour saisir ce qu’il y a de positif dans le processus d’individuation, si souvent présenté comme négatif ?
Je n’ai pas de réponse toute faite, mais par exemple, j’ai été frappé par le cas de ce gros équipement culturel dans une ville rhônalpine : une scène de musiques actuelles pour la gestion de laquelle la mairie avait lancé un appel d’offres, il y a quelques années. Parmi les réponses venues de toute la France, l’une émanait d’une dizaine d’associations locales de jeunes — de petites associations spécialisées dans le théâtre, la musique, la danse, le chant… Leurs responsables s’étaient regroupés pour présenter un projet de prise en charge de cette structure. Et ils sont arrivés à 15 devant le jury ! La mairie a dit non…, on n’en veut qu’un. Eux ont tenu bon, ils n’ont pas lâché, et finalement ils ont été choisis : la direction actuelle est assurée par un collectif associatif, un peu informel, qui réunit 100 à 150 personnes actives. Les élus locaux ont eu du mal, mais ils se sont adaptés. Donc des évolutions sont possibles. L’enjeu, pour passer d’une politique de la réparation à une politique de l’accompagnement, c’est de ne pas être dans un rapport pédagogique, mais dans un rapport d’écoute. C’est ce qu’explique Jacques Rancière dans « Le maître et l’ignorant » : on apprend plus en supposant que celui auquel on apprend sait des choses, qu’en postulant a priori une différence totale entre celui qui saurait et celui qui ne saurait rien.
Mais concrètement, comment faire avec la diversité, l’hétérogénéité des groupes qui se constituent aujourd’hui ?
D’abord, il faut accepter le conflit. Il ne faut pas vouloir intervenir avec l’idée de mettre tout le monde dans le même panier et de rassembler. Ras le bol des discours sur le « vivre ensemble » ! J’ai envie de dire mon indignation quant à ce discours auquel aujourd’hui tout le monde ou presque souscrit, de Régis Debray à Marcel Gauchet, selon lequel on doit taire les différences au nom d’une espèce de pacte social. On n’est pas là pour faire des premières communions ! La démocratie, c’est mettre ensemble des gens qui n’ont pas d’intérêt commun. Donc forcément, c’est de la bagarre, c’est du conflit, du dissensus. Si on étouffe ça, on tue aussi la démocratie. À ce sujet : je suis un défenseur des NIMBY ! On les critique au nom du fait qu’ils défendraient des intérêts particuliers par rapport à l’intérêt général. Mais l’intérêt général, ça n’existe pas en soi. C’est constamment remis en cause, c’est le résultat de conflits. À un moment donné, ça émerge comme intérêt général…, c’est tout. Avec André Micoud et d’autres, nous avons enquêté, il y a déjà longtemps, auprès des opposants à l’autoroute Lyon / Saint-Etienne. Qu’avons nous vu ? Des paysans installés là depuis longtemps, des néoruraux, des vieux châtelains, des ouvriers de Rive-de-Gier et de Saint-Chamond qui avaient trouvé un terrain pas cher dans le coin, des Parisiens propriétaires de résidences secondaires, des cadres moyens de Givors qui étaient venus s’installer là…, bref, une population bigarrée au possible, socialement hétérogène, qui arrive à se mettre d’accord sur un tract. C’est passionnant ! Cela veut dire que ces gens ont surmonté leurs différences de langage, leurs a priori… : ils ont fait de la politique ! Ils sont allés voir les maires, les conseillers généraux, les députés, la Région, l’Europe…, ils ont fait de la politique constamment. Et quand on va voir de près, ces gens-là défendent des intérêts qui ne sont pas si particuliers que ça. Ils sont obligés de prendre en compte plein de dimensions du monde commun que l’on partage aujourd’hui, et les conflits qui traversent ce monde commun. Les écologistes qui se sont mobilisés contre des lignes haute tension dans le Verdon, ou pour la protection des ours dans les Pyrénées, c’est la même chose : ils ont étudié comment était alimentées l’Italie et l’Allemagne en électricité… ; ils ont dû lire des textes européens, se renseigner sur les flux de marchandises entre l’Espagne, le Maroc et le Nord de l’Europe, comprendre pourquoi tant de camions passaient par là, etc. Ils ont posé des questions très intéressantes ! Ce sont des gens qui voient le monde, qui ont d’emblée une conscience européenne. Paradoxalement, ces gens qui traitent leurs petites affaires dans leur coin sont ceux qui ont tendance à prendre en compte la globalisation, alors que ceux qui font de la politique politicienne ont tendance à réduire leur vision à l’Etat Nation ! Je pense pour ma part que lorsqu’on va dans le concret des choses, dans le singulier, on a beaucoup de chances de rejoindre autrement l’universel.
Ces luttes collectives ont-elles des effets structurants, du point de vue sociologique ? Il en reste quelque chose, sur le long terme ?
Oui, je maintiens que ces gens-là, même lorsque leurs actions n’ont pas abouti, sont bien plus politisés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient auparavant. Il se construit des liens — ce qu’on appelait avant de la conscience politique. Je pense qu’on est sujet politique dans l’action, en se confrontant au réel. De même que l’intérêt général en soi n’existe pas, la politique n’existe pas en soi. Je prends un autre exemple : les Réseaux Education Sans Frontière. Ils rassemblent à la fois de vieux militants blanchis sous le harnois, qui ont fait toutes les guerres depuis de 68, des gens politisés depuis longtemps…, et puis des mères et des pères de famille simplement révoltés parce que Rachida va être mise dehors et sa mère expulsée… Ces gens-là ne mènent pas impunément des combats communs : une fois qu’ils ont travaillé ensemble, cela leur reste toute leur vie. On en revient là au fait que ce sont les expériences, les épreuves qui font le bonhomme, ou la femme. C’est cela qui détermine le rapport qu’on a à aux autres. C’est ça, être sujet politique.
Mais peut-on qualifier les liens qui se nouent dans ces moments de mobilisation collective comme relevant du registre de la solidarité, au sens "d’interdépendance" qui a longtemps été donné à ce terme ?
Oui. La solidarité qui naît dans ces formes d’action est peut-être critique, suspensive…, mais elle est de meilleure qualité, si j’ose dire, que la solidarité "innée", liée à des appartenances communes. Parce qu’elle est réflexive : elle implique que l’individu pense son rapport aux autres. Je distingue trois caractéristiques de l’individu singulier : premièrement, la tendance selon laquelle les relations horizontales prennent le pas sur les relations verticales ; deuxièmement, la mobilisation des affects : on peut désormais évoquer ses sentiments, ses passions privées dans l’espace public, et cela a du poids. Auparavant, pour faire triompher une cause, il fallait soit faire masse (on défile dans la rue, comme une somme d’individus anonymes) ; soit être proche des élus, ce qui était facilité par la continuité entre la sphère politique et la sphère associative — un fait qui n’existe plus aujourd’hui : on constate au contraire un déni, voire un rejet des politiques de la part des associatifs. Maintenant, un individu singulier crie ses émotions, et cela peut faire bouger plein de choses, parce que ce sera repris très vite par des milliers d’individus. Et la troisième caractéristique de l’individu singulier, c’est la réflexivité. La société dans son ensemble étant de plus en plus réflexive, l’individu lui-même est obligé de l’être. Les pratiques des gens sont constamment analysées en temps réel, on nous submerge d’informations sur la nouvelle façon de vivre, d’élever ses enfants, de faire l’amour, de préparer de bons repas, etc. Nous sommes tous confrontés à ces modèles de bonnes pratiques, donc obligés d’avoir un point de vue sur nos propres comportements. C’est en cela que nous sommes davantage aujourd’hui dans des solidarités réflexives, qu’on le veuille ou pas. Mais c’est un mouvement continu, je ne voudrais pas passer pour post-moderne... L’artiste au XIXème siècle était un individu singulier…, maintenant, tout le monde est artiste, en quelque sorte.
Diriez-vous que ces solidarités "réflexives" sont émancipatrices, par rapport à celles d’hier ?
Peut-être. En tout cas, elles sont moins enfermantes. Et j’ai tendance à penser que c’est mieux, parce que celles qui dominaient autrefois étaient parfois sacrément pesantes. Tout ce qui nous rend libre va dans le bon sens. Vive la désaffiliation ! Robert Castel avait déjà livré en son temps une version positive de la désaffiliation, dans un article sur Tristan et Yseult paru dans Le Débat. La limite de ces solidarités contemporaines, c’est sans doute leur caractère plus éphémère, moins durable. Mais là aussi, il faut se méfier de nos réflexes critiques. Dominique Cardon a écrit récemment un bon article sur ce sujet, dans lequel il explique que les responsables politiques dévalorisent très vite les liens faibles, notamment ceux qui se nouent via Internet. Mais au nom de quoi les solidarités traditionnelles seraient-elles meilleures que celles qui transitent par ce qu’on appelle aujourd’hui les "réseaux sociaux" ? Tous les attachements se valent, à partir du moment où ils aident à construire la personne. On ne saurait opposer ceux qui prévalaient davantage hier (les attachements verticaux, familiaux, par exemple) à ceux qui émergent aujourd’hui dans l’ensemble de la société et ne sont plus l’exclusivité d’une fraction des seules couches supérieures. Ne soyons pas méprisants avec ces attachements-là.

Étude
Et si le turn-over et l’attractivité en berne des métiers du prendre soin était lié à des transformations organisationnelles et managériales ?

Étude
Comment le care peut renouveler notre rapport à l’autre, à la société, à la nature et aux objets ?

Étude
Retour sur les principaux modes d’intervention relevant du « filet d’hospitalité » existant sur son territoire.

Dossier
Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?

Étude
Comment expliquer le manque d'attractivité des métiers du prendre soin ? pourquoi on candidate, on tient, on s’en va ? Retrouvez la synthèse des enseignements des différentes enquêtes conduites sur ces questions.

Article
Cheminer vers la sobriété : L’altruisme est-il le balancier nécessaire à cette démarche de funambule ? « Pas si simple », répond la mathématicienne Ariadna Fossas Tenas

Article
En 2022, la loi bioéthique ouvrait le don du sang aux homosexuels dans les mêmes conditions aux hétérosexuels. En matière de sentiment d’appartenance à une catégorie sociale, que nous apprennent les controverses qui ont abouti à cette évolution ?

Interview de Elies Ben Azib
Directeur du Centre social La Garde à Marseille
Dans cet entretien, Elies Ben Azib nous présente un répertoire d’actions, et évalue son efficience dans le contexte politique actuel, sans porter de jugement sur les combats menés en tant que tels.
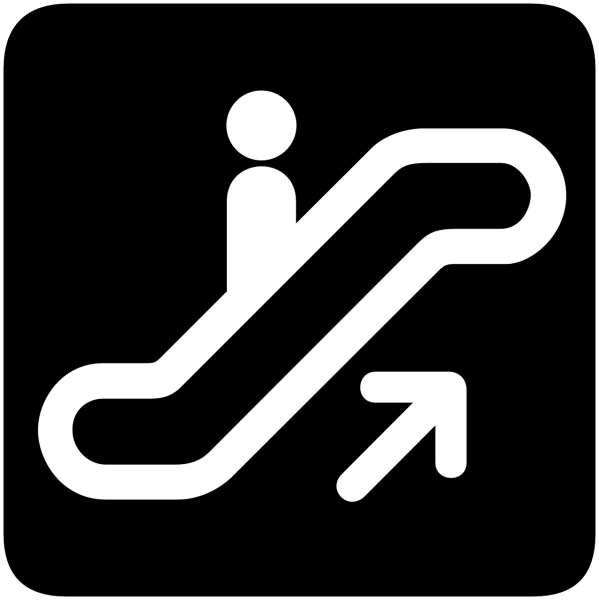
Texte d'Emmanuelle SANTELLI
Dans le cadre d’une étude effectuée par le Groupe de Recherche sur la Socialisation, (UMR 5040 CNRS, Lyon II), Emmanuelle Santelli étudie les parcours des populations d’origine maghrébine dans une perspective intergénérationnelle : comment se construisent les trajectoires professionnelles en référence aux parcours des parents.
Ce texte s’appuie sur une enquête effectuée sur les descendants d’immigrés algériens qui ont eu des parcours réussis.