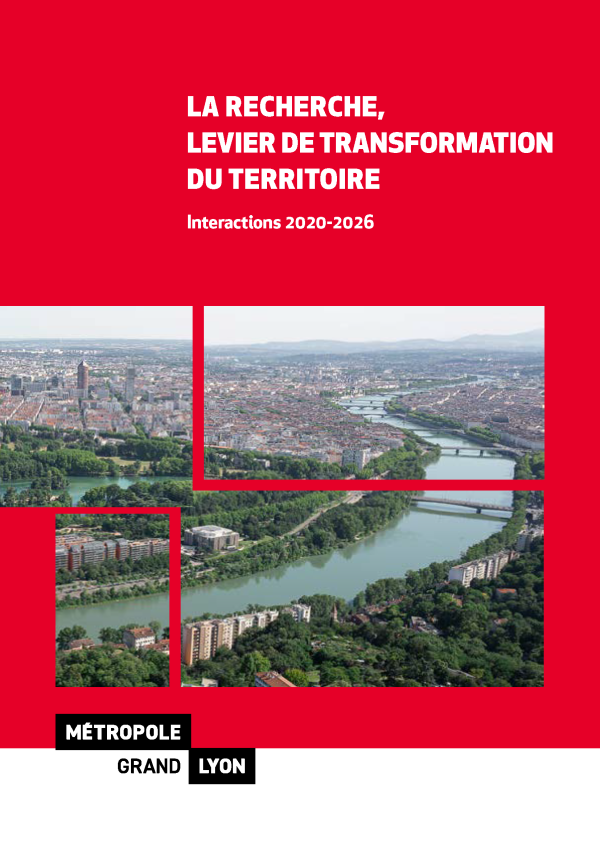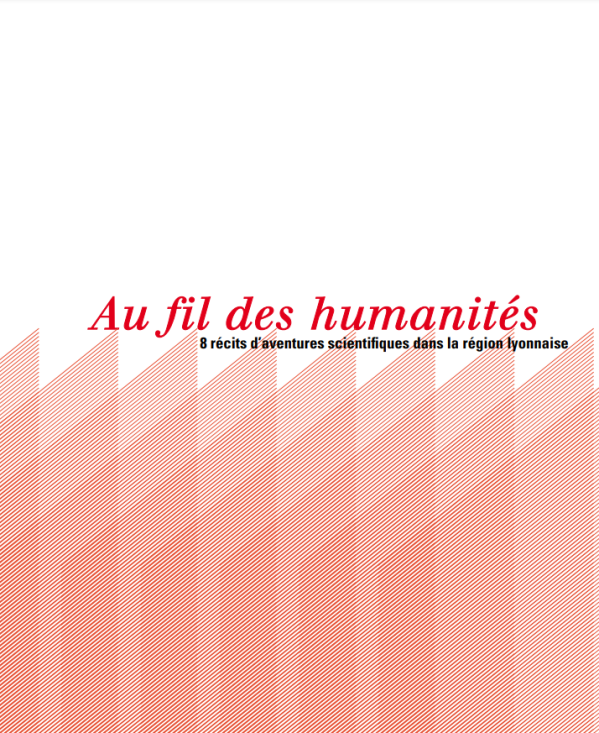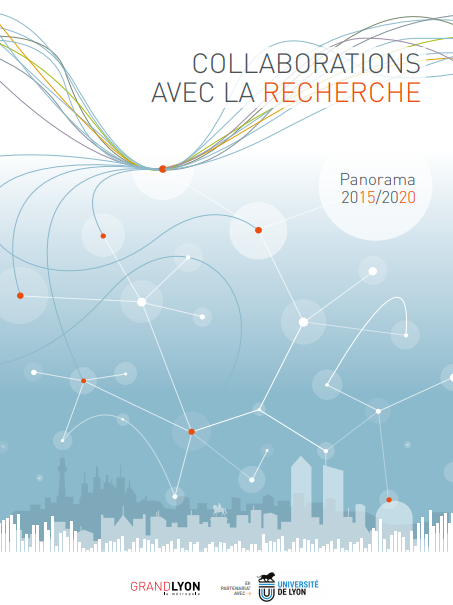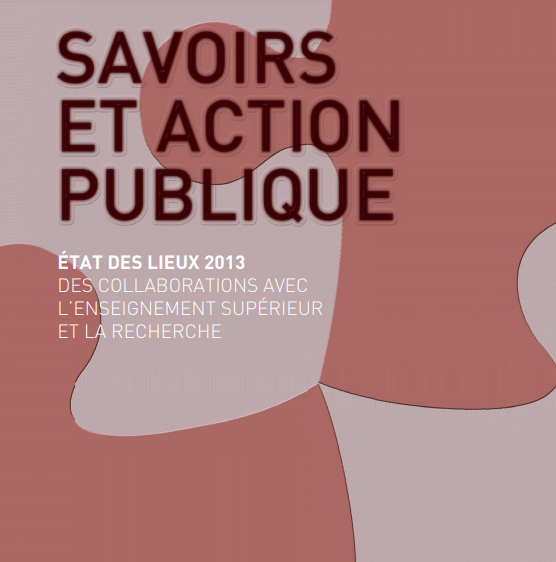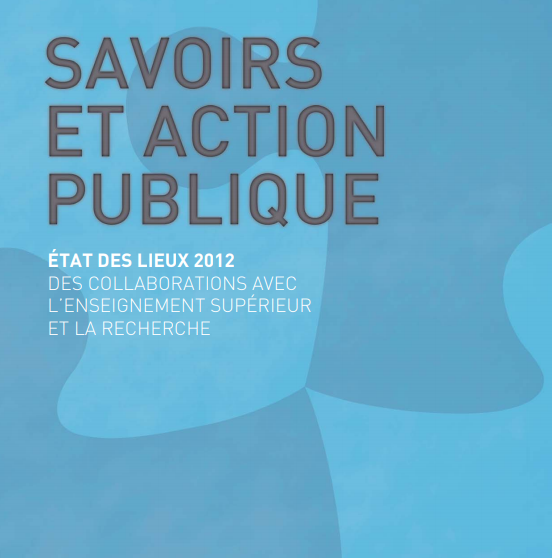Le BioPARK est fondé sur une coopération franco-suisse. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les tenants de cette coopération ?
Il faut considérer Archamps comme un laboratoire expérimental de relations si possible réussies avec le tissu économique et innovant Suisse. Aujourd’hui, nous avons un réseau de coopérations avec des personnes et des institutions identifiées de part et d’autre de la frontière. Ce réseau se construit depuis 5 ans par des échanges et des rencontres. Il a donné lieu à la formation d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS). Ce GIS va pouvoir se matérialiser et se poser de manière stratégique dans les 6 mois qui viennent puisque des locaux vont être livrés nous permettant d’exécuter dans un laboratoire implanté dans la zone transfrontalière une grande partie de nos projets scientifiques.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en place de ces coopérations ?
Il est indispensable de connaître les règles du jeu de l’ensemble des partenaires et bien sûr de nos amis suisses. Une des particularités du Biopark, c’est que, au grand bénéfice de la Région Rhône-Alpes, nous avons ici un certain nombre de personnes qui connaissent très bien la façon dont le système fonctionne de l’autre côté de la frontière. C’est très important car il y a encore des barrières psychologiques et culturelles, et pas seulement politiques qu’il faut pouvoir lever pour faire avancer un dossier.
Et sur le plan économique et entrepreneurial, quels sont les résultats ?
C’est l’autre volet très important du Biopark : la valorisation. Le seul fait d’avoir dit que l’on faisait un Biopark avec des moyens et une plate-forme scientifique un peu spécifique (mettant à disposition une animalerie par exemple) a fait qu’il y a 4 ans Addex Pharmaceuticals France s’est installé ici. Ils ont quand même 1 200 m2 maintenant et sont en train de plus que doubler la surface de leur implantation ! Et aujourd’hui, beaucoup d’entreprises sont dans une logique de bilocalisation, au grand bénéfice de la Technopôle d’Archamps. En quelque sorte, la localisation à Genève permet une ouverture sur le monde et la localisation en France permet une ouverture au marché européen. Cela présente également des avantages sur le plan fiscal. Cette bilocalisation est une tendance qui va croissante et qui est certainement en train de reconfigurer l’espace économique de la région genevoise. Il y a eu un changement psychologique total depuis la signature des accords bilatéraux en juin 2004 qui a contribué à libérer des coopérations. Il faut bien voir que nous avons à faire à un territoire bien particulier qui comprend une frontière, une langue commune et un pôle urbain international important à proximité.
Comment Lyon va-t-elle se mailler avec cet ovni frontalier ?
Le CNRS, l’INSERM et l’université Claude Bernard sont déjà parties prenantes dans des projets phares. Et c’est d’ailleurs la Fondation Rhône-Alpes Futur, responsable des sept plates-formes régionales de Rhône-Alpes Genopole, qui gère le personnel technique et les équipements de la plate-forme. Mais je dirais qu’à l’heure actuelle, il y a un danger évident de voir des projets d’excellence naître en France et filer de l’autre côté de la frontière pour se développer. Il faut à tout prix se prémunir contre ce genre de scénario !
Quelle est la contribution des Suisses au projet à l’heure actuelle ?
Pour l’heure, les investissements d’infrastructures (locaux, équipements) sont financés à 95% par les Français (Conseil Général de Haute-Savoie et Conseil Régional Rhône-Alpes). En ce qui concerne les individus (et donc les salaires) par contre, c’est équilibré. Mais il est évident que la Suisse n’interviendra qu’à partir du moment où les infrastructures seront présentes et actives. Leur contribution financière reste encore à négocier. Il faut qu’on leur montre très concrètement ce que ce grand projet peut apporter et qu’on leur fasse la preuve de son intérêt. Pour l’instant, leur contribution reste limitée.
Vous êtes bien placé pour porter un regard critique sur les développements actuels de l’université genevoise dans le domaine des sciences de la vie. Quel regard portez-vous sur l’excellence genevoise en la matière ?
Dans le choix des thématiques et des directions de recherche à implémenter, ces universités, toujours à l’affût de ce qu’il se passe sur le plan de l’innovation et de la recherche fondamentale, ont su systématiquement dire dans quelle direction il faut orienter les efforts. Aujourd’hui, en Suisse, il y a des axes précis de recherche qui s’activent et qui trouvent assez rapidement un écho dans le tissu industriel, comme c’est le cas pour les biotechnologies. Cela a été mené de manière consciente sur Genève et Lausanne.
Concrètement, comment cette politique habile que vous décrivez se traduit-elle ?
Ces décisions sont aujourd’hui appuyées par des moyens conséquents. A Genève, et en Suisse en général, quand on embauche un professeur à l’université, on le paie bien ! Les salaires et les dotations pour les projets de recherche sont très élevés ici ! Il y a en outre des équipements de qualité qui sont mis à disposition, rapidement lorsqu’il le faut. Les laboratoires de 100 personnes n’existent pas ici ! Trente personnes, c’est un maximum ! Je dirais que c’est un fonctionnement très américain. Un professeur de l’université n’est pas sélectionné de la même manière qu’en France. En Suisse, il y a un appel d’offres sur une direction de recherche jugée indispensable pour l’université de Genève et cet appel d’offre, en général, va chercher la personne la plus adaptée mondialement pour remplir la fonction souhaitée. Ce système permet d’assurer un niveau d’excellence très élevé. Et comme les autorités publiques mettent les moyens derrière, ils sont capables de concurrencer les plus grandes universités américaines.
En est-il de même du volet économique ?
Après quelques années de cafouillage, je dirais qu’ils arrivent aujourd’hui à quelque chose que nous n’avons pas, à savoir Eclosion. Eclosion est un incubateur d’entreprises spécialisé dans les biotechnologies. Cet incubateur parvient aujourd’hui, contrairement à ce qui se passe en France, à mobiliser des financements importants sur un mode public-privé, où un projet sélectionné va connaître une mise à l’épreuve sur environ 18 mois pendant lesquels est faite la « preuve du concept ». Au cours de cette période, les scientifiques ont les moyens de travailler vite, les financiers prennent le temps de se concerter et l’on aboutit alors assez rapidement au premier tour de table avec des financements qui peuvent aller de 10 à 50 Millions de francs suisses ! On n’a pas cela en France. Et à partir du moment où l’on est arrivé du côté suisse à quelque chose qui prend de l’allure en 2-3 ans, il y a un relais des investisseurs et/ou des banques qui, au vu de leur puissance à Genève, accompagnent puissamment et font grossir ce mouvement.
Genève, en tant que place bancaire majeure, est donc particulièrement attractive pour le financement des jeunes entreprises biotech ?
C’est sûr ! Il y a de l’argent à Genève, des capitaux qui viennent de toutes parts et qui sont prêts à être investis dans les biotech. Nous sommes dans un environnement où la puissance financière peut se déployer à travers des investissements conséquents. Ils ne sont pas à essayer de décrocher un petit brevet par ci et par là, sans tenter d’en tirer le meilleur parti ! En France, on est dans des montages qui sont pathétiques à côté de ce qui devrait être ! Nous n’avons pas de leviers aussi puissants en France parce que les moyens disponibles et surtout les règles du jeu ne le permettent pas.
Y a-t-il une manière particulière d’innover en Suisse ?
Oui, elle est liée à un certain particularisme. Je pense à l’exigence de qualité et la forte mobilisation de moyens d’une part, et d’autre part, les Suisses regardent ce qu’il se passe autour, ils savent ce que veut dire le benchmarking. Eclosion en est un très bon exemple : ils ont passé du temps à mettre au point ce modèle d’incubateur, ils sont allés voir aux Etats-Unis, en Angleterre, etc. et puis, ils vont chercher l’expertise à l’extérieur ! En général, les autochtones ne sont pas les premiers servis, c’est une très grosse différence avec les Français. En fait, c’est un aspect très important de ce que l’on appelle « La Genève internationale ». Elle n’est pas internationale uniquement parce qu’il y a des organisations internationales, mais parce que les Genevois ont un comportement qui est instinctivement tourné vers le monde, vers le mondial. Si vous allez sur le site web de Bioalps par exemple, cluster biotech de la région lémanique (qui est essentiellement francophone), vous verrez qu’il est entièrement en anglais, il n’y a même pas de version française. Les Genevois ont fait le choix de l’international. Je dirais que Lyon a des relations internationales tandis que Genève est internationale ! Dans ce contexte, de l’extérieur, Lyon est trop souvent associée à des ...lyonnaiseries !
Avez-vous l’impression que les relations sont plus faciles entre Genève et Grenoble ?
C’est possible en effet. Grenoble est dans les faits, grâce au développement des sciences exactes, plus internationale que Lyon, c’est ce qui explique, je pense, une complicité et une proximité pour l’instant, plus fortes entre Genève et Grenoble qu’entre Genève et Lyon. En effet, il y a, entre Grenoble et Genève un point commun très important : la physique. Il y a, entre les deux villes, une communauté de pensée et une ouverture scientifique qui est propice au dialogue. Lyon peut changer tout cela et ses interrogations actuelles permettent d’espérer voir se dessiner une réalité à la hauteur de ses ambitions affichées, de moteur majeur de l’axe lémanique franco-suisse.