Sommes-nous notre cerveau ?

Étude
Interview de Mireille GUIGAZ
<< Clermont-Ferrand, Saint-Etienne et Lyon sont en train de structurer un continuum >>.
Interview de Mireille Guigaz, Déléguée Générale en 2006 du CLARA, Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes.
Pourriez-vous présenter le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes ?
Le CLARA est un réseau de mise en synergie des acteurs de la recherche en cancérologie. Ce n’est pas une nouvelle institution ! Notre rôle est de créer des interconnexions destinées à produire de la masse critique. Ces interconnexions permettent de rassembler des ressources humaines, les différents plateaux techniques hospitaliers et de marier le public avec le privé, notamment avec les biotechs et l’industrie pharmaceutique.
Pour vous donner une idée du spectre d’action, voici deux exemples :
Le CLARA travaille avec tous ceux qui ont à voir avec la recherche sur le cancer. On n’est pas dans du soin de routine, on est dans du soin où l’on injecte de l’innovation ! C’est donc aussi de la recherche clinique. Nos principaux partenaires sont les hôpitaux, les universités, les établissements publics scientifiques et techniques (INSERM, CNRS, INRA), les entreprises biotechs et l’industrie pharmaceutique. A cela s’ajoutent des partenaires qui nous financent : les collectivités territoriales, l’Etat et l’Institut National du Cancer (INCa).
Vous êtes à la tête du CLARA depuis 18 mois. Quel bilan pouvez-vous en tirer ?
Je constate que le paysage de la recherche en France est plein comme un œuf ! Des strates supplémentaires sont régulièrement rajoutées sans que rien ne soit jamais supprimé… Il y a une réelle difficulté à s’insérer dans un paysage institutionnel lourd et sédimenté. Nous, nous travaillons plutôt sur les points de contact. Je dis souvent que nous faisons de l’interstitiel ! Nous sommes tout petits et mobiles, nous sommes comme les hoplites, vous savez, ces petites équipes envoyées en éclaireurs dans les armées grecques antiques. On est dans la fluidité, ce qui est parfois difficile à faire reconnaître comme valeur ajoutée. Dans notre équipe « Tête de réseau », nous ne sommes que 9 et je ne souhaite pas augmenter les effectifs pour pouvoir conserver cette fluidité. La seule chose à redouter, c’est d’être une couche supplémentaire dans le grand millefeuille institutionnel ! A nous d’apporter quelque chose de nouveau. C’est notre défi. Pour certains, nous sommes trop petits, pour d’autres nous sommes dérangeants… Or, les vraies trouvailles se font souvent à la frontière des disciplines. Nous ne savons pas toujours ce qui va sortir d’une mise en connexion de chercheurs ! Sur 10 pistes, une seule peut-être aboutira… Notre réussite se mesure à la qualité des projets novateurs qui émergent et à ceux qui sont constitués via les appels d’offres de l’INCa. Il y a 1700 chercheurs concernés en Rhône-Alpes. A nous de susciter le désir de la transversalité, de montrer que le réseau, c’est nouveau. C’est l’idée du cluster, joliment traduit par « grappe » en québécois. Des opportunités, il y en a plein, car la richesse d’un réseau, c’est la richesse de ses acteurs. Et notre région est forte de nombreux atouts… suffisamment pour pouvoir jouer dans la cour européenne !
Quelle place occupe Saint-Etienne dans ce dispositif ?
C’est une question qui n’a pas lieu d’être ! Mon poignet est-il plus important que mon genou ? Non, les deux font partie intégrante de mon corps. C’est la même chose pour Saint-Etienne, qui est totalement intégrée au tissu rhônalpin. Les populations passent sans arrêt de Saint-Etienne à Lyon et de Lyon à Saint-Etienne, les territoires de santé se recoupent…. Saint-Etienne est plus petit que Lyon, c’est un fait. On est sur un schéma d’attraction réciproque. En réalité, le mouvement qui se dessine dans le paysage inter-régional va d’ouest en est : Clermont-Ferrand, Saint-Etienne et Lyon sont en train de structurer un continuum, il y a un déplacement similaire à celui que l’on peut observer au niveau de l’Union Européenne avec l’intégration des pays de l’Est. Et il se trouve qu’actuellement Saint-Etienne fait la jonction entre Clermont-Ferrand et Lyon car les Stéphanois ont déjà passé des partenariats avec les deux autres agglomérations. Il y a là un début de continuité territoriale.
Concrètement, comment sont réparties les compétences en cancérologie de la région ?
L’un des points forts de Lyon que nous voulons encore développer est l’immunologie et les liens entre cancers, infections et virus. Les dernières découvertes scientifiques montrent que plusieurs cancers sont induits par des virus : le cancer du col de l’utérus, de l’estomac, du foie (avec l’hépatite C)… Grenoble est un pôle d’excellence sur les nanotechnologies, Clermont-Ferrand a choisi le thème prioritaire « nutrition et cancer ». Et Saint-Etienne va accueillir un Institut de la Santé Publique largement tourné vers le cancer. Plusieurs types d’études pourront y être conduites :
L’Institut de la Santé publique a déjà démarré des projets concrets de recherche. Quant au bâtiment, il est en cours de construction. En France, un seul autre institut de ce type existe à Montpellier. Le rayonnement de l’Institut de Santé Publique de Saint-Etienne peut donc assez rapidement dépasser les frontières de Rhône-Alpes s’il fonctionne bien.
A votre avis, la santé est-elle un bon point d’accroche pour renforcer le tandem Lyon/Saint-Etienne ?
Je ne me vois pas vous répondre non, n’est-ce pas ? Mais en fait, c’est une conviction profonde, corroborée par les faits : les enjeux de santé dans un pays comme le nôtre demeurent majeurs, en particulier dans le cancer. Le cancer représente en France 150 000 morts par an, ce qui, en comparaison des 6 000 morts du sida par an ou des 5 000 décès dus aux accidents de la route, mérite une mobilisation politique ! Notre inter-région dispose de tous les atouts indispensables pour réussir dans le domaine de la lutte contre le cancer, notamment sur le plan de la recherche fondamentale et de la recherche clinique. En termes de potentiel, nous pouvons sans rougir supporter la comparaison avec d’autres grandes régions d’Europe. En termes de mobilisation et de résultats, il faut se rappeler que rien n’est jamais acquis : nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Le monde bouge très vite, celui qui n’avance pas recule. Il faut du travail et encore du travail, de l’ambition et aussi de l’enthousiasme. Les chercheurs du réseau Cancéropôle n’en manquent pas.

Interview de Isabelle MAGNIN
Directrice de CREATIS

Interview de MARIE LANG et Jean-Pierre DUFFET
Directrice du Centre National de Gestion des essais des produits de santé (CeNGEPS)

Interview de Laurent LEMPEREUR
Directeur de la direction des contrôles

Interview de Isabelle DIAZ
Directrice biotechnologies et recherche au LEEM

Interview de Charles Auffray
European Institute for Systems Biology & Medicine
Interview de Philippe GRAND
Associé d'Ernt & Young
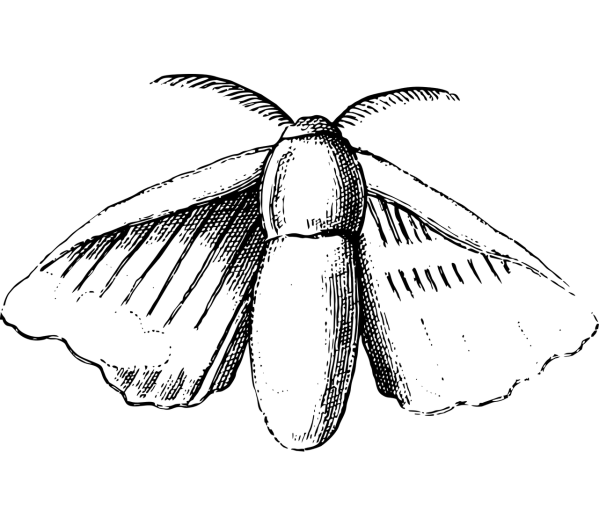
Interview de Erik Langlinay
"En ce début de XXIe siècle, la chimie de Lyon se caractérise surtout par l’appui sur une région industrielle diversifiée, sa reconversion vers la pharmacie et l’excellence de sa formation technicienne".
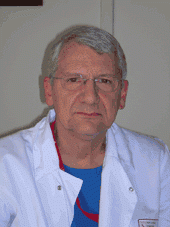
Interview de Olivier BASTIEN
Directeur de la Commission transplantation des Hospices Civils de Lyon