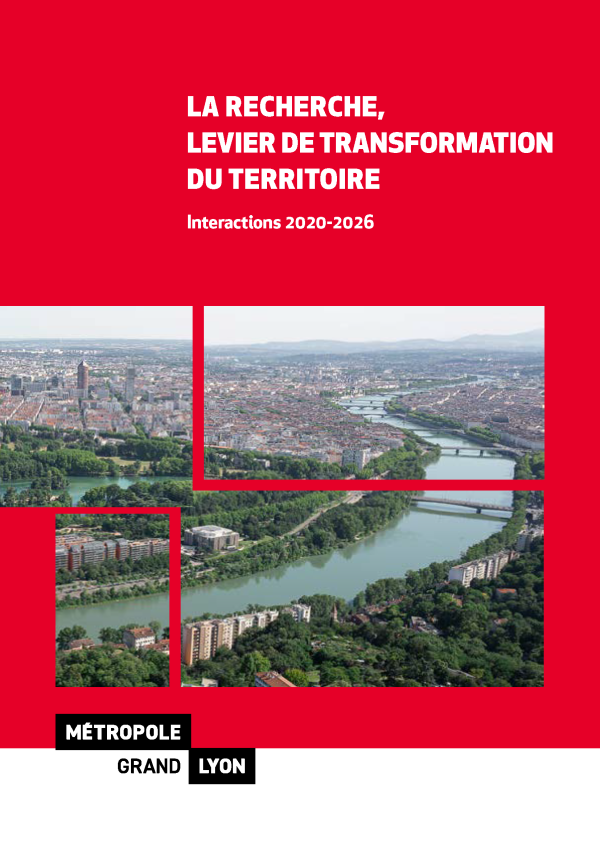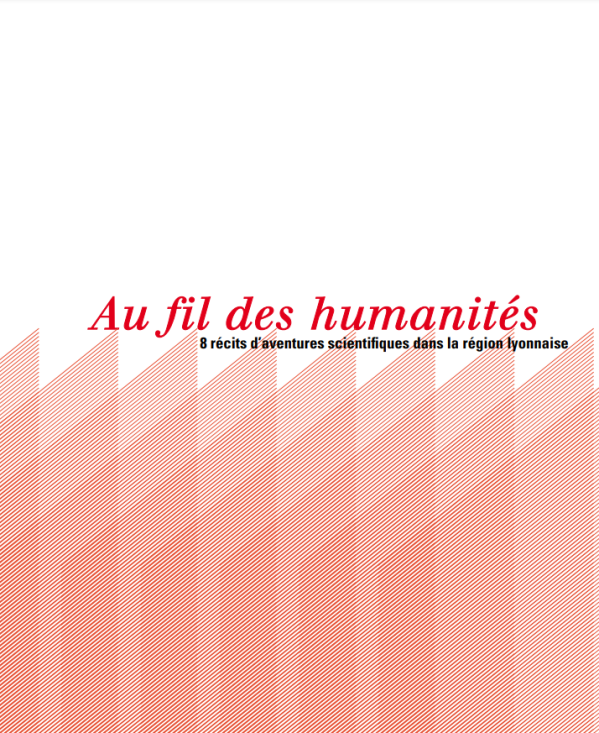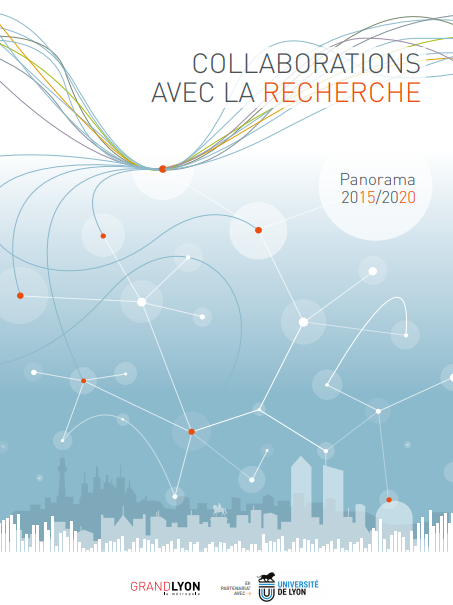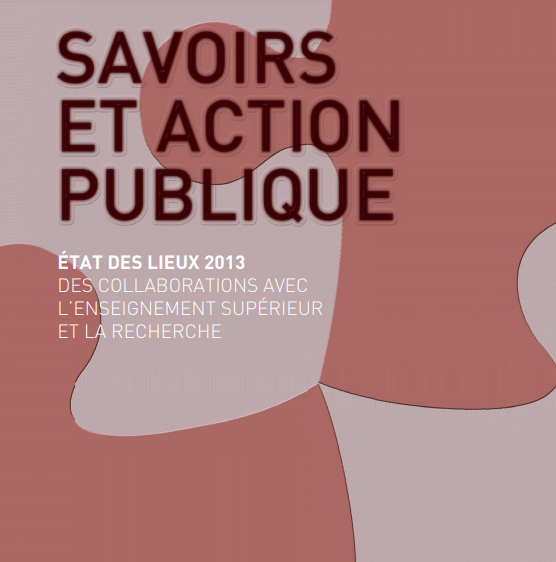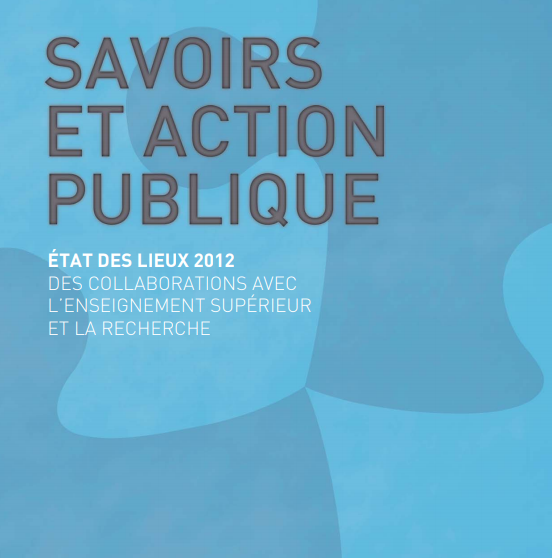Pourriez-vous nous rappeler brièvement les origines et les circonstances de la création du Centre Thomas More ?
Le couvent de la Tourette, construit pas Le Corbusier en 1960, était destiné à la formation des dominicains.
A la fin des années 60, les jeunes dominicains ont souhaité revenir en ville, près des universités, ce qui a privé le bâtiment de sa fonction initiale. C’est à ce moment-là, au début des années 1970, qu’est née l’idée d’ouvrir dans ce qui demeurait un couvent dominicain, un centre de réflexion spécialisé sur les relations entre sciences humaines et religions. Très vite, le projet s’est élargi à des débats de philosophie, dans le champ des sciences humaines en général (le plus souvent sans spécificité religieuse) et, plus récemment à l’histoire de l’art et aux questions d’architecture contemporaine. Par ailleurs nous sommes un centre d’accueil pour des architectes du monde entier qui viennent passer ici au minimum 24 heures. Nous en recevons entre 3 500 et 4 000 par an. Le Centre Thomas More, dont le nom rappelle la portée utopique, se situe hors de toute institution universitaire ou scientifique, sans pour autant être affilié à une obédience quelconque. Il se veut un lieu d’échange et de parole libre et a créé un style où l’invité dispose de temps pour s’exprimer, tout comme la salle : nous ne recevons jamais plus de 4 à 5 intervenants sur deux jours.
Quelles sont les grandes orientations de réflexion et les disciplines que le Centre cherche à faire connaître ?
Nous sommes un lieu tourné vers l’architecture et l’urbanisme au premier chef. Cela s’explique par le monument dans lequel nous vivons : notre moteur est notre bâtiment. Il est un lieu de pensée sur l’architecture, l’urbanisme, la vie urbaine. Nous sommes un des rares lieux de travail sur l’architecture contemporaine installé hors de Paris. De tous les arts, c’est l’architecture qui s’impose le plus dans la vie quotidienne. Quand un roman ne vous intéresse pas, vous ne le lisez pas, quand un film vous ennuie, vous l’évitez, mais quand un bâtiment est en face de vous ou que vous l’habitez, vous pouvez difficilement l’occulter. L’urbanisme, l’architecture sont à la jonction de l’art et de la vie quotidienne. Je crois qu’il est essentiel de développer une éducation à notre environnement. On admet assez facilement qu’il faut apprendre à décoder les images : l’ère de la télévision, des nouvelles technologies demande cette capacité critique. Il en va de même pour notre environnement urbain, qui s’impose à nous sans que nous ayons forcément conscience de sa prégnance et de l’importance du rôle joué par ceux qui l’élaborent, qu’ils soient architectes, urbanistes ou encore décideurs politiques.
Quelles sont vos perspectives de développement ?
L’année 2000 marquera une étape dans la vie du Centre. En effet, nous devrions obtenir le label de Centre culturel de rencontres attribué par le Ministère de la culture. Il n’en existe aujourd’hui que 9 en France. Cela nous apportera des moyens supplémentaires et nous permettra dès le début 2000 de créer un premier emploi de professionnel de la culture. Cela devrait aussi susciter des soutiens plus importants de la part du Département du Rhône, de l’État, et de la Région Rhône-Alpes. La commune d’Eveux elle même va s’engager pour le Centre Thomas More. Nous travaillons principalement sur le site de La Tourette. Nous avons certes un café d’architecture conduit avec la Maison de l’architecture et qui se tient au Café Bartholdi place des Terreaux à Lyon, mais l’essentiel de notre travail se fait ici. Ce qui ne va pas sans difficulté, car nous sommes dans un coin paumé, que certains jugent peu confortable, où il faut payer sa place : les motivations à venir doivent donc être fortes ! Finalement notre souci est de faire vivre ce bâtiment et de le transmettre aux générations futures. C’est un échange de bons procédés : on rend service en offrant un espace de haute qualité architecturale et en y suscitant le débat et la réflexion ; en retour, nos visiteurs font vivre le couvent et en parlent à l’extérieur.
Y-a-t-il selon vous un nouveau secteur d’intervention qui se dessine autour de la vie intellectuelle, comme on a vu celui de la vie culturelle se former depuis les années 1960-70 ?
Je prendrais les choses différemment. Je crois que le Centre Thomas More a été un à un moment un lieu Malraux, a commencé à s’imposer l’idée d’une intervention des pouvoirs publics dans le secteur culturel, intervention reprise à leur compte par les collectivités locales. Aujourd’hui, le culturel est un mot qui est largement répandu, notamment chez les décideurs politiques. Je ne crois pas que ça soit vraiment le cas pour le mot intellectuel. Si des passerelles entre le monde politique et celui des intellectuels peuvent naître,
c’est évidemment souhaitable. Longtemps, les mondes de la recherche et des décideurs se sont ignorés, je pense que les choses changent, mais on ne peut pas encore dire que les décideurs soient aussi attentifs à la vie intellectuelle qu’ils le sont à la vie culturelle.
Souhaitez-vous que les collectivités locales vous soutiennent davantage ? Quel pourrait être leur intérêt à le faire ?
Une société a besoin de lieux d’intelligence d’elle-même. La vie d’une société est souvent en avance sur sa réflexion, on ne découvre bien des mutations qu’après coup. Il m’apparaît comme relevant du service public de favoriser un travail sur la compréhension du fonctionnement de la société. L’État connaît bien cette nécessité, ne serait-ce que parce qu’il finance des universités, des instituts, des laboratoires de recherches.
Les collectivités locales en sont moins conscientes. Pourtant on ne peut attendre d’aide du secteur privé : le mécénat intellectuel n’a pas cours en France, alors qu’il est relativement fréquent en matière culturelle. Il nous a toujours été difficile de trouver un partenaire privé, d’où la nécessité d’un appui venant de partenaires publics.
Comment expliquez-vous la faible reconnaissance médiatique de vos travaux ?
C’est une vraie faiblesse de notre travail : nous avons peu de traces écrites, et nous privilégiions le moment de la parole par rapport à sa restitution littéraire, l’événement sur ses retombées. Cela est dû à un manque de temps et d’hommes. Cette institution fonctionne encore avec des moyens rudimentaires, même si les choses sont en train d’évoluer. Par exemple, pour l’architecture, nous allons diffuser nos travaux sur Internet et j’espère, par une série de publications. Pour ce qui concerne nos relations avec les media grand public, il est clair que ce que nous faisons, les intéresse peu. Mais je pense que les gens qui viennent à La Tourette vont ensuite être des relais de ce qui se dit ici. Même si on ne parle pas directement de nous, c’est aussi à La Tourette qu’ont pu s’élaborer, être mises en débat des idées que l’on retrouvera ensuite ailleurs, et pourquoi pas dans la grande presse.
En quoi le Centre Thomas More contribue-t-il à la rencontre entre intellectuels et artistes ? Faites-vous une distinction entre ces deux catégories ?
Nous sommes un lieu de réflexion sur l’art plus qu’un lieu de création. Et cela suppose du travail en commun entre artistes et intellectuels. Un de nos atouts est que nombre de chercheurs et de créateurs (architectes bien sûr, mais aussi plasticiens, chorégraphes...) aiment fréquenter ce lieu. Dans notre projet de Centre, nous devrions avoir des artistes en résidence sur les questions de l’image en particulier. Et n’oublions pas que nous sommes dans un monument qui est une œuvre d’art habitable et habitée !